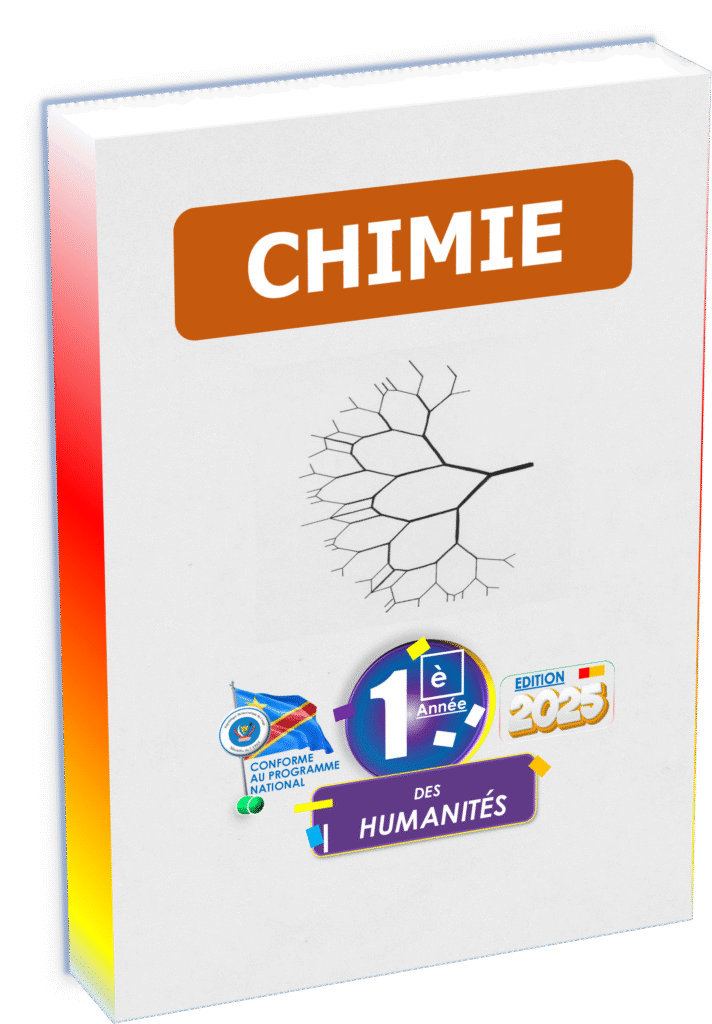
COURS DE CHIMIE, 1ÈRE ANNÉE, NIVEAU SECONDAIRE, POUR LES OPTIONS COMMUNES
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
PRÉLIMINAIRES
1. Objectifs généraux du cours 🎯
Cette section articule les finalités de l’enseignement de la chimie en première année, visant à doter l’élève d’une compréhension fondamentale de la matière, de ses transformations et de ses interactions. L’accent est mis sur la capacité à observer le monde à travers une lentille scientifique, en établissant des liens entre les phénomènes quotidiens et les principes chimiques sous-jacents, depuis la cuisson des aliments jusqu’à la corrosion des métaux observée dans les zones côtières de Moanda.
2. Compétences visées 🧠
Le développement de compétences spécifiques constitue le cœur de ce programme. L’élève doit acquérir la capacité de résoudre des problèmes quantitatifs, d’interpréter des formules chimiques, d’équilibrer des équations, de mener des expérimentations simples en toute sécurité et d’analyser des données. L’objectif est de former un esprit critique et méthodique, capable d’appliquer la démarche scientifique pour comprendre et interagir avec son environnement.
3. Matériel et sécurité en laboratoire ⚠️
La maîtrise des bonnes pratiques de laboratoire est une priorité absolue. Ce point détaille l’identification, l’utilisation correcte et l’entretien du matériel de base (verrerie, instruments de mesure). Une attention rigoureuse est portée aux règles de sécurité universelles, à la manipulation des produits chimiques, à la gestion des déchets et aux procédures d’urgence, assurant ainsi un environnement d’apprentissage sécurisé pour tous.
4. Méthodologie d’enseignement 🧑🏫
Une approche pédagogique active et contextualisée est préconisée. La méthodologie favorise l’apprentissage par la découverte, la résolution de problèmes et l’expérimentation. Les leçons intègrent systématiquement des exemples tirés du contexte congolais, tels que l’extraction du cobalt dans le Lualaba ou les processus de fermentation du manioc pour produire le « fufu » ou le « chikwangue », afin de rendre la chimie pertinente et tangible pour l’élève.
PARTIE I : CHIMIE GÉNÉRALE ET MINÉRALE
CHAPITRE 1 : Grandeurs et unités en chimie
1.1 Mesures de masse et de volume
Ce sous-chapitre établit les fondements de la quantification en chimie. Il enseigne la manipulation précise de la balance pour la détermination de la masse et l’utilisation de la verrerie graduée (cylindres, burettes, pipettes) pour la mesure des volumes. La distinction entre masse et poids est clarifiée, de même que la notion de densité comme rapport entre ces deux grandeurs.
1.2 Notation scientifique et chiffres significatifs
L’apprentissage se concentre sur les outils mathématiques indispensables à la manipulation des nombres en sciences. La notation scientifique est introduite pour exprimer de manière concise les très grandes et très petites valeurs. La notion de chiffres significatifs est développée pour refléter la précision des mesures et pour garantir que les résultats des calculs ne suggèrent pas une précision supérieure à celle des données initiales.
1.3 Température et pression
Les concepts de température et de pression sont définis comme des grandeurs physiques essentielles décrivant l’état d’un système. Les différentes échelles de température (Celsius, Kelvin) et leurs conversions sont étudiées. Les unités de pression (Pascal, atmosphère, bar) et les instruments de mesure comme le baromètre sont présentés, jetant les bases pour l’étude ultérieure des gaz.
1.4 Calculs de concentration
Cette section introduit les diverses manières d’exprimer la composition quantitative d’une solution. Elle couvre le calcul des concentrations massique, molaire (molarité) et du pourcentage en masse. Des exercices pratiques guident l’élève dans la préparation de solutions de concentrations spécifiques à partir de solutés solides ou par dilution de solutions mères.
CHAPITRE 2 : Structure de la matière
2.1 Théorie atomique
La théorie atomique de Dalton est présentée comme le pilier conceptuel de la chimie moderne. Ses postulats sont examinés en détail : la matière est composée d’atomes indivisibles, les atomes d’un même élément sont identiques, et les réactions chimiques consistent en un réarrangement d’atomes. Cette base permet de comprendre la loi de conservation de la masse.
2.2 Modèles atomiques successifs
Une perspective historique retrace l’évolution de la représentation de l’atome. Le parcours intellectuel est exploré, du modèle de Thomson (« plum pudding ») à la découverte du noyau par Rutherford, puis au modèle planétaire de Bohr qui introduit les niveaux d’énergie quantifiés, pour aboutir à une vision introductive du modèle quantique actuel.
2.3 Configuration électronique
Ce point explique comment les électrons se répartissent dans les différentes couches et sous-couches énergétiques autour du noyau. Les règles de remplissage (principe d’Aufbau, règle de Hund, principe d’exclusion de Pauli) sont enseignées pour permettre à l’élève de déterminer la configuration électronique de n’importe quel élément et de prédire sa réactivité chimique.
2.4 Propriétés périodiques
L’analyse de la configuration électronique conduit à l’étude des tendances périodiques. Les variations du rayon atomique, de l’énergie d’ionisation, de l’affinité électronique et de l’électronégativité sont expliquées en fonction de la position de l’élément dans le tableau périodique. Ces tendances permettent de justifier les propriétés physiques et chimiques des familles d’éléments.
CHAPITRE 3 : Tableau périodique et classification
3.1 Historique et organisation
La genèse du tableau périodique est explorée, en mettant en lumière le travail précurseur de Dmitri Mendeleïev et son organisation initiale basée sur la masse atomique. La transition vers le tableau moderne, classé par numéro atomique croissant (loi de Moseley), est expliquée pour en justifier la structure actuelle et sa puissance prédictive.
3.2 Groupes et périodes
La structure du tableau périodique est décomposée en ses éléments constitutifs. Les périodes (lignes horizontales) sont associées au remplissage d’une nouvelle couche électronique, tandis que les groupes ou familles (colonnes verticales) rassemblent les éléments ayant des configurations électroniques de valence similaires, et donc des propriétés chimiques analogues.
3.3 Métaux, non-métaux et métalloïdes
Une classification fondamentale des éléments est établie en fonction de leurs propriétés. Les caractéristiques des métaux (éclat, conductivité, malléabilité), des non-métaux (isolants, fragiles) et des métalloïdes (propriétés intermédiaires) sont décrites. La ligne de démarcation en escalier dans le tableau périodique est utilisée pour les localiser.
3.4 Tendances des propriétés
Ce sous-chapitre synthétise et renforce la compréhension des variations systématiques des propriétés au sein du tableau périodique. La discussion se concentre sur la manière dont le caractère métallique, la réactivité et la nature des oxydes formés évoluent le long des périodes et des groupes, offrant un cadre prédictif robuste pour la chimie des éléments.
CHAPITRE 4 : Liaison chimique
4.1 Liaison ionique
La formation de composés ioniques par le transfert complet d’un ou plusieurs électrons d’un atome métallique vers un atome non métallique est détaillée. Le concept d’attraction électrostatique entre les cations et les anions résultants pour former un réseau cristallin stable, comme le sel gemme extrait à Mpenge, est au cœur de cette section.
4.2 Liaison covalente
La liaison covalente est présentée comme le partage d’une ou plusieurs paires d’électrons entre deux atomes, généralement non métalliques, pour atteindre une configuration électronique stable. Les structures de Lewis sont introduites comme un outil pour visualiser ces partages et prédire la géométrie moléculaire simple (liaisons simples, doubles, triples).
4.3 Liaison métallique
Ce type de liaison, spécifique aux métaux, est expliqué par le modèle du « gaz d’électrons ». Les électrons de valence sont délocalisés et forment une « mer » qui entoure un réseau ordonné de cations métalliques. Ce modèle permet de justifier de manière intuitive les propriétés caractéristiques des métaux, comme leur excellente conductivité électrique et thermique, cruciale pour l’industrie du cuivre de la région de l’ex-Katanga.
4.4 Forces intermoléculaires
Une distinction claire est faite entre les liaisons intramoléculaires (ioniques, covalentes) et les forces intermoléculaires (forces de Van der Waals, liaison hydrogène), beaucoup plus faibles. L’influence de ces forces sur les propriétés macroscopiques de la matière, telles que les points de fusion et d’ébullition, est analysée en détail.
PARTIE II : RÉACTIONS ET CONCEPTS FONDAMENTAUX
CHAPITRE 5 : Nomenclature et formule chimique
5.1 Règles de nomenclature IUPAC
L’objectif est de maîtriser le langage universel de la chimie. Les règles systématiques de l’Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée (IUPAC) pour nommer les composés inorganiques (ioniques, moléculaires, acides) sont enseignées de manière rigoureuse, afin de garantir une communication claire et sans ambiguïté entre scientifiques.
5.2 Formules empiriques et moléculaires
La distinction entre la formule empirique, qui indique le rapport le plus simple entre les atomes, et la formule moléculaire, qui donne le nombre réel d’atomes dans une molécule, est établie. Des méthodes de calcul basées sur la composition en pourcentage massique et la masse molaire sont développées pour déterminer ces deux types de formules.
5.3 Isomérie
Le concept fascinant d’isomérie est introduit, montrant que des composés peuvent partager la même formule moléculaire tout en ayant des structures, et donc des propriétés, différentes. L’accent est mis sur l’isomérie de structure (de chaîne, de position, de fonction) à travers des exemples simples.
5.4 Formules développées et topologiques
Différentes méthodes de représentation des molécules sont présentées pour visualiser leur structure en deux dimensions. La formule développée plane montre toutes les liaisons, tandis que la formule semi-développée simplifie la notation. La formule topologique, plus concise, est introduite pour représenter les squelettes carbonés.
CHAPITRE 6 : Réactions chimiques et équations
6.1 Types de réactions
Une classification systématique des réactions chimiques est proposée pour aider à les organiser et à prédire leurs produits. Les principaux types sont étudiés : synthèse (combinaison), décomposition, déplacement simple, double déplacement (précipitation, neutralisation acido-basique) et combustion.
6.2 Équilibrage d’équations
Cette section fondamentale enseigne la méthode pour ajuster les coefficients stœchiométriques dans une équation chimique. Le principe de la conservation de la masse est le guide central, garantissant que le nombre d’atomes de chaque élément est identique du côté des réactifs et des produits.
6.3 Rendement et bilan massique
Les calculs stœchiométriques sont approfondis pour inclure la notion de réactif limitant, qui détermine la quantité maximale de produit pouvant être formée. Le concept de rendement d’une réaction est introduit, comparant la quantité de produit réellement obtenue expérimentalement (rendement réel) à la quantité théoriquement possible (rendement théorique).
6.4 Énergie des réactions
L’aspect énergétique des transformations chimiques est abordé. Les réactions sont classées en exothermiques (libérant de l’énergie, ΔH < 0) et endothermiques (absorbant de l’énergie, ΔH > 0). Le concept de variation d’enthalpie (ΔH) est introduit comme mesure de la chaleur échangée à pression constante.
CHAPITRE 7 : Chimie des solutions
7.1 Solubilité et facteurs influents
La formation des solutions est étudiée en détail, en définissant les termes soluté, solvant et solubilité. L’influence de la température sur la solubilité des solides et des gaz, ainsi que l’effet de la pression sur la solubilité des gaz (loi de Henry), sont analysés à travers des exemples pratiques.
7.2 Concentration molaire
La molarité (mol/L) est consolidée comme l’unité de concentration la plus utilisée pour les calculs quantitatifs en chimie des solutions. Des exercices portent sur la préparation de solutions de molarité donnée et sur les calculs de dilution (M1V1 = M2V2).
7.3 Propriétés colligatives
Ce sous-chapitre explore les propriétés des solutions qui dépendent uniquement du nombre de particules de soluté et non de leur nature. L’abaissement de la pression de vapeur, l’élévation du point d’ébullition, l’abaissement du point de congélation et la pression osmotique sont présentés de manière qualitative et quantitative.
7.4 Titrages
La technique du titrage est introduite comme une méthode d’analyse volumétrique précise pour déterminer la concentration d’une solution inconnue. Le focus est mis sur les titrages acido-basiques, incluant le choix de l’indicateur coloré approprié et le calcul de la concentration à partir du point d’équivalence.
CHAPITRE 8 : Acides et bases
8.1 Théories de Brønsted-Lowry et Lewis
Les définitions des acides et des bases sont élargies au-delà du modèle d’Arrhenius. La théorie de Brønsted-Lowry, centrée sur le transfert de protons (H+), et la théorie de Lewis, basée sur le don ou l’acception de paires d’électrons, sont expliquées pour fournir un cadre conceptuel plus général et puissant.
8.2 Force des acides et bases
La distinction entre les acides/bases forts (qui s’ionisent complètement en solution) et faibles (qui s’ionisent partiellement) est fondamentale. Le concept de constante d’acidité (Ka) et de basicité (Kb) est introduit pour quantifier la force relative des acides et des bases faibles.
8.3 pH et pOH
L’échelle de pH est présentée comme une méthode logarithmique pratique pour exprimer l’acidité ou la basicité d’une solution aqueuse. La relation mathématique entre [H+], [OH-], pH et pOH est établie, ainsi que le produit ionique de l’eau (Ke), permettant des calculs de pH pour diverses solutions.
8.4 Solutions tampon
Le fonctionnement des solutions tampons, qui résistent aux variations de pH lors de l’ajout de petites quantités d’acide ou de base, est expliqué. Leur composition (un acide faible et sa base conjuguée) et leur importance capitale dans les systèmes biologiques, comme le maintien du pH sanguin, sont mises en évidence.
CHAPITRE 9 : Oxydoréduction
9.1 Notion d’oxydation et réduction
Les réactions d’oxydoréduction sont définies par le transfert d’électrons. L’oxydation est une perte d’électrons et la réduction un gain d’électrons. Le concept de nombre d’oxydation est introduit comme un outil comptable pour suivre le mouvement des électrons et identifier les espèces qui sont oxydées et réduites.
9.2 Couple oxydant‐réducteur
Les processus d’oxydation et de réduction sont toujours couplés. Cette section introduit la notion de couple redox (Ox/Red) et enseigne la méthode des demi-réactions pour équilibrer les équations d’oxydoréduction complexes en milieux acide et basique.
9.3 Potentiel standard
Le concept de potentiel de réduction standard (E°) est introduit pour quantifier la tendance d’une espèce à être réduite. L’utilisation d’un tableau de potentiels standards pour prédire la spontanéité d’une réaction redox et pour calculer la force électromotrice (f.e.m.) d’une pile électrochimique est démontrée.
9.4 Applications (pile, corrosion)
Les principes de l’oxydoréduction sont illustrés par des applications technologiques et des phénomènes courants. Le fonctionnement d’une pile galvanique (pile Daniell) est détaillé. La corrosion, comme la rouille du fer, est expliquée comme un processus d’oxydoréduction indésirable, un enjeu majeur pour les infrastructures du port de Matadi.
PARTIE III : CHIMIE APPLIQUÉE ET THÉMATIQUE
CHAPITRE 10 : Chimie organique générale
10.1 Hydrocarbures saturés et insaturés
Ce chapitre pose les bases de la chimie du carbone. Les hydrocarbures, composés uniquement de carbone et d’hydrogène, sont classés en alcanes (liaisons simples), alcènes (liaisons doubles) et alcynes (liaisons triples). La nomenclature de base de ces familles est abordée.
10.2 Groupes fonctionnels principaux
Les groupes fonctionnels sont présentés comme des atomes ou des groupes d’atomes qui confèrent des propriétés chimiques spécifiques aux molécules organiques. Les familles des alcools, éthers, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques et amines sont introduites, avec leurs structures et nomenclature.
10.3 Réactions de substitution et addition
Les types de réactions fondamentales en chimie organique sont explorés. La réaction de substitution, typique des alcanes, et la réaction d’addition, caractéristique des alcènes et des alcynes sur leurs liaisons multiples, sont expliquées avec des mécanismes simplifiés.
10.4 Polymères simples
L’introduction à la chimie des polymères se fait par l’étude de la polymérisation par addition. La formation de polymères courants comme le polyéthylène à partir de monomères d’éthylène est utilisée comme exemple pour illustrer le concept de macromolécule et son importance dans la vie moderne.
CHAPITRE 11 : Gaz et lois des gaz
11.1 Loi de Boyle-Mariotte
Cette loi fondamentale décrit la relation inversement proportionnelle entre la pression et le volume d’une quantité fixe de gaz à température constante (P₁V₁ = P₂V₂). Des exemples et des calculs illustrent comment le volume d’un gaz diminue lorsque sa pression augmente.
11.2 Loi de Charles et loi d’Avogadro
La loi de Charles établit une relation directe entre le volume et la température absolue d’un gaz à pression constante. La loi d’Avogadro postule que, dans les mêmes conditions de température et de pression, des volumes égaux de gaz différents contiennent le même nombre de molécules.
11.3 Équation d’état des gaz parfaits
Les lois individuelles des gaz sont unifiées dans l’équation d’état des gaz parfaits (PV = nRT). Cette équation puissante relie la pression, le volume, la quantité de matière (en moles) et la température d’un gaz, permettant de calculer l’une de ces variables si les autres sont connues.
11.4 Mélanges gazeux
Le comportement des mélanges gazeux est décrit par la loi de Dalton. Elle stipule que la pression totale d’un mélange de gaz est égale à la somme des pressions partielles que chaque gaz exercerait s’il était seul dans le même volume. Ce principe est essentiel pour comprendre l’atmosphère.
CHAPITRE 12 : Thermochimie
12.1 Enthalpie
L’enthalpie (H) est formellement définie comme la chaleur totale d’un système. L’accent est mis sur la variation d’enthalpie (ΔH), qui représente la chaleur absorbée ou libérée lors d’une réaction chimique à pression constante et qui permet de caractériser une réaction comme étant endothermique ou exothermique.
12.2 Chaleur spécifique et capacité thermique
Ces concepts quantifient la relation entre la chaleur et la variation de température. La chaleur spécifique est la quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1°C la température de 1 gramme de substance. La capacité thermique s’applique à un objet entier. Les calculs calorimétriques (q = mcΔT) sont pratiqués.
12.3 Lois de Hess
La loi de Hess est un principe fondamental de la thermochimie. Elle énonce que la variation d’enthalpie d’une réaction globale est la même, que la réaction se fasse en une ou plusieurs étapes. Cette loi permet de calculer les variations d’enthalpie de réactions difficiles à mesurer directement.
12.4 Diagrammes enthalpiques
Les diagrammes enthalpiques sont introduits comme un outil visuel pour représenter les changements d’énergie au cours d’une réaction. Ils montrent les niveaux d’énergie relatifs des réactifs et des produits, illustrant clairement si une réaction est exothermique (les produits sont plus bas) ou endothermique (les produits sont plus hauts).
CHAPITRE 13 : Cinétique chimique
13.1 Vitesse de réaction
La cinétique chimique s’intéresse à la vitesse à laquelle les réactions se produisent. La vitesse de réaction est définie comme la variation de la concentration d’un réactif ou d’un produit par unité de temps. Des méthodes pour mesurer et exprimer cette vitesse sont présentées.
13.2 Ordre de réaction
L’étude se penche sur la manière dont la vitesse de réaction dépend de la concentration des réactifs. La loi de vitesse et la notion d’ordre de réaction (ordre zéro, premier, second) sont introduites pour décrire mathématiquement cette dépendance.
13.3 Facteurs cinétiques
Les quatre facteurs principaux qui influencent la vitesse d’une réaction sont examinés : la concentration des réactifs, la température, la surface de contact (pour les réactifs dans des phases différentes) et la nature intrinsèque des réactifs. L’effet de chaque facteur est expliqué au niveau moléculaire.
13.4 Catalyse
Le rôle des catalyseurs est expliqué : ce sont des substances qui augmentent la vitesse d’une réaction sans être consommées. Le mécanisme d’action par l’abaissement de l’énergie d’activation est décrit, ainsi que la distinction entre catalyse homogène et hétérogène, avec des exemples industriels et biologiques (enzymes).
CHAPITRE 14 : Équilibre chimique
14.1 Constante d’équilibre
Pour les réactions réversibles, l’état d’équilibre dynamique est atteint lorsque les vitesses des réactions directe et inverse sont égales. La constante d’équilibre (Kc ou Kp) est introduite comme une expression mathématique qui relie les concentrations des produits et des réactifs à l’équilibre, indiquant l’étendue de la réaction.
14.2 Principe de Le Châtelier
Ce principe qualitatif est un outil puissant pour prédire comment un système à l’équilibre réagit à une perturbation. Il stipule que si un changement (de concentration, de pression ou de température) est appliqué à un système à l’équilibre, le système se déplacera dans la direction qui atténue ce changement.
14.3 Équilibres homogènes et hétérogènes
Une distinction est faite entre les équilibres où tous les réactifs et produits sont dans la même phase (homogènes) et ceux où ils sont dans des phases différentes (hétérogènes). La convention selon laquelle les concentrations des solides et des liquides purs sont omises de l’expression de la constante d’équilibre est expliquée.
14.4 Applications industrielles
L’importance des principes de l’équilibre chimique dans l’industrie est mise en évidence. Le procédé Haber-Bosch pour la synthèse de l’ammoniac est utilisé comme une étude de cas pour montrer comment les conditions de température et de pression sont optimisées en appliquant le principe de Le Châtelier pour maximiser le rendement.
ANNEXES
A. Tableaux de conversion et constantes physico-chimiques 📊
Cette annexe constitue une référence rapide pour les élèves et les enseignants. Elle compile les constantes physiques fondamentales (constante des gaz parfaits R, nombre d’Avogadro NA, etc.), les facteurs de conversion entre différentes unités de mesure (pression, énergie, température) et d’autres données numériques fréquemment utilisées dans les exercices de chimie.
B. Listes de solubilité et pKa courants 💧
Cet outil pratique fournit des informations essentielles pour la résolution de problèmes qualitatifs et quantitatifs. Il contient un tableau des règles de solubilité pour les composés ioniques courants dans l’eau, ainsi qu’une liste des valeurs de pKa pour une sélection d’acides faibles, permettant de prédire les réactions de précipitation et d’évaluer la force relative des acides.
C. Schémas de sécurité et procédures d’urgence ⛑️
La sécurité étant primordiale, cette section offre un support visuel concis et clair. Elle présente les pictogrammes de danger normalisés du Système Général Harmonisé (SGH), le matériel de sécurité de base (hotte, douche de sécurité, extincteur) et les étapes à suivre en cas d’incidents courants au laboratoire (déversement de produits chimiques, brûlures, contact avec les yeux).


