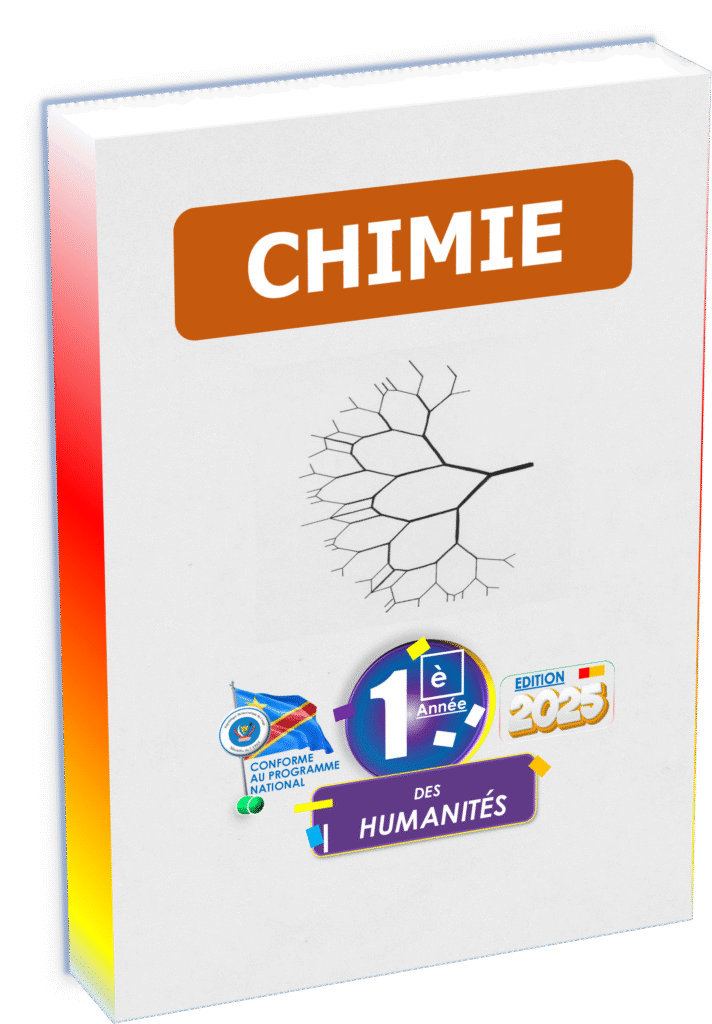
COURS DE CHIMIE, 2ÈME ANNÉE, NIVEAU SECONDAIRE, POUR LES OPTIONS COMMUNES
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
PRÉLIMINAIRES
1. Objectifs généraux du cours 🎯
Ce programme vise à approfondir la compréhension des principes chimiques fondamentaux en explorant des domaines plus spécialisés comme la thermodynamique, la cinétique avancée et la chimie analytique. L’ambition est de construire un pont entre les concepts théoriques et leurs applications technologiques, industrielles et environnementales, en préparant l’élève à une analyse plus critique et quantitative des transformations de la matière.
2. Compétences visées 🧠
Au terme de ce cours, l’élève devra maîtriser l’interprétation de données instrumentales, la construction de raisonnements mécanistiques pour les réactions, et l’application des principes thermodynamiques pour prédire la spontanéité des processus. Les compétences incluent la résolution de problèmes complexes d’équilibre, la synthèse de concepts de chimie organique et inorganique, et l’évaluation de l’impact chimique sur l’environnement.
3. Rappels de chimie 1ʳᵉ année 📚
Une consolidation rigoureuse des acquis de la première année est effectuée. Cette section révise intensivement la stœchiométrie, les types de liaisons chimiques, l’équilibrage des réactions d’oxydoréduction, les lois des gaz et les concepts acido-basiques de base. Cette révision garantit que tous les élèves disposent du socle de connaissances indispensable pour aborder les thèmes avancés du programme.
4. Sécurité et matériel spécialisé 🔬
Les protocoles de sécurité sont renforcés pour la manipulation de substances plus réactives et l’utilisation d’équipements spécifiques. La familiarisation avec le matériel de titrage précis, les cellules électrochimiques, les montages de chromatographie simple et les spectrophotomètres est abordée. Une attention particulière est portée à la gestion des déchets chimiques générés par des expériences plus complexes.
PARTIE I : CHIMIE PHYSIQUE ET DES SOLUTIONS
CHAPITRE 1 : Solides cristallins et amorphes
1.1 Réseaux cristallins et maille élémentaire
Cette section explore l’organisation ordonnée des atomes, ions ou molécules dans les solides cristallins. L’étude se concentre sur les différents types de réseaux de Bravais et la description de la maille élémentaire comme unité de répétition fondamentale, en prenant pour exemple la structure cubique du diamant extrait dans la province du Kasaï-Oriental.
1.2 Indices de Miller
Un système de notation, les indices de Miller, est introduit pour décrire de manière univoque l’orientation des plans et des directions dans un réseau cristallin. Cette compétence est essentielle pour comprendre les propriétés anisotropes des cristaux, comme le clivage des minéraux.
1.3 Défauts structuraux
L’analyse s’écarte du cristal parfait pour examiner les imperfections réelles. Les défauts ponctuels (lacunes, interstitiels), linéaires (dislocations) et plans (joints de grains) sont classifiés, et leur rôle crucial dans la détermination des propriétés mécaniques des matériaux est expliqué.
1.4 Propriétés physiques
La corrélation entre la structure cristalline interne et les propriétés macroscopiques est établie. L’explication de la dureté, de la conductivité électrique, de la transparence et des propriétés magnétiques se base sur le type de liaison et l’arrangement atomique au sein du solide.
CHAPITRE 2 : Solutions et dispersion colloïdale
2.1 Types de mélanges et phases
Une classification fine des mélanges est opérée, distinguant les solutions vraies (homogènes à l’échelle moléculaire), les dispersions colloïdales (particules de taille intermédiaire) et les suspensions (hétérogènes). La notion de phase est précisée pour chaque type de système.
2.2 Loi de Henry et gaz dissous
L’étude se focalise sur la solubilité des gaz dans les liquides, régie par la loi de Henry. Cette loi, qui relie la concentration du gaz dissous à sa pression partielle, trouve des applications concrètes dans la carbonatation des boissons ou la « maladie des caissons » en plongée sous-marine, un risque potentiel dans le lac Tanganyika.
2.3 Micelles et colloïdes
La formation de structures organisées comme les micelles par des molécules amphiphiles (tensioactifs) est détaillée. Les différents types de colloïdes (sols, gels, émulsions, mousses) sont présentés avec des exemples du quotidien, comme le lait ou la mayonnaise.
2.4 Propriétés optiques et stabilité
Les caractéristiques distinctives des colloïdes sont examinées. L’effet Tyndall (diffusion de la lumière) est expliqué comme méthode d’identification. Les facteurs assurant la stabilité des dispersions colloïdales, notamment le mouvement brownien et les répulsions électrostatiques, sont analysés.
PARTIE II : CHIMIE MINÉRALE ET ORGANIQUE AVANCÉE
CHAPITRE 3 : Chimie des ions en solution
3.1 Hydrolyse des ions
Ce sous-chapitre traite de la réaction de certains cations et anions avec l’eau, modifiant le pH de la solution. Le caractère acide des cations de métaux petits et très chargés et le caractère basique des anions provenant d’acides faibles sont expliqués et quantifiés.
3.2 Complexation et constantes de formation
La formation d’ions complexes par la liaison d’un cation métallique central (acide de Lewis) à des ligands (bases de Lewis) est étudiée. La stabilité de ces complexes est évaluée quantitativement à l’aide des constantes de formation successives et globales (Kf).
3.3 Chélates
Le concept de chélation est introduit, décrivant la formation de complexes particulièrement stables lorsque des ligands polydentates (agents chélatants) se lient à un ion métallique en plusieurs points. L’effet chélatant et son importance en biochimie et en toxicologie sont soulignés.
3.4 Applications en analyse volumétrique
L’utilisation des réactions de complexation dans les titrages complexométriques est développée. Le titrage de l’ion calcium par l’EDTA est présenté comme un exemple classique pour déterminer la dureté de l’eau, une analyse pertinente pour les régies de distribution d’eau des grandes villes comme Lubumbashi.
CHAPITRE 4 : Équilibres acido-basiques avancés
4.1 Diagrammes de distribution
Les diagrammes de distribution sont introduits comme un outil graphique puissant. Ils représentent la fraction de chaque espèce (acide, base conjuguée) en fonction du pH, permettant une visualisation claire des domaines de prédominance pour les acides faibles et les polyacides.
4.2 Titrages multipoints
L’analyse des courbes de titrage est approfondie pour les polyacides et les polybases. L’identification des différents points d’équivalence et des points de demi-équivalence permet la détermination successive des différentes constantes d’acidité (pKa) de la molécule.
4.3 Calculs pH de solutions mixtes
Des méthodes de calcul plus complexes sont développées pour déterminer le pH de solutions contenant des mélanges d’acides et de bases, ou des sels d’acides faibles et de bases faibles. Le concept d’espèce majoritaire et l’utilisation d’approximations justifiées sont enseignés.
4.4 Applications biologiques
L’importance cruciale du contrôle du pH dans les systèmes vivants est mise en exergue. Le fonctionnement du système tampon bicarbonate dans le sang et le rôle du pH dans l’activité enzymatique sont étudiés comme des exemples primordiaux de l’application des équilibres acido-basiques en biologie.
CHAPITRE 5 : Chimie inorganique des métaux de transition
5.1 Structure électronique et propriétés
Les caractéristiques uniques des métaux de transition sont reliées à leur configuration électronique, notamment le remplissage de la sous-couche d. Leurs propriétés distinctives comme la densité élevée, les points de fusion élevés et le paramagnétisme sont expliquées.
5.2 Couleurs et spectres
L’origine de la couleur intense de nombreux composés de métaux de transition est élucidée par la théorie du champ cristallin. L’absorption de lumière visible pour promouvoir des électrons d dans des orbitales d’énergie différente est présentée comme le mécanisme fondamental, illustré par les couleurs vives des composés de cobalt et de cuivre extraits dans le Haut-Katanga.
5.3 États d’oxydation multiples
La capacité des métaux de transition à exister sous plusieurs états d’oxydation stables est une de leurs propriétés les plus importantes. Cette flexibilité est expliquée par la faible différence d’énergie entre les électrons ns et (n-1)d, et son rôle en catalyse et en biochimie est souligné.
5.4 Catalyse homogène
Le rôle exceptionnel des métaux de transition comme catalyseurs en phase homogène est examiné. Leur aptitude à changer facilement d’état d’oxydation et à former des complexes intermédiaires labiles en fait des agents catalytiques extrêmement efficaces pour de nombreuses synthèses organiques et industrielles.
CHAPITRE 6 : Chimie organique : fonctions oxygénées
6.1 Alcools et phénols
Cette section étudie la famille des alcools (groupe -OH sur un carbone saturé) et des phénols (-OH sur un cycle aromatique). Leurs propriétés physiques (liaison hydrogène), leur acidité relative, et leurs réactions principales (oxydation, déshydratation, estérification) sont détaillées.
6.2 Éthers et époxydes
Les éthers (liaison C-O-C) sont présentés comme des composés relativement inertes, souvent utilisés comme solvants. Les époxydes, des éthers cycliques à trois chaînons, sont mis en évidence pour leur grande réactivité due à la tension de cycle, permettant des réactions d’ouverture de cycle utiles en synthèse.
6.3 Aldéhydes et cétones
Ces deux familles, caractérisées par le groupe carbonyle (C=O), sont étudiées conjointement. Leurs réactions d’addition nucléophile sur le carbone électrophile du carbonyle sont au cœur du chapitre, ainsi que les réactions d’oxydoréduction qui permettent de les distinguer (test de Tollens).
6.4 Acides carboxyliques et dérivés
Les acides carboxyliques, contenant le groupe carboxyle (-COOH), et leurs dérivés fonctionnels (esters, amides, chlorures d’acyle, anhydrides) sont explorés. L’acidité des acides carboxyliques et l’interconversion de leurs dérivés par des réactions de substitution nucléophile sur l’acyle sont des concepts clés.
PARTIE III : CHIMIE APPLIQUÉE ET INSTRUMENTALE
CHAPITRE 7 : Polymères et macromolécules
7.1 Polymérisation par addition
Le mécanisme de la polymérisation en chaîne (par addition) est décrit en détail, impliquant des étapes d’amorçage, de propagation et de terminaison. La synthèse de polymères vinyliques courants comme le polypropylène ou le PVC est utilisée comme modèle.
7.2 Polymérisation par condensation
La polymérisation par étapes (par condensation) est présentée comme un mécanisme alternatif où la liaison de monomères s’accompagne de l’élimination d’une petite molécule (souvent l’eau). La formation des polyesters et des polyamides (comme le Nylon) illustre ce processus.
7.3 Propriétés des polymères
Les propriétés physiques des polymères (thermiques, mécaniques) sont reliées à leur structure : longueur de chaîne, degré de ramification, cristallinité et forces intermoléculaires. La distinction entre thermoplastiques et thermodurcissables est établie.
7.4 Élastomères et fibres
Deux classes importantes de polymères sont étudiées pour leurs applications spécifiques. Les élastomères, comme le caoutchouc naturel des hévéas de la province de l’Équateur, sont caractérisés par leur élasticité. Les fibres, comme le polyester, sont appréciées pour leur résistance à la traction.
CHAPITRE 8 : Cinétique avancée et mécanismes réactionnels
8.1 Théories collisionnelles
La théorie des collisions est présentée comme un modèle simple pour expliquer la vitesse des réactions. Elle postule que pour réagir, les molécules doivent entrer en collision avec une énergie suffisante (énergie d’activation) et une orientation appropriée.
8.2 Énergie d’activation et loi d’Arrhenius
La relation quantitative entre la température et la constante de vitesse est décrite par la loi d’Arrhenius. Le concept d’énergie d’activation est approfondi comme la barrière énergétique que les réactifs doivent franchir, et son calcul à partir de données expérimentales est démontré.
8.3 Chaînes radicalaires
Les mécanismes en chaîne, impliquant des intermédiaires très réactifs appelés radicaux libres, sont introduits. Les trois étapes caractéristiques (initiation, propagation, terminaison) sont illustrées par des exemples comme la chloration du méthane.
8.4 Mécanismes catalytiques hétérogènes
Le fonctionnement des catalyseurs solides est expliqué par un mécanisme impliquant l’adsorption des réactifs à la surface du catalyseur, la réaction sur le site actif, puis la désorption des produits. Ce modèle est fondamental pour de nombreux procédés industriels.
CHAPITRE 9 : Thermodynamique chimique
9.1 Entropie et deuxième principe
L’entropie (S) est introduite comme une mesure du désordre ou de la dispersion de l’énergie et de la matière. Le deuxième principe de la thermodynamique, qui stipule que l’entropie de l’univers augmente pour tout processus spontané, est énoncé comme une loi fondamentale de la nature.
9.2 Énergie libre de Gibbs
L’énergie libre de Gibbs (G) est définie comme la fonction thermodynamique qui combine l’enthalpie (H) et l’entropie (S). La variation d’énergie libre (ΔG = ΔH – TΔS) est présentée comme le critère ultime de spontanéité d’une réaction à température et pression constantes.
9.3 Équilibre et spontanéité
La relation entre la variation d’énergie libre standard (ΔG°) et la constante d’équilibre (K) est établie (ΔG° = -RT ln K). Cette équation permet de calculer la constante d’équilibre à partir de données thermodynamiques et de prédire la position de l’équilibre.
9.4 Applications industrie et environnement
Les principes de la thermodynamique sont appliqués à des problèmes concrets. L’analyse de la faisabilité de procédés industriels, l’optimisation des rendements et l’évaluation de la stabilité des polluants dans l’environnement sont discutées pour montrer la pertinence de cette discipline.
CHAPITRE 10 : Électrochimie appliquée
10.1 Diagrammes de Pourbaix
Les diagrammes potentiel-pH (diagrammes de Pourbaix) sont présentés comme des cartes de stabilité thermodynamique pour les espèces en solution aqueuse. Ils permettent de prédire les domaines de prédominance d’un élément et les conditions de corrosion ou de passivation d’un métal.
10.2 Protection cathodique et corrosion
La corrosion est expliquée comme un processus électrochimique. Des méthodes de protection sont détaillées, en particulier la protection cathodique par anode sacrificielle ou par courant imposé, des techniques essentielles pour la maintenance des pipelines et des infrastructures portuaires de Boma.
10.3 Batteries et accumulateurs
Le fonctionnement des différentes sources d’énergie électrochimique est exploré. La distinction entre les piles primaires (non rechargeables) et les accumulateurs (rechargeables) est faite, avec une étude de cas sur la batterie plomb-acide et les batteries lithium-ion, dont les matériaux de base sont des ressources stratégiques pour la RDC.
10.4 Électrolyse industrielle
L’électrolyse, qui utilise un courant électrique pour forcer une réaction redox non spontanée, est présentée sous l’angle de ses applications industrielles. La production d’aluminium, de chlore, de soude, et le raffinage électrolytique du cuivre sont décrits comme des procédés majeurs.
CHAPITRE 11 : Chimie analytique instrumentale
11.1 Spectrophotométrie UV-Vis
Cette technique d’analyse quantitative est basée sur l’absorption de la lumière dans les domaines ultraviolet et visible par les molécules. La loi de Beer-Lambert est au cœur de cette section, permettant de relier l’absorbance à la concentration d’une espèce en solution.
11.2 Chromatographie gazeuse
La chromatographie en phase gazeuse (CPG) est introduite comme une méthode puissante pour séparer et analyser les composés volatils d’un mélange. Le principe de la séparation entre une phase stationnaire et une phase mobile gazeuse est expliqué.
11.3 Chromatographie liquide
Similaire dans son principe à la CPG, la chromatographie en phase liquide (HPLC) utilise une phase mobile liquide pour séparer les composés d’un mélange. Sa grande polyvalence pour l’analyse de composés non volatils ou thermiquement instables est soulignée.
11.4 Spectroscopie IR et RMN
Une introduction aux deux techniques spectroscopiques les plus importantes pour la détermination de la structure des molécules organiques est proposée. La spectroscopie infrarouge (IR) identifie les groupes fonctionnels, tandis que la résonance magnétique nucléaire (RMN) renseigne sur l’environnement des atomes d’hydrogène et de carbone.
CHAPITRE 12 : Chimie de l’environnement
12.1 Polluants atmosphériques
L’étude porte sur la chimie de l’atmosphère, en se concentrant sur les principaux polluants (oxydes de soufre et d’azote, ozone, particules fines) et leurs sources. Les phénomènes des pluies acides, du smog photochimique et de la destruction de la couche d’ozone sont expliqués.
12.2 Traitement de l’eau
Les différentes étapes du traitement de l’eau potable (coagulation, floculation, décantation, filtration, désinfection) sont décrites d’un point de vue chimique. Les procédés d’épuration des eaux usées sont également abordés pour réduire la pollution des cours d’eau, comme le fleuve Congo à Kinshasa.
12.3 Déchets solides et recyclage
La gestion des déchets solides constitue un enjeu environnemental majeur. Les différentes stratégies sont présentées : réduction à la source, réutilisation, recyclage (des métaux, plastiques, verre) et valorisation énergétique, en opposition à la mise en décharge.
12.4 Impact sur la santé
La toxicologie chimique est introduite pour établir le lien entre l’exposition aux polluants environnementaux et leurs effets sur la santé humaine. Les notions de dose-réponse, de toxicité aiguë et chronique, et les impacts de polluants spécifiques comme les métaux lourds sont discutés.
CHAPITRE 13 : Chimie industrielle
13.1 Procédés de synthèse en continu
La différence entre les procédés en discontinu (batch) et en continu est expliquée. L’avantage des systèmes en continu pour la production à grande échelle en termes d’efficacité, de contrôle et de sécurité est mis en avant dans l’industrie chimique lourde.
13.2 Catalyse industrielle
L’importance économique et environnementale de la catalyse dans l’industrie est soulignée. Des exemples de catalyseurs hétérogènes utilisés dans le raffinage du pétrole, la production d’acide sulfurique (procédé de contact) et la dépollution automobile sont analysés.
13.3 Génie des procédés (bioréacteurs)
Une introduction au génie des procédés est faite à travers l’étude des réacteurs chimiques. L’accent est mis sur les bioréacteurs, qui utilisent des systèmes biologiques (micro-organismes, enzymes) pour réaliser des transformations chimiques, notamment dans l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique.
13.4 Sécurité et réglementation
La gestion des risques dans l’industrie chimique est une priorité. Les concepts de sécurité des procédés, l’analyse des dangers (HAZOP), et l’importance des fiches de données de sécurité (FDS) sont présentés, ainsi que le cadre réglementaire national et international.
CHAPITRE 14 : Biochimie fondamentale
14.1 Structure des biomolécules
Ce chapitre introduit les quatre grandes familles de molécules du vivant. Il explore la structure des glucides (monosaccharides et polysaccharides), des lipides (acides gras, triglycérides, phospholipides), des protéines (acides aminés et niveaux de structure) et des acides nucléiques (ADN et ARN).
14.2 Enzymologie
Les enzymes sont présentées comme les catalyseurs biologiques hautement spécifiques et efficaces. Le modèle de la clé et de la serrure, la cinétique de Michaelis-Menten, et les facteurs influençant l’activité enzymatique (pH, température, inhibiteurs) sont décrits.
14.3 Métabolisme énergétique
Un aperçu des principales voies métaboliques productrices d’énergie est donné. Les processus de la glycolyse, du cycle de Krebs et de la phosphorylation oxydative sont introduits pour montrer comment la cellule extrait l’énergie chimique des nutriments pour produire de l’ATP.
14.4 Acides nucléiques et synthèse protéique
Le rôle central de l’ADN comme support de l’information génétique est expliqué. Les processus de la transcription (de l’ADN à l’ARN messager) et de la traduction (de l’ARN au polypeptide) sont décrits comme les étapes fondamentales du dogme central de la biologie moléculaire.
ANNEXES
A. Tableaux de constantes thermodynamiques 📊
Cette annexe fournit des données numériques essentielles pour les calculs de thermodynamique. Elle compile les valeurs d’enthalpie standard de formation (ΔH°f), d’entropie molaire standard (S°) et d’énergie libre de Gibbs standard de formation (ΔG°f) pour une large gamme de substances chimiques.
B. Listes de longueurs de liaison et angles moléculaires 📏
Cet outil de référence est destiné à l’étude de la structure moléculaire. Il contient des tableaux de valeurs typiques pour les longueurs des liaisons covalentes simples, doubles et triples, ainsi que les angles de liaison caractéristiques associés aux différentes géométries moléculaires (VSEPR).
C. Glossaire des termes spécialisés 📖
Ce glossaire alphabétique définit de manière claire et concise les termes techniques et les concepts complexes introduits tout au long du cours. Il sert d’aide-mémoire rapide pour l’élève, facilitant la révision et la compréhension précise du vocabulaire spécialisé de la chimie de deuxième année.


