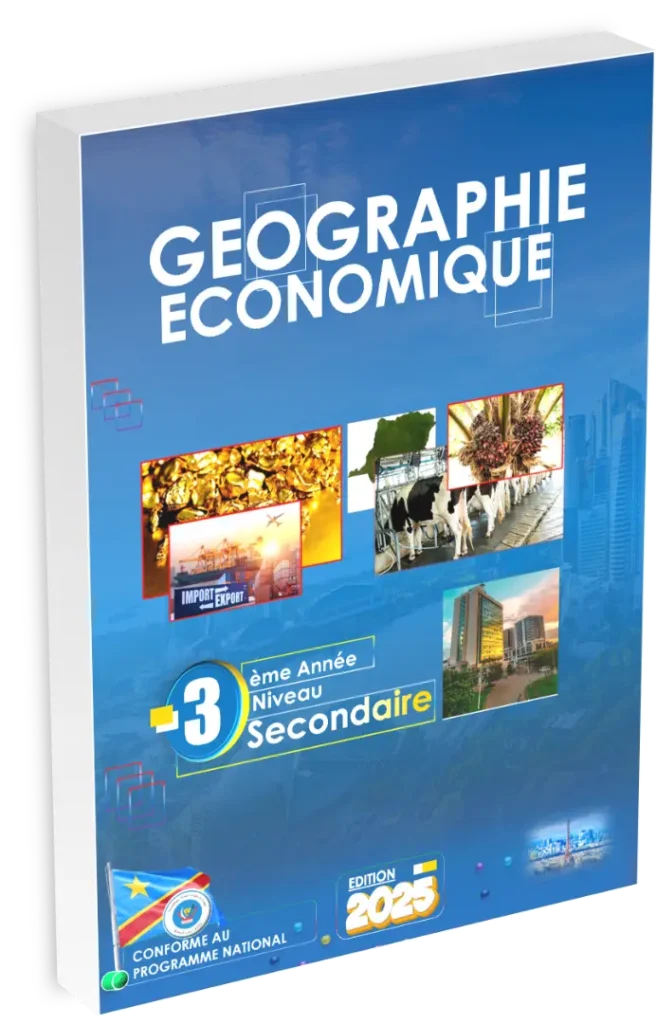
COURS DE GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE, 3ÈME ANNÉE DES HUMANITÉS
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
PRÉLIMINAIRES
0.1. Note Introductive et Contexte Curriculaire
Ce cours de Géographie Économique est conçu spécifiquement pour les élèves de la 3ème Année des Humanités (anciennement 5ème année secondaire) en République Démocratique du Congo. Il s’aligne rigoureusement sur le Programme National de Géographie , visant à doter l’apprenant d’une compréhension approfondie des mécanismes de production, de transformation et d’échange à l’échelle mondiale, avec un ancrage systématique dans les réalités congolaises. L’approche pédagogique privilégie l’analyse des statistiques actuelles, l’étude des potentiels locaux et la compréhension des enjeux de la mondialisation.
0.2. Objectifs Terminaux d’Intégration
Au terme de cette année scolaire, l’élève devra être capable d’expliquer les mécanismes économiques et commerciaux d’un pays en se basant sur les potentialités du sol, du sous-sol et des facteurs humains . Il devra établir des liens concrets entre la production des différents pays et leur niveau de développement, tout en situant la RDC dans les flux économiques mondiaux.
0.3. Compétences de Base Visées
- Analyse des Ressources : Déterminer les variétés de cultures et de ressources minérales et expliquer leurs mécanismes de mise en valeur .
- Compréhension des Systèmes : Expliquer les systèmes économiques (libéralisme, dirigisme, mondialisation) et les mouvements d’échanges internationaux .
- Localisation et Cartographie : Identifier sur des cartes les grandes zones de production (agricole, minière, industrielle) et les grands flux commerciaux .
0.4. Méthodologie et Évaluation
L’enseignement combine l’exposé interactif, l’analyse documentaire (graphiques, cartes, tableaux statistiques) et les travaux pratiques. L’évaluation se fonde sur la capacité de l’élève à interpréter des données économiques, à réaliser des croquis de synthèse et à proposer des solutions aux problèmes de développement, notamment ceux liés à l’économie extravertie de la RDC.
PREMIÈRE PARTIE : LES BASES DE L’ÉCONOMIE ET LES RESSOURCES AGRICOLES
Aperçu : 🌍 Cette première partie pose les fondements théoriques de la géographie économique avant d’explorer le secteur primaire. Elle analyse la répartition mondiale et nationale des grandes cultures vivrières et industrielles, ainsi que l’exploitation des ressources biologiques (forêts, pêche, élevage). L’accent est mis sur la sécurité alimentaire, les techniques de production et la place de l’agriculture congolaise dans l’économie de marché.
CHAPITRE 1 : INTRODUCTION À LA GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE
1.1. Définition et Champ d’Action
La géographie économique étudie la distribution spatiale des activités économiques de l’homme, comprenant la production, la circulation, l’échange et la consommation des richesses . Elle analyse les rapports entre le milieu naturel et les activités humaines, cherchant à expliquer pourquoi certaines régions, comme la Silicon Valley ou le bassin minier du Katanga, se spécialisent dans des secteurs précis.
1.2. La Notion d’Environnement Économique
L’environnement économique englobe l’ensemble des facteurs externes qui influencent les décisions de production et d’échange. Il inclut les ressources naturelles disponibles, les infrastructures, la stabilité politique et les cadres législatifs. En RDC, cet environnement est caractérisé par un potentiel immense mais freiné par des défis logistiques majeurs, comme l’état des routes de desserte agricole dans le Kwilu ou le Sankuru.
1.3. Les Facteurs de Production
Les facteurs de production se divisent en trois catégories : le capital naturel (terre, eau, minerais), le travail (main-d’œuvre qualifiée et non qualifiée) et le capital technique/financier. L’interaction efficace de ces facteurs détermine la productivité d’une région.
1.4. Les Secteurs d’Activité Économique
L’économie se structure en trois secteurs : le secteur primaire (extraction et agriculture), le secteur secondaire (transformation industrielle) et le secteur tertiaire (services et commerces). L’analyse de la répartition de la population active dans ces secteurs permet d’évaluer le niveau de développement d’un pays.
CHAPITRE 2 : L’ÉCONOMIE DES CÉRÉALES
2.1. Le Blé : Culture et Commerce Mondial
Le blé, base de l’alimentation occidentale, exige des climats tempérés ou subtropicaux. Sa production est dominée par la Chine, l’Inde et la Russie. Bien que peu cultivé en RDC (quelques essais dans le Haut-Katanga), il constitue un poste d’importation majeur pour la minoterie congolaise (ex : Minocongo à Matadi) sous forme de farine de froment .
2.2. Le Riz : Riziculture Inondée et Pluviale
Le riz nourrit la moitié de l’humanité, particulièrement en Asie des moussons. Il nécessite chaleur et humidité. En RDC, la riziculture est pratiquée dans la cuvette centrale (Bumba dans la Mongala) et dans l’est (plaine de la Ruzizi au Sud-Kivu). La production locale peine cependant à couvrir la demande urbaine croissante de Kinshasa, entraînant des importations massives.
2.3. Le Maïs : Céréale Polyvalente
Le maïs est cultivé tant pour l’alimentation humaine qu’animale. Il s’adapte à divers climats tropicaux et tempérés. En RDC, c’est une culture vivrière essentielle, notamment dans l’espace Kasaïen et le Katanga, où il constitue la base du « fufu ». Les crises de la farine de maïs dans le Haut-Katanga illustrent la dépendance alimentaire vis-à-vis des pays voisins comme la Zambie.
2.4. Les Autres Céréales Secondaires
Le sorgho et le millet sont cruciaux pour les zones arides du Sahel, mais aussi présents dans les savanes congolaises pour la production de boissons locales et l’alimentation traditionnelle. L’orge et le seigle restent marginaux dans l’économie congolaise.
CHAPITRE 3 : LES PLANTES INDUSTRIELLES SACCHARIFÈRES ET STIMULANTES
3.1. La Canne à Sucre et l’Industrie Sucrière
Plante des régions tropicales humides, la canne à sucre nécessite de grands espaces et une irrigation maîtrisée. La production congolaise est symbolisée par la compagnie sucrière de Kwilu-Ngongo dans le Kongo Central, qui alimente le marché national. La betterave à sucre, culture tempérée, complète la production mondiale .
3.2. Le Caféier : Arabica et Robusta
Le café est une culture de rente majeure pour les pays tropicaux. La RDC produit deux variétés : le Robusta dans les zones de basse altitude (Uele, Équateur) et l’Arabica de haute qualité sur les terres volcaniques du Nord-Kivu et de l’Ituri. La relance de la filière café est vitale pour l’exportation agricole congolaise .
3.3. Le Cacaoyer et le Théier
Le cacao, exigeant un climat équatorial strict, est cultivé dans le Mayombe (Kongo Central) et de plus en plus dans le Nord-Kivu (Beni). Le théier, nécessitant altitude et humidité, trouve son terroir de prédilection dans les régions montagneuses du Kivu (plantations de Butembo et Walungu).
3.4. Les Circuits de Commercialisation
Ces produits subissent la fluctuation des cours mondiaux fixés dans les bourses de Londres ou New York. Les producteurs congolais font face aux défis de l’enclavement qui augmentent les coûts de transport vers les ports d’exportation comme Mombasa ou Matadi.
CHAPITRE 4 : LES OLÉAGINEUX ET LES RESSOURCES FORESTIÈRES
4.1. Le Palmier à Huile : Une Richesse Nationale
Originaire du bassin du Congo, le palmier à huile fournit l’huile de palme (pulpe) et l’huile palmiste (amande). Les grandes plantations industrielles (Feronia, PHC) coexistent avec une production artisanale villageoise intense dans le Kwilu, la Tshopo et l’Équateur. C’est la première source de lipides pour les ménages congolais .
4.2. Les Autres Oléagineux Tropicaux et Tempérés
L’arachide est largement cultivée dans les savanes du Bandundu et du Kasaï pour la consommation locale. Le coton (pour sa graine), le soja et le sésame complètent cette gamme. Les oléagineux tempérés (colza, tournesol, olivier) dominent les marchés européens.
4.3. Les Grandes Zones Forestières et l’Exploitation du Bois
La RDC possède le deuxième massif forestier tropical du monde. L’exploitation du bois d’œuvre (Wenge, Sapelli, Afrormosia) est concentrée dans le Mai-Ndombe, la Tshopo et l’Équateur. La gestion durable et la lutte contre l’exploitation illégale sont des enjeux écologiques et économiques majeurs .
4.4. Le Caoutchouc Naturel et Synthétique
L’hévéa, cultivé pour son latex, est une culture industrielle historique en RDC (Congo Central, Équateur). Il subit la concurrence du caoutchouc synthétique issu de la pétrochimie. La relance des hévéacultures est observée dans le territoire de Bongandanga et à Tshela.
CHAPITRE 5 : LES CULTURES TEXTILES ET FRUITIÈRES
5.1. Le Coton : Culture et Industrie Textile
Le coton est la fibre naturelle la plus utilisée. En RDC, sa culture a décliné mais des efforts de relance existent dans l’Uele et le Maniema. L’industrie textile locale (ex: Sotexki à Kisangani) tente de survivre face aux importations de friperies et de tissus imprimés asiatiques .
5.2. Les Autres Fibres Naturelles
La laine (élevage ovin) et la soie sont peu développées en RDC. Par contre, les fibres végétales comme le sisal ou l’urena lobata ont eu une importance historique pour la sacherie, nécessaire au transport des produits agricoles.
5.3. Les Cultures Fruitières Tropicales
La banane (plantain et douce), l’ananas, les agrumes et la mangue constituent une part importante de l’alimentation et du commerce interurbain (ex: approvisionnement de Kinshasa par le Kongo Central). Le manque d’unités de transformation (jus, conserves) entraîne des pertes post-récolte considérables.
5.4. Les Cultures Vivrières Complémentaires
Le manioc, bien que tubercule, est la base de la sécurité alimentaire en RDC. Il est cultivé sur l’ensemble du territoire. Sa transformation en cossettes, fufu ou chikwangue génère une activité économique intense, particulièrement le long des axes fluviaux.
CHAPITRE 6 : L’ÉLEVAGE ET LA PÊCHE
6.1. Les Types d’Élevage et Zones de Production
On distingue l’élevage extensif traditionnel et l’élevage intensif moderne. En RDC, les grands plateaux du Katanga (Marungu) et de l’Ituri sont des zones pastorales par excellence pour les bovins. L’élevage de petit bétail (chèvres, porcs) et la volaille sont omniprésents dans les zones rurales et périurbaines .
6.2. La Pêche : Artisanale et Industrielle
La pêche maritime est limitée à la courte côte atlantique (Muanda). La pêche fluviale et lacustre est prédominante (Fleuve Congo, Lacs Tanganyika, Albert, Edouard). Le potentiel halieutique est immense mais sous-exploité faute de chaînes de froid adéquates.
6.3. Les Produits et Dérivés
Outre la viande et le poisson, l’élevage fournit le lait, les peaux et les œufs. La RDC reste importatrice nette de produits carnés et laitiers, ce qui grève sa balance commerciale.
6.4. Les Problèmes et Perspectives du Secteur
Les épizooties, le manque d’intrants vétérinaires, la surpêche dans certaines zones et la pollution des eaux sont des freins majeurs. Le développement de la pisciculture en étangs (Nord-Kivu, Kinshasa) représente une solution d’avenir pour l’autonomie protéique.
DEUXIÈME PARTIE : LES RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES, MINIÈRES ET INDUSTRIELLES
Aperçu : 🏭 Cette partie examine les moteurs de l’économie moderne. Elle détaille le potentiel géologique exceptionnel de la RDC (« Scandale Géologique ») et analyse les infrastructures énergétiques nécessaires à l’industrialisation. L’étude couvre l’extraction, la transformation des minerais et la typologie des industries, mettant en lumière le contraste entre la richesse du sous-sol et la faiblesse du tissu industriel local.
CHAPITRE 7 : LES SOURCES D’ÉNERGIE
7.1. L’Hydroélectricité : Le Potentiel Congolais
L’eau est la principale richesse énergétique de la RDC grâce au débit puissant et régulier du fleuve Congo. Le site d’Inga (Kongo Central) possède un potentiel unique au monde (44 000 MW pour le Grand Inga). Les centrales existantes (Inga I et II, Zongo, Ruzizi) alimentent les industries minières et les villes, mais le taux d’électrification national reste faible .
7.2. Le Pétrole et le Gaz Naturel
Les hydrocarbures sont exploités sur le littoral (bassin côtier de Muanda) par des sociétés comme Perenco. Des gisements prometteurs existent dans la Cuvette Centrale et le Graben Albertine (Ituri). Le gaz méthane du Lac Kivu représente une ressource énergétique majeure pour l’électrification de l’Est (Nord et Sud-Kivu).
7.3. La Houille et l’Uranium
Le charbon (houille) est exploité à Luena (Haut-Lomami) pour alimenter les cimenteries et la métallurgie. L’uranium, historiquement extrait à Shinkolobwe (Haut-Katanga), reste une ressource stratégique sous haute surveillance.
7.4. Les Énergies Renouvelables Alternatives
Le solaire et la biomasse (bois de chauffe, charbon de bois) sont essentiels pour les ménages congolais. Le développement des énergies vertes est crucial pour réduire la pression sur les forêts (déforestation autour de Kinshasa et Lubumbashi).
CHAPITRE 8 : LES RESSOURCES MINIÈRES MÉTALLIQUES
8.1. Le Cuivre et le Cobalt : La Ceinture de Cuivre
La RDC est leader mondial du cobalt et grand producteur de cuivre, concentrés dans le Lualaba et le Haut-Katanga (Kolwezi, Likasi, Lubumbashi). Ces minerais sont vitaux pour la transition énergétique mondiale (batteries électriques). L’exploitation est dominée par des multinationales (chinoises, suisses) et la Gecamines .
8.2. L’Étain, le Coltan et le Wolframite
Ces minerais (« 3T ») sont exploités artisanalement et semi-industriellement dans le Grand Kivu (Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema) et le Katanga. Le coltan est indispensable à l’industrie électronique. La traçabilité est un enjeu majeur pour éviter les « minerais de conflit ».
8.3. Le Fer et le Manganèse
Des gisements importants de fer existent (Banalia, Kasai) mais sont peu exploités faute d’infrastructures de transport lourd. Le manganèse est présent dans le Lualaba (Kisenge).
8.4. La Sidérurgie et la Métallurgie
La métallurgie congolaise se concentre sur la première transformation du cuivre et du cobalt (cathodes, hydroxydes). L’absence d’une industrie sidérurgique lourde intégrée empêche la production locale d’acier nécessaire à la construction.
CHAPITRE 9 : LES MÉTAUX PRÉCIEUX ET PIERRES PRÉCIEUSES
9.1. Le Diamant : Joaillerie et Industrie
La RDC est un grand producteur de diamant industriel et de joaillerie, principalement au Kasaï Oriental (MIBA à Mbuji-Mayi) et au Kasaï Central (Tshikapa). L’exploitation est partagée entre industrielle et artisanale, cette dernière alimentant souvent des circuits informels .
9.2. L’Or : Gisements Industriels et Artisanaux
L’or est exploité industriellement dans le Haut-Uele (Kibali Goldmines) et le Sud-Kivu (Twangiza). L’exploitation artisanale est répandue en Ituri et au Maniema. L’or constitue une réserve de valeur et un produit d’exportation clé.
9.3. L’Argent et le Platine
Souvent associés aux minerais de cuivre ou d’or, l’argent et le platine sont des sous-produits de la métallurgie valorisés sur les marchés internationaux.
9.4. Impact Économique et Environnemental
L’extraction minière génère des revenus fiscaux importants mais pose de graves problèmes environnementaux (pollution des eaux, dégradation des sols) et sociaux (déplacement de populations, travail des enfants dans les mines artisanales).
CHAPITRE 10 : TYPES ET STRUCTURES INDUSTRIELLES
10.1. Les Industries Extractives
Elles dominent l’économie congolaise. Leur fonction est d’extraire les matières premières du sol et du sous-sol. Elles sont localisées sur les gisements (ex: Tenke Fungurume Mining).
10.2. Les Industries de Base et Lourdes
Elles transforment les matières premières en produits semi-finis. En RDC, cela concerne principalement la pyrométallurgie et l’hydrométallurgie du cuivre/cobalt, ainsi que les cimenteries (Cilu, PPC, Cimenkat) indispensables au BTP.
10.3. Les Industries de Transformation et Légères
Ce sont les industries alimentaires (brasseries Bralima/Brasimba, minoteries), textiles et chimiques (savonneries, plastiques). Elles sont généralement situées près des grands centres de consommation comme Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani .
10.4. Localisation et Déséquilibre Industriel
Le tissu industriel de la RDC est très inégalement réparti, concentré sur trois pôles : Kinshasa-Kongo Central (industries de consommation et portuaire), le Katanga (mines) et Kisangani (pôle déclinant). Le reste du pays est sous-industrialisé.
TROISIÈME PARTIE : LES ÉCHANGES, LA CIRCULATION ET L’ORGANISATION MONDIALE
Aperçu : ✈️ Cette dernière partie connecte la production à la consommation. Elle analyse les réseaux de transport qui permettent la circulation des biens, les mécanismes monétaires et commerciaux, ainsi que la structure des échanges internationaux. Elle étudie la position de la RDC et de l’Afrique dans la mondialisation, abordant les problématiques de la dette, de l’aide au développement et de l’intégration régionale.
CHAPITRE 11 : TRANSPORTS ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
11.1. Les Transports Terrestres : Route et Rail
Le réseau routier congolais est insuffisant et dégradé, entravant l’intégration économique nationale. Les axes vitaux incluent la RN1 (Banana-Kinshasa-Lubumbashi). Le rail (SNCC, SCTP) est crucial pour l’évacuation des minerais (Lobito corridor) et le transport de masse, mais nécessite une réhabilitation lourde .
11.2. Les Transports Fluviaux et Maritimes
Le fleuve Congo et ses affluents (Oubangui, Kasaï) constituent une « autoroute naturelle » de 15 000 km, essentielle pour relier Kinshasa à Kisangani et aux régions enclavées. Le port maritime de Matadi et le projet du port en eaux profondes de Banana sont les portes d’entrée et de sortie du commerce international.
11.3. Le Transport Aérien
Dans un pays continent aux infrastructures terrestres défaillantes, l’avion est souvent le seul moyen de liaison rapide entre les provinces. L’aéroport de N’Djili est le hub principal. Le fret aérien joue un rôle clé pour les zones enclavées.
11.4. La Révolution des Télécommunications
L’explosion de la téléphonie mobile et de l’internet par fibre optique (atterrissage à Muanda) transforme l’économie (Mobile Money). Cela facilite les échanges commerciaux et l’accès à l’information bancaire, même dans les zones rurales.
CHAPITRE 12 : COMMERCE ET CIRCULATION MONÉTAIRE
12.1. Le Commerce Intérieur
Il est caractérisé par la difficulté d’approvisionnement des villes et la faiblesse des échanges interprovinciaux. Le commerce informel y occupe une place prépondérante, assurant la survie de nombreux ménages urbains.
12.2. Le Commerce Extérieur : Import-Export
La balance commerciale de la RDC est structurellement dépendante des cours des matières premières (exportation de cuivre/cobalt/pétrole) et de l’importation de produits manufacturés et alimentaires. Les principaux partenaires sont la Chine (premier client minier), l’Union Européenne et l’Afrique du Sud .
12.3. La Monnaie et l’Inflation
Le Franc Congolais subit des fluctuations face au Dollar Américain, entraînant une « dollarisation » de l’économie. L’inflation érode le pouvoir d’achat. La Banque Centrale du Congo joue un rôle clé dans la régulation monétaire .
12.4. Les Institutions Financières Internationales
Le FMI, la Banque Mondiale et la BAD interviennent par des prêts et des appuis budgétaires. Leur rôle est déterminant dans la stabilisation macroéconomique et le financement des infrastructures.
CHAPITRE 13 : SYSTÈMES ET ORGANISATIONS ÉCONOMIQUES
13.1. Les Systèmes Économiques
Comparaison entre le libéralisme (économie de marché, libre entreprise), le socialisme (planification centrale, propriété étatique) et le protectionnisme. La RDC évolue dans une économie libérale mixte où l’État tente de réguler le marché tout en attirant les investissements privés .
13.2. La Division Internationale du Travail (DIT)
La DIT assigne aux pays du Sud (comme la RDC) le rôle de fournisseurs de matières brutes et aux pays du Nord (et émergents) celui de producteurs de biens manufacturés et de services à haute valeur ajoutée. Cette structure perpétue la dépendance économique.
13.3. Les Multinationales
Acteurs majeurs de la mondialisation, les firmes multinationales (Glencore, Huawei, Total) détiennent des capitaux et des technologies supérieurs aux budgets de certains États. Elles contrôlent une grande part de la production minière et des télécommunications en RDC.
13.4. Les Organismes de Régulation et d’Intégration
L’OMC régule le commerce mondial. L’OPEP (pétrole) influence les prix de l’énergie. Au niveau régional, la RDC est membre de la SADC, de la CEEAC et de l’EAC, cherchant à intégrer son marché dans des zones de libre-échange africaines (ZLECAf).
CHAPITRE 14 : INÉGALITÉS ET NOUVEL ORDRE ÉCONOMIQUE
14.1. L’Inégalité des Échanges Nord-Sud
Les termes de l’échange sont souvent défavorables aux pays producteurs de matières premières (détérioration des termes de l’échange). La valeur ajoutée est captée par les pays industrialisés qui transforment les produits .
14.2. La Dette et l’Aide au Développement
Le poids de la dette extérieure freine l’investissement public. L’aide au développement (APD), bien qu’importante, ne suffit pas à déclencher le décollage économique et crée parfois une mentalité d’assistance.
14.3. La Mondialisation et ses Acteurs
La mondialisation connecte les marchés mais accentue les compétitions. Pour la RDC, l’enjeu est de passer d’une économie de rente à une économie diversifiée pour tirer profit de ce marché global.
14.4. Vers un Nouvel Ordre Économique
Le dialogue Nord-Sud et la coopération Sud-Sud (avec les BRICS par exemple) visent à rééquilibrer les relations économiques internationales. L’industrialisation locale des ressources (ex: fabrication de batteries en RDC) est la voie privilégiée pour sortir du sous-développement .
ANNEXES
A.1. Cartes Thématiques de la RDC
- Carte agricole : Zones de cultures vivrières et industrielles.
- Carte minière : Localisation des gisements de cuivre, cobalt, or, diamant, coltan.
- Carte énergétique : Sites hydroélectriques, lignes haute tension, bassins pétroliers.
- Carte des transports : Réseaux routiers prioritaires, voies ferrées, voies navigables.
A.2. Tableaux Statistiques
- Production annuelle des principaux minerais (5 dernières années).
- Évolution du PIB et de la croissance économique.
- Balance commerciale (Importations vs Exportations).
- Données démographiques et population active par secteur.
A.3. Glossaire des Termes Économiques
Définitions concises des termes clés : PIB, PNB, Inflation, Balance des paiements, Termes de l’échange, Libéralisme, Protectionnisme, Holding, Trust, Cartel, Mondialisation.
A.4. Bibliographie Sélective
Liste des ouvrages de référence, rapports de la Banque Centrale du Congo, codes minier et forestier, et manuels scolaires agréés par le Ministère de l’EPST.



