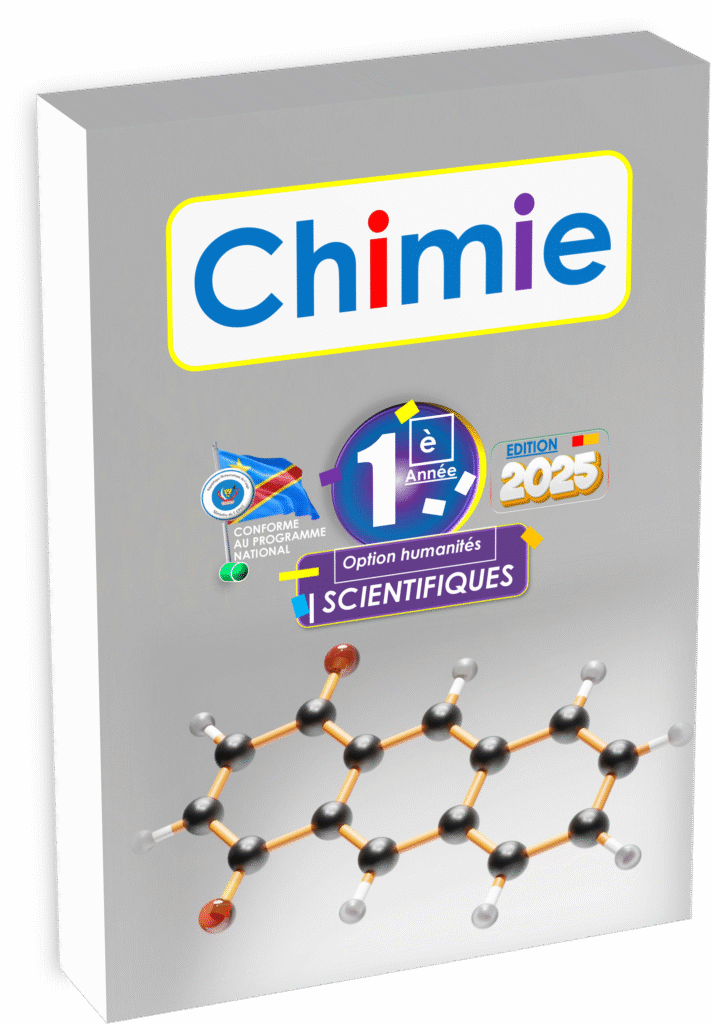
COURS DE CHIMIE, 1ÈRE ANNÉE, OPTION HUMANITÉS SCIENTIFIQUES
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC
PRÉLIMINAIRES
I. Présentation du cours 📜
Ce cours de chimie générale établit les fondements de la science de la matière et de ses transformations. Il est conçu pour fournir aux élèves des humanités scientifiques une compréhension rigoureuse des principes atomiques, des liaisons chimiques et des réactions, compétences indispensables pour aborder les sciences de la vie, la physique et les technologies. Le programme ancre systématiquement les concepts théoriques dans des contextes pertinents pour la République Démocratique du Congo.
II. Objectifs généraux 🎯
L’objectif principal est de développer la capacité de l’élève à observer, décrire et interpréter les phénomènes chimiques. À l’issue de ce cours, l’élève maîtrisera la structure de la matière à l’échelle atomique et moléculaire, saura équilibrer des équations chimiques, comprendra les principes de la stœchiométrie et sera initié à la chimie du carbone.
III. Compétences visées 🧠
Ce programme vise à développer des compétences analytiques et pratiques. L’élève apprendra à manipuler en sécurité le matériel de laboratoire, à appliquer un protocole expérimental, à modéliser une réaction chimique par une équation, à utiliser le tableau périodique comme un outil prédictif et à résoudre quantitativement des problèmes de stœchiométrie.
IV. Méthode d’évaluation 📝
L’évaluation sera continue, combinant des interrogations formatives pour valider la compréhension des concepts, des rapports de laboratoire pour mesurer les compétences pratiques et des examens semestriels. Ces derniers évalueront la capacité à résoudre des problèmes complexes, en mobilisant plusieurs chapitres pour analyser, par exemple, un processus d’extraction de minerais à Likasi ou une réaction de saponification pour la production locale de savon.
V. Matériel requis 🧪
Une maîtrise effective des concepts de ce cours nécessite un accès à un laboratoire de chimie fonctionnel, équipé de verrerie de base (béchers, éprouvettes, erlenmeyers), d’instruments de mesure (balances), de sources de chaleur (bec Bunsen) et de produits chimiques de base. Un tableau périodique des éléments constitue un outil de référence indispensable pour chaque élève.
PREMIÈRE PARTIE : INTRODUCTION À LA CHIMIE ET STRUCTURE DE LA MATIÈRE
Cette partie inaugurale établit les fondements conceptuels de la chimie en développant la compréhension de la structure atomique et moléculaire. Elle présente les notions de base nécessaires à l’analyse chimique, initiant les élèves aux méthodes d’investigation et aux principes qui régissent le comportement de la matière. ⚛️
CHAPITRE 1 : NOTIONS FONDAMENTALES DE CHIMIE
Ce chapitre distingue la chimie des autres sciences et définit son champ d’étude en explorant la nature de la matière et les changements qu’elle subit.
1.1 Définition et objet d’étude de la chimie
La chimie est présentée comme la science qui étudie la composition, la structure, les propriétés et les transformations de la matière. Son importance est illustrée par des applications concrètes, de la métallurgie du cuivre au Katanga à la pharmacopée traditionnelle congolaise.
1.2 Phénomènes physiques et phénomènes chimiques
Une distinction claire est établie entre un phénomène physique, qui ne modifie pas la nature de la substance (ex: fusion de la glace), et un phénomène chimique, qui la transforme en une nouvelle substance (ex: combustion du charbon de bois, ou makala).
1.3 États de la matière et leurs transformations
Les trois états principaux de la matière (solide, liquide, gaz) et leurs propriétés caractéristiques sont décrits. Les processus de changement d’état (fusion, vaporisation, condensation, solidification) sont définis et analysés en termes d’énergie.
1.4 Divisibilité de la matière et particules ultimes
Le concept de la divisibilité de la matière est exploré, menant à l’idée que la matière est constituée de particules fondamentales et indivisibles par des moyens chimiques : les atomes.
CHAPITRE 2 : STRUCTURE DE L’ATOME
Ce chapitre plonge au cœur de la matière pour en découvrir le constituant fondamental, l’atome, et explorer les modèles qui ont permis de comprendre sa structure complexe.
2.1 Notion et modèles atomiques
L’évolution historique des modèles de l’atome est retracée, depuis la théorie de Dalton jusqu’aux modèles planétaires de Rutherford et Bohr, pour aboutir à une vision moderne simplifiée.
2.2 Constitution et représentation de l’atome
La structure de l’atome est détaillée : un noyau central dense et chargé positivement, contenant des protons et des neutrons, autour duquel gravitent des électrons, chargés négativement.
2.3 Particules subatomiques et leurs propriétés
Les caractéristiques des trois particules subatomiques principales sont étudiées : leur masse relative, leur charge électrique et leur localisation au sein de l’atome.
2.4 Dimensions et échelle atomique
L’élève prend conscience de l’échelle extrêmement petite de l’atome. Des analogies sont utilisées pour visualiser le rapport entre la taille du noyau et celle de l’atome dans son ensemble.
CHAPITRE 3 : CARACTÉRISTIQUES DE L’ATOME
Ce chapitre quantifie les propriétés de l’atome, introduisant les concepts qui permettent de différencier les éléments chimiques et de comprendre leur comportement.
3.1 Nombre atomique et nombre de masse
Le numéro atomique (Z) est défini comme le nombre de protons, identifiant de manière unique un élément chimique. Le nombre de masse (A) est défini comme le nombre total de nucléons (protons + neutrons).
3.2 Neutralité de l’atome et notion d’isotopes
La neutralité électrique de l’atome est expliquée par l’égalité entre le nombre de protons et d’électrons. La notion d’isotopes, atomes d’un même élément ayant un nombre de neutrons différent, est introduite.
3.3 Masse atomique et notion de mole
La masse atomique est présentée comme la masse moyenne d’un atome d’un élément. La mole est ensuite définie comme l’unité de quantité de matière, un concept crucial pour les calculs chimiques, reliant le monde microscopique au monde macroscopique.
3.4 Configuration électronique et symbole de Lewis
La répartition des électrons en couches et sous-couches énergétiques (configuration électronique) est décrite. La représentation de Lewis est introduite comme une méthode simple pour visualiser les électrons de valence.
CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION PÉRIODIQUE DES ÉLÉMENTS
Ce chapitre présente le tableau périodique comme l’outil d’organisation le plus puissant en chimie, permettant de classer et de prédire les propriétés des éléments.
4.1 Organisation du tableau périodique
La structure du tableau périodique est expliquée, avec ses lignes (périodes) et ses colonnes (groupes ou familles), où les éléments sont classés par numéro atomique croissant.
4.2 Familles et périodes d’éléments
Les élèves apprennent que les éléments d’une même famille partagent des propriétés chimiques similaires en raison de leur configuration électronique de valence identique.
4.3 Propriétés périodiques des éléments
L’évolution de certaines propriétés le long des périodes et des familles est analysée : le rayon atomique, l’énergie d’ionisation et l’électronégativité.
4.4 Métaux, non-métaux et métalloïdes
La grande division du tableau périodique est étudiée. Les propriétés caractéristiques des métaux (conductivité, malléabilité), des non-métaux et des métalloïdes sont décrites, en lien avec les ressources minières de la RDC (cuivre, cobalt, zinc, coltan).
DEUXIÈME PARTIE : LIAISONS CHIMIQUES ET STRUCTURES MOLÉCULAIRES
Cette partie développe la compréhension des forces qui unissent les atomes pour former des molécules et des composés. L’exploration des différents types de liaisons chimiques permet d’appréhender la relation fondamentale entre la structure microscopique des substances et leurs propriétés macroscopiques. 🔗
CHAPITRE 5 : LA MOLÉCULE ET LA LIAISON CHIMIQUE
Ce chapitre introduit la molécule comme une entité stable formée d’atomes liés et explore les principes qui gouvernent la formation de ces liaisons.
5.1 Notion de molécule et sa constitution
La molécule est définie comme un assemblage électriquement neutre d’au moins deux atomes liés par des liaisons chimiques. La distinction entre corps simples moléculaires (O₂, N₂) et corps composés (H₂O, CO₂) est établie.
5.2 Règle de l’octet et stabilité chimique
La règle de l’octet est présentée comme un principe fondamental expliquant la tendance des atomes à réagir pour acquérir la configuration électronique stable d’un gaz noble, généralement avec huit électrons de valence.
5.3 Électronégativité et polarité des liaisons
L’électronégativité est définie comme la capacité d’un atome à attirer les électrons dans une liaison. La différence d’électronégativité entre deux atomes permet de déterminer la polarité d’une liaison covalente.
5.4 Types de molécules et représentations
Les élèves apprennent à représenter les molécules en utilisant différentes formules : brute, de Lewis (structurale), et développée, chacune apportant un niveau d’information différent sur la structure.
CHAPITRE 6 : LA LIAISON IONIQUE
Ce chapitre se concentre sur un type majeur de liaison chimique, la liaison ionique, qui résulte du transfert complet d’électrons et qui est à l’origine de la formation des composés ioniques.
6.1 Formation des ions et liaison ionique
Le processus de formation d’ions est expliqué : les atomes métalliques tendent à perdre des électrons pour former des cations (+), tandis que les atomes non métalliques tendent à en gagner pour former des anions (-). La liaison ionique est l’attraction électrostatique qui en résulte.
6.2 Propriétés des composés ioniques
Les propriétés typiques des composés ioniques sont décrites : ce sont des solides cristallins à température ambiante, avec des points de fusion élevés, et ils sont souvent solubles dans l’eau.
6.3 Structures cristallines ioniques
L’organisation ordonnée des ions dans un réseau cristallin est présentée. Le sel de cuisine (NaCl), exploité à Mwaro au Tanganyika, sert d’exemple pour illustrer une structure cubique simple.
6.4 Solubilité et conductibilité des composés ioniques
La capacité des composés ioniques à se dissoudre dans l’eau en libérant des ions mobiles est expliquée. Cette mobilité des ions est ce qui permet aux solutions ioniques de conduire le courant électrique.
CHAPITRE 7 : LA LIAISON COVALENTE
Ce chapitre explore la liaison covalente, où les électrons sont partagés entre les atomes, formant la base de la quasi-totalité des molécules en chimie organique et biologique.
7.1 Formation de la liaison covalente
La liaison covalente est définie comme le partage d’une ou plusieurs paires d’électrons entre deux atomes, permettant à chacun de satisfaire la règle de l’octet.
7.2 Liaisons simples, doubles et triples
La distinction est faite en fonction du nombre de paires d’électrons partagées : une paire pour une liaison simple (ex: H-H), deux paires pour une liaison double (ex: O=O), et trois paires pour une liaison triple (ex: N≡N).
7.3 Géométrie moléculaire et théorie VSEPR
Une introduction à la théorie VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion) est faite pour prédire la géométrie tridimensionnelle des molécules. Le principe est que les paires d’électrons de valence autour d’un atome central se repoussent et s’orientent pour minimiser cette répulsion.
7.4 Hybridation et orbitales moléculaires
Le concept d’hybridation des orbitales atomiques (sp, sp², sp³) est introduit de manière simplifiée pour expliquer les géométries moléculaires observées, comme la forme tétraédrique du méthane (CH₄).
CHAPITRE 8 : LA LIAISON MÉTALLIQUE
Ce chapitre décrit la nature spécifique de la liaison qui unit les atomes dans les métaux, expliquant ainsi leurs propriétés uniques de conductivité et de malléabilité.
8.1 Modèle de la mer d’électrons
Le modèle de la liaison métallique est présenté : un réseau ordonné de cations métalliques baignant dans une « mer » d’électrons de valence délocalisés et mobiles.
8.2 Propriétés des métaux
Ce modèle permet d’expliquer les propriétés caractéristiques des métaux : leur excellente conductivité électrique et thermique (due aux électrons mobiles), leur éclat métallique, ainsi que leur ductilité et leur malléabilité.
8.3 Alliages et leurs propriétés
Un alliage est défini comme un mélange de métaux, ou d’un métal avec un non-métal. Les alliages, comme le laiton (cuivre et zinc), possèdent des propriétés souvent améliorées par rapport à leurs constituants.
8.4 Applications technologiques des métaux
L’importance des métaux dans la société moderne est soulignée à travers leurs applications, notamment l’utilisation du cuivre pour les câbles électriques ou du fer pour les constructions, reliant la théorie aux industries extractives et de transformation du pays.
TROISIÈME PARTIE : RÉACTIONS CHIMIQUES ET STŒCHIOMÉTRIE
Cette partie explore les transformations de la matière et les relations quantitatives qui les gouvernent. Elle développe les outils nécessaires pour écrire et équilibrer les équations chimiques, et pour calculer les quantités de réactifs et de produits, initiant les élèves aux aspects quantitatifs de la chimie. ⚖️
CHAPITRE 9 : LES RÉACTIONS CHIMIQUES
Ce chapitre se concentre sur la description qualitative et symbolique des transformations chimiques.
9.1 Équations chimiques et équilibrage
L’équation chimique est présentée comme la représentation symbolique d’une réaction. Les élèves apprennent à équilibrer ces équations en appliquant la loi de conservation de la masse de Lavoisier, en s’assurant que le nombre d’atomes de chaque élément est le même chez les réactifs et les produits.
9.2 Types de réactions chimiques
Une classification des réactions chimiques est proposée : réactions de synthèse (combinaison), de décomposition (analyse), de déplacement simple et de double déplacement (métathèse). Chaque type est illustré par des exemples clairs.
9.3 Conditions de déroulement des réactions
Les facteurs qui influencent le déroulement d’une réaction, tels que la température, la concentration, la pression et la présence d’un catalyseur, sont introduits qualitativement.
9.4 Réactions d’oxydoréduction
Les réactions d’oxydoréduction (redox) sont définies comme des réactions impliquant un transfert d’électrons. Les concepts d’oxydation (perte d’électrons) et de réduction (gain d’électrons) sont établis.
CHAPITRE 10 : CALCULS STŒCHIOMÉTRIQUES
Ce chapitre aborde l’aspect quantitatif des réactions chimiques, en utilisant les équations équilibrées pour effectuer des calculs sur les masses et les quantités de matière.
10.1 Lois pondérales et relations stœchiométriques
Les lois de la conservation de la masse (Lavoisier) et des proportions définies (Proust) sont rappelées comme fondements de la stœchiométrie. Les coefficients stœchiométriques d’une équation équilibrée sont interprétés en termes de moles.
10.2 Calculs avec les masses molaires
Les élèves apprennent à utiliser les masses molaires pour convertir les masses de réactifs et de produits en quantités de matière (moles), et inversement. Des problèmes de type « masse-masse » ou « mole-masse » sont résolus.
10.3 Rendement et pureté des réactions
Le rendement d’une réaction est défini comme le rapport entre la quantité de produit réellement obtenue et la quantité théorique attendue. La notion de pureté d’un réactif est également prise en compte dans les calculs.
10.4 Réactif limitant et réactif en excès
Le concept de réactif limitant est introduit pour les situations où les réactifs ne sont pas mélangés dans les proportions stœchiométriques. C’est le réactif qui est entièrement consommé et qui détermine la quantité maximale de produit formé.
CHAPITRE 11 : LES FONCTIONS CHIMIQUES INORGANIQUES
Ce chapitre classifie les composés inorganiques en grandes familles ou « fonctions », basées sur leurs propriétés chimiques communes.
11.1 Oxydes et leurs propriétés
Les oxydes sont définis comme des composés de l’oxygène avec un autre élément. La distinction est faite entre les oxydes basiques (formés avec un métal) et les oxydes acides (formés avec un non-métal).
11.2 Acides et leurs caractéristiques
Les acides sont présentés selon la théorie d’Arrhenius comme des substances qui libèrent des ions hydrogène (H⁺) en solution aqueuse. Leurs propriétés (goût aigre, réaction avec les indicateurs colorés) sont décrites.
11.3 Bases et hydroxydes
Les bases sont définies comme des substances qui libèrent des ions hydroxyde (OH⁻) en solution aqueuse. Les hydroxydes métalliques sont les exemples les plus courants. Leurs propriétés (sensation savonneuse, réaction avec les indicateurs) sont étudiées.
11.4 Sels et leur formation
Un sel est défini comme un composé ionique formé par la réaction de neutralisation entre un acide et une base. Les règles de nomenclature des sels sont introduites.
QUATRIÈME PARTIE : INTRODUCTION À LA CHIMIE ORGANIQUE ET APPLIQUÉE
Cette partie constitue une initiation à l’étude des composés du carbone et de leurs propriétés spécifiques. Elle présente la diversité structurale des molécules organiques et leurs applications dans la vie quotidienne, sensibilisant les élèves à l’importance de la chimie du carbone dans les systèmes biologiques et industriels. 🌿
CHAPITRE 12 : FONDEMENTS DE LA CHIMIE ORGANIQUE
Ce chapitre établit les concepts de base qui distinguent la chimie organique de la chimie inorganique.
12.1 Spécificité du carbone et tétravalence
La position unique de l’atome de carbone dans le tableau périodique est soulignée. Sa capacité à former quatre liaisons covalentes stables (tétravalence) et à se lier à lui-même pour former de longues chaînes et des cycles est la clé de l’immense diversité des composés organiques.
12.2 Chaînes carbonées et isomérie
Les différents types de chaînes carbonées (linéaires, ramifiées, cycliques) sont décrits. La notion d’isomérie de constitution, où des composés ont la même formule brute mais des structures différentes, est introduite.
12.3 Groupes fonctionnels principaux
Les groupes fonctionnels sont présentés comme des atomes ou des groupes d’atomes qui confèrent des propriétés chimiques spécifiques à une molécule. Les principales fonctions (alcool, aldéhyde, cétone, acide carboxylique) sont identifiées.
12.4 Nomenclature des composés organiques simples
Les règles de base de la nomenclature IUPAC (Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée) sont enseignées pour nommer de manière systématique les alcanes et les composés organiques simples.
CHAPITRE 13 : LES HYDROCARBURES
Ce chapitre se concentre sur la famille la plus simple de composés organiques, les hydrocarbures, constitués uniquement de carbone et d’hydrogène.
13.1 Alcanes et leurs propriétés
Les alcanes sont étudiés comme des hydrocarbures saturés (ne contenant que des liaisons simples C-C). Leurs propriétés physiques et leur réactivité chimique limitée (combustion, halogénation) sont décrites.
13.2 Alcènes et alcynes
Les alcènes (contenant au moins une double liaison C=C) et les alcynes (contenant au moins une triple liaison C≡C) sont présentés comme des hydrocarbures insaturés. Leur réactivité, notamment les réactions d’addition, est étudiée.
13.3 Hydrocarbures aromatiques
Le benzène est introduit comme le prototype des hydrocarbures aromatiques. Sa structure cyclique particulière et sa stabilité sont expliquées.
13.4 Dérivés halogénés des hydrocarbures
Les dérivés halogénés, où un ou plusieurs atomes d’hydrogène sont remplacés par un halogène (F, Cl, Br, I), sont brièvement présentés, en mentionnant leurs applications comme solvants ou dans la fabrication de polymères.
CHAPITRE 14 : APPLICATIONS PRATIQUES : TECHNIQUES DE PRÉPARATION
Ce chapitre final relie la théorie chimique à des applications pratiques et contextualisées, en se basant sur les savoir-faire locaux et les ressources disponibles en RDC.
14.1 Préparation du jus de fruits
Un protocole simple pour la préparation et la conservation de jus de fruits (mangue, ananas) est détaillé. Ce processus permet d’aborder des concepts chimiques comme les solutions, les acides (acide citrique) et la conservation par modification du pH ou par pasteurisation.
14.2 Fabrication d’un insecticide naturel
La fabrication d’un insecticide biodégradable à partir de ressources locales (feuilles de neem, piment) est proposée comme une alternative écologique aux pesticides de synthèse. Les principes actifs et leur mode d’action sont discutés de manière simplifiée.
14.3 La saponification
Le processus de saponification, réaction entre un corps gras (huile de palme) et une base forte (soude caustique), est étudié pour la fabrication artisanale de savon. Cette application permet de concrétiser les notions de fonctions (ester, alcool) et de réactions chimiques.
14.4 Fermentation alcoolique
La transformation des sucres en alcool par l’action de levures est expliquée. Ce processus, utilisé pour la production de boissons fermentées traditionnelles comme le vin de palme, illustre une réaction biochimique catalysée par des enzymes.
ANNEXES
Ces annexes regroupent des informations de référence et des outils méthodologiques essentiels pour renforcer la maîtrise des concepts et des techniques abordés dans ce cours de chimie de première année. 📋
I. Classification périodique des éléments complète
Une version complète et à jour du tableau périodique est fournie, incluant les noms, symboles, numéros atomiques et masses atomiques relatives de tous les éléments connus. Cet outil est indispensable pour la résolution d’exercices tout au long de l’année.
II. Table des masses atomiques et molaires
Une table alphabétique des éléments les plus courants est présentée, avec leur masse molaire atomique. Cela facilite les calculs stœchiométriques en évitant des recherches fastidieuses et en permettant de se concentrer sur la méthode de résolution.
III. Règles de nomenclature chimique
Les règles de nomenclature pour les composés inorganiques (oxydes, acides, bases, sels) et les hydrocarbures simples sont résumées sous forme de fiches méthodologiques claires. Des exemples illustrent chaque règle pour en faciliter l’application.
IV. Sécurité au laboratoire de chimie
Cette section cruciale rappelle les règles fondamentales de sécurité à respecter lors des manipulations en laboratoire : port de blouse et de lunettes, manipulation correcte des produits chimiques, utilisation du matériel de verrerie et conduite à tenir en cas d’accident.
V. Verrerie et matériel de laboratoire courants
Les principaux instruments et pièces de verrerie utilisés en chimie (bécher, erlenmeyer, éprouvette graduée, fiole jaugée, pipette, burette, etc.) sont illustrés et leur fonction respective est décrite. La connaissance de ce matériel est un prérequis pour toute activité expérimentale.


