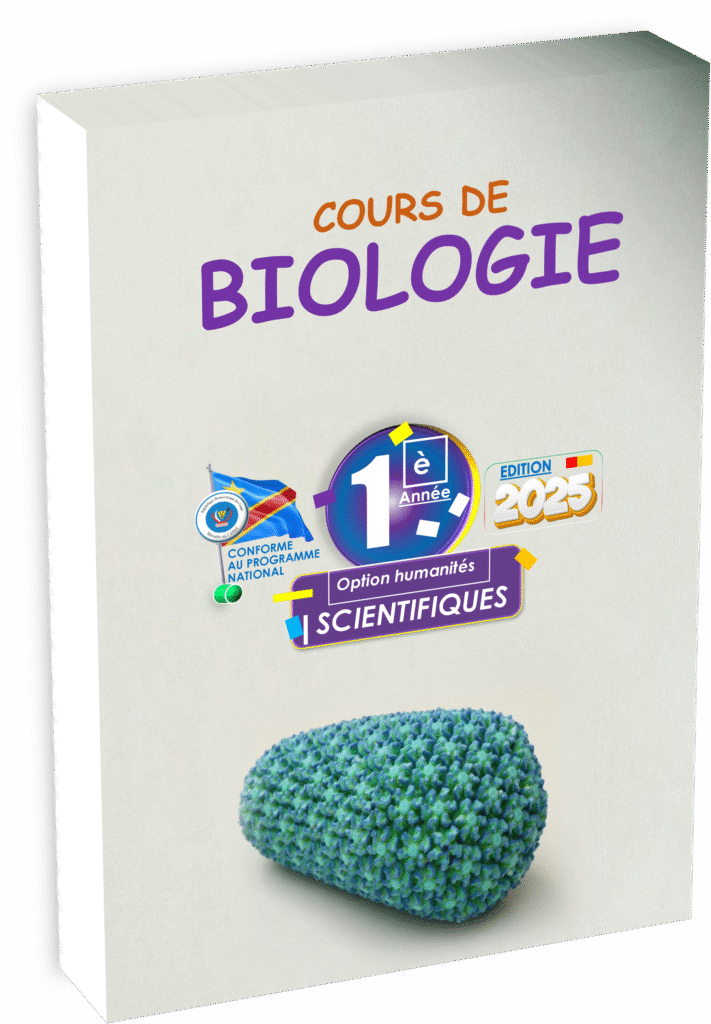
COURS DE PHYSIQUE, 1ÈRE ANNÉE DES HUMANITÉS SCIENTIFIQUES
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC
PRÉLIMINAIRES
I. Présentation du cours 📜
Ce cours de physique établit les bases de la mécanique classique, en se concentrant sur la métrologie, la cinématique, la dynamique et la statique. Il est conçu pour développer chez l’élève une compréhension rigoureuse des lois qui gouvernent le mouvement et l’équilibre des corps. Le programme ancre les principes théoriques dans des situations concrètes et pertinentes, tirées de l’environnement technologique et naturel de la République Démocratique du Congo, afin de rendre l’apprentissage significatif et applicable.
II. Objectifs généraux 🎯
L’objectif fondamental est de doter l’élève des outils conceptuels et mathématiques nécessaires pour décrire, analyser et prédire les phénomènes mécaniques. Au terme de ce cours, il devra maîtriser le Système International d’unités, appliquer les lois de Newton pour résoudre des problèmes de dynamique, et analyser les conditions d’équilibre des structures simples, jetant ainsi les bases pour des études scientifiques et techniques approfondies.
III. Compétences visées 🧠
Ce programme vise à forger des compétences d’analyse, de modélisation et de résolution de problèmes. L’élève apprendra à effectuer des mesures physiques en tenant compte des incertitudes, à représenter des grandeurs vectorielles comme la vitesse et la force, à appliquer un raisonnement déductif pour analyser un système mécanique, et à communiquer ses résultats de manière claire et structurée en utilisant le langage de la physique.
IV. Méthode d’évaluation 📝
L’évaluation des acquis sera continue et diversifiée. Elle comprendra des interrogations courtes pour vérifier la maîtrise des définitions et des formules, des travaux pratiques pour évaluer les compétences expérimentales, et des examens semestriels. Ces derniers intégreront des situations-problèmes complexes, comme l’étude du mouvement d’un wagonnet minier dans le Haut-Katanga ou l’analyse des forces s’exerçant sur le pont Matadi.
V. Matériel requis 🔬
Pour une assimilation efficace des concepts, ce cours nécessite un accès à du matériel expérimental de base. Cela inclut des instruments de mesure (mètres, chronomètres, dynamomètres), des plans inclinés, des masses marquées, des ressorts et des vecteurs de force. Un accès à un laboratoire bien équipé est un atout majeur pour la réalisation des manipulations et la vérification des lois physiques.
PREMIÈRE PARTIE : MÉTROLOGIE ET MESURES PHYSIQUES
Cette partie établit les fondements de la mesure en physique en développant les concepts d’étalons, d’instruments de mesure et de système d’unités. Elle aborde les notions d’incertitudes et d’erreurs de mesure, initiant les élèves à la rigueur expérimentale et aux méthodes quantitatives nécessaires à l’investigation scientifique en physique. 📏
CHAPITRE 1 : NOTIONS FONDAMENTALES DE MÉTROLOGIE
Ce chapitre introduit la science de la mesure comme le fondement de toute démarche expérimentale en physique.
1.1 Définition et importance de la métrologie
La métrologie est définie comme la science des mesures et de leurs applications. Son importance cruciale est soulignée dans des domaines variés comme le commerce, l’industrie et la recherche scientifique, garantissant l’équité des transactions et la reproductibilité des expériences.
1.2 Grandeurs physiques et leurs classifications
Une grandeur physique est présentée comme toute propriété d’un phénomène qui peut être quantifiée par la mesure. La distinction fondamentale entre les grandeurs scalaires (définies par une valeur numérique) et les grandeurs vectorielles (définies par une valeur, une direction et un sens) est établie.
1.3 Principe de la mesure physique
Le processus de mesure est décrit comme une comparaison d’une grandeur inconnue à une grandeur de même nature prise comme unité (étalon). Ce principe de comparaison est la base de toute quantification en sciences.
1.4 Qualités d’une mesure et normalisation
Les qualités d’une bonne mesure, telles que la justesse, la fidélité et la précision, sont définies. La nécessité de la normalisation des unités est expliquée pour assurer l’universalité et la cohérence des mesures à l’échelle mondiale.
CHAPITRE 2 : ÉTALONS ET INSTRUMENTS DE MESURE
Ce chapitre se concentre sur les références de mesure et les outils utilisés pour les réaliser.
2.1 Notion d’étalon et traçabilité métrologique
Un étalon est défini comme la matérialisation d’une unité de mesure. La notion de traçabilité, qui est la chaîne ininterrompue de comparaisons reliant une mesure à un étalon national ou international, est introduite pour garantir la fiabilité des résultats.
2.2 Étalons primaires et secondaires
La hiérarchie des étalons est présentée, distinguant les étalons primaires, définis avec la plus haute précision, des étalons secondaires et de travail, qui sont utilisés pour calibrer les instruments de mesure courants.
2.3 Caractéristiques des instruments de mesure
Les caractéristiques techniques d’un instrument, telles que sa portée, sa sensibilité, sa résolution et sa justesse, sont définies. Ces paramètres permettent de choisir l’instrument le plus adapté à une mesure donnée.
2.4 Classification et utilisation des instruments
Les instruments de mesure sont classifiés en fonction de leur principe de fonctionnement (analogique ou numérique) et de la grandeur mesurée. Les règles de bonne utilisation pour minimiser les erreurs de manipulation sont enseignées.
CHAPITRE 3 : SYSTÈME INTERNATIONAL ET AUTRES SYSTÈMES D’UNITÉS
Ce chapitre présente le cadre universel des unités de mesure utilisé en science et en technologie.
3.1 Historique et organisation du Système International
L’historique du Système International d’unités (SI) est retracé, depuis la création du système métrique jusqu’à ses redéfinitions modernes basées sur des constantes fondamentales de la physique.
3.2 Unités de base et unités dérivées
Les sept unités de base du SI (mètre, kilogramme, seconde, ampère, kelvin, mole, candela) sont présentées comme les piliers du système. Les unités dérivées (newton, joule, watt, etc.) sont ensuite construites par des relations algébriques à partir de ces unités de base.
3.3 Autres systèmes d’unités usuels
D’autres systèmes, comme le système CGS (centimètre-gramme-seconde) ou les unités impériales (pouce, livre), sont brièvement présentés pour leur pertinence historique ou dans certains contextes spécifiques.
3.4 Conversions et équivalences d’unités
Les techniques de conversion d’unités, en utilisant des facteurs de conversion, sont enseignées. La maîtrise de ces techniques est indispensable pour assurer la cohérence des calculs impliquant des données de sources diverses.
CHAPITRE 4 : INCERTITUDES ET ERREURS DE MESURE
Ce chapitre aborde le fait inhérent que toute mesure expérimentale est entachée d’une imperfection.
4.1 Types d’erreurs en métrologie
La distinction est faite entre les erreurs systématiques, qui affectent la justesse de la mesure et peuvent être corrigées, et les erreurs aléatoires, qui affectent la fidélité et sont inévitables.
4.2 Incertitudes absolue et relative
L’incertitude absolue est définie comme l’intervalle dans lequel se trouve la valeur vraie de la grandeur mesurée. L’incertitude relative, exprimée en pourcentage, permet de juger de la qualité (précision) de la mesure.
4.3 Propagation des incertitudes
Les règles de calcul pour déterminer l’incertitude d’un résultat obtenu à partir de plusieurs mesures (somme, produit, etc.) sont établies. Cette propagation des incertitudes est essentielle pour évaluer la fiabilité du résultat final.
4.4 Expression des résultats expérimentaux
La convention scientifique pour présenter un résultat de mesure est enseignée : la valeur mesurée doit toujours être accompagnée de son incertitude et de son unité, en respectant un nombre de chiffres significatifs cohérent.
DEUXIÈME PARTIE : CINÉMATIQUE DU POINT MATÉRIEL
Cette partie développe l’étude du mouvement des corps sans considération des causes qui le produisent. Elle explore les concepts de référentiel, de trajectoire, de vitesse et d’accélération, permettant aux élèves de décrire et analyser quantitativement les mouvements observés dans leur environnement. 🚗
CHAPITRE 5 : NOTIONS FONDAMENTALES DE CINÉMATIQUE
Ce chapitre pose les bases conceptuelles nécessaires à la description de tout mouvement.
5.1 Référentiel et repère d’espace
Le référentiel est défini comme le solide de référence par rapport auquel le mouvement est étudié. Un repère d’espace (un système d’axes) et une horloge y sont associés pour localiser l’objet dans l’espace et le temps.
5.2 Point matériel et trajectoire
Le modèle du point matériel est introduit pour simplifier l’étude du mouvement d’un objet en le réduisant à un point. La trajectoire est définie comme l’ensemble des positions successives occupées par ce point au cours du temps.
5.3 Abscisse et espace parcouru
Sur une trajectoire, l’abscisse repère la position du mobile à un instant donné. L’espace parcouru correspond à la longueur de la trajectoire entre deux instants.
5.4 Relativité du mouvement et du repos
Le caractère relatif du mouvement et du repos est souligné : un objet peut être en mouvement dans un référentiel et au repos dans un autre. L’exemple d’un passager dans un train en marche illustre parfaitement ce principe.
CHAPITRE 6 : VITESSE ET MOUVEMENT
Ce chapitre se concentre sur la grandeur qui caractérise la rapidité d’un mouvement.
6.1 Définition et caractéristiques de la vitesse
La vitesse est définie comme la grandeur qui mesure le rapport de la distance parcourue au temps mis pour la parcourir. C’est une grandeur vectorielle, caractérisée par une valeur, une direction et un sens.
6.2 Vitesse moyenne et vitesse instantanée
La vitesse moyenne est calculée sur un intervalle de temps, tandis que la vitesse instantanée est la vitesse du mobile à un instant précis. La vitesse instantanée est la limite de la vitesse moyenne lorsque l’intervalle de temps tend vers zéro.
6.3 Représentation vectorielle de la vitesse
Le vecteur vitesse est introduit comme un outil graphique puissant. Il est toujours tangent à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement. Sa longueur est proportionnelle à la valeur de la vitesse.
6.4 Détermination expérimentale de la vitesse
Des méthodes simples pour mesurer expérimentalement une vitesse sont proposées, par exemple en chronométrant le temps de parcours d’une distance connue, comme lors d’une course dans la cour de l’école.
CHAPITRE 7 : ACCÉLÉRATION ET VARIATION DE VITESSE
Ce chapitre introduit la grandeur qui décrit comment la vitesse d’un mobile change au cours du temps.
7.1 Notion d’accélération
L’accélération est définie comme la grandeur qui mesure la variation du vecteur vitesse par unité de temps. Un mouvement est dit accéléré si la vitesse augmente, et décéléré (ou retardé) si elle diminue.
7.2 Accélération moyenne et instantanée
L’accélération moyenne est calculée sur un intervalle de temps, tandis que l’accélération instantanée est l’accélération à un moment précis.
7.3 Représentation vectorielle de l’accélération
Le vecteur accélération est introduit. Dans un mouvement rectiligne, il a la même direction que la vitesse. Son sens indique si le mouvement est accéléré ou décéléré.
7.4 Relation entre vitesse et accélération
La relation fondamentale est établie : l’accélération est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. De même, la vitesse est la primitive de l’accélération.
CHAPITRE 8 : MOUVEMENT RECTILIGNE UNIFORME
Ce chapitre étudie le cas de mouvement le plus simple : un déplacement en ligne droite à vitesse constante.
8.1 Caractéristiques du mouvement rectiligne uniforme
Le mouvement rectiligne uniforme (MRU) est caractérisé par une trajectoire rectiligne et un vecteur vitesse constant en norme, en direction et en sens. Par conséquent, le vecteur accélération est nul.
8.2 Équations horaires du mouvement
L’équation horaire de la position pour un MRU est établie : , où est la vitesse constante et est la position initiale.
8.3 Représentations graphiques
Les graphiques associés au MRU sont analysés : le diagramme des positions est une droite affine, le diagramme des vitesses est une droite horizontale, et le diagramme des accélérations est confondu avec l’axe du temps.
8.4 Applications pratiques
Le modèle du MRU est appliqué à des situations concrètes, comme l’estimation du temps de trajet d’un bus entre Matadi et Boma, en supposant une vitesse moyenne constante.
TROISIÈME PARTIE : DYNAMIQUE DU POINT MATÉRIEL
Cette partie explore les relations entre les forces et les mouvements qu’elles produisent. Elle développe les lois fondamentales de la mécanique newtonienne et leurs applications, permettant aux élèves de comprendre les causes des mouvements et de prédire leur évolution. ⚙️
CHAPITRE 9 : FORCES ET INTERACTIONS
Ce chapitre introduit le concept de force comme la modélisation d’une action mécanique.
9.1 Notion de force et ses caractéristiques
Une force est définie comme toute cause capable de modifier l’état de mouvement d’un corps ou de le déformer. Elle est modélisée par un vecteur et caractérisée par son point d’application, sa direction, son sens et son intensité.
9.2 Classification des forces
Les forces sont classifiées en deux grandes catégories : les forces de contact (frottements, réaction d’un support) et les forces à distance (force gravitationnelle, force électrique).
9.3 Représentation vectorielle des forces
L’utilisation de vecteurs pour représenter les forces est systématisée. La notion de force résultante (somme vectorielle de toutes les forces agissant sur un corps) est introduite.
9.4 Mesure des forces et dynamomètres
L’unité de force dans le SI, le newton (N), est définie. Le dynamomètre est présenté comme l’instrument de mesure de l’intensité d’une force, basé sur la déformation élastique d’un ressort.
CHAPITRE 10 : LOIS DE NEWTON
Ce chapitre présente les trois lois fondamentales qui constituent le socle de la mécanique classique.
10.1 Principe d’inertie et première loi
La première loi de Newton (principe d’inertie) est énoncée : dans un référentiel galiléen, un corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme si la somme des forces qui s’exercent sur lui est nulle.
10.2 Principe fondamental de la dynamique
La deuxième loi de Newton établit la relation entre la cause (la force) et l’effet (l’accélération) : la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un corps est égale au produit de la masse du corps par son vecteur accélération ().
10.3 Principe d’action et réaction
La troisième loi de Newton (principe des actions réciproques) est énoncée : lorsqu’un corps A exerce une force sur un corps B, le corps B exerce simultanément sur A une force de même intensité, de même direction, mais de sens opposé.
10.4 Applications des lois de Newton
Les lois de Newton sont appliquées à la résolution de problèmes simples, comme le calcul de la force nécessaire pour accélérer un objet ou l’analyse des forces lors d’une interaction.
CHAPITRE 11 : MASSE ET POIDS
Ce chapitre clarifie la distinction entre deux concepts souvent confondus dans le langage courant.
11.1 Notion de masse et ses propriétés
La masse est définie comme une mesure de l’inertie d’un corps, c’est-à-dire sa résistance au changement de mouvement. C’est une grandeur scalaire intrinsèque, invariante, mesurée en kilogrammes (kg).
11.2 Poids d’un corps et champ gravitationnel
Le poids est défini comme la force gravitationnelle exercée par la Terre sur un corps. C’est une grandeur vectorielle, mesurée en newtons (N), qui dépend de la masse du corps et de l’accélération de la pesanteur ().
11.3 Distinction entre masse et poids
La différence fondamentale est synthétisée : la masse est une propriété de la matière, tandis que le poids est une force. La relation qui les lie est .
11.4 Variations du poids selon la localisation
L’accélération de la pesanteur () variant légèrement avec l’altitude et la latitude, le poids d’un même objet n’est pas strictement identique à Kinshasa (basse altitude) et au sommet du Mont Stanley.
CHAPITRE 12 : APPLICATIONS DE LA DYNAMIQUE
Ce chapitre applique les principes de la dynamique à des situations de mouvement plus complexes.
12.1 Mouvement des projectiles
L’étude du mouvement d’un projectile lancé dans le champ de pesanteur terrestre est abordée. En négligeant les frottements de l’air, la trajectoire est une parabole.
12.2 Forces de frottement
Les forces de frottement, qui s’opposent au mouvement, sont introduites. La distinction est faite entre le frottement statique et le frottement cinétique.
12.3 Mouvement sur plan incliné
L’analyse dynamique d’un objet glissant ou roulant sur un plan incliné est effectuée, en décomposant le poids en une composante parallèle et une composante perpendiculaire au plan.
12.4 Systèmes mécaniques simples
Des systèmes simples impliquant plusieurs corps reliés (par des cordes, des poulies) sont analysés en appliquant les lois de Newton à chaque composant du système.
QUATRIÈME PARTIE : STATIQUE ET ÉQUILIBRE
Cette partie traite des conditions d’équilibre des corps solides soumis à diverses forces. Elle développe les méthodes d’analyse des systèmes en équilibre et leurs applications pratiques, sensibilisant les élèves aux principes fondamentaux de la construction et de la stabilité des structures. ⚖️
CHAPITRE 13 : ÉQUILIBRE DES FORCES CONCOURANTES
Ce chapitre se concentre sur l’équilibre d’un point matériel ou d’un corps dont toutes les forces s’appliquent en un même point.
13.1 Composition de forces concourantes
La méthode du parallélogramme et la méthode du polygone des forces sont utilisées pour trouver graphiquement la résultante (somme vectorielle) de plusieurs forces concourantes.
13.2 Décomposition d’une force
Une force peut être décomposée en deux ou plusieurs composantes selon des directions données. La décomposition sur des axes orthogonaux est particulièrement utile pour l’analyse analytique.
13.3 Conditions d’équilibre des forces concourantes
La condition d’équilibre d’un point matériel est énoncée : la somme vectorielle de toutes les forces qui s’exercent sur lui doit être nulle. Graphiquement, cela signifie que le polygone des forces est fermé.
13.4 Applications et résolution graphique
Des problèmes d’équilibre statique, comme un objet suspendu par plusieurs câbles, sont résolus en utilisant des méthodes graphiques et analytiques.
CHAPITRE 14 : ÉQUILIBRE DES FORCES PARALLÈLES
Ce chapitre étend l’étude de l’équilibre aux corps étendus soumis à des forces parallèles.
14.1 Résultante de forces parallèles
La méthode pour déterminer la résultante de plusieurs forces parallèles est présentée. La position du point d’application de cette résultante est calculée.
14.2 Centre de gravité et centre de masse
Le centre de gravité d’un corps est défini comme le point d’application du poids total du corps. Pour un corps homogène, il coïncide avec le centre de masse (ou centre géométrique).
14.3 Équilibre des leviers
Le principe des leviers est étudié comme une application de l’équilibre des forces parallèles. La condition d’équilibre est liée à l’égalité des moments des forces.
14.4 Applications pratiques de l’équilibre
Les principes de la statique sont appliqués à des situations concrètes comme l’équilibre d’une balance Roberval utilisée au marché de la Liberté à Masina, ou la stabilité d’un chargement sur un camion.
ANNEXES
Annexe I : Tables de constantes physiques fondamentales 📊
Cette annexe fournit les valeurs numériques des constantes physiques les plus importantes utilisées dans le cours, telles que l’accélération de la pesanteur standard () et la constante gravitationnelle universelle (G). C’est une référence rapide pour la résolution de problèmes.
Annexe II : Préfixes et facteurs de conversion usuels 🔄
Un tableau récapitulatif des préfixes du Système International (kilo, méga, milli, micro, etc.) est présenté, ainsi qu’une liste des facteurs de conversion les plus courants entre le SI et d’autres systèmes d’unités. Cet outil est essentiel pour assurer la cohérence des calculs.
Annexe III : Formules et relations cinématiques essentielles 📝
Cette section regroupe de manière synthétique toutes les formules clés de la cinématique et de la dynamique vues au cours de l’année : équations horaires des mouvements, lois de Newton, et formules relatives au travail et à l’énergie. C’est un aide-mémoire précieux pour les révisions.


