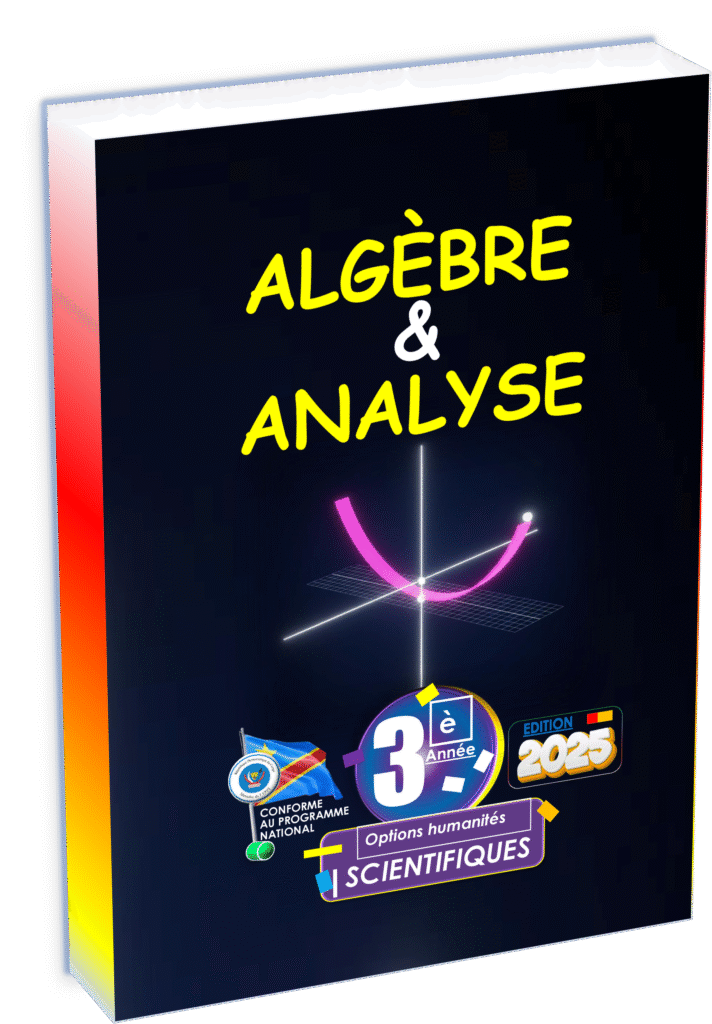
COURS D’ALGÈBRE ET ANALYSE, 3ÈME ANNÉE DES HUMANITÉS SCIENTIFIQUES
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC
PRÉLIMINAIRES
I. Présentation du cours 📜
Ce cours d’algèbre et d’analyse de troisième année constitue le couronnement du cycle secondaire en mathématiques, en abordant des structures algébriques abstraites et des concepts d’analyse avancée. Le programme est conçu pour développer une pensée formelle et rigoureuse, en explorant la théorie des groupes, des anneaux et des corps, l’algèbre linéaire, la théorie des nombres et les séries de Fourier. Il vise à préparer les élèves les plus performants aux exigences des études supérieures en mathématiques, physique et ingénierie.
II. Objectifs généraux 🎯
L’objectif fondamental est d’amener l’élève à maîtriser les structures algébriques et les outils d’analyse fonctionnelle qui sous-tendent les mathématiques modernes. Au terme de ce cours, il devra être capable de manipuler les concepts de l’algèbre abstraite, de résoudre des systèmes d’équations linéaires à l’aide de matrices et de déterminants, de comprendre les fondements de l’arithmétique modulaire et de s’initier à l’analyse de Fourier.
III. Compétences visées 🧠
Ce programme vise à forger une capacité de raisonnement abstrait et de démonstration formelle. L’élève apprendra à identifier et à analyser des structures algébriques, à appliquer les algorithmes de l’algèbre linéaire, à utiliser la théorie des nombres pour des applications en cryptographie, et à décomposer des fonctions périodiques en séries de Fourier. Ces compétences sont essentielles pour la recherche et l’innovation scientifique.
IV. Méthode d’évaluation 📝
L’évaluation sera axée sur la démonstration de théorèmes et la résolution de problèmes complexes et non standards. Elle comprendra des devoirs surveillés pour tester la rigueur du raisonnement, des présentations orales sur des sujets théoriques pour évaluer la clarté de l’expression mathématique, et des examens finaux. Ces derniers intégreront des problèmes de synthèse qui exigent une compréhension profonde des liens entre les différents domaines du cours.
V. Matériel requis 💻
La maîtrise des concepts de ce cours est facilitée par l’utilisation d’outils de calcul formel. En plus d’une calculatrice programmable, l’accès à un logiciel de calcul symbolique (comme Maxima ou SageMath) est fortement recommandé pour permettre l’exploration des structures algébriques, la manipulation de matrices de grande taille et la visualisation des séries de Fourier, préparant ainsi aux outils utilisés à l’université.
PREMIÈRE PARTIE : GROUPES, ANNEAUX ET CORPS
Cette partie approfondit la théorie algébrique en explorant les structures de groupes, anneaux et corps. Elle développe la compréhension des homomorphismes, sous-structures et leurs propriétés, établissant les bases de l’algèbre abstraite avancée. 🏛️
CHAPITRE 1 : GROUPES ET SYMMÉTRIES
Ce chapitre introduit la structure algébrique la plus fondamentale, le groupe, qui formalise la notion de symétrie.
1.1 Définitions et exemples de groupes
Un groupe est défini axiomatiquement comme un ensemble muni d’une loi de composition interne associative, possédant un élément neutre et où chaque élément a un inverse. Des exemples variés sont étudiés (groupes de nombres, groupes de permutations, groupes de symétries de figures géométriques).
1.2 Sous-groupes et ordre d’un élément
La notion de sous-groupe est introduite. Le théorème de Lagrange, qui relie l’ordre d’un sous-groupe à l’ordre du groupe, est présenté. L’ordre d’un élément est défini et ses propriétés sont étudiées.
1.3 Homomorphismes et isomorphismes
Un homomorphisme est une application entre deux groupes qui préserve la structure. Un isomorphisme est un homomorphisme bijectif, qui établit une équivalence de structure entre deux groupes.
1.4 Actions de groupe et applications
La notion d’action de groupe sur un ensemble est introduite comme un outil puissant pour étudier les symétries. Des applications, comme la formule de Burnside pour le dénombrement d’orbites, sont présentées.
CHAPITRE 2 : ANNEAUX ET IDÉAUX
Ce chapitre étudie la structure d’anneau, qui généralise l’arithmétique des nombres entiers.
2.1 Définition et propriétés des anneaux
Un anneau est un ensemble muni de deux lois (addition et multiplication) vérifiant un ensemble d’axiomes. L’anneau des entiers () et les anneaux de polynômes servent d’exemples centraux.
2.2 Sous-anneaux et idéaux
Les notions de sous-anneau et d’idéal (un sous-groupe absorbant pour la multiplication) sont définies. Les idéaux jouent un rôle analogue aux sous-groupes distingués dans la théorie des groupes.
2.3 Homomorphismes d’anneaux
Les homomorphismes d’anneaux sont les applications qui préservent les deux lois de la structure. Le noyau d’un homomorphisme est un idéal.
2.4 Anneaux principaux et factoriels
Des types d’anneaux aux propriétés arithmétiques importantes sont étudiés : les anneaux principaux, où tout idéal est engendré par un seul élément, et les anneaux factoriels, où l’on dispose d’une factorisation unique.
CHAPITRE 3 : CORPS ET EXTENSIONS
Ce chapitre se concentre sur la structure de corps, où toutes les opérations arithmétiques usuelles sont possibles.
3.1 Définition et exemples de corps
Un corps est un anneau commutatif où tout élément non nul est inversible pour la multiplication. Les corps , et sont les exemples fondamentaux.
3.2 Corps de fractions et polynômes
La construction du corps des fractions d’un anneau intègre est présentée, généralisant la construction de à partir de .
3.3 Extensions de corps et degré
Une extension de corps est une manière de voir un corps comme un sous-ensemble d’un corps plus grand. Le concept de degré de l’extension est introduit.
3.4 Corps finis et applications
Les corps finis (ou corps de Galois) sont étudiés. Leurs applications en théorie des codes (codes correcteurs d’erreurs) et en cryptographie sont soulignées, des domaines essentiels pour la sécurisation des communications numériques en RDC.
CHAPITRE 4 : POLYNÔMES ET FACTORISATION
Ce chapitre approfondit l’étude des anneaux de polynômes sur un corps.
4.1 Polynômes sur un corps
Les propriétés de l’anneau des polynômes à coefficients dans un corps sont étudiées.
4.2 Divisibilité et racines
La relation entre les racines d’un polynôme et ses diviseurs de degré 1 est approfondie.
4.3 Factorisation irréductible
Le concept de polynôme irréductible (qui ne peut pas être factorisé) est central. Le théorème fondamental de l’algèbre, qui stipule que tout polynôme non constant sur a une racine, est énoncé.
4.4 Éléments primitifs et théorème de Gauss
Le théorème de Gauss sur les polynômes à coefficients entiers et ses applications à la recherche de racines rationnelles sont étudiés.
DEUXIÈME PARTIE : MODULES ET MATRICES
Cette partie aborde la généralisation des espaces vectoriels aux modules sur un anneau et étudie les matrices, déterminants et leurs applications à la résolution de systèmes linéaires. 🧮
CHAPITRE 5 : MODULES SUR UN ANNEAU
Ce chapitre introduit une généralisation de la notion d’espace vectoriel.
5.1 Définition et exemples de modules
Un module sur un anneau est une structure similaire à un espace vectoriel, mais où les scalaires appartiennent à l’anneau plutôt qu’à un corps.
5.2 Sous-modules et morphismes
Les notions de sous-module et d’homomorphisme de modules sont définies en analogie avec les sous-espaces vectoriels et les applications linéaires.
5.3 Modules libres et bases
Un module libre est un module qui admet une base. Contrairement aux espaces vectoriels, tous les modules n’ont pas de base.
5.4 Théorème de structure des modules sur PID
Le théorème de structure des modules de type fini sur un anneau principal (PID) est présenté comme un résultat majeur de l’algèbre, avec des applications à la réduction des endomorphismes.
CHAPITRE 6 : MATRICES ET TRANSFORMATIONS LINÉAIRES
Ce chapitre se concentre sur l’outil matriciel pour l’étude des applications linéaires.
6.1 Opérations sur matrices
Les opérations d’addition, de multiplication par un scalaire et de produit matriciel sont maîtrisées.
6.2 Rang et inversibilité
Le rang d’une matrice est défini. Les conditions d’inversibilité d’une matrice carrée et les méthodes de calcul de l’inverse (méthode de la comatrice, méthode de Gauss-Jordan) sont étudiées.
6.3 Changement de base
La matrice de passage d’une base à une autre est définie. Les formules de changement de coordonnées pour les vecteurs et de changement de matrice pour les applications linéaires sont établies.
6.4 Applications aux transformations
La diagonalisation et la trigonalisation des matrices sont introduites comme des techniques de réduction permettant de simplifier l’étude des transformations linéaires.
CHAPITRE 7 : DÉTERMINANTS ET PROPRIÉTÉS
Ce chapitre est consacré à l’étude du déterminant, un nombre associé à une matrice carrée.
7.1 Définition du déterminant
Le déterminant est défini de manière récursive ou à l’aide des permutations.
7.2 Propriétés algébriques
Les propriétés fondamentales du déterminant (linéarité par rapport aux colonnes, effet des opérations élémentaires, déterminant d’un produit) sont démontrées.
7.3 Formule de Laplace
Le développement de Laplace selon une ligne ou une colonne est présenté comme une méthode de calcul du déterminant.
7.4 Applications géométriques
L’interprétation géométrique du déterminant comme une mesure de l’aire (en 2D) ou du volume (en 3D) est soulignée.
CHAPITRE 8 : SYSTÈMES LINÉAIRES
Ce chapitre applique l’algèbre linéaire à la résolution systématique des systèmes d’équations.
8.1 Méthodes de résolution
La méthode du pivot de Gauss est systématisée comme l’algorithme le plus efficace pour résoudre n’importe quel système d’équations linéaires.
8.2 Théorème de Rouché-Frobenius
Ce théorème fondamental établit les conditions d’existence et le nombre de solutions d’un système linéaire en comparant le rang de la matrice du système et celui de la matrice augmentée.
8.3 Résolution paramétrique
La résolution de systèmes dépendant de paramètres est étudiée, en discutant l’ensemble des solutions en fonction des valeurs de ces paramètres.
8.4 Interprétation géométrique
L’interprétation géométrique de la solution d’un système comme l’intersection de droites (en 2D) ou de plans (en 3D) est approfondie, avec des applications en ingénierie structurale, par exemple pour analyser les forces dans un treillis du pont Maréchal à Matadi.
TROISIÈME PARTIE : THÉORIE DES NOMBRES AVANCÉE
Cette partie explore les propriétés avancées des entiers et des nombres premiers, incluant les concepts de congruences, théorème de Fermat, et applications modulaires. 🔢
CHAPITRE 9 : ARITHMÉTIQUE DES CONGRUENCES
Ce chapitre développe l’arithmétique modulaire, un outil essentiel en théorie des nombres et en cryptographie.
9.1 Relations de congruence
La relation de congruence modulo n est définie et ses propriétés de compatibilité avec l’addition et la multiplication sont établies.
9.2 Anneau Z/nZ
La structure d’anneau de l’ensemble des classes de résidus modulo n est étudiée. La condition pour que soit un corps (n premier) est démontrée.
9.3 Théorème de Fermat—Euler
Le petit théorème de Fermat et sa généralisation, le théorème d’Euler, sont démontrés et appliqués à des problèmes de calcul de puissances en arithmétique modulaire.
9.4 Cryptographie élémentaire
Le système de chiffrement RSA est présenté comme une application directe du théorème d’Euler, montrant comment la théorie des nombres est à la base de la sécurité des communications modernes, y compris les transactions bancaires à travers la RDC.
CHAPITRE 10 : NOMBRES PREMIERS ET FACTORISATION
Ce chapitre se concentre sur les briques fondamentales de l’arithmétique, les nombres premiers.
10.1 Infinité des nombres premiers
La démonstration classique d’Euclide sur l’infinité des nombres premiers est présentée et analysée.
10.2 Crible d’Ératosthène
Le crible d’Ératosthène est étudié comme un algorithme ancien mais efficace pour trouver tous les nombres premiers jusqu’à une certaine limite.
10.3 Test de primalité
La différence entre les tests de primalité déterministes et probabilistes est discutée. Le test de primalité de Fermat est présenté comme un exemple de test probabiliste.
10.4 Factorisation en nombres premiers
Le théorème fondamental de l’arithmétique (factorisation unique) est rappelé. La difficulté calculatoire de la factorisation de grands nombres est soulignée comme étant la clé de la sécurité du système RSA.
CHAPITRE 11 : FONCTIONS ARITHMÉTIQUES
Ce chapitre introduit des fonctions définies sur les entiers qui encodent des propriétés arithmétiques.
11.1 Fonction φ d’Euler
La fonction indicatrice d’Euler, , qui compte les entiers premiers avec n et inférieurs à n, est définie et ses propriétés sont étudiées.
11.2 Fonction multiplicative
Une fonction arithmétique est dite multiplicative si pour m et n premiers entre eux. De nombreuses fonctions importantes (comme ) ont cette propriété.
11.3 Sommes diviseurs
Des fonctions comme le nombre de diviseurs et la somme des diviseurs sont étudiées.
11.4 Formules de convolution
Le produit de convolution de Dirichlet est introduit comme une opération sur les fonctions arithmétiques, dotant leur ensemble d’une structure algébrique riche.
CHAPITRE 12 : ÉQUATIONS DIOPHANTIENNES
Ce chapitre est consacré à la résolution d’équations polynomiales où les solutions recherchées sont des entiers.
12.1 Équations linéaires
La condition d’existence et la méthode de résolution complète des équations diophantiennes linéaires sont établies en utilisant l’algorithme d’Euclide.
12.2 Méthode de descente infinie
Cette méthode de démonstration par l’absurde, développée par Fermat, est présentée et appliquée pour montrer l’absence de solutions entières à certaines équations.
12.3 Équations quadratiques modulo n
L’étude des résidus quadratiques et le symbole de Legendre sont introduits comme des outils pour étudier les équations du second degré dans .
12.4 Applications cryptographiques
Des liens sont établis entre la difficulté de résoudre certaines équations diophantiennes (comme le problème du logarithme discret) et la sécurité de certains protocoles cryptographiques.
QUATRIÈME PARTIE : ANALYSE COMPLÈTE ET SÉRIES
Cette partie couvre l’étude des fonctions de variable réelle et complexe, séries de Fourier, et intégrales impropres, renforçant les compétences en analyse fonctionnelle. 📈
CHAPITRE 13 : FONCTIONS DE VARIABLE RÉELLE
Ce chapitre approfondit l’étude des propriétés topologiques et analytiques des fonctions réelles.
13.1 Continuité et dérivabilité
Les définitions formelles (avec et ) de la continuité et de la dérivabilité sont maîtrisées.
13.2 Théorème des valeurs intermédiaires
Ce théorème fondamental, ainsi que le théorème des bornes atteintes pour les fonctions continues sur un intervalle fermé borné, sont démontrés et appliqués.
13.3 Lieux d’oscillation
L’étude de la convergence uniforme des suites et séries de fonctions est introduite.
13.4 Intégrales impropres
L’intégration est étendue à des intervalles non bornés ou à des fonctions non bornées. Les critères de convergence pour les intégrales impropres sont étudiés.
CHAPITRE 14 : SÉRIES ET TRANSFORMÉE DE FOURIER
Ce chapitre introduit un outil d’analyse fondamental pour l’étude des phénomènes périodiques.
14.1 Séries de Taylor et de Fourier
Les séries de Taylor permettent d’approximer une fonction par un polynôme. Les séries de Fourier permettent de décomposer une fonction périodique en une somme de sinus et de cosinus.
14.2 Convergence et régularité
Les conditions de convergence d’une série de Fourier (théorème de Dirichlet) sont étudiées en lien avec la régularité de la fonction.
14.3 Transformée de Fourier
La transformée de Fourier est présentée comme la généralisation de la décomposition de Fourier aux fonctions non périodiques.
14.4 Applications aux équations aux dérivées partielles
Les séries de Fourier sont un outil essentiel pour résoudre des équations fondamentales de la physique, comme l’équation de la chaleur ou l’équation d’onde, avec des applications en sismologie pour analyser les ondes sismiques dans la région du Graben.
ANNEXES
Annexe I : Formulaire d’algèbre abstraite 📖
Cette annexe résume les définitions axiomatiques des structures de groupe, d’anneau et de corps, ainsi que les principaux théorèmes (Lagrange, isomorphisme) pour une référence rapide.
Annexe II : Tableaux de propriétés modulaires 🔢
Des tables récapitulant les propriétés de l’anneau et les valeurs de la fonction d’Euler pour les petites valeurs de n sont fournies.
Annexe III : Tables des séries et transformées 📊
Un formulaire présente les développements en série de Taylor des fonctions usuelles et les transformées de Fourier de signaux de base.


