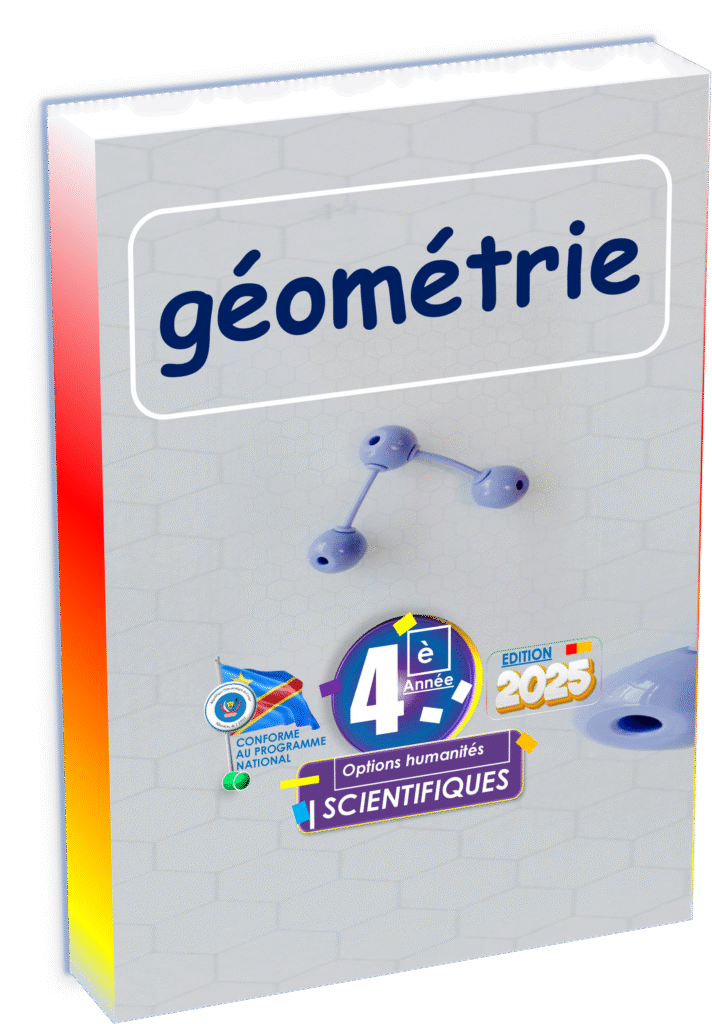
COURS DE GÉOMÉTRIE, 4ÈME ANNÉE DES HUMANITÉS SCIENTIFIQUES
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
PRÉLIMINAIRES
I. Présentation du cours
Ce cours de Géométrie constitue une exploration rigoureuse des structures de l’espace, depuis les fondements axiomatiques jusqu’aux applications en géométrie différentielle et projective. Il a pour vocation de transcender l’approche intuitive des formes pour la remplacer par une maîtrise analytique et algébrique, offrant aux élèves une compréhension profonde des concepts qui sous-tendent la physique moderne, l’ingénierie et l’informatique graphique.
II. Objectifs généraux
L’objectif fondamental est de développer une double compétence : la capacité de raisonnement abstrait au sein de structures algébriques comme les espaces vectoriels, et l’aptitude à appliquer ces structures pour résoudre des problèmes concrets dans des contextes euclidiens et non-euclidiens. Les élèves apprendront à manipuler les transformations, à analyser les propriétés des courbes et surfaces et à unifier différentes perspectives géométriques.
III. Compétences visées
À l’issue de cette formation, l’élève sera capable d’analyser et de résoudre des problèmes géométriques complexes en utilisant des outils algébriques, de caractériser des objets géométriques par leurs invariants et de modéliser des phénomènes spatiaux. La compétence ultime est une aisance dans la navigation entre les formalismes abstraits et leurs interprétations géométriques concrètes.
IV. Méthode d’évaluation
L’évaluation sera axée sur la démonstration de la compréhension théorique et la capacité de résolution de problèmes. Elle comportera des exercices de démonstration axiomatique, la résolution de problèmes analytiques complexes, l’étude de transformations géométriques et la réalisation de projets de modélisation, assurant une validation complète des aptitudes de raisonnement et d’application.
V. Matériel requis
Une maîtrise approfondie du cours exige des instruments de traçage de précision pour la visualisation, une calculatrice scientifique performante, ainsi qu’un accès à des logiciels de calcul formel et de géométrie dynamique. Ces outils numériques sont essentiels pour explorer les concepts avancés et visualiser les objets géométriques en trois dimensions.
PREMIÈRE PARTIE : ESPACES ET TRANSFORMATIONS LINÉAIRES 空間
Cette partie établit les fondations algébriques de la géométrie moderne. Elle délaisse l’approche purement visuelle pour introduire les espaces vectoriels comme le cadre universel de la linéarité. L’étude des opérateurs, des formes bilinéaires et une introduction aux espaces de dimension infinie fournissent un langage puissant et abstrait pour décrire les transformations et les structures géométriques de manière unifiée.
CHAPITRE 1 : ESPACES VECTORIELS
1.1 Bases et dimension
Ce chapitre formalise la notion d’espace vectoriel comme un ensemble muni d’opérations d’addition et de multiplication par un scalaire. Les concepts de base et de dimension sont introduits comme des outils fondamentaux pour caractériser la « taille » d’un espace et pour y établir un système de coordonnées.
1.2 Sous-espaces et sommes directes
L’étude de la structure interne des espaces vectoriels est approfondie à travers la notion de sous-espace vectoriel. Le concept de somme directe de sous-espaces est présenté comme une méthode pour décomposer un espace complexe en composantes plus simples, une technique essentielle en algèbre linéaire et dans ses applications.
1.3 Espaces duals
Le concept d’espace dual, l’espace des formes linéaires, est introduit. Cette approche offre une perspective complémentaire pour analyser les espaces vectoriels et constitue une notion fondamentale en géométrie différentielle et en physique théorique, notamment en mécanique analytique.
1.4 Espaces topologiques
Une introduction aux espaces vectoriels topologiques est proposée, ajoutant une notion de « proximité » ou de « convergence » à la structure algébrique. Ce concept est indispensable pour étendre l’analyse aux espaces de dimension infinie, comme les espaces de fonctions.
CHAPITRE 2 : OPÉRATEURS LINÉAIRES
2.1 Endomorphismes et matrices
Les applications linéaires, ou endomorphismes, sont étudiées comme les transformations qui préservent la structure d’un espace vectoriel. Leur représentation par des matrices, une fois une base choisie, est systématisée comme un outil de calcul puissant pour analyser les rotations, projections et autres transformations.
2.2 Noyau, image et rang
Les sous-espaces fondamentaux associés à un opérateur linéaire, le noyau et l’image, sont définis. Le théorème du rang, qui relie leurs dimensions, est démontré comme un résultat central de l’algèbre linéaire, permettant de classifier et de comprendre la nature de ces transformations.
2.3 Polynômes minimal et caractéristique
L’étude spectrale des endomorphismes débute avec l’introduction du polynôme caractéristique, dont les racines sont les valeurs propres de l’opérateur. Le polynôme minimal est également défini comme un outil plus fin pour analyser la structure de la transformation.
2.4 Décomposition de Jordan
La décomposition de Jordan est présentée comme une forme canonique pour les matrices qui ne sont pas diagonalisables. Elle offre une description quasi-diagonale d’un endomorphisme, ce qui est crucial pour la résolution de systèmes d’équations différentielles linéaires.
CHAPITRE 3 : FORMES BILINÉAIRES
3.1 Formes symétriques et alternées
Les formes bilinéaires sont introduites comme des applications qui prennent deux vecteurs et retournent un scalaire, de manière linéaire en chaque argument. Les cas particuliers des formes symétriques et antisymétriques (ou alternées) sont distingués, en lien avec les notions de produit scalaire et de produit vectoriel.
3.2 Invariants de Sylvester
La loi d’inertie de Sylvester est étudiée pour la classification des formes quadratiques réelles. La signature de la forme (le triplet des nombres de valeurs propres positives, négatives et nulles) est présentée comme un invariant fondamental sous les changements de base.
3.3 Diagonalisation orthogonale
Le théorème spectral est introduit dans le contexte des espaces euclidiens. Il garantit que tout endomorphisme symétrique peut être diagonalisé dans une base orthonormée, une propriété aux conséquences profondes en mécanique et en statistique.
3.4 Produits scalaires et normes
Le concept de produit scalaire est formalisé comme une forme bilinéaire symétrique définie positive. Il permet de définir les notions géométriques de norme (longueur) d’un vecteur et d’orthogonalité, généralisant ainsi la géométrie euclidienne à des espaces abstraits.
CHAPITRE 4 : ESPACES DE HILBERT
4.1 Convergence et complétude
Ce chapitre offre une introduction aux espaces de Hilbert, qui sont des espaces vectoriels munis d’un produit scalaire et qui sont complets (toute suite de Cauchy y converge). Cette propriété de complétude est essentielle pour l’analyse fonctionnelle.
4.2 Séries de Fourier
Les séries de Fourier sont présentées comme une application fondamentale de la théorie des espaces de Hilbert. Tout signal périodique ou fonction peut être décomposé en une somme de fonctions sinusoïdales orthogonales, une technique au cœur du traitement du signal et des télécommunications.
4.3 Opérateurs compacts
La notion d’opérateur compact est introduite comme une classe d’opérateurs linéaires sur les espaces de Hilbert dont les propriétés sont très proches de celles des matrices en dimension finie. Ils jouent un rôle clé dans la théorie des équations intégrales.
4.4 Théorème spectral
Le théorème spectral est généralisé aux opérateurs auto-adjoints compacts sur un espace de Hilbert. Ce résultat puissant est une pierre angulaire de la mécanique quantique, où les observables physiques sont représentées par de tels opérateurs.
DEUXIÈME PARTIE : GÉOMÉTRIE EUCLIDIENNE ET AFFINE 🌐
Cette section applique les outils de l’algèbre linéaire à l’étude des géométries plus familières. La géométrie affine se concentre sur les propriétés préservées par les transformations qui conservent le parallélisme, tandis que la géométrie euclidienne y ajoute les notions de distance et d’angle. Ces concepts sont fondamentaux pour l’ingénierie, l’architecture et la conception mécanique, par exemple dans la planification des infrastructures à travers la RDC.
CHAPITRE 5 : GÉOMÉTRIE AFFINE
5.1 Homothéties et translations
Les transformations affines fondamentales sont étudiées. Les translations sont définies comme des déplacements de tous les points dans une même direction, tandis que les homothéties correspondent à des agrandissements ou des réductions par rapport à un centre fixe.
5.2 Droites et plans affines
La définition formelle des droites et des plans comme des sous-espaces affines est donnée. Leurs représentations paramétriques et cartésiennes sont étudiées, ainsi que les notions de parallélisme et d’intersection.
5.3 Coordonnées barycentriques
Les coordonnées barycentriques sont introduites comme une méthode pour repérer un point en fonction de sa position relative par rapport aux sommets d’un simplexe (triangle en 2D, tétraèdre en 3D). Cet outil est très utilisé en géométrie algorithmique et en infographie.
5.4 Courbes et surfaces affines
L’étude s’étend aux objets courbes dans un cadre affine. Les propriétés invariantes par transformation affine, comme les points d’inflexion d’une courbe ou la nature d’une quadrique, sont analysées.
CHAPITRE 6 : GÉOMÉTRIE EUCLIDIENNE
6.1 Distance et angle
Forts de la structure du produit scalaire, les concepts de distance entre deux points et d’angle entre deux vecteurs ou deux droites sont rigoureusement définis. Les formules de calcul dans un repère orthonormé sont établies.
6.2 Cercles et sphères
Le cercle et la sphère sont étudiés comme les ensembles de points équidistants d’un centre. Leurs équations cartésiennes et leurs propriétés fondamentales (tangentes, intersections) sont explorées en détail.
6.3 Cercles inscrits et circonscrits
L’étude des triangles est enrichie par la construction des cercles inscrits (tangents aux trois côtés) et circonscrits (passant par les trois sommets). Les propriétés des centres de ces cercles (centre du cercle inscrit, centre du cercle circonscrit) sont démontrées.
6.4 Applications métriques
Des relations métriques classiques dans les triangles, comme le théorème de Pythagore généralisé (loi des cosinus) et la loi des sinus, sont démontrées et appliquées à la résolution de problèmes de triangulation, une technique de base en topographie pour cartographier des régions comme le Kasaï.
CHAPITRE 7 : ISOMÉTRIES ET ORTHOGONALITÉ
7.1 Rotations et réflexions
Les isométries, transformations qui conservent les distances, sont classifiées. Les rotations (autour d’un point ou d’un axe) et les réflexions (par rapport à une droite ou un plan) sont analysées en détail, ainsi que leurs compositions.
7.2 Similitudes
Les similitudes sont introduites comme des transformations qui multiplient toutes les distances par un même facteur. Elles conservent les angles et les formes, et sont une généralisation des isométries.
7.3 Matrices orthogonales
La représentation matricielle des isométries vectorielles est étudiée. Il est démontré que ces transformations correspondent aux matrices orthogonales (dont l’inverse est égal à la transposée), qui jouent un rôle central en mécanique du solide.
7.4 Groupes d’isométrie
La structure de groupe des ensembles d’isométries est explorée. L’étude des groupes de symétrie d’une figure géométrique permet de classifier les objets en fonction de leurs propriétés d’invariance, une approche fondamentale en cristallographie.
CHAPITRE 8 : GÉOMÉTRIE DES DROITES ET PLANS
8.1 Positions relatives
Ce chapitre systématise l’étude des positions relatives des droites et des plans dans l’espace à trois dimensions : parallélisme, intersection, et droites gauches (non coplanaires). Les conditions analytiques correspondantes sont établies.
8.2 Distances et angles
Des formules sont développées pour calculer les distances (point à plan, point à droite, entre deux droites gauches) et les angles (entre deux droites, entre deux plans, entre une droite et un plan). Ces calculs sont essentiels pour les applications en ingénierie civile, par exemple pour la conception du Pont Maréchal à Matadi.
8.3 Projection orthogonale
La projection orthogonale d’un point, d’une droite ou d’une figure sur une droite ou un plan est définie et étudiée. C’est le fondement du dessin technique et de nombreuses méthodes d’optimisation (comme la méthode des moindres carrés).
8.4 Sections de solides
La détermination de la nature de la section d’un solide géométrique (cube, cylindre, cône) par un plan est abordée. Cette compétence est importante en stéréotomie et pour la visualisation d’objets tridimensionnels.
TROISIÈME PARTIE : GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE ET PROJETIVE 📈
Cette section est consacrée à l’étude des courbes et des surfaces définies par des équations algébriques. Après une analyse détaillée des coniques, le cours offre une introduction aux courbes de degré supérieur. Il culmine avec la géométrie projective, une extension puissante de la géométrie euclidienne qui unifie l’étude des formes en introduisant la notion de points à l’infini.
CHAPITRE 9 : CONIQUES
9.1 Équations générales
L’équation générale du second degré à deux variables est présentée comme l’équation qui définit toutes les coniques (ellipse, parabole, hyperbole). Le lien avec les sections planes d’un cône est établi.
9.2 Classification et invariants
La classification des coniques est réalisée à l’aide des invariants de l’équation (déterminant, trace). Ces quantités permettent de déterminer la nature d’une conique indépendamment du système de coordonnées choisi.
9.3 Réduction par rotations et translations
Une méthode systématique de réduction de l’équation générale est développée. Par une rotation et une translation appropriées du repère, toute équation de conique peut être ramenée à sa forme canonique (ou réduite), ce qui simplifie grandement son analyse.
9.4 Applications géométriques
Les propriétés géométriques remarquables des coniques sont étudiées, notamment les foyers, les directrices et les propriétés de réflexion (utilisées dans les antennes paraboliques ou les télescopes). Leurs applications en physique, notamment en mécanique céleste pour décrire les orbites planétaires, sont soulignées.
CHAPITRE 10 : CUBIQUES ET QUARTIQUES
10.1 Familles de cubiques
Ce chapitre offre une incursion dans le monde des courbes algébriques de degré trois, ou cubiques. La richesse et la diversité de leurs formes, bien plus grandes que celles des coniques, sont illustrées à travers l’étude de familles de courbes spécifiques.
10.2 Points singuliers
Contrairement aux coniques, les cubiques peuvent posséder des points singuliers (points de rebroussement, points doubles). Les méthodes analytiques pour détecter et classifier ces singularités sont présentées.
10.3 Transformations birationnelles
Le concept de transformation birationnelle est introduit comme un outil puissant pour simplifier l’étude des courbes algébriques complexes en les mettant en correspondance avec des courbes plus simples.
10.4 Exemples particuliers
Des exemples célèbres de cubiques et quartiques, comme le Folium de Descartes, la Cissoïde de Dioclès ou les Lemniscates de Bernoulli, sont étudiés pour leurs propriétés historiques et géométriques particulières.
CHAPITRE 11 : GÉOMÉTRIE PROJETIVE
11.1 Plans et droites à l’infini
La géométrie projective est introduite en complétant le plan affine par une « droite à l’infini », sur laquelle les droites parallèles se coupent. Cette construction élégante permet de traiter de manière unifiée des cas auparavant distincts.
11.2 Transformations projectives
Les transformations projectives (ou homographies) sont définies comme les transformations qui conservent l’alignement. Elles généralisent les transformations affines et sont fondamentales en vision par ordinateur et en infographie pour modéliser la perspective.
11.3 Harmonie et birapports
Le birapport de quatre points alignés est présenté comme l’invariant fondamental de la géométrie projective. La notion de division harmonique, un cas particulier où le birapport vaut -1, est étudiée pour ses nombreuses propriétés géométriques.
11.4 Dualité projective
Le principe de dualité est un concept central de la géométrie projective. Il énonce que tout théorème du plan projectif reste vrai si l’on échange les mots « point » et « droite », offrant une symétrie remarquable à la théorie.
CHAPITRE 12 : AUTOMORPHISMES PROJETIFS
12.1 Groupes de Möbius
Les transformations de Möbius sont étudiées comme les automorphismes de la droite projective complexe. Leurs liens profonds avec l’analyse complexe et la géométrie hyperbolique sont esquissés.
12.2 Réseaux et pavages
L’action des groupes de transformations sur le plan est utilisée pour étudier les réseaux et les pavages périodiques. Cette approche par la théorie des groupes permet une classification systématique des symétries possibles.
12.3 Applications complexes
Les outils de l’analyse complexe sont appliqués à la résolution de problèmes géométriques, illustrant la puissance des méthodes qui mêlent algèbre, géométrie et analyse.
12.4 Géométrie de Riemann
Une brève introduction à la sphère de Riemann est proposée comme modèle de la géométrie projective complexe et comme un premier exemple de variété, ouvrant la voie à la géométrie différentielle.
QUATRIÈME PARTIE : GÉOMÉTRIE DIFFÉRENTIELLE 🌀
Cette partie finale introduit l’utilisation des outils du calcul différentiel pour étudier les propriétés géométriques des courbes et des surfaces. Elle se concentre sur les propriétés locales (intrinsèques) qui ne dépendent pas de la manière dont l’objet est plongé dans l’espace ambiant. Ces concepts sont au cœur de la physique moderne, notamment la relativité générale, et de la modélisation de formes en ingénierie.
CHAPITRE 13 : COURBES DIFFÉRENTIABLES
13.1 Paramétrisation et régularité
La notion de courbe paramétrée est définie, ainsi que les conditions de régularité qui assurent que la courbe est « lisse ». Le vecteur tangent et la longueur d’un arc de courbe sont définis à l’aide du calcul différentiel.
13.2 Courbure et torsion
Deux quantités fondamentales qui décrivent localement la géométrie d’une courbe dans l’espace sont introduites. La courbure mesure la tendance de la courbe à s’écarter de sa tangente, tandis que la torsion mesure sa tendance à quitter son plan osculateur.
13.3 Éléments de Frenet
Le repère mobile de Frenet (tangent, normal, binormal) est construit en chaque point d’une courbe régulière. Les équations de Frenet-Serret sont établies comme un système d’équations différentielles qui relie la variation de ce repère à la courbure et à la torsion.
13.4 Applications mécaniques
Les concepts de la géométrie différentielle des courbes trouvent des applications directes en cinématique. Le vecteur tangent est lié à la vitesse, et le vecteur accélération peut être décomposé en ses composantes tangentielle et normale, liées à la variation de la vitesse et à la courbure de la trajectoire.
CHAPITRE 14 : SURFACES DIFFÉRENTIABLES
14.1 Paramétrisation locale
La notion de surface paramétrée (ou nappe) est introduite comme une généralisation des courbes. Le plan tangent en un point est défini comme la meilleure approximation linéaire de la surface au voisinage de ce point.
14.2 Formes fondamentales
La première forme fondamentale est définie comme une forme quadratique qui permet de mesurer les longueurs, les angles et les aires sur la surface elle-même (géométrie intrinsèque). La seconde forme fondamentale décrit la manière dont la surface est courbée dans l’espace ambiant.
14.3 Courbure de Gauss et moyenne
À partir des deux formes fondamentales, les courbures principales, la courbure de Gauss et la courbure moyenne sont définies. Le Theorema Egregium de Gauss, qui énonce que la courbure de Gauss est une propriété intrinsèque, est présenté comme un résultat majeur de la géométrie.
14.4 Géodésiques et applications
Une géodésique est une courbe tracée sur une surface qui généralise la notion de « ligne droite ». C’est localement le chemin le plus court entre deux points. Ce concept est fondamental en cartographie et en relativité générale, où les corps suivent les géodésiques de l’espace-temps.
ANNEXES
I. Formulaire de géométrie linéaire et analytique
Cette annexe rassemble de manière synthétique les formules et les théorèmes clés de l’algèbre linéaire, de la géométrie affine et de la géométrie euclidienne abordés dans le cours. Elle constitue un aide-mémoire pratique pour la résolution d’exercices.
II. Tables de courbure et éléments de Frenet
Des exemples de calculs détaillés des éléments de Frenet (repère, courbure, torsion) pour plusieurs courbes classiques (hélice circulaire, etc.) sont fournis. Ces tables servent de référence pour les applications pratiques et les exercices.
III. Glossaire des transformations projectives
Ce glossaire définit de manière précise les termes spécifiques à la géométrie projective (birapport, division harmonique, homographie, dualité). Il facilite la lecture et la compréhension des chapitres consacrés à cette géométrie non-euclidienne.


