
…
TOUS LES MANUELS :
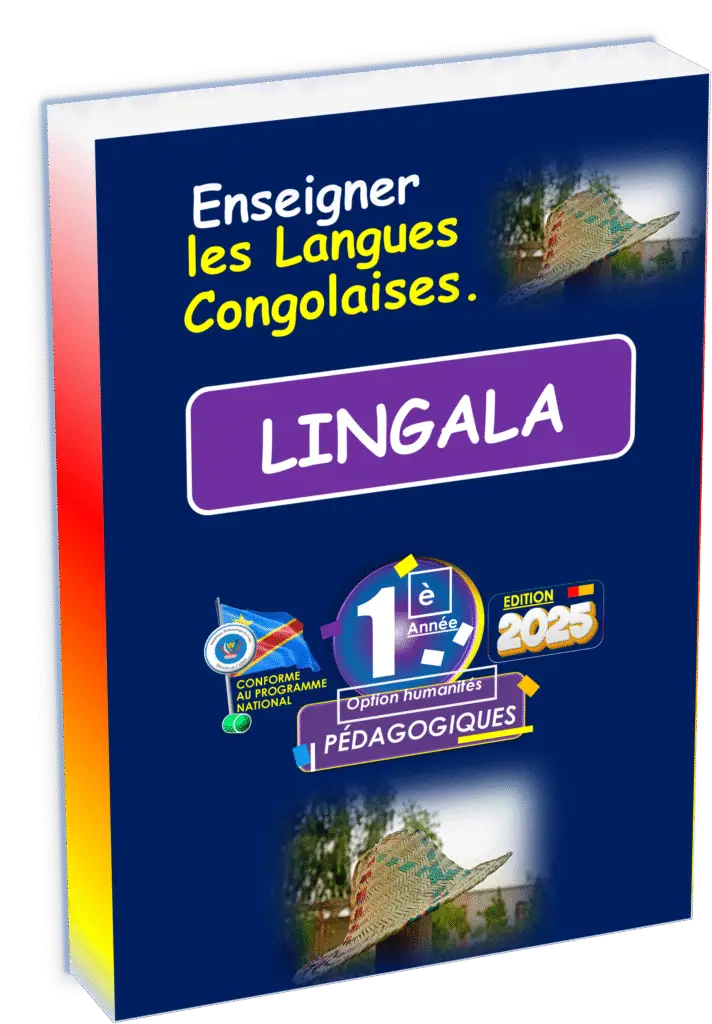
ENSEIGNEMENT DU LINGALA, 1ÈRE ANNÉE, OPTION HUMANITÉS PÉDAGOGIQUES
Édition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC
Préliminaires
Ce module introductif établit les fondations normatives, pédagogiques et méthodologiques du cours. Il dote le futur enseignant des cadres de référence essentiels pour une mise en œuvre rigoureuse et efficace du programme de lingala en première année des humanités pédagogiques.
1. Cadre institutionnel et alignement curriculaire 🏛️
Cette section détaille l’ancrage du programme dans les textes légaux régissant l’enseignement en République Démocratique du Congo. L’analyse porte sur la conformité du curriculum avec les finalités de l’éducation nationale, en assurant que chaque objectif d’apprentissage contribue à la formation d’un citoyen compétent et culturellement ancré. L’alignement avec le Programme du Domaine d’Apprentissage des Langues (PDAL) est ici explicité pour garantir une cohérence verticale et horizontale avec les autres disciplines.
2. Objectifs pédagogiques et compétences visées 🎯
Sont définis ici les profils de sortie de l’élève au terme de la première année. Les compétences visées sont déclinées en savoirs (connaissances linguistiques), savoir-faire (capacités de communication orale et écrite) et savoir-être (attitudes culturelles). L’objectif terminal est de permettre à l’élève de manipuler les structures de base du lingala dans des situations de communication simples et concrètes. Lengo ya moboko eza ete, na suka ya mobu, moyekoli akoka kosalela maloba mpe mibeko ya lingala na ndenge ya peto mpo na kosolola na bato.
3. Approche bilingue et APS en 1ʳᵉ année ↔️
La méthodologie préconisée est l’Approche Pédagogique par les Situations (APS) dans un contexte bilingue lingala-français. Ce point expose comment l’enseignement s’articule autour de situations-problèmes authentiques, tirées du quotidien de l’élève à Kinshasa, à Kikwit ou à Gemena. Le recours stratégique au français sert de levier pour la conceptualisation des règles grammaticales, tandis que le lingala reste la langue cible de communication et d’apprentissage actif.
4. Ressources didactiques et modalités d’évaluation 📚
Un inventaire critique des ressources pédagogiques est proposé, incluant les manuels agréés, les guides du maître, et les supports audiovisuels pertinents. Les modalités d’évaluation sont également précisées : l’accent est mis sur une évaluation formative continue (observations, interrogations orales, exercices structuraux) et des évaluations sommatives (tests écrits, mises en situation) conçues pour mesurer l’acquisition réelle des compétences communicatives.
Chapitre 1 : Système phonologique de base
Ce chapitre constitue le socle de l’apprentissage en se concentrant sur les unités sonores fondamentales du lingala. La maîtrise de la prononciation correcte des phonèmes et de l’intonation est l’objectif premier pour assurer une communication orale intelligible.
1.1 Inventaire des voyelles et consonnes 🗣️
L’étude systématique des sept voyelles (a, e, ɛ, i, o, ɔ, u) et des consonnes du lingala est entreprise. Des exercices de discrimination auditive et de production articulatoire sont proposés, en utilisant des paires minimales pour distinguer des sons proches. Ndakisa, bososoli bokeseni kati na « kolo » (maître) na « kolɔ » (ramasser) to kati na « libele » (sein) na « libɛlɛ » (toujours). L’analyse s’appuie sur des exemples tirés de la diversité lexicale des différentes provinces congolaises.
1.2 Tonalité et accentuation 🎶
Cette section aborde le rôle crucial des tons (haut, bas) dans la distinction sémantique en lingala. Des exemples concrets illustrent comment un changement de ton modifie le sens d’un mot. Tala ndakisa oyo: « mutu » (tête) na ton bas, kasi « mutú » (personne) na ton haut na voyelle ya suka. Yango wana, kotia mongongo malamu ezali na ntina monene. L’accentuation de base, généralement portée sur l’avant-dernière syllabe, est également expliquée et pratiquée.
1.3 Variations régionales de prononciation 🗺️
Une sensibilisation aux principales variantes phonétiques régionales est effectuée. L’objectif est de développer une compréhension passive des accents de différentes régions (par exemple, la prononciation de la lettre ‘r’ à Kinshasa par rapport à l’Équateur) sans pour autant enseigner activement ces variantes, afin de maintenir une norme pédagogique commune.
1.4 Normes orthographiques élémentaires ✍️
Ce point établit la correspondance entre les phonèmes étudiés et leur graphie. Les règles de base de l’orthographe du lingala standard sont enseignées, notamment la transcription des sons spécifiques comme /mb/, /nd/, /ng/, /nz/. Des dictées de mots et de phrases courtes permettent de consolider ces acquis. Moyekoli asengeli koyeba kokoma maloba lokola « mboka », « ndeko », « nganda » na « nzala » kozanga kobunga.
Chapitre 2 : Morphologie élémentaire
Ce chapitre explore la structure interne des mots en lingala. L’élève apprend à identifier et à manipuler les morphèmes (préfixes, radicaux, suffixes) qui constituent les unités de sens, en se concentrant sur le système des classes nominales, un pilier de la grammaire bantoue.
2.1 Classes nominales et accords simples 🧩
L’introduction au système des classes nominales (1 à 14) est centrale. L’élève apprend à identifier la classe d’un nom à partir de son préfixe et à réaliser les accords simples avec les adjectifs qualificatifs. Ndakisa: « mwasi molai » (cl. 1), « basi balai » (cl. 2), « eloko monene » (cl. 7), « biloko minene » (cl. 8). Liteya likotalisa ndenge nini préfixe ya kombo ebongolaka mpe préfixe ya elobeli.
2.2 Formation du pluriel ➕
La formation du pluriel est présentée comme une application directe du système de classes, en se basant sur l’appariement des classes singulier/pluriel (par ex., 1/2, 3/4, 5/6, 7/8). Des exercices systématiques de transformation du singulier au pluriel et vice-versa sont réalisés avec un vocabulaire varié.
2.3 Pronoms personnels et possessifs 👤
L’étude porte sur les formes des pronoms personnels sujets (ngai, yo, ye, biso, bino, bango) et leur intégration dans la conjugaison, ainsi que sur les pronoms possessifs et la manière de les accorder avec le nom possédé. Mpo na kolakisa bomoko, tokoyekola kosalela: « buku na ngai » (mon livre), « ndako na bango » (leur maison).
2.4 Dérivation lexicale basique 🔄
Les mécanismes simples de formation de nouveaux mots sont introduits. L’élève découvre comment, à partir d’un radical verbal, on peut dériver des noms d’agent, des noms d’action ou des adjectifs en utilisant des suffixes spécifiques. Ndakisa: radical « -ling- » (aimer) ekoki kopesa « bolingo » (amour, cl. 14) to « molingi » (amant, cl. 1).
Chapitre 3 : Verbe et conjugaison de base
Ce chapitre se consacre au cœur de la phrase : le verbe. Les futurs enseignants apprennent les mécanismes fondamentaux de la conjugaison en lingala, leur permettant de situer une action dans le temps et d’exprimer différentes modalités.
3.1 Radical verbal et préfixes de sujet ⚙️
La distinction entre le radical verbal (porteur du sens lexical) et les affixes grammaticaux (préfixes sujet, infixes temporels) est établie. L’élève s’exerce à identifier le radical et à le combiner correctement avec les préfixes personnels étudiés précédemment. Na verbe « kosala » (faire), radical ezali « -sal-« . Mpo na kokanga yango, esengeli kobakisa préfixe ya moto: « na-sal-i » (j’ai fait).
3.2 Temps fondamentaux : présent, passé, futur ⏳
La conjugaison aux trois temps de base est enseignée : le présent d’habitude (-aka), le passé simple/récent (-aki ou flexion tonale) et le futur (-ko-). La formation de chaque temps est expliquée à travers des tableaux de conjugaison et mise en pratique dans des phrases contextuelles, évoquant des situations à Matadi ou à Kananga.
3.3 Formes négatives et interrogatives ❓
L’élève apprend à construire des phrases négatives, principalement avec le préfixe te-…-te, et des phrases interrogatives (questions fermées avec intonation montante, questions ouvertes avec des mots interrogatifs comme nani, nini, wapi). Mpo na kotuna, ekoki kozala: « Okei wapi? » (Où vas-tu?). Mpo na kowangana: « Te, nakei te. » (Non, je ne pars pas).
3.4 Introduction aux verbes irréguliers ⚠️
Une initiation aux verbes les plus courants présentant des irrégularités est proposée, notamment le verbe « kozala » (être) et « kokende » (aller). Leurs formes spécifiques aux différents temps sont mémorisées et utilisées dans des exercices de substitution.
Chapitre 4 : Syntaxe de la phrase simple
Ce chapitre vise à donner à l’élève la capacité de construire des phrases grammaticalement correctes et sémantiquement claires. L’accent est mis sur l’organisation des constituants de la phrase de base.
4.1 Ordre des mots SVO ➡️
La structure canonique de la phrase déclarative en lingala, Sujet-Verbe-Objet (SVO), est présentée et consolidée. Des exercices de réorganisation de mots et de construction de phrases à partir d’éléments donnés permettent de mécaniser cet ordre. Ndakisa: « Mama azali kolamba pondu. » (Maman prépare les feuilles de manioc). Ebongwani te: « Kolamba mama pondu azali. »
4.2 Coordination élémentaire 🔗
L’utilisation des conjonctions de coordination de base comme na (et), kasi (mais), to (ou) est enseignée pour relier des mots ou des propositions de même nature. L’objectif est de dépasser la phrase simple pour créer des énoncés légèrement plus complexes.
4.3 Introduction à la subordination 🖇️
Une première approche de la subordination est faite à travers l’étude des propositions complétives introduites par ete (que) et des relatives simples introduites par le pronom relatif invariable. Cela permet de construire des phrases enchâssées. Ndakisa: « Nakanisi ete akozonga lobi. » (Je pense qu’il reviendra demain).
4.4 Placement des adverbes 📍
Les règles de positionnement des adverbes de temps, de lieu et de manière sont étudiées. Leur place, généralement après le verbe ou en fin de phrase, est illustrée par de nombreux exemples pour éviter les erreurs de construction.
Chapitre 5 : Vocabulaire fondamental
L’acquisition d’un lexique de base est indispensable à la communication. Ce chapitre organise l’apprentissage du vocabulaire autour de thématiques concrètes et pertinentes pour l’environnement de l’élève.
5.1 Lexique de la vie quotidienne 🏡
Le vocabulaire essentiel lié à la famille (libota), à la maison (ndako), à la nourriture (bilei), aux vêtements (bilamba) et aux activités journalières est enseigné de manière active à travers des dialogues et des descriptions.
5.2 Champs sémantiques liés à l’environnement 🌱
L’apprentissage se focalise sur les termes relatifs à l’environnement naturel (la faune, la flore, le fleuve, la forêt) et à l’environnement urbain (le marché, l’école, la rue). Ce vocabulaire est contextualisé en fonction des réalités géographiques du Congo, de la forêt du bassin du Congo aux savanes du Katanga. Tokoyekola bankombo ya nyama lokola « nkosi », « nzoku », mpe ya banzete lokola « liboyo » to « wenge ».
5.3 Termes culturels de base 🎭
Un lexique de base lié aux pratiques culturelles est introduit : les fêtes, la musique, la danse, les instruments traditionnels (lokole, ngoma), et les concepts sociaux fondamentaux comme le bolingo (amour) et le bondeko (fraternité).
5.4 Emprunts et variations dialectales 🌐
Cette section explore l’origine de certains mots du lingala, notamment les emprunts au français, au portugais ou à d’autres langues congolaises. Une sensibilisation aux variantes lexicales régionales est également proposée (par exemple, « pain » à Kinshasa vs. « mapa » dans d’autres régions).
Chapitre 6 : Compréhension orale initiale
Ce chapitre développe les compétences réceptives orales. L’objectif est d’amener l’élève à comprendre des énoncés simples et courants en lingala, prononcés à un débit normal.
6.1 Stratégies d’écoute active 👂
Des techniques d’écoute sont enseignées : repérage des mots-clés, attention aux indices non verbaux, inférence à partir du contexte. L’élève apprend à se concentrer sur l’essentiel du message pour en saisir le sens global.
6.2 Reconnaissance de phonèmes et mots clés 🔍
Des exercices ciblés de discrimination auditive sont menés pour permettre à l’élève de reconnaître les sons distinctifs du lingala et d’identifier les mots porteurs de sens dans le flux de la parole.
6.3 Compréhension de directives simples 🚶♂️
L’aptitude à comprendre et à exécuter des instructions orales simples, telles que celles données en classe ou dans la vie courante, est développée à travers des jeux et des mises en situation. Molakisi akopesa mitindo: « Fungola buku », « Telema », « Koma na etanda ».
6.4 Exercices de discrimination auditive 🎧
Des activités basées sur l’écoute d’enregistrements (dialogues, annonces, récits courts) permettent de vérifier la compréhension détaillée et de former l’oreille aux différentes intonations et aux rythmes de la langue.
Chapitre 7 : Lecture et décodage
Ce chapitre est dédié à l’acquisition des compétences de base en lecture. L’élève apprend à transformer les signes écrits en sons et en sens, progressant de la syllabe au texte court.
7.1 Techniques de décodage syllabique 📖
Le principe de la lecture syllabique, particulièrement adapté à la structure phonologique du lingala (Consonne-Voyelle), est enseigné. L’élève s’entraîne à fusionner les syllabes pour former des mots.
7.2 Lecture de mots et phrases courtes 📜
Après la maîtrise de la syllabe, la lecture fluide de mots isolés puis de phrases courtes est travaillée. L’accent est mis sur la rapidité du déchiffrage et le respect de l’intonation.
7.3 Identification d’informations explicites 📌
L’élève apprend à repérer des informations spécifiques (qui, quoi, où, quand) dans un texte simple. Cette compétence est la base de la compréhension de l’écrit.
7.4 Compréhension de courts textes narratifs 📄
La lecture et la compréhension de récits très courts, comme des fables ou des anecdotes, sont abordées. L’élève doit être capable de restituer l’idée principale de l’histoire lue. Moyekoli asengeli kotanga lisolo moke mpe kolimbola likanisi ya ntina oyo ezali na kati.
Chapitre 8 : Production orale élémentaire
Ce chapitre vise à développer la capacité de l’élève à s’exprimer oralement en lingala dans des situations de communication structurées et familières.
8.1 Salutations et présentations 👋
Les formules de salutation (mbote, sango nini?) et les structures de base pour se présenter (donner son nom, son âge, son origine) sont enseignées et pratiquées de manière intensive.
8.2 Dialogues guidés 💬
L’élève participe à des dialogues scénarisés portant sur des thèmes de la vie quotidienne (au marché, à l’école). Le canevas fourni le guide dans ses interventions et lui permet de gagner en confiance.
8.3 Formules de politesse 🙏
L’apprentissage des expressions de politesse courantes (palado, mersi, kombola te) est intégré dans toutes les activités de production orale pour développer également le savoir-être.
8.4 Jeux de rôles structurés 🎭
Des jeux de rôles permettent de simuler des situations de communication réelles (par exemple, acheter un produit à la boutique, demander son chemin). L’élève mobilise ses acquis linguistiques de manière ludique et active. Na lisano, moko akozala moteki na wenze ya Gambela, mosusu akozala mosombi. Bakosolola mpo na kosomba biloko.
Chapitre 9 : Production écrite initiale
Ce chapitre initie l’élève à la production d’écrits simples en lingala. L’objectif est de le rendre capable de transcrire des idées simples de manière lisible et grammaticalement acceptable.
9.1 Rédaction de mots et phrases simples 🖋️
Les premiers exercices consistent en la copie de mots, puis en la rédaction de phrases simples à partir d’un modèle ou d’une image. L’accent est mis sur la correction orthographique et la structure SVO.
9.2 Construction de courts paragraphes 📝
L’élève apprend à organiser quelques phrases simples de manière logique pour former un paragraphe cohérent, par exemple pour décrire une personne, un objet ou une activité simple.
9.3 Usage basique de la ponctuation ✒️
L’utilisation des signes de ponctuation fondamentaux (le point, la virgule, le point d’interrogation) est enseignée pour structurer l’écrit et marquer les intonations.
9.4 Correction et auto-révision 🧐
Des stratégies simples d’auto-correction sont introduites. L’élève est encouragé à relire ses productions pour vérifier l’orthographe, les accords et l’ordre des mots, développant ainsi son autonomie.
Chapitre 10 : Culture et traditions
Ce chapitre intègre la dimension culturelle à l’apprentissage de la langue. Le lingala est présenté non seulement comme un outil de communication, mais aussi comme le véhicule d’une vision du monde et d’un patrimoine.
10.1 Proverbes et maximes 🦉
L’étude de quelques proverbes (masese) courants permet de découvrir la sagesse populaire et d’analyser des structures syntaxiques et lexicales riches. Ndakisa: « Mayi ya sika eboyaka mbuma te, » elingi koloba ete esengeli koyamba mayele ya sika.
10.2 Chants et récits oraux 🎤
L’écoute et l’apprentissage de chants traditionnels ou populaires, ainsi que de courts récits issus de la tradition orale, servent de support pour le travail sur le rythme, l’intonation et le vocabulaire culturel.
10.3 Coutumes communautaires 🤝
Une introduction aux principales coutumes et pratiques sociales (le mariage, le deuil, les fêtes) des peuples de l’aire linguistique lingala est proposée, en s’appuyant sur un lexique spécifique.
10.4 Valeurs et éthique locale 💖
Les valeurs fondamentales véhiculées par la langue, telles que le respect des aînés (limemya), la solidarité (boyokani) et l’hospitalité (boyambi), sont explicitées et discutées en classe.
Chapitre 11 : Comparaison Lingala–Français
Ce chapitre exploite le bilinguisme des apprenants comme une ressource. La comparaison explicite entre les deux langues permet de prévenir les interférences et de faciliter les transferts de compétences positifs.
11.1 Structures parallèles de base ⚖️
L’analyse comparée se concentre sur les structures syntaxiques similaires (ex. SVO) pour renforcer la compréhension, tout en soulignant les différences fondamentales (ex. absence de genre en lingala, système des classes).
11.2 Vocabulaire cognat et spécifique 🧬
Le repérage des cognats (mots d’origine commune ou empruntés, comme buku pour livre) est utilisé comme une passerelle lexicale. À l’inverse, les « faux amis » et les concepts spécifiques à chaque langue sont identifiés.
11.3 Transfert lexical initial 🔄
Les stratégies de transfert lexical conscient du français vers le lingala sont abordées, en montrant comment intégrer un mot français dans la structure phonologique et morphologique du lingala.
11.4 Séquences bilingues limitées 🗣️
Des activités contrôlées de commutation de code (code-switching) sont proposées pour analyser comment les locuteurs bilingues utilisent les deux langues dans une même conversation, une réalité sociolinguistique à Kinshasa et dans d’autres grandes villes.
Chapitre 12 : Évaluation formative et feedback
Ce chapitre outille le futur enseignant en techniques d’évaluation au service de l’apprentissage. L’objectif est de savoir diagnostiquer les difficultés des élèves et d’apporter une remédiation efficace.
12.1 Conception de grilles simples 📊
Le futur enseignant apprend à élaborer des grilles d’observation et d’évaluation simples pour mesurer de manière objective les compétences orales et écrites, sur la base de critères clairs et prédéfinis.
12.2 Exercices progressifs ciblés 📈
La conception d’exercices à difficulté croissante est abordée. Ces exercices permettent de vérifier l’acquisition progressive des notions grammaticales, lexicales ou phonologiques.
12.3 Techniques de remédiation rapide 🛠️
Des stratégies pour apporter un feedback correctif immédiat et constructif sont présentées. L’accent est mis sur la correction qui aide l’élève à comprendre son erreur sans le démotiver. Soki moyekoli abungi, molakisi asengeli kolakisa ye libunga na ndenge ya boboto mpe kopesa ye nzela ya komikosola.
12.4 Auto- et co-évaluation 🧑🤝🧑
Des techniques simples pour impliquer les élèves dans leur propre évaluation et dans celle de leurs pairs sont introduites, afin de développer leur autonomie et leur esprit critique.
Chapitre 13 : Projets et ateliers interdisciplinaires
Ce chapitre promeut une approche de l’enseignement du lingala qui décloisonne les disciplines. La langue devient un outil pour explorer d’autres domaines du savoir.
13.1 Intégration avec sciences et histoire 🌍
Des idées de projets sont proposées pour utiliser le lingala dans le cadre du cours de sciences (décrire un animal de la faune locale) ou d’histoire (raconter un bref épisode de l’histoire du Congo).
13.2 Création de panneaux et affiches 🎨
Les élèves sont amenés à réaliser des productions écrites et visuelles en lingala (affiches sur des thèmes de santé, panneaux de vocabulaire illustré) pour une exposition dans l’école.
13.3 Ateliers de chant et de récitation 🎶
L’organisation d’ateliers où les élèves interprètent des chants ou récitent des poèmes en lingala permet de travailler la prononciation, le rythme et l’expression orale de manière engageante.
13.4 Présentations collectives 🧑🏫
Les élèves préparent et réalisent de courtes présentations orales en groupe sur des sujets culturels ou sociaux simples, développant ainsi leurs compétences de communication et de collaboration.
Chapitre 14 : Transition vers la 2ᵉ année
Ce chapitre final a une fonction charnière : il consolide les acquis de la première année et prépare les élèves et l’enseignant aux défis de l’année suivante.
14.1 Bilan des acquis de la 1ʳᵉ année ✅
Un bilan détaillé des compétences linguistiques et culturelles que l’élève doit maîtriser à la fin de la première année est dressé. Il sert de checklist pour l’évaluation finale.
14.2 Objectifs pour l’année suivante 🚀
Les objectifs principaux de la deuxième année sont présentés de manière succincte pour donner une perspective de progression et motiver les élèves.
14.3 Stratégies de consolidation 🧠
Des activités de révision et de consolidation à mener pendant les vacances ou au début de l’année suivante sont suggérées pour éviter la perte des acquis. Mpo na kobosana te, bayekoli bakoki kosolola lingala na mabota na bango to kotanga babuku ya mike na ntango ya konje.
14.4 Plan de suivi bilinguistique 📈
Un plan pour le suivi de l’évolution des compétences bilingues de chaque élève est esquissé, en insistant sur l’importance de maintenir un équilibre entre le développement du lingala et celui du français.
Annexes
Cette section regroupe des outils de référence pratiques destinés à accompagner l’enseignant et l’élève tout au long de l’année.
A. Tableaux de conjugaison de base 📋
Ces tableaux récapitulatifs présentent de manière claire et structurée la conjugaison des verbes modèles et des principaux verbes irréguliers aux temps fondamentaux étudiés durant l’année. Ils constituent un aide-mémoire essentiel.
B. Glossaire des notions grammaticales 📖
Ce glossaire bilingue (lingala-français) définit les termes techniques de grammaire utilisés dans le programme (par exemple, likelelo pour verbe, ekelelo pour nom, ndelo ya ntango pour temps de conjugaison). Il facilite la compréhension et la précision terminologique.
C. Bibliographie et ressources complémentaires 🌐
Une sélection d’ouvrages de référence (grammaires, dictionnaires), de sites web et d’autres ressources pédagogiques est fournie pour permettre à l’enseignant d’approfondir ses connaissances et de trouver du matériel didactique supplémentaire.



