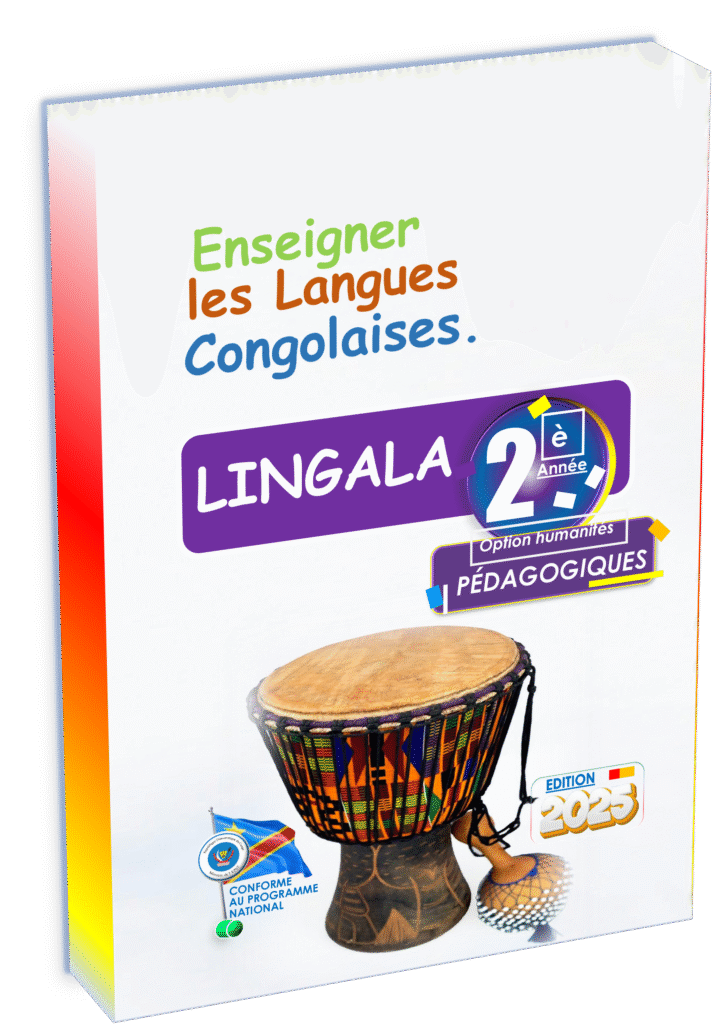
ENSEIGNEMENT DU LINGALA, 2ÈME ANNÉE, OPTION HUMANITÉS PÉDAGOGIQUES
Édition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC
Préliminaires
Ce module d’introduction renforce les fondements du curriculum en l’adaptant aux exigences de la deuxième année. Il fournit au futur enseignant les cadres conceptuels et méthodologiques nécessaires pour approfondir les compétences linguistiques et culturelles des apprenants.
1. Cadre institutionnel et alignement curriculaire 🏛️
Cette section réaffirme l’ancrage du programme dans les directives nationales de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique (EPST). L’accent est mis sur la progression curriculaire par rapport à la première année, en assurant un alignement parfait avec les compétences terminales du cycle des humanités. Le lien avec le Cadre Commun de Référence pour les Langues est explicité pour situer l’apprentissage dans une perspective de certification des compétences.
2. Objectifs pédagogiques et compétences visées 🎯
Les objectifs de cette année visent le passage d’une compétence de communication élémentaire à une maîtrise structurée de la langue. Les compétences ciblées incluent l’analyse grammaticale, la production de discours argumentés et l’interprétation de textes complexes. Lengo monene ya mobu ya mibale eza ya kokotisa moyekoli na bososoli ya mozindo ya mibeko ya monoko, mpe kopesa ye likoki ya kokoma mpe koloba na ndenge ya mayele mpo na kolimbisa likanisi na ye.
3. Approche bilingue et APS en 2ᵉ année ↔️
La méthodologie de l’Approche Pédagogique par les Situations (APS) est approfondie. Les situations-problèmes deviennent plus complexes, exigeant des élèves non seulement de communiquer mais aussi d’analyser et de résoudre des problèmes en utilisant le lingala. Le bilinguisme lingala-français est utilisé comme un outil d’analyse contrastive pour affiner la compréhension des structures idiomatiques propres à chaque langue.
4. Ressources didactiques et modalités d’évaluation 📚
Sont présentées ici les ressources spécifiques à la deuxième année, incluant des corpus de textes littéraires, des articles de presse et des supports audio-visuels authentiques (extraits de théâtre populaire de Kinshasa, chansons de l’OK Jazz). Les modalités d’évaluation évoluent vers des tâches plus intégratives comme la dissertation, le commentaire de texte et le débat oral, mesurant des compétences de haut niveau.
Chapitre 1 : Phonétique et prosodie avancées
Ce chapitre affine la compétence phonologique de l’élève en allant au-delà des sons isolés pour aborder la musicalité de la phrase (prosodie), un élément essentiel pour une expression orale naturelle et authentique.
1.1 Particularités phonétiques du Lingala 🗣️
L’étude porte sur des phénomènes phonétiques complexes tels que l’harmonie vocalique, l’assimilation et la sandhi (modification des sons à la jonction des mots). Ndakisa, na bokutani ya maloba, « moto oyo » ekoki kokoma « moto’yo » na kolobela mbangu, elision wana esalisaka ete maloba matambola malamu.
1.2 Intonation, accentuation et rythme 🎶
L’analyse se concentre sur les schémas intonatifs de la phrase déclarative, interrogative et exclamative. L’élève apprend à moduler sa voix pour exprimer des nuances de sens, comme le doute, la certitude ou l’ironie, en respectant le rythme propre à la langue lingala.
1.3 Allophones et variations régionales 🗺️
Cette section explore les variantes contextuelles d’un même phonème (allophones) et approfondit l’étude des variations dialectales. L’objectif est de développer une compétence de compréhension fine des parlers de différentes régions, comme celui de l’Équateur ou du Kasaï, tout en maintenant la production orale dans la norme standard.
1.4 Normes orthographiques approfondies ✍️
Les règles orthographiques complexes sont abordées, notamment la gestion des tons à l’écrit dans les ouvrages didactiques, la transcription des mots empruntés et l’écriture des noms propres complexes. Moyekoli asengeli koyeba bokeseni ya kokoma kati na « naíno » (pas encore) mpe « naino » (d’abord), esika accent elakisaka bokeseni ya ntina.
Chapitre 2 : Morphologie complexe
Ce chapitre approfondit l’étude de la formation des mots en introduisant des mécanismes de dérivation plus élaborés et en explorant les exceptions du système des classes nominales.
2.1 Classes nominales étendues et accords 🧩
L’étude couvre les classes nominales moins fréquentes (locatifs, augmentatifs, diminutifs) et les règles d’accord complexes qu’elles impliquent avec les adjectifs, les pronoms et les verbes. Tokotala ndenge nini ba classes 16, 17, 18 (pa-, ku-, mu-) esalelamaka mpo na kolakisa esika, lokola « pamboka » (au village).
2.2 Dérivation lexicale et affixation multiple 🔄
Les processus de dérivation par affixation multiple sont analysés. L’élève apprend comment un seul radical peut générer une famille de mots en combinant plusieurs préfixes et suffixes. Na kozwa radical « -boma » (tuer), tokoki kozwa « mobomi » (tueur), « libomi » (le meurtre), mpe ata « ebomeli » (arme du crime) to « bomaboma » (tuerie).
2.3 Pronoms relatifs et personnels complexes 👤
Les formes complexes des pronoms sont étudiées, notamment le pronom relatif variable qui s’accorde en classe avec son antécédent, ainsi que les pronoms personnels compléments et disjoints.
2.4 Pluriels irréguliers et exceptions ⚠️
Une attention particulière est portée aux noms présentant des pluriels irréguliers ou appartenant à plusieurs classes, ainsi qu’aux exceptions dans les règles d’accord. La maîtrise de ces cas particuliers témoigne d’une connaissance avancée de la langue.
Chapitre 3 : Conjugaison et formes verbales
Ce chapitre enrichit la palette verbale de l’élève en introduisant les temps composés, les modes et les voix, lui permettant d’exprimer des actions et des pensées avec une grande précision.
3.1 Temps composés et aspects verbaux ⏳
La formation et l’emploi des temps composés (plus-que-parfait, futur antérieur) sont enseignés. L’étude des aspects verbaux (inchoatif, perfectif, imperfectif) permet de distinguer la manière dont l’action est envisagée dans son déroulement. Ndakisa, bokeseni kati na « azalaki kolia » (aspect imperfectif: il était en train de manger) mpe « alei » (aspect perfectif: il a mangé).
3.2 Modes conditionnel et subjonctif 💭
L’apprentissage se focalise sur le mode conditionnel pour exprimer l’hypothèse ou l’irréel, et sur le mode subjonctif pour marquer le souhait, l’ordre ou l’incertitude. « Soki ozalaki awa, mbɛlɛ tolingaki kosepela. » (Si tu avais été là, nous nous serions amusés).
3.3 Voix passive et causative ⚙️
L’élève apprend à transformer une phrase de la voix active à la voix passive (le sujet subit l’action) et à utiliser la forme causative pour exprimer le fait de faire faire une action. Ndakisa: « Mama alambisi mwana pondu » (Maman fait préparer le pondu par l’enfant) eza forme causative ya « Mwana alambi pondu ».
3.4 Verbes irréguliers et tournures idiomatiques 🌀
L’étude des verbes irréguliers est complétée, et un répertoire de tournures verbales idiomatiques est introduit. La maîtrise de ces expressions, comme « kokata lokolo » (traverser) ou « komela moto » (tromper quelqu’un), est cruciale pour une communication authentique.
Chapitre 4 : Syntaxe de la phrase complexe
Ce chapitre a pour objectif de rendre l’élève capable de construire et d’analyser des phrases complexes, en maîtrisant les différents types de subordination et les procédés de mise en relief.
4.1 Subordonnées circonstancielles et relatives 🖇️
L’étude systématique des propositions subordonnées circonstancielles (de temps, de cause, de but, de manière) est menée. La construction des propositions relatives complexes, avec des antécédents variés, est également approfondie.
4.2 Phrases concessives, consécutives et conditionnelles ↔️
La construction de phrases exprimant la concession (atako, bien que), la conséquence (yango wana, c’est pourquoi) et la condition (soki, si) est travaillée à travers des exercices de transformation et de rédaction. « Atako mbula ezalaki konoka makasi, bana bakei na kelasi. » (Bien que la pluie tombait fort, les enfants sont allés à l’école).
4.3 Discours rapporté et incises 🗣️
Les techniques de transposition du discours direct au discours indirect sont enseignées, avec une attention aux changements de pronoms et de temps verbaux. L’usage des propositions incises pour commenter ou préciser un propos est également étudié.
4.4 Structures emphatiques et focalisation 🎯
L’élève apprend à utiliser différentes structures syntaxiques (détachement, clivage) pour mettre en relief un élément de la phrase (focalisation). Mpo na kotia kilo na likambo, olobi te « Nandimi likanisi wana te », kasi olobi « Likanisi wana, ngai nandimi yango te. »
Chapitre 5 : Lexique spécialisé et registres
Ce chapitre vise à élargir le répertoire lexical de l’élève au-delà du vocabulaire courant, en l’initiant aux termes spécifiques de certains domaines et aux différents niveaux de langue.
5.1 Vocabulaire socio-économique 💰
Un lexique relatif à l’économie (commerce, finance), à la politique (gouvernement, élections) et à la société (justice, éducation) est introduit, en s’appuyant sur des articles de presse de Bukavu ou des débats de la société civile de Lubumbashi.
5.2 Termes techniques et scientifiques 🔬
Une initiation au vocabulaire de base des sciences (biologie, physique) et des techniques (informatique, mécanique) est proposée, pour permettre à l’élève de comprendre et de reformuler des contenus spécialisés en lingala.
5.3 Registres formel, familier et littéraire 🤵🧐🧑🎨
La distinction entre les différents registres de langue est établie. L’élève apprend à adapter son discours à la situation de communication, en utilisant un langage soutenu (monoko ya bakoma) dans un exposé, ou un langage familier (lingala ya balabala) dans une conversation informelle.
5.4 Emprunts, calques et néologismes 🆕
Le phénomène de l’emprunt est analysé de manière critique. L’élève étudie comment la langue intègre et adapte des mots étrangers, et est sensibilisé aux processus de création de mots nouveaux (néologismes) pour répondre aux besoins de la modernité.
Chapitre 6 : Compréhension écrite approfondie
Ce chapitre développe les compétences de lecture critique. L’élève passe de la simple compréhension d’informations explicites à l’analyse, l’interprétation et l’évaluation de textes variés.
6.1 Analyse de textes argumentatifs ⚖️
L’élève apprend à identifier la thèse, les arguments et les exemples dans un texte argumentatif. Il s’exerce à repérer les stratégies de persuasion de l’auteur.
6.2 Identification d’idées principales et secondaires 📌
Des techniques de lecture efficace sont enseignées pour distinguer l’essentiel de l’accessoire dans un texte, afin de dégager rapidement sa structure logique et ses idées directrices.
6.3 Inférences et interprétation critique 🤔
La compétence à lire entre les lignes est développée. L’élève apprend à déduire les informations implicites, à comprendre les sous-entendus et à porter un jugement critique sur le contenu et la forme d’un texte.
6.4 Techniques de synthèse et de reformulation 📝
L’élève s’entraîne à résumer un texte en en restituant les idées principales avec ses propres mots, une compétence essentielle pour la prise de notes et la préparation de comptes rendus. Lengo eza: kokola likoki ya kotanga mokanda molai mpe kolimbola makanisi ya ntina na maloba moke ya yemei.
Chapitre 7 : Production écrite avancée
Ce chapitre est consacré à la maîtrise de l’écriture formelle. L’élève apprend à structurer une pensée complexe et à la communiquer de manière claire, cohérente et argumentée à l’écrit.
7.1 Rédaction d’essais et dissertations ✍️
La méthodologie de la dissertation est enseignée : analyse du sujet, recherche d’idées, élaboration d’un plan structuré (introduction, développement, conclusion) et rédaction argumentée.
7.2 Structuration de l’argumentation 🏗️
L’accent est mis sur la construction de paragraphes argumentatifs solides, chacun développant une idée principale étayée par des arguments, des exemples concrets tirés de la vie à Kisangani ou à Mbuji-Mayi, et une conclusion partielle.
7.3 Usage des connecteurs logiques complexes 🔗
Un répertoire étendu de connecteurs logiques (kasi, kutu, na yango, longola wana) est étudié et mis en pratique pour assurer la fluidité et la cohérence du raisonnement.
7.4 Révision stylistique et cohésion textuelle 🧐
L’élève apprend à réviser ses propres textes pour en améliorer le style (richesse du vocabulaire, variété des structures de phrases) et la cohésion (gestion des reprises pronominales, des accords, de la concordance des temps).
Chapitre 8 : Expression orale structurée
Ce chapitre vise à développer l’éloquence de l’élève. Il s’agit de le rendre capable de prendre la parole en public de manière organisée, convaincante et adaptée à l’auditoire.
8.1 Présentations formelles et exposés 🧑🏫
Les techniques de préparation et de réalisation d’un exposé oral sont abordées : structuration du contenu, création de supports visuels simples, gestion du temps de parole et du contact avec le public.
8.2 Débats guidés et discussions thématiques 💬
L’élève participe à des débats sur des sujets de société. Il apprend à formuler une opinion, à l’étayer par des arguments, à écouter et à réfuter les arguments de ses interlocuteurs avec respect. Na kati ya lisano ya ndenge wana, bana bakoyekola lolenge ya kotombola likanisi na bango na limemya mpe koyoka makanisi ya baninga.
8.3 Techniques de négociation verbale 🤝
Des simulations de situations de négociation sont organisées pour développer la capacité à convaincre, à faire des concessions et à parvenir à un compromis par le dialogue.
8.4 Écoute active et rétroaction 👂
La compétence d’écoute active est travaillée comme un élément essentiel de l’interaction orale. L’élève apprend à reformuler les propos de l’autre pour s’assurer de sa compréhension et à donner un feedback constructif.
Chapitre 9 : Analyse stylistique et grammaticale
Ce chapitre outille l’élève pour une analyse fine du discours. Il apprend à déconstruire un texte pour en comprendre les mécanismes internes, tant sur le plan stylistique que grammatical.
9.1 Figures de style avancées ✨
L’étude des figures de style (métaphores, métonymies, euphémismes, etc.) est approfondie, en s’appuyant sur des exemples tirés de la littérature orale et écrite en lingala.
9.2 Analyse détaillée de structures syntaxiques 🔬
L’élève s’exerce à l’analyse logique et grammaticale de phrases complexes, en identifiant la nature et la fonction de chaque proposition et de chaque constituant.
9.3 Cohésion et cohérence discursives 🧩
Les mécanismes qui assurent l’unité d’un texte (cohésion) et sa pertinence (cohérence) sont analysés : anaphores, connecteurs, progression thématique.
9.4 Variation stylistique par contexte 🎭
L’analyse porte sur la manière dont un même auteur ou locuteur adapte son style en fonction de son intention, de son public et du genre de discours (journalistique, politique, poétique).
Chapitre 10 : Littérature et patrimoine culturel
Ce chapitre explore la richesse du patrimoine littéraire et culturel véhiculé par la langue lingala. La langue est étudiée comme un art et un miroir de la société.
10.1 Contes et proverbes en Lingala 🦉
L’analyse de contes (lisapo) et de proverbes (lisese) permet d’étudier les structures narratives traditionnelles, la symbolique des personnages et la philosophie populaire. « Lisese elobaka ete: mosapi moko esukolaka elongi te, » yango ekolakisa ntina ya bomoko.
10.2 Poésie traditionnelle et chants 🎤
L’étude de la poésie et des chants traditionnels (par exemple, les chants épiques des Mongo) offre un accès privilégié au travail sur le rythme, la métrique et les images poétiques.
10.3 Textes contemporains et presse locale 📰
La lecture et l’analyse d’extraits de romans, de pièces de théâtre et d’articles de journaux en lingala permettent de découvrir la vitalité de la création contemporaine et les débats qui animent la société.
10.4 Valeurs culturelles et éthique communautaire 💖
À travers les textes, une réflexion est menée sur les valeurs cardinales de la culture congolaise (la famille, la solidarité, le respect de la parole donnée) et leur évolution.
Chapitre 11 : Traduction et médiation interculturelle
Ce chapitre initie l’élève à la pratique de la traduction comme un pont entre les langues et les cultures. Il développe des compétences de transfert de sens et de médiation.
11.1 Principes de traduction Lingala–Français ↔️
Les principes fondamentaux de la traduction sont exposés : la recherche de l’équivalence plutôt que du mot à mot, et la prise en compte des contextes culturels.
11.2 Équivalences pragmatiques et culturelles 🌍
L’élève apprend à trouver des équivalents fonctionnels pour les expressions idiomatiques, les références culturelles et les niveaux de langue qui n’ont pas de correspondant direct dans la langue cible.
11.3 Exercices de traduction ciblés ✍️
Des exercices progressifs de traduction (thème et version) sont réalisés sur des textes courts de genres variés (narratif, informatif, dialogué).
11.4 Guide de médiation et annotation ℹ️
L’élève est initié à la technique de l’annotation, qui consiste à ajouter des notes explicatives à une traduction pour éclairer le lecteur sur des aspects culturels ou linguistiques spécifiques.
Chapitre 12 : Évaluation formative et remédiation
Ce chapitre vise à doter le futur enseignant d’outils d’évaluation sophistiqués pour accompagner efficacement l’apprentissage et mettre en place une pédagogie différenciée.
12.1 Conception de grilles d’évaluation avancées 📊
Le futur enseignant apprend à créer des grilles d’évaluation multicritères pour des productions complexes (dissertation, exposé), permettant une analyse fine des points forts et des faiblesses.
12.2 Séquences d’apprentissage différenciées 🧑🤝🧑
Des stratégies sont proposées pour adapter les contenus et les activités au niveau hétérogène des élèves, en proposant des parcours de renforcement pour ceux en difficulté et d’approfondissement pour les plus avancés.
12.3 Feedback constructif et remédiation 🛠️
Les techniques de feedback sont affinées pour qu’il soit précis, encourageant et qu’il débouche sur un plan de remédiation personnalisé. Kosala feedback ya malamu elingi koloba: kolakisa moyekoli esika abungi, nini asengeli kosala mpo abongisa, mpe kolendisa ye.
12.4 Auto- et co-évaluation 🧐
Les élèves sont formés à utiliser des grilles d’évaluation pour analyser de manière critique leurs propres travaux et ceux de leurs camarades, développant ainsi leur autonomie et leur métacognition.
Chapitre 13 : Projets interdisciplinaires
Ce chapitre encourage la mise en œuvre de projets d’envergure qui mobilisent les compétences en lingala au service d’autres disciplines, ancrant l’apprentissage dans des réalisations concrètes.
13.1 Collaboration avec sciences humaines et arts 🤝
Des projets sont montés en collaboration avec les enseignants d’histoire (réaliser une interview en lingala d’une personne âgée sur l’histoire locale), de géographie ou d’arts plastiques.
13.2 Production de journaux et revues scolaires 🗞️
Les élèves sont amenés à créer, rédiger et mettre en page un journal scolaire en lingala, couvrant des sujets variés liés à la vie de l’école et à l’actualité.
13.3 Ateliers multimodaux en Lingala 🎬
Des ateliers de création sont organisés : écriture et interprétation de sketches, réalisation de courts-métrages ou de reportages audio en lingala, intégrant ainsi les compétences linguistiques et les TICE.
13.4 Transferts codico-culturels 🌐
Les projets favorisent une réflexion sur les transferts entre les codes linguistiques (lingala, français) et les univers culturels qu’ils représentent, préparant les élèves à devenir des acteurs compétents dans un monde globalisé.
Chapitre 14 : Transition vers la 3ᵉ année
Ce chapitre finalise le parcours de la deuxième année en assurant une transition solide vers l’année suivante, qui marque l’achèvement du cycle des humanités pédagogiques.
14.1 Bilan des acquis et axes d’amélioration ✅
Un bilan exhaustif des compétences acquises est réalisé. Chaque élève, avec l’aide de l’enseignant, identifie ses points forts et les axes sur lesquels il doit encore progresser.
14.2 Objectifs pour l’année suivante 🚀
Les enjeux et les objectifs spécifiques de la troisième année sont présentés, notamment la préparation aux épreuves de certification et la consolidation d’une expertise linguistique et didactique.
14.3 Stratégies de consolidation bilinguistique 🧠
Des pistes de travail sont proposées pour que l’élève continue à développer ses compétences de manière autonome, en lisant la presse, en écoutant la radio et en cherchant des occasions de pratiquer la langue.
14.4 Plan de suivi individualisé 📈
Un plan de suivi personnalisé est ébauché pour chaque élève, fixant des objectifs précis pour le début de la troisième année et suggérant des ressources adaptées à ses besoins.
Annexes
Cette section compile des outils de référence conçus pour une consultation rapide et efficace, servant de support constant à l’enseignant et à l’apprenant.
A. Tableaux de conjugaison détaillés 📋
Ces tableaux exhaustifs présentent la conjugaison complète des verbes-types et des principaux verbes irréguliers à tous les modes, temps et aspects étudiés. Ils sont un instrument de vérification indispensable.
B. Glossaire des notions grammaticales 📖
Le glossaire bilingue (lingala-français) définit avec précision l’ensemble des concepts linguistiques, stylistiques et littéraires abordés au cours du programme, unifiant ainsi la terminologie.
C. Répertoire des ressources pédagogiques complémentaires 🌐
Ce répertoire actualisé propose une sélection commentée de grammaires de référence, de dictionnaires, d’œuvres littéraires, de sites internet, de chaînes YouTube et d’applications mobiles pour l’étude approfondie du lingala.


