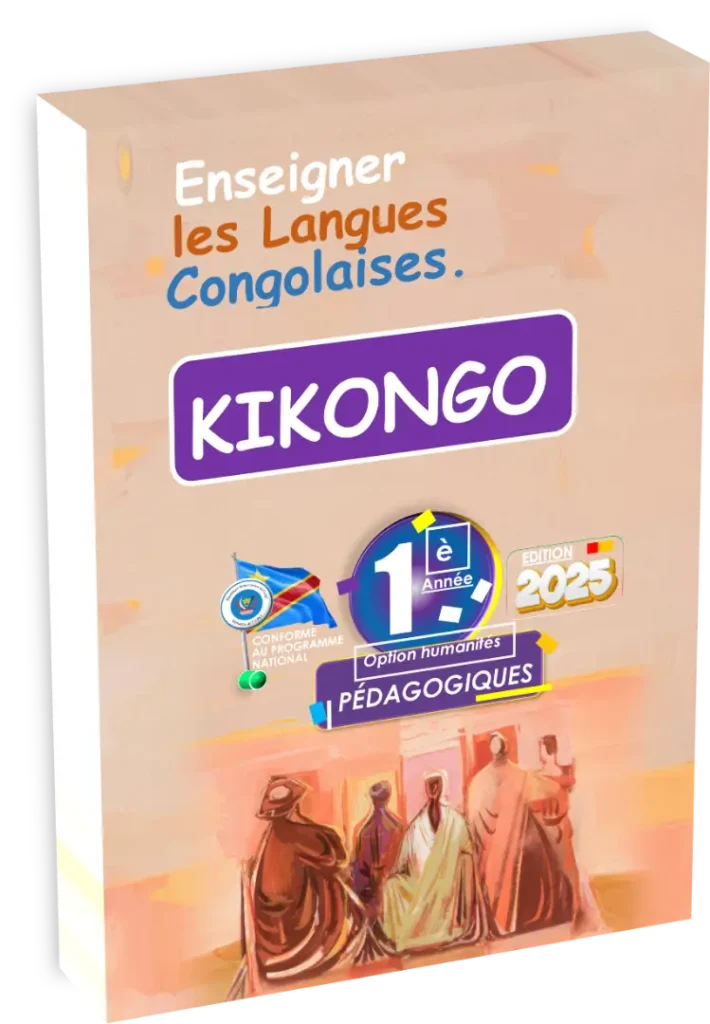
ENSEIGNEMENT DE KIKONGO, 1ÈRE ANNÉE, OPTION HUMANITÉS PÉDAGOGIQUES
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC
Préliminaires
1. Cadre institutionnel et alignement curriculaire
Cette section ancre l’enseignement du kikongo dans le programme national, en soulignant son statut de langue nationale et son rôle dans la formation des futurs enseignants. 📚 Le cours est conçu pour s’aligner scrupuleusement sur les directives de l’EPSP, assurant que chaque malongi (enseignant) dispose d’un cadre ya kieleka (fiable) pour la planification de ses leçons.
2. Objectifs pédagogiques et compétences visées
Ce point définit les compétences fondamentales que le mwana-kelasi (élève) doit acquérir au terme de la première année. 🎯 L’objectif est l’atteinte du niveau A1 du CECRL, ce qui implique la capacité de comprendre et d’utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets, bonso (comme) se présenter ou poser des questions simples.
3. Approche bilingue et APS en 1ʳᵉ année
La méthodologie s’appuie sur l’Approche Par les Situations (APS) dans un contexte bilingue kikongo-français. ✍️ Cette nzila (approche) utilise des situations de vie concrètes et authentiques, tirées du quotidien à Matadi ou Kinshasa, pour donner un sens immédiat à l’apprentissage de la ndinga (langue) et encourager les transferts de compétences entre les deux langues.
4. Ressources didactiques et évaluation formative
Sont présentées ici l’ensemble des ressources qui soutiennent le cours. 🛠️ Ceci inclut le manuel de l’élève (mukanda wa mwana-kelasi), le guide du maître, et des outils pour la tathmini ya kulonguka (l’évaluation formative), comme des fiches d’observation et des banques d’exercices progressifs pour un suivi wa ngolo (rigoureux).
Chapitre 1 : Introduction au système phonologique
1.1 Inventaire des voyelles et consonnes
Ce sous-chapitre présente de manière systématique les phonèmes du kikongo. 🗣️ Une attention particulière est portée aux sons qui n’existent pas en français, comme certaines consonnes prénasalisées (mf, mp, nd, ng), afin de poser dès le départ les bases d’une matamshi (prononciation) correcte.
1.2 Tonalité et accentuation
L’étude introduit la notion de tons, un aspect fondamental de la prosodie du kikongo. 🎶 Les élèves apprennent à distinguer les tons haut et bas et à comprendre leur rôle dans la différenciation lexicale (un même mot peut changer de sens selon le ton), ainsi que les règles de l’accent tonique.
1.3 Variations régionales de prononciation
Une sensibilisation à la diversité dialectale du kikongo est proposée. 🌍 À travers des écoutes d’enregistrements, les élèves découvrent les variations de prononciation entre les parlers de Mbanza-Ngungu et de Boma, développant ainsi une compréhension plus large de l’espace linguistique kongo.
1.4 Normes orthographiques de base
Cette section établit les conventions de l’écriture standardisée du kikongo. ✒️ Elle présente l’alphabet, la correspondance entre les graphèmes et les phonèmes, et les règles élémentaires de la segmentation des mambu (mots), pour garantir une production écrite lisible et cohérente dès le début.
Chapitre 2 : Bases morphologiques
2.1 Classes nominales et accords simples
Ce point introduit le système des makalasi ma bankumbu (classes nominales), qui est la pierre angulaire de la grammaire kikongo. 🧩 Les classes les plus courantes (ex: mu-ba, ki-bi) sont présentées avec leurs préfixes et le mécanisme de kuwakana (accord) simple avec les adjectifs est expliqué.
2.2 Formation du pluriel
La formation du pluriel des nkumbu (noms) est systématisée. 📊 Les élèves apprennent que le pluriel est principalement marqué par le changement du préfixe de classe, en suivant des paires régulières (ex: mu-ntu → ba-ntu), une règle fondamentale pour la construction de phrases correctes.
2.3 Pronoms personnels et possessifs
L’étude se concentre sur les formes des pronoms personnels sujets (mono, nge, yandi, etc.) et les déterminants possessifs. 👨👩👧👦 La manière de marquer la possession en kikongo, qui implique des accords avec le possesseur et l’objet possédé, est expliquée avec des mbandu (exemples) clairs.
2.4 Dérivation lexicale élémentaire
Une première approche de la uundaji wa mambu (formation des mots) est proposée. ⚙️ Les élèves découvrent comment, à partir d’un radical verbal, on peut former des noms d’agent ou des noms d’action par l’ajout de préfixes et de suffixes spécifiques, illustrant la logique interne de la langue.
Chapitre 3 : Verbe et conjugaison simple
3.1 Radical verbal et préfixes de sujet
La structure du kingana (verbe) est décomposée. 🔬 Les élèves apprennent à identifier le radical verbal, qui porte le sens, et à le précéder des biantete bia muntu (préfixes de sujet) qui marquent la personne et le nombre (ex: tu-, lu-, ba-).
3.2 Temps de base : présent, passé, futur
La conjugaison aux trois temps fondamentaux est enseignée. ⏳ Les élèves apprennent à former le présent simple, le passé récent et le futur en insérant les marqueurs temporels appropriés dans la structure verbale, leur donnant les outils pour situer une action dans le ntangu (temps).
3.3 Formes négatives et interrogatives
Les mécanismes pour construire des phrases négatives et interrogatives sont expliqués. ❓ La négation est généralement marquée par des particules ou des affixes spécifiques. L’interrogation se fait par l’intonation ou l’utilisation de mots interrogatifs de base comme nani? (qui?) ou wapi? (où?).
3.4 Introduction aux verbes irréguliers
Ce sous-chapitre présente quelques bingana (verbes) très courants qui ne suivent pas les règles de conjugaison standard. ⚡ La mémorisation des formes de verbes comme « être » (ku-kala) ou « avoir » (ku-vanda na) est une étape nécessaire pour la communication de base.
Chapitre 4 : Syntaxe de la phrase simple
4.1 Ordre des mots : SVO
La structure canonique de la ngongo (phrase) déclarative simple est établie : Sujet-Verbe-Objet (SVO). ➡️ Cette règle de base, similaire à celle du français, facilite la construction des premières phrases et sert de fondement pour les développements syntaxiques futurs.
4.2 Coordination de propositions
L’articulation de deux idées simples est abordée. 🔗 Les élèves apprennent à utiliser les conjonctions de coordination de base comme na (et), kansi (mais) ou kadi (ou) pour relier deux propositions de même niveau et former des phrases un peu plus longues.
4.3 Introduction à la subordination
Une première incursion dans la phrase complexe est proposée. 🔗 L’usage de conjonctions de subordination simples pour introduire une cause ou un but est présenté, mu mbandu (par exemple) pour exprimer des relations logiques élémentaires.
4.4 Placement des adverbes
La position des adverbes et des compléments circonstanciels dans la ngongo est clarifiée. 📍 Il est montré que ces éléments, qui précisent le temps, le lieu ou la manière, se placent généralement après le verbe pour ne pas perturber la structure SVO de base.
Chapitre 5 : Vocabulaire fondamental
5.1 Lexique de la vie quotidienne
Ce point vise à doter l’élève des mambu ma nsalulu (mots usuels) pour les situations de tous les jours. 🛍️ Des champs sémantiques comme la famille (dibuta), la nourriture (madia), la maison (nzo) et les activités quotidiennes sont couverts pour permettre une communication immédiate.
5.2 Champs sémantiques liés à l’environnement
Le vocabulaire relatif à la nature et à l’environnement local est exploré. 🌳 Les élèves apprennent les noms des animaux, des plantes et des phénomènes naturels typiques de la région du Kongo Central, ancrant l’apprentissage de la ndinga dans son contexte écologique.
5.3 Termes culturels et coutumiers
Un lexique de base lié à la culture kongo est introduit. 🏺 Des termes relatifs aux coutumes, aux objets d’art, à la musique et à l’organisation sociale sont enseignés pour permettre aux élèves de commencer à parler de leur kikulu (culture) dans la langue qui la véhicule.
5.4 Emprunts et variations dialectales
Ce sous-chapitre aborde la dynamique du vocabulaire. 💬 Sont étudiés les emprunts courants au français ou au lingala, ainsi que quelques variations lexicales entre les différents parlers kikongo, bonso entre celui de Kinshasa et celui de la côte atlantique.
Chapitre 6 : Compréhension orale et écoute
6.1 Stratégies d’écoute active
Des techniques pour améliorer la compréhension de l’oral sont enseignées. 👂 L’élève apprend à se concentrer sur les mots-clés, à utiliser le contexte et les indices non verbaux pour deviner le sens d’un message simple, même s’il ne comprend pas chaque diambu (mot).
6.2 Reconnaissance de phonèmes et mots clés
L’entraînement de l’oreille est une priorité. 🎧 Des exercices d’écoute ciblés permettent aux élèves de s’habituer aux sons spécifiques du kikongo et de développer la capacité à repérer rapidement les informations essentielles dans un énoncé oral court.
6.3 Compréhension de courtes consignes
La capacité à réagir à des maludiku (instructions) simples données en classe est développée. ✍️ Des activités comme « levez-vous », « asseyez-vous », « ouvrez le livre » sont pratiquées pour rendre la langue kikongo fonctionnelle dans l’environnement d’apprentissage.
6.4 Exercices de discrimination auditive
Des mazoezi (exercices) spécifiques sont proposés pour affiner la perception des sons. 🎶 Il s’agit d’apprendre à distinguer des paires minimales, c’est-à-dire des mots qui ne diffèrent que par un seul son (consonne, voyelle ou ton), une compétence cruciale pour éviter les malentendus.
Chapitre 7 : Lecture et décodage
7.1 Techniques de décodage syllabique
L’apprentissage de la lecture commence par la maîtrise de la syllabe. 🧐 La structure syllabique régulière du kikongo (Consonne-Voyelle) est utilisée pour enseigner une méthode de décodage systématique qui permet aux élèves de lire des mots nouveaux de manière autonome.
7.2 Lecture de mots et phrases courtes
La fluidité de la lecture est développée progressivement. 📖 Après le décodage, les élèves s’entraînent à lire des listes de mots, puis des phrases simples, en visant une lecture à voix haute qui respecte le rythme et l’accentuation de base de la ndinga.
7.3 Identification d’informations explicites
Cette compétence consiste à trouver des informations précises dans un texte. 📌 À travers des questions simples (qui, quoi, où), les élèves apprennent à scanner un court texte pour y localiser des noms, des lieux ou des actions mentionnés explicitement.
7.4 Compréhension de courts textes narratifs
La lecture vise la compréhension globale de misamu (récits) simples. 📜 Les élèves lisent des contes ou des anecdotes très courts et doivent être capables d’en identifier les personnages principaux, le lieu et la succession des événements.
Chapitre 8 : Production orale élémentaire
8.1 Présentations brèves
Les élèves s’entraînent à prendre la parole en continu sur un sujet préparé. 🎤 Il s’agit de produire quelques phrases simples pour se présenter, décrire sa famille ou son école, en utilisant le vocabulaire et les structures grammaticales déjà appris. Kusonika ve, kansi kutuba (ne pas écrire, mais parler).
8.2 Dialogues et échanges guidés
L’interaction orale est pratiquée à travers des mbokena (dialogues) structurés. 🗣️ Les élèves apprennent par cœur et jouent des mini-scènes de la vie quotidienne (saluer, acheter du pain), ce qui leur donne confiance pour commencer à parler.
8.3 Salutations et formules de politesse
La connaissance des codes sociaux de la communication est fondamentale. 👋 Les différentes manières de saluer selon le moment de la journée et le statut de l’interlocuteur sont enseignées, ainsi que les formules de politesse de base (mfu, mbote, etc.).
8.4 Jeux de rôles structurés
La langue est mise en pratique dans des situations simulées. 🎭 Les jeux de rôle permettent aux élèves de mobiliser leurs acquis de manière ludique et interactive, par exemple en simulant une visite au marché de Gambela à Kinshasa ou une conversation téléphonique simple.
Chapitre 9 : Production écrite initiale
9.1 Rédaction de mots et phrases simples
L’écriture commence par la maîtrise de l’unité de base. 📝 Les élèves s’exercent à écrire correctement des mots isolés, puis à les assembler pour former des ngongo (phrases) simples et grammaticalement correctes, en appliquant les règles d’accord de base.
9.2 Mise en forme de courts paragraphes
La capacité à organiser plusieurs phrases est développée. 🧱 Les élèves apprennent à rédiger un court paragraphe descriptif ou narratif en reliant quelques phrases simples sur un même sujet, en veillant à la cohérence de l’ensemble. Kusonika fioti-fioti (écrire petit à petit).
9.3 Usage basique de la ponctuation
Les conventions de l’écriture sont consolidées. ✍️ L’utilisation du point pour marquer la fin d’une phrase et de la majuscule en début de phrase est systématisée pour donner aux productions écrites une structure claire et lisible.
9.4 Correction et auto-révision
L’élève est initié à la relecture de ses propres textes. 🔄 Des grilles de relecture très simples sont proposées pour aider les élèves à vérifier l’orthographe des mots, les accords de base et la ponctuation, développant ainsi leur autonomie dans le processus d’écriture.
Chapitre 10 : Culture et traditions
10.1 Contes et proverbes kikongo
Ce point explore la sagesse populaire véhiculée par la ndinga Kikongo. 🤔 L’étude de bingana (proverbes) et de misamu mya ntama (contes anciens) permet de découvrir les valeurs, la morale et la vision du monde de la société kongo.
10.2 Chants et expressions orales
La dimension artistique de la langue est mise en avant. 🎶 L’apprentissage de nkunga (chants) traditionnels et d’expressions idiomatiques courantes permet de s’immerger dans la musicalité de la langue et de comprendre des aspects de la vie sociale et rituelle.
10.3 Coutumes ancestrales et rituels
Une introduction à l’ethnographie de la région est proposée. 🏺 Les grandes étapes de la vie (naissance, mariage, deuil) et les rituels qui les accompagnent sont présentés pour donner un aperçu des nsiku (coutumes) qui structurent la société.
10.4 Valeurs et éthique communautaire
Les fondements moraux de la société kongo sont discutés. 🤝 Des valeurs comme le respect des aînés (nitu), la solidarité communautaire (kintwadi) et l’hospitalité sont expliquées et illustrées à travers des exemples concrets, montrant que la langue est le véhicule d’une kimuntu (éthique).
Chapitre 11 : Approche comparée avec le français
11.1 Structures de phrase parallèles
Une analyse contrastive simple des deux langues est menée. 🇫🇷🇨🇩 La comparaison de l’ordre des mots et de la structure des phrases simples en kikongo et en français aide les élèves à prendre conscience des similitudes et des différences, facilitant ainsi les transferts.
11.2 Vocabulaire cognat versus spécifique
Le lexique est examiné sous l’angle du contact des langues. 🔍 Les élèves apprennent à reconnaître les mambu (mots) d’origine française (cognats) et à les distinguer du vocabulaire purement kongo, une compétence utile pour éviter les faux amis.
11.3 Stratégies de transfert lexical
Des techniques pour enrichir le vocabulaire dans les deux langues sont proposées. 🧠 Les élèves sont encouragés à utiliser consciemment leur connaissance du français pour deviner le sens de certains mots en kikongo et inversement, dans une logique d’enrichissement mutuel.
11.4 Séquences bilingues limitées
La pratique du bilinguisme est structurée en classe. 🔄 L’enseignant met en place de courtes séquences où les deux langues sont utilisées de manière complémentaire pour une même tâche, par exemple expliquer une règle de grammaire en français et faire les exercices en kikongo.
Chapitre 12 : Évaluation formative et feedback
12.1 Conception de grilles simples
L’évaluation est rendue transparente pour les élèves. 📈 L’enseignant utilise des grilles d’évaluation très simples qui décrivent les attentes pour une tâche donnée, permettant aux élèves de comprendre ce sur quoi ils sont évalués et comment ils peuvent progresser.
12.2 Exercices progressifs ciblés
La remédiation est intégrée à l’apprentissage. ✅ Pour chaque point de grammaire ou de vocabulaire, des mazoezi (exercices) de difficulté croissante sont proposés, allant de la simple reconnaissance à la production guidée, pour s’adapter au rythme de chaque mwana-kelasi.
12.3 Techniques de remédiation rapide
Des stratégies pour corriger les erreurs de manière efficace sont présentées. 👍 L’enseignant apprend à utiliser des techniques de correction qui ne sont pas stigmatisantes et qui encouragent l’élève à se corriger lui-même, favorisant ainsi une maendeleo (progression) positive.
12.4 Auto- et co-évaluation
L’élève est rendu acteur de son évaluation. 🙋♂️ Des activités simples de kuyitadila (auto-évaluation) et d’évaluation par les pairs sont introduites pour développer l’autonomie et la capacité à réfléchir sur son propre processus d’apprentissage.
Chapitre 13 : Projets et ateliers interdisciplinaires
13.1 Intégration avec sciences et histoire
Le kikongo est utilisé comme un outil pour apprendre d’autres matières. 🔬 Des mini-projets comme la description d’une plante locale en kikongo ou la narration d’un fait historique simple de la région permettent de montrer que la ndinga est une langue de savoirs.
13.2 Création de panneaux et affiches
La créativité des élèves est mobilisée. 🎨 La réalisation d’affiches ou de panneaux illustrés sur des thèmes culturels (ex: les instruments de musique kongo) est un moyen concret et motivant de pratiquer l’écriture et d’organiser l’information.
13.3 Ateliers de chant et de récitation
La dimension orale et artistique de la langue est valorisée. 🎶 Des ateliers permettent aux élèves d’apprendre et de réciter des poèmes simples ou de chanter des nkunga (chansons) en groupe, ce qui améliore la prononciation, la mémorisation et la confiance en soi.
13.4 Présentations collectives
Le travail en équipe est encouragé. 👨👩👧👦 Les élèves préparent en petits groupes de courtes présentations sur un sujet donné, développant ainsi leurs compétences de collaboration, de recherche simple d’information et de prise de parole collective.
Chapitre 14 : Transition vers la 2ᵉ année
14.1 Bilan des acquis de la 1ʳᵉ année
Un bilan complet des compétences acquises est dressé. 📊 Ce bilan permet à chaque élève de visualiser ses progrès en compréhension, en expression orale et écrite, et de prendre conscience des bases solides qu’il a construites au cours de l’année.
14.2 Objectifs pour l’année suivante
Les perspectives d’apprentissage sont clarifiées. 🎯 Les objectifs de la deuxième année sont présentés pour donner aux élèves une vision claire du chemin qui reste à parcourir et pour maintenir leur ngolo (motivation) dans l’apprentissage de la langue.
14.3 Stratégies de consolidation
Des pistes pour renforcer les acquis pendant les vacances sont proposées. 🧠 Des suggestions d’activités comme l’écoute de musique, la conversation avec des locuteurs natifs ou la lecture de textes simples sont données pour éviter la perte des compétences.
14.4 Plan de suivi bilinguistique
La continuité du projet bilingue est assurée. 📈 Un plan de suivi est établi pour s’assurer que les compétences développées en kikongo en première année seront réinvesties et serviront de tremplin pour l’apprentissage du français et des autres matières l’année suivante.
Annexes
A. Tableaux des conjugaisons de base
Cette annexe fournit des zitini (tableaux) de référence pour les conjugaisons des verbes réguliers aux temps de base. 📋 C’est un outil de consultation rapide conçu pour aider l’élève à automatiser les formes verbales et à vérifier ses propres productions.
B. Glossaire des termes grammaticaux
Ce kamuselo (glossaire) bilingue (kikongo-français) définit tous les termes techniques utilisés dans le manuel. 📖 Son but est de familiariser les élèves avec le métalangage nécessaire pour parler de la langue et analyser son fonctionnement.
C. Bibliographie et ressources complémentaires
Cette section offre des pistes pour aller plus loin. 🌐 Elle propose une liste commentée de dictionnaires, de grammaires simples, de sites web avec des contes ou de la musique kongo, et d’autres bisadilu (ressources) pour enrichir l’apprentissage.



