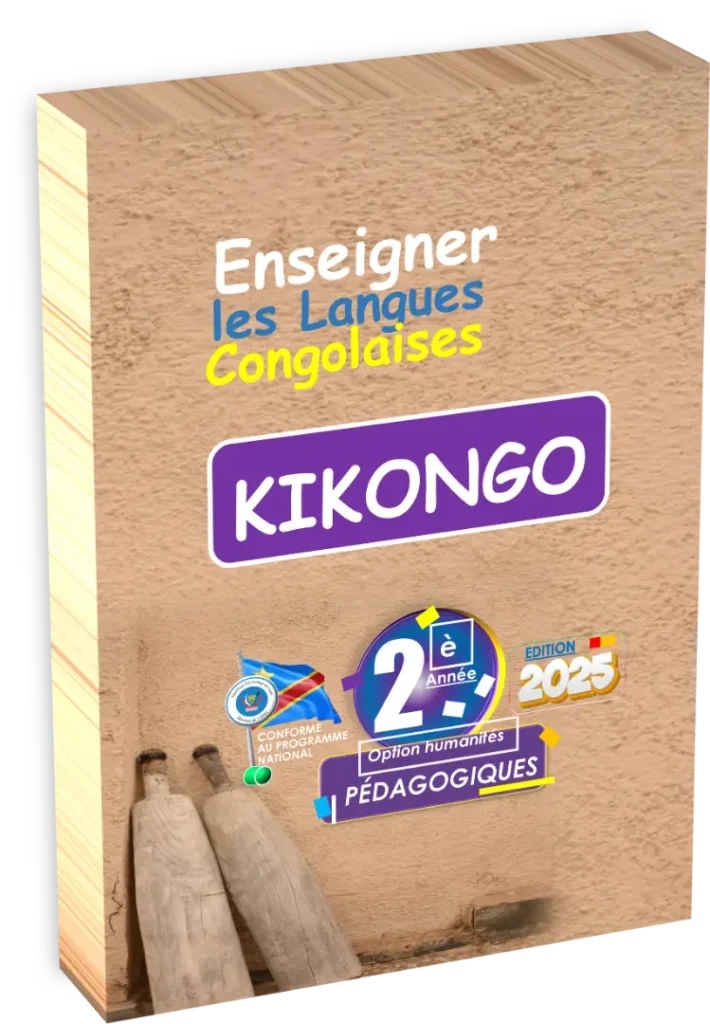
ENSEIGNEMENT DE KIKONGO, 2ÈME ANNÉE, OPTION HUMANITÉS PÉDAGOGIQUES
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC
Préliminaires
1. Cadre institutionnel et alignement curriculaire
Cette section situe le programme de deuxième année dans la continuité du cycle, en renforçant son ancrage dans le curriculum national. 📚 Le cours vise à consolider les acquis fondamentaux et à les étendre, assurant que chaque malongi (enseignant) suit une progression ya ngolo (solide) et cohérente avec les bampango (objectifs) de la réforme éducative en RDC.
2. Objectifs pédagogiques et compétences visées
Ce point détaille les compétences à atteindre, visant un niveau A2 du CECRL. 🎯 Le mwana-kelasi (élève) doit être capable de comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées, de communiquer lors de tâches simples et habituelles, et de décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et d’évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.
3. Approche bilingue et APS en 2ᵉ année
La méthodologie de l’Approche Par les Situations (APS) est approfondie avec des scénarios plus complexes. ✍️ Cette nzila (approche) bilingue amène l’élève à mobiliser le kikongo et le français pour résoudre des problèmes concrets, comme organiser un événement culturel à l’école de Kintambo à Kinshasa, transformant ainsi la ndinga (langue) en un véritable outil d’action.
4. Ressources didactiques et modalités d’évaluation
Sont recensés ici les supports pédagogiques spécifiques à la deuxième année. 🛠️ Ceci inclut un manuel (mukanda) proposant des textes plus longs et des activités plus ouvertes, un guide du maître avec des stratégies de différenciation, et des modalités de tathmini (évaluation) qui intègrent des productions écrites et orales plus élaborées.
Chapitre 1 : Phonologie et prosodie avancées
1.1 Particularités phonétiques du Kikongo
Ce sous-chapitre explore en détail les sons spécifiques du kikongo qui posent des difficultés aux apprenants. 🗣️ Une analyse articulatoire fine des consonnes prénasalisées (mb, nd, ng) et des voyelles nasales est menée pour affiner la matamshi (prononciation) et la discrimination auditive.
1.2 Intonation et rythme de l’énoncé
L’étude se porte sur la musicalité de la phrase kikongo, le kiimbo. 🎶 Les élèves apprennent à reconnaître et à produire les schémas intonatifs de base pour la déclaration, l’interrogation et l’exclamation, une compétence essentielle pour une communication orale expressive et ya kieleka (authentique).
1.3 Allophones et variations régionales
La conscience de la diversité de la ndinga Kikongo est développée. 🌍 Les élèves découvrent que certains sons peuvent être prononcés de différentes manières (allophones) selon le contexte ou la région, mu kifuani (par exemple) en comparant un parler de la côte atlantique à celui de la province du Kwilu.
1.4 Normes orthographiques approfondies
La maîtrise de l’écriture standardisée est consolidée. ✒️ Sont abordées des règles plus complexes comme la segmentation des mots composés, l’écriture des emprunts et l’usage correct des signes diacritiques, afin d’assurer une production écrite conforme aux normes za masonama (de l’écrit).
Chapitre 2 : Morphologie complexe
2.1 Classes nominales étendues et accords
L’étude des makalasi ma bankumbu (classes nominales) est élargie. 🧩 Les élèves découvrent des classes moins fréquentes, comme celles des locatifs ou des augmentatifs, et s’entraînent à appliquer les règles de kuwakana (accord) dans des phrases plus longues impliquant plusieurs adjectifs et pronoms.
2.2 Dérivation lexicale et affixation multiple
Le processus de uundaji wa mambu (formation des mots) est approfondi. ⚙️ Les élèves apprennent à analyser et à créer des mots en combinant plusieurs biakesi (affixes) sur un même nsi (radical), par exemple pour former un verbe causatif à partir d’un nom, ce qui démontre la grande productivité de la langue.
2.3 Pronoms relatifs et réciproques
De nouvelles catégories de pronoms sont introduites pour complexifier le discours. 🔗 La formation des propositions relatives simples et l’usage des pronoms réciproques pour exprimer une action mutuelle sont enseignés, permettant de construire des ngongo za mpinda (phrases complexes).
2.4 Pluriels irréguliers et exceptions
Les irrégularités du système nominal sont systématisées. 📊 Au-delà des règles générales de formation du pluriel, une attention particulière est portée aux nkumbu (noms) qui présentent des formes plurielles exceptionnelles ou qui appartiennent à des classes non appariées, un nzayilu (savoir) nécessaire pour une maîtrise fine de la langue.
Chapitre 3 : Conjugaison et formes verbales
3.1 Temps composés et aspects verbaux
La conjugaison du kingana (verbe) s’enrichit de nouvelles nuances temporelles. ⏳ Les élèves apprennent à former et à utiliser des temps composés (comme le passé accompli) et à distinguer les aspects verbaux (accompli vs inaccompli), pour une expression plus précise de la chronologie des événements.
3.2 Modes irréel, subjonctif et optatif
L’expression de l’hypothèse, du souhait et de l’ordre est développée. 🙏 L’étude du subjonctif, du conditionnel (irréel) et de l’optatif permet aux élèves de dépasser la simple description du réel pour formuler des ngindu (pensées) plus abstraites et nuancées.
3.3 Voix passive et causative
Les élèves apprennent à modifier la perspective de l’action. 🧍➡️ La formation de la kauli ya kutendwa (voix passive) pour mettre en focus le patient, et de la voix causative pour exprimer le fait de « faire faire » une action, sont des compétences clés pour une plus grande flexibilité syntaxique.
3.4 Verbes irréguliers et défectifs
La connaissance des bingana (verbes) irréguliers est élargie. ⚡ Une liste plus exhaustive de verbes à conjugaison particulière est étudiée et mémorisée, en incluant des verbes défectifs qui n’apparaissent qu’à certains temps ou modes.
Chapitre 4 : Syntaxe de la phrase complexe
4.1 Subordonnées circonstancielles
La capacité à construire des ngongo za mpinda (phrases complexes) est renforcée. 🔗 Les élèves apprennent à utiliser les conjonctions appropriées pour introduire des propositions subordonnées exprimant le temps, la cause, le but et la manière.
4.2 Phrases concessives et conditionnelles
L’expression de relations logiques complexes est au cœur de ce chapitre. ❓ La construction de systèmes conditionnels (« si… alors… ») et l’expression de la concession (« bien que… ») sont enseignées pour permettre aux élèves de structurer un raisonnement wa kuludika (logique).
4.3 Discours rapporté et incises
Les techniques pour rapporter les paroles de quelqu’un (usemi wa taarifa) sont introduites. 🗣️ Les élèves apprennent les bases du passage du discours direct au discours indirect, en prêtant attention aux changements de pronoms et de temps verbaux.
4.4 Structures emphatiques et focalisées
Ce point enseigne comment mettre en relief une information dans la phrase. ➡️ Des procédés syntaxiques comme le déplacement d’un constituant en début de phrase ou l’utilisation de particules de focalisation sont étudiés pour attirer l’attention sur l’élément le plus important du diambu (message).
Chapitre 5 : Lexique spécialisé et terminologie
5.1 Vocabulaire socio-économique
Le lexique s’étend à des domaines de la vie en société. 📈 Des termes liés au commerce, au travail, à l’administration locale et à l’économie informelle, bonso dans le grand marché de Matadi, sont introduits pour permettre de discuter de réalités socio-économiques.
5.2 Termes techniques et scientifiques
Un premier vocabulaire lié aux siasi (sciences) et aux techniques est abordé. 🔬 Les élèves apprennent les termes de base en kikongo pour décrire des phénomènes naturels, des opérations mathématiques simples ou des outils technologiques courants, ouvrant la voie à un usage plus large de la langue.
5.3 Champs lexicaux culturels
Le vocabulaire lié au kimvwama kia kikulu` (patrimoine culturel) est enrichi. 🏺 Des champs sémantiques comme la musique, la danse, l’art sculptural ou les systèmes de parenté sont explorés pour donner aux élèves les mots pour décrire la richesse de leur culture.
5.4 Emprunts et néologismes
L’analyse de la dynamique du msamiati (vocabulaire) se poursuit. 💬 Les processus d’intégration des emprunts au français et au lingala sont étudiés, ainsi que les mécanismes de création de mots nouveaux pour désigner des réalités modernes, tala (voir) par exemple le domaine de la téléphonie mobile.
Chapitre 6 : Compréhension écrite approfondie
6.1 Analyse de textes argumentatifs
Les élèves sont initiés à la lecture de textes qui défendent un point de vue. 🧐 Ils apprennent à identifier la thèse d’un auteur, les ludika (arguments) qu’il utilise et les exemples qui les soutiennent, une compétence fondamentale pour développer leur esprit critique.
6.2 Repérage des idées principales et secondaires
La capacité à structurer l’information lue est développée. 📌 Des stratégies de lecture active, comme le survol du texte et l’identification des mots-clés, sont enseignées pour permettre de distinguer rapidement les ngindu za nene (idées principales) des détails secondaires.
6.3 Inférences et interprétation critique
Ce point vise à former un lecteur capable de lire entre les lignes. 💡 Les élèves s’entraînent à déduire des informations implicites, à comprendre les intentions de l’auteur et à formuler une première interprétation personnelle et justifiée du nsamu (message) du texte.
6.4 Techniques de résumé et de synthèse
La compétence à condenser l’information est introduite. 📝 Les élèves apprennent les étapes de base du résumé : repérer les idées essentielles, les reformuler avec leurs propres mots et les organiser de manière logique et concise. Ce kisalu (travail) est essentiel.
Chapitre 7 : Production écrite avancée
7.1 Rédaction de dissertations et essais
L’écriture de textes argumentatifs structurés est l’objectif de ce chapitre. ✍️ Les élèves sont guidés pour kusonika (écrire) de courts essais dans lesquels ils doivent présenter un point de vue, l’organiser en paragraphes et le soutenir par des arguments pertinents.
7.2 Articulation claire de l’argumentation
La logique du discours écrit est travaillée. 🧱 Les élèves apprennent à construire un paragraphe argumentatif en partant d’une idée directrice, en la développant et en l’illustrant par un mbandu (exemple) concret, assurant ainsi la clarté de leur ludika (raisonnement).
7.3 Usage des connecteurs logiques complexes
La maîtrise des biangidiki (mots de liaison) est approfondie. 🔗 Une gamme plus large de connecteurs est introduite pour exprimer des relations logiques plus fines comme la cause, la conséquence, l’opposition ou la concession, afin de fluidifier le texte.
7.4 Révision stylistique et cohésion textuelle
L’autocorrection est systématisée. 🔄 Les élèves utilisent des grilles de relecture plus détaillées pour vérifier non seulement la grammaire, mais aussi la clarté du style, la richesse du vocabulaire et la cohérence globale de leurs productions écrites.
Chapitre 8 : Expression orale structurée
8.1 Présentations formelles et exposés
La prise de parole en continu est développée vers des formes plus académiques. 🎤 Les élèves apprennent à préparer et à réaliser de courts masongi (exposés) sur un sujet donné, en structurant leur intervention et en s’adressant à un public.
8.2 Débats guidés et discussions thématiques
L’interaction orale s’oriente vers l’échange d’idées. 🗣️ Des débats sont organisés en classe sur des thèmes simples, où les élèves doivent exprimer leur opinion, écouter celle des autres et y réagir de manière constructive. Mbokena ya ngolo (Une discussion sérieuse).
8.3 Techniques de négociation verbale
Des stratégies de communication pour atteindre un objectif sont enseignées. 🤝 À travers des jeux de rôle, les élèves s’entraînent à formuler une demande, à faire une proposition et à trouver un compromis, des compétences utiles muna kintwadi (dans la communauté).
8.4 Écoute active et repérage de registres
La compétence d’écoute est affinée. 👂 Les élèves apprennent à identifier le niveau de langue (familier, standard) d’un locuteur et à adapter leur propre registre en conséquence, une compétence sociolinguistique importante.
Chapitre 9 : Analyse grammaticale et stylistique
9.1 Analyse détaillée de structures syntaxiques
L’étude de la mfunu a ndinga (grammaire) devient plus analytique. 🔬 Les élèves apprennent à décomposer des phrases complexes, à identifier la nature et la fonction des différentes propositions, et à comprendre comment elles s’articulent pour créer du sens.
9.2 Figures de style et registres de langue
Une première initiation à la stylistique est proposée. 🎨 Les élèves apprennent à reconnaître quelques figures de style simples (comparaison, métaphore) dans des bingana (proverbes) ou des poèmes, et à distinguer les principaux registres de langue.
9.3 Variation stylistique selon le contexte
La capacité à adapter son kalukalu (style) est développée. 👔 Les élèves prennent conscience que l’on ne parle pas et n’écrit pas de la même manière dans une lettre à un ami ou dans une demande administrative, et s’exercent à varier leur expression.
9.4 Cohésion et cohésion discursives
L’analyse porte sur ce qui fait l’unité d’un texte. 🔗 Les élèves étudient les procédés de reprise (pronoms, synonymes) et l’usage des connecteurs qui assurent la cohésion et la progression logique d’un paragraphe à l’autre.
Chapitre 10 : Littérature et patrimoine culturel
10.1 Étude de contes et proverbes kikongo
L’exploration de la fasihi simulizi (littérature orale) est approfondie. 🤔 L’analyse de misamu (contes) et de bingana (proverbes) se concentre sur leur structure narrative, leur portée symbolique et les leçons de sagesse qu’ils transmettent de génération en génération.
10.2 Poésie et chants traditionnels
La dimension esthétique du kikulu (la culture) est mise en valeur. 🎶 L’étude de bisia (poèmes) et de nkunga (chants) traditionnels permet d’analyser le travail sur le rythme, les sonorités et les images, et de comprendre leur fonction dans les rituels et la vie communautaire.
10.3 Textes contemporains et presse locale
Une ouverture sur l’usage moderne de la langue écrite est proposée. 📰 La lecture d’articles de journaux locaux ou de courts textes d’auteurs contemporains permet de voir comment la ndinga Kikongo s’adapte pour traiter de sujets d’actualité.
10.4 Identité culturelle et valeurs communautaires
La langue est étudiée comme le pilier de l’identité. 🤝 À travers les textes, une réflexion est menée sur les valeurs fondamentales de la société kongo, comme le kintwadi (la solidarité) et l’importance des ancêtres, et sur la manière dont elles façonnent l’individu.
Chapitre 11 : Traduction et médiation interculturelle
11.1 Principes de traduction Kikongo–Français
Les bases de la ntemolo (traduction) sont introduites. 🧭 Les élèves réfléchissent aux défis posés par le passage d’une langue à l’autre, en abordant les notions de traduction littérale versus traduction du sens.
11.2 Équivalence pragmatique et culturelle
La traduction est présentée comme un pont entre les cultures. 🌍 Les élèves apprennent que traduire une expression idiomatique ou une référence culturelle exige de trouver une équivalence qui produit le même effet sur le lecteur, bonso pour les proverbes.
11.3 Exercices de traduction ciblés
La pratique de la traduction est menée sur des textes courts et simples. ✍️ Les exercices de thème et de version se concentrent sur des points de grammaire ou de lexique spécifiques pour entraîner les élèves à surmonter les difficultés les plus courantes.
11.4 Guide de médiation et annotation
Ce point initie au rôle de médiateur culturel. 🤝 Les élèves apprennent à ajouter de courtes notes explicatives à une traduction pour éclairer le lecteur sur un aspect culturel wa nsi (spécifique) qui pourrait rester obscur.
Chapitre 12 : Évaluation formative et remédiation
12.1 Conception de grilles d’évaluation avancées
L’évaluation devient un outil d’apprentissage plus fin. 📈 Le malongi (enseignant) utilise des grilles d’évaluation détaillées qui permettent de donner un retour précis à l’élève sur ses points forts et les aspects à améliorer dans ses productions.
12.2 Séquences d’apprentissage différenciées
La pédagogie s’adapte aux besoins de chaque mwana-kelasi. 🪜 L’enseignant apprend à proposer des activités et des supports variés pour un même objectif, afin de permettre à chaque élève de progresser à son rythme.
12.3 Feedback constructif et remédiation
La correction des erreurs vise à construire la confiance. ✅ Les techniques de feedback positif et constructif sont privilégiées, en se concentrant sur une ou deux erreurs à la fois et en proposant des mazoezi (exercices) de remédiation ciblés.
12.4 Auto- et co-évaluation
L’implication de l’élève dans son évaluation est renforcée. 🙋♂️ Les pratiques de kuyiyidika (auto-évaluation) et d’évaluation par les pairs sont plus fréquentes, développant l’esprit critique et la capacité à apprendre des autres.
Chapitre 13 : Projets interdisciplinaires
13.1 Intégration avec sciences humaines et arts
Le kisalu (projet) devient un carrefour de disciplines. 🤝 Des projets comme la réalisation d’une carte historique de l’ancien royaume Kongo ou la création d’une pièce de théâtre inspirée d’un conte traditionnel permettent de mobiliser des savoirs variés.
13.2 Production de journaux scolaires
La pratique de l’écriture est ancrée dans un projet concret et communicatif. 📰 La rédaction d’un numéro du zulunalu ya kelasi (journal de l’école) en kikongo motive les élèves et leur permet de travailler des genres d’écrits variés (brèves, interviews, reportages).
13.3 Ateliers multimodaux en Kikongo
La créativité s’exprime à travers différents médias. 💻 Les élèves réalisent de courtes vidéos, des enregistrements audio de poèmes ou des diaporamas commentés en kikongo, intégrant ainsi les compétences numériques à l’apprentissage de la langue.
13.4 Transferts codico-culturels
L’analyse des interactions entre langues et cultures est encouragée. 🌐 Les élèves sont invités à observer et à analyser des situations de bilinguisme autour d’eux, mu kifuani (par exemple) l’usage alterné du kikongo et du français dans les chansons populaires de Kinshasa.
Chapitre 14 : Transition vers la 3ᵉ année
14.1 Bilan des acquis et axes d’amélioration
Un bilan approfondi des compétences est réalisé en fin d’année. 📊 Ce bilan personnalisé permet de mesurer les progrès accomplis et d’identifier les axes de travail prioritaires pour chaque élève en vue de l’année suivante.
14.2 Objectifs linguistiques pour l’année suivante
La projection vers le futur maintient la motivation. 🎯 Les objectifs plus ambitieux de la troisième année sont présentés, montrant aux élèves le chemin vers une maîtrise plus grande et plus assurée de la ndinga Kikongo.
14.3 Stratégies de consolidation des compétences
Des conseils sont donnés pour un apprentissage continu. 🧠 Des stratégies pour kukolesa (renforcer) les acquis pendant les vacances sont proposées, comme la lecture suivie d’un livre simple ou la tenue d’un petit journal personnel en kikongo.
14.4 Plan de suivi bilinguistique
La cohérence du parcours bilingue est réaffirmée. 📈 Un plan de suivi est mis en place pour garantir que les compétences consolidées en deuxième année serviront de socle solide pour les apprentissages plus complexes de la troisième année, tant en kikongo qu’en français.
Annexes
A. Tableaux de conjugaison détaillés
Cette annexe est une ressource grammaticale enrichie. 📋 Elle contient des zitini (tableaux) de conjugaison pour les temps et modes étudiés, incluant les principaux verbes irréguliers, offrant un support de référence fiable pour l’élève.
B. Glossaire terminologique spécialisé
Ce kamuselo (glossaire) bilingue (kikongo-français) s’étoffe de nouveaux termes. 📖 Il définit les notions grammaticales et stylistiques abordées en deuxième année, consolidant le métalangage nécessaire à une analyse plus fine de la langue.
C. Répertoire des ressources pédagogiques complémentaires
Cette section propose des bisadilu (outils) pour diversifier l’apprentissage. 🌐 Elle inclut une liste de sites web éducatifs, de chaînes YouTube en kikongo, de recueils de contes et de contacts d’associations culturelles pour encourager l’autonomie et la curiosité.



