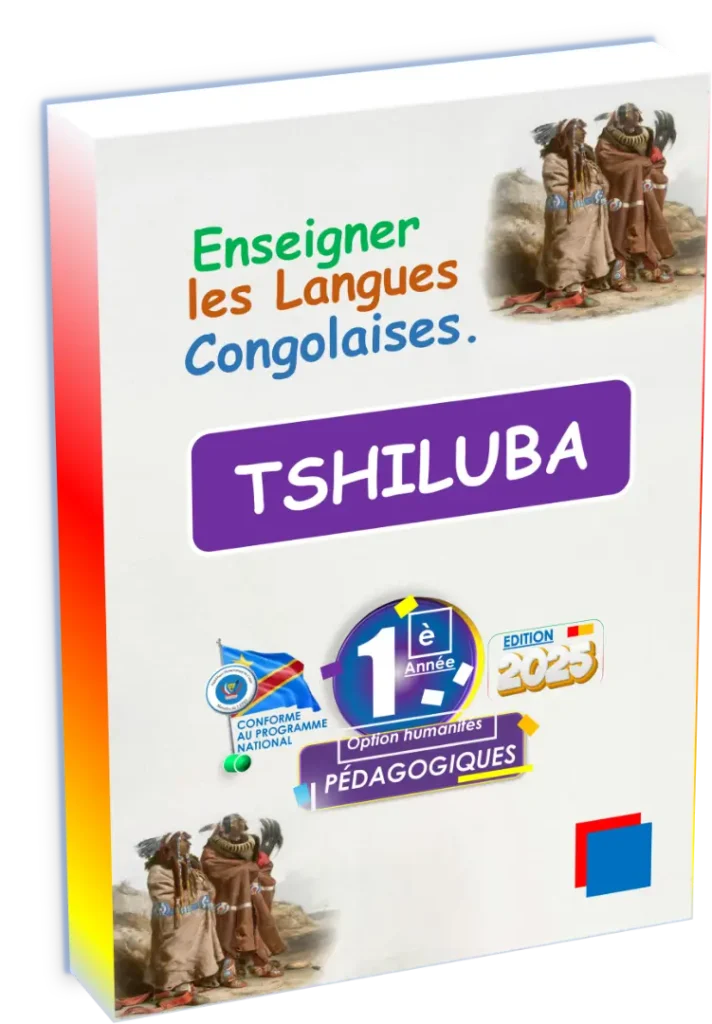
ENSEIGNEMENT DE TSHILUBA, 1ÈRE ANNÉE, OPTION HUMANITÉS PÉDAGOGIQUES
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC
Préliminaires
1. Contexte et justification
L’introduction de ce programme pour l’enseignement du Tshiluba répond à la nécessité de renforcer les compétences linguistiques des futurs enseignants dans l’une des quatre langues nationales de la République Démocratique du Congo. L’ancrage de la formation dans la langue maternelle ou véhiculaire première des élèves vise à garantir une meilleure assimilation des savoirs fondamentaux et à valoriser le patrimoine culturel Luba. Bua tshinyi ne mushindu kayi, dilongesha edi didi ne mushinga wa bungi bua bana betu ba mu Kasaï ne mu ditunga dionso. Cette démarche s’inscrit dans la réforme de l’éducation qui promeut un enseignement contextualisé et efficace.
2. Objectifs généraux du curriculum
Le curriculum vise à doter les élèves-maîtres d’une maîtrise fonctionnelle et structurée du Tshiluba, leur permettant non seulement de communiquer avec aisance, mais aussi de l’utiliser comme un outil pédagogique précis. Les objectifs couvrent la compréhension orale et écrite, la production de discours cohérents, l’analyse grammaticale et l’intégration des éléments culturels dans la pratique enseignante. Tshipatshila tshinene ntshia se: mulongi onso afike ku dimanya Tshiluba bimpe, bua yeye muine pende kulongeshaku bakuabu diledi.
3. Cadre légal et politique linguistique nationale
Ce programme s’appuie sur la Loi-cadre n°14/004 du 11 février 2014 de l’Enseignement National et la Stratégie Sectorielle de l’Éducation et de la Formation (SSEF 2016-2025). Il concrétise la politique linguistique nationale qui प्रône la promotion des langues congolaises comme vecteurs d’enseignement primaire et comme disciplines à part entière dans le cycle secondaire, assurant ainsi une transition didactique solide vers le français.
4. Méthodologie de l’approche par situations
L’approche par situations (APS) constitue le fondement méthodologique de ce programme. Chaque leçon est conçue pour partir d’un contexte réel et significatif pour l’élève (une discussion au marché de Mbuji-Mayi, la lecture d’un conte de la région de Kananga). Dilongesha difila mu nsombelu wa buena-bantu, ce qui signifie que l’apprentissage de la grammaire, du lexique ou de la syntaxe se fait à travers la résolution de problèmes concrets, transformant la connaissance linguistique en une compétence pratique et mobilisable.
Partie I : Corps du cours
Chapitre 1 – Système graphique et alphabet standardisé ✍️
1.1. Inventaire des signes lettres et digrammes
Cette section établit l’ensemble des graphèmes utilisés pour transcrire le Tshiluba. L’étude porte sur les lettres simples de l’alphabet latin ainsi que sur les digrammes spécifiques comme ny, ng, sh et mp, qui représentent des phonèmes uniques. L’objectif est d’assurer une reconnaissance visuelle infaillible de chaque unité graphique par les apprenants.
1.2. Principes de correspondance graphème-phonème
Ici, l’accent est mis sur la relation stable et prévisible entre un signe écrit (graphème) et le son qu’il représente (phonème). Contrairement au français, le Tshiluba présente une grande régularité, où chaque lettre ou digramme correspond quasi systématiquement à un seul son, ce qui facilite l’apprentissage de la lecture et de l’orthographe. Ku dîba edi, tulonga mudibu bafunda dîyi ne mudibu badibala.
1.3. Traits diacritiques et variations allographiques
L’analyse se concentre sur l’utilisation des accents pour marquer les tons (haut, bas, montant, descendant), qui sont essentiels à la distinction sémantique des mots. Par exemple, kùbàlà (compter) et kúbàlà (briller). Les variations de graphie (allographes) selon les contextes sont également examinées pour une maîtrise complète de l’écriture.
1.4. Activités d’identification et de discrimination visuelle
Des exercices pratiques sont proposés pour renforcer la reconnaissance des lettres et des mots. Ces activités incluent le tri de mots contenant des digrammes spécifiques, l’identification de tons sur des mots isolés et en contexte, et des jeux de discrimination visuelle pour éviter les confusions entre des graphèmes proches, comme b et d.
Chapitre 2 – Phonologie et phonétique du Tshiluba 🗣️
2.1. Inventaire des phonèmes vocaliques et consonantiques
Ce point dresse la liste exhaustive des sons du Tshiluba. Il détaille les sept voyelles (a, e, ɛ, i, o, ɔ, u) et l’ensemble des consonnes, y compris les consonnes prénasalisées (mb, nd, ng) typiques des langues bantoues. Tulongolola miadi yonso ya mu Tshiluba, tuimanye bimpe. L’articulation précise de chaque son est démontrée, par exemple la différence entre le s et le sh.
2.2. Les tons et leur fonction distinctive
Une exploration approfondie du système tonal du Tshiluba est menée. L’enseignant apprendra à identifier et à produire les différents tons et à comprendre leur rôle crucial dans la différenciation des significations lexicales et grammaticales. Des paires minimales comme mútu (tête) et mùtù (cœur) illustrent cette fonction de manière explicite.
2.3. Phénomènes d’assimilation et de coarticulation
Cette section analyse les modifications que subissent les sons au contact les uns des autres dans la chaîne parlée. Des phénomènes comme l’assimilation nasale (un n devenant m devant un b) ou l’harmonie vocalique sont expliqués à l’aide d’exemples tirés de conversations authentiques, par exemple à Kabinda ou à Mwene-Ditu.
2.4. Exercices d’écoute et de répétition
Pour développer une perception auditive fine et une prononciation correcte, des exercices d’écoute de locuteurs natifs et de répétition de mots, de paires minimales et de phrases sont intégrés. Ces activités visent à automatiser la production des sons et des schémas tonals corrects. Bua kuumvua ne kuakula bimpe, tudi ne bua kuteleja ne kuambulula.
Chapitre 3 – Morphologie nominale 🧩
3.1. Classes nominales et accords grammaticaux
Le cœur du système grammatical Tshiluba est présenté à travers ses classes nominales. L’étude détaille chaque classe (préfixe singulier/pluriel) comme mu-/ba- (classe 1/2 pour les humains : mu-ntu/ba-ntu) ou ki-/bi- (classe 7/8 pour les objets : ki-ntu/bi-ntu). L’accent est mis sur les mécanismes d’accord que le préfixe nominal impose à l’adjectif, au pronom et au verbe.
3.2. Pluriels réguliers et irréguliers
La formation du pluriel est systématiquement étudiée. Si la plupart des noms suivent des schémas réguliers basés sur les paires de classes (di-kàsà devient ma-kàsà), les exceptions et les pluriels irréguliers (par exemple, des noms qui n’ont pas de singulier) sont également identifiés et mémorisés pour une maîtrise complète.
3.3. Dérivation et composition nominales
Cette section explore les processus de création de nouveaux noms. La dérivation à partir de radicaux verbaux (ex: ku-longa [enseigner] → mu-longeshi [enseignant]) et la composition par juxtaposition de deux noms sont analysées pour enrichir le vocabulaire de l’apprenant de manière structurée. Mudi mêna mapiamapia enzeka.
3.4. Ateliers de segmentation morphologique
Des ateliers pratiques invitent les élèves à décomposer des noms complexes en leurs plus petites unités de sens (morphèmes) : préfixe de classe, radical et suffixe éventuel. Cette compétence analytique est fondamentale pour comprendre la structure interne du lexique et inférer le sens de mots inconnus.
Chapitre 4 – Morphologie verbale ⚙️
4.1. Radicaux verbaux et affixes pronominaux
La structure du verbe Tshiluba est disséquée en identifiant le radical (porteur du sens lexical) et les différents affixes qui s’y attachent. L’étude se concentre sur les préfixes sujet (n-di, u-di, u-di…) et les infixes objet (-mu-, -ba-…), qui sont essentiels à la construction de la forme verbale conjuguée.
4.2. Conjugaison des temps simples
La formation et l’emploi des temps de base (présent, passé simple, futur simple) sont enseignés de manière systématique. Des tableaux de conjugaison clairs sont utilisés pour illustrer les schémas de chaque temps pour différents types de verbes. Tukonkonona mushindu wa kuakula malu a lelu, a makelela ne a matuku atshilualua.
4.3. Conjugaison des temps composés
Ce point aborde les temps verbaux plus complexes, qui expriment des nuances aspectuelles (action achevée, en cours) ou temporelles (passé récent, passé lointain). La formation de ces temps, souvent à l’aide d’auxiliaires, est expliquée avec des exemples contextualisés, comme un récit d’événements s’étant déroulés à Lusambo.
4.4. Pratique de tableaux de conjugaison
Des exercices intensifs basés sur des tableaux de conjugaison permettent aux élèves de systématiser leurs connaissances. Ils s’entraînent à conjuguer une variété de verbes à tous les temps et à toutes les personnes, assurant ainsi une maîtrise active et fluide des formes verbales.
Chapitre 5 – Syntaxe de la phrase simple 🧱
5.1. Ordre des mots et fonctions grammaticales
L’étude se concentre sur la structure canonique de la phrase simple en Tshiluba, qui est majoritairement de type Sujet-Verbe-Objet (SVO). Les fonctions grammaticales de base (sujet, prédicat, complément) sont identifiées et leur rôle dans la construction du sens est analysé. Tulongolola bimpe biamu bia mu kakuyikuyi.
5.2. Construction du groupe nominal sujet
Cette section détaille la manière dont le groupe sujet est formé. Elle examine la structure du nom principal et des éléments qui peuvent l’accompagner, comme les adjectifs qualificatifs, les démonstratifs et les possessifs, en insistant sur les règles d’accord dictées par la classe du nom-tête.
5.3. Construction du groupe verbal prédicat
L’analyse porte sur le groupe verbal, qui constitue le noyau de la phrase. Sa construction est étudiée en détail, depuis le verbe conjugué simple jusqu’aux structures plus complexes incluant des compléments d’objet (direct et indirect) et des compléments circonstanciels (de lieu, de temps, de manière).
5.4. Exercices de reconstitution de phrases
Des activités pratiques de type « remettre en ordre » sont proposées. Les élèves reçoivent des mots ou des groupes de mots en désordre et doivent les réorganiser pour former des phrases grammaticalement correctes et sémantiquement cohérentes, renforçant ainsi leur compréhension de la syntaxe.
Chapitre 6 – Syntaxe de la phrase complexe 🔗
6.1. Subordination (relatives, complétives)
L’introduction aux phrases complexes commence par l’étude de la subordination. Les élèves apprennent à construire des propositions subordonnées relatives (qui complètent un nom) et complétives (qui fonctionnent comme complément d’objet d’un verbe), en maîtrisant les mots subordonnants appropriés. Mudi tukuyikuyi tubidi tukandakaja.
6.2. Coordination et juxtaposition
Les mécanismes de coordination (lier des propositions de même niveau avec des conjonctions comme ne [et], kadi [mais]) et de juxtaposition (placer des propositions l’une à côté de l’autre sans mot de liaison) sont enseignés pour permettre la construction de phrases et de discours plus fluides et élaborés.
6.3. Phrases interrogatives et exclamatives
La formation des différents types de phrases est explorée. Les élèves apprennent à poser des questions (interrogation totale avec l’intonation, interrogation partielle avec des mots interrogatifs comme nganyi? [qui?] ou tshinyi? [quoi?]) et à formuler des exclamations pour exprimer des émotions vives.
6.4. Pratique de transformations syntaxiques
Des exercices de transformation permettent de consolider les acquis. Les élèves s’entraînent à passer d’une phrase simple à une phrase complexe, d’une phrase affirmative à une phrase interrogative ou négative, développant ainsi leur flexibilité et leur maîtrise syntaxique.
Chapitre 7 – Champs lexicaux et terminologie de base 🗃️
7.1. Vocabulaire de la vie quotidienne
Cette section vise à enrichir le lexique des apprenants avec le vocabulaire essentiel pour décrire leur environnement immédiat et leurs activités journalières. Les thèmes abordés incluent la famille (ba mu dîku), la nourriture (biakudia), le logement (mu-nzubu) et les activités à la maison ou à l’école.
7.2. Lexique technique et disciplinaire
Un vocabulaire plus spécialisé, nécessaire à l’enseignement des disciplines fondamentales (mathématiques, sciences, histoire), est introduit. L’objectif est de fournir aux futurs enseignants les termes précis pour expliquer des concepts académiques en Tshiluba.
7.3. Emprunts et néologismes
L’évolution de la langue est abordée à travers l’étude des mots empruntés à d’autres langues (notamment le français, comme mashinyi pour machine) et des néologismes créés pour désigner de nouvelles réalités. Mêyi a ku bangenda ne mêyi mapiamapia atubuikila. Cela permet de comprendre le dynamisme du lexique.
7.4. Activités de classement lexical
Pour organiser et mémoriser le nouveau vocabulaire, des activités de classement sont proposées. Les élèves regroupent des mots par champs lexicaux, créent des cartes mentales ou classent des termes selon leur origine ou leur fonction, ce qui favorise une appropriation durable.
Chapitre 8 – Cohérence textuelle et connecteurs ➡️
8.1. Connecteurs temporels et logiques
L’étude porte sur les mots et expressions qui assurent les liaisons logiques et temporelles au sein d’un texte. L’emploi correct de connecteurs comme bua muntu (d’abord), pashishe (ensuite), nunku (donc) ou kadi (mais) est essentiel pour construire un discours structuré et compréhensible.
8.2. Organisation du discours narratif
Les élèves apprennent à structurer un récit de manière cohérente. L’analyse se porte sur les éléments clés d’une narration : la situation initiale, l’élément déclencheur, les péripéties et la situation finale. Des exemples sont tirés de contes populaires de la région du Kasaï. Mushindu wa kulonda malu bilondeshile ndambu.
8.3. Organisation du discours explicatif
Cette section se concentre sur la structure des textes qui visent à informer ou à expliquer un phénomène. Les élèves apprennent à organiser leurs idées, à définir des concepts, à fournir des exemples et à conclure de manière claire, par exemple pour expliquer le cycle de l’eau à des élèves de l’école primaire à Tshikapa.
8.4. Exercices de liaison de segments textuels
Des exercices pratiques consistent à fournir aux élèves des phrases ou des paragraphes désorganisés qu’ils doivent relier à l’aide des connecteurs appropriés. Ces activités développent leur capacité à produire des textes fluides et logiquement articulés.
Chapitre 9 – Lecture guidée et compréhension 📖
9.1. Stratégies de prédiction et d’inférence
Les élèves-maîtres sont formés à des techniques de lecture active. Avant de lire un texte, ils apprennent à formuler des hypothèses sur son contenu à partir du titre ou d’une illustration (prédiction) et à déduire les informations implicites pendant la lecture (inférence). Kuela meji ku bidi mua kuikala mu mukanda kumpala kua kubala.
9.2. Analyse de textes narratifs
La compréhension de textes narratifs (contes, nouvelles, récits de vie) est approfondie. L’analyse porte sur l’identification des personnages, du cadre spatio-temporel, de l’intrigue et du message ou de la morale du texte.
9.3. Analyse de textes informatifs
Cette partie se focalise sur la lecture de textes documentaires ou explicatifs. Les élèves apprennent à repérer l’idée principale, les informations clés, les exemples et la structure logique du texte (cause/conséquence, comparaison, etc.).
9.4. Fiches de lecture et questions ciblées
Des outils concrets comme les fiches de lecture sont utilisés pour guider et structurer la compréhension. Les élèves s’entraînent à répondre à des questions ciblées qui vérifient les différents niveaux de compréhension (littérale, inférentielle, critique).
Chapitre 10 – Production écrite 📝
10.1. Planification et organisation d’un texte
Avant de rédiger, les élèves apprennent les étapes de la planification : recherche et organisation des idées, élaboration d’un plan détaillé (introduction, développement, conclusion). Cette méthode assure la clarté et la cohérence de la production finale. Kulongolola meji kumpala kua kutuadija kufunda.
10.2. Rédaction de paragraphes cohérents
L’unité de base du texte, le paragraphe, est étudiée en détail. Les élèves apprennent à construire un paragraphe autour d’une idée principale, soutenue par des idées secondaires et des exemples, et à assurer des transitions fluides entre les paragraphes.
10.3. Révision et correction orthographique
La phase de relecture est institutionnalisée comme une étape cruciale du processus d’écriture. Les élèves développent des stratégies pour réviser leur propre texte, en vérifiant l’orthographe, la grammaire (accords), la ponctuation et la syntaxe.
10.4. Atelier de production rédigée
Des ateliers d’écriture mettent les élèves en situation de production. Ils sont amenés à rédiger différents types de textes (lettre, récit, description) en appliquant toutes les étapes du processus, depuis la planification jusqu’à la révision finale, sous la supervision de l’enseignant.
Chapitre 11 – Approche didactique bilingue 🇨🇩🇫🇷
11.1. Transition progressive vers le français
Ce point stratégique aborde la méthodologie pour passer de l’enseignement en Tshiluba (L1) à l’enseignement en français (L2). Il s’agit de construire les apprentissages sur les acquis solides en langue nationale pour faciliter le transfert de compétences vers la langue seconde.
11.2. Techniques d’alternance codique
L’utilisation contrôlée de l’alternance de langues (code-switching) en classe est présentée comme un outil didactique. L’enseignant apprend quand et comment passer du Tshiluba au français pour expliquer un concept difficile, donner une consigne ou traduire un terme technique. Kudienzela miakulu ibidi bua kulongesha bimpe.
11.3. Séquences pédagogiques phasées
Des modèles de leçons bilingues sont proposés. Ces séquences sont structurées en phases : une première phase entièrement en Tshiluba pour l’introduction et la compréhension du concept, suivie d’une phase de transition où le lexique français est introduit, et enfin une phase de consolidation en français.
11.4. Outils d’évaluation formative
Des outils spécifiques sont développés pour évaluer les compétences des élèves dans un contexte bilingue. L’évaluation formative permet de suivre les progrès dans les deux langues et d’identifier les difficultés de transfert pour y apporter une remédiation ciblée.
Chapitre 12 – Intégration interculturelle 🌍
12.1. Récits et proverbes traditionnels
L’étude de la langue est indissociable de la culture qu’elle véhicule. Cette section propose d’utiliser des récits, des mythes et des proverbes (nsona) du patrimoine Luba comme supports d’apprentissage. Par exemple, l’analyse grammaticale d’un proverbe permet d’étudier une structure syntaxique particulière.
12.2. Chants et chants fonctionnels
Les chants (misambu) traditionnels ou populaires sont exploités comme matériel pédagogique. Leur rythme et leur structure répétitive facilitent la mémorisation du vocabulaire et des tournures idiomatiques, tout en plongeant les élèves dans l’univers culturel congolais.
12.3. Exemples tirés du patrimoine local
Chaque leçon de grammaire ou de lexique est systématiquement illustrée par des exemples ancrés dans la réalité locale. Pour enseigner le vocabulaire de l’agriculture, on utilisera des exemples liés à la culture du maïs dans le Lomami, plutôt que des exemples abstraits. Tudia ne nzembu ya kuetu bua kumanya muakulu wetu bimpe.
12.4. Activités de valorisation culturelle
Des activités comme la collecte de contes auprès des aînés, l’organisation de petites pièces de théâtre basées sur des légendes locales ou des expositions sur l’artisanat de la région sont proposées pour que les élèves deviennent des acteurs de la préservation et de la transmission de leur culture.
Chapitre 13 – Évaluation et suivi des apprentissages 📊
13.1. Critères d’évaluation formative
Des critères clairs et précis sont définis pour l’évaluation continue des apprentissages. Ces critères couvrent les différentes compétences (compréhension orale, production écrite, maîtrise grammaticale) et permettent à l’enseignant et à l’élève de situer le niveau atteint.
13.2. Grille de progression des compétences
Une grille détaillée est fournie pour suivre l’évolution de chaque élève tout au long de l’année. Elle décrit les compétences attendues à chaque étape, permettant un suivi individualisé et objectif des progrès réalisés. Mukanda wa kumona mudi mulongi ukola mu malonga.
13.3. Feedback et remédiation
Les stratégies pour fournir un retour d’information (feedback) constructif et efficace sont enseignées. Suite à l’évaluation, des pistes de remédiation personnalisées sont proposées pour aider les élèves à surmonter leurs difficultés spécifiques.
13.4. Portfolio de l’élève
La mise en place d’un portfolio est encouragée. Cet outil permet à l’élève de collecter ses travaux les plus significatifs, de réfléchir sur son propre parcours d’apprentissage et de visualiser concrètement ses progrès, ce qui renforce sa motivation.
Chapitre 14 – Formation et accompagnement des enseignants 👨🏾🏫👩🏾🏫
14.1. Protocoles de formation initiale
Cette section définit les contenus et les modalités de la formation initiale des futurs enseignants de Tshiluba. Elle précise les connaissances linguistiques, didactiques et culturelles indispensables pour mettre en œuvre ce programme avec succès.
14.2. Techniques de co-enseignement
Des modèles de collaboration entre enseignants sont proposés, comme le co-enseignement où un enseignant plus expérimenté travaille en tandem avec un novice. Cette approche favorise le partage de bonnes pratiques et un soutien mutuel.
14.3. Supervision et mentorat
Un cadre pour la supervision pédagogique et le mentorat est établi. Des conseillers pédagogiques effectuent des visites de classe régulières pour observer, conseiller et accompagner les enseignants dans leur pratique quotidienne. Bua mudimu wa kulongesha wende bimpe, kudi bena meji badi batufikila ku tubadi.
14.4. Réflexion professionnelle et retour d’expérience
Les enseignants sont encouragés à développer une pratique réflexive. Des moments sont prévus pour qu’ils puissent analyser leurs propres séances de cours, échanger sur leurs difficultés et leurs réussites, et ainsi améliorer continuellement leur enseignement.
Annexes
Annexe A – Liste des ressources et manuels recommandés 📚
Cette annexe propose une bibliographie sélective et commentée d’ouvrages de référence, de grammaires, de dictionnaires et de manuels scolaires conformes au programme. Elle guide l’enseignant dans le choix de supports pédagogiques fiables et pertinents pour enrichir son enseignement.
Annexe B – Modèles de fiches d’activités et grilles d’évaluation 📋
Une collection de fiches d’activités prêtes à l’emploi et de grilles d’évaluation reproductibles est fournie. Ces outils pratiques sont conçus pour faciliter la préparation des cours et pour assurer une évaluation harmonisée des compétences des élèves sur l’ensemble du territoire national.
Annexe C – Glossaire des termes linguistiques 🔍
Un glossaire définit de manière simple et précise tous les termes techniques de linguistique et de didactique utilisés dans le programme. Mukanda wa miaku ya malu a ndongeshilu. Il sert de référence pour les enseignants afin de garantir une compréhension commune et un usage correct de la terminologie spécialisée.



