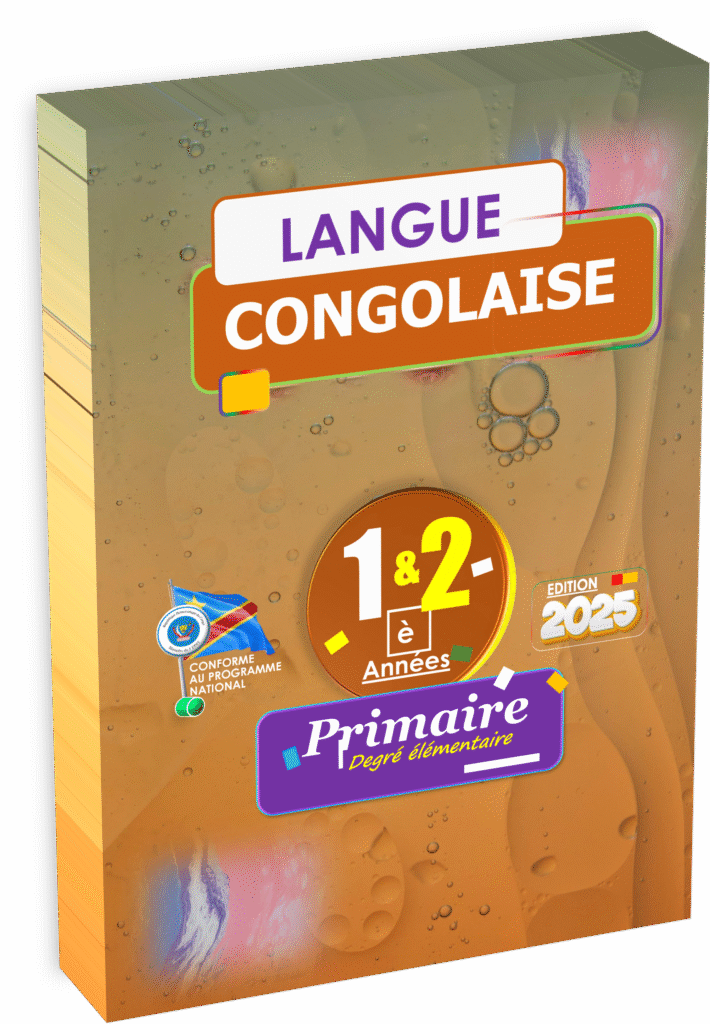
COURS DE LANGUE CONGOLAISE, 1ÈRE ET 2ÈME ANNÉE PRIMAIRE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
PRÉLIMINAIRES
0.1. Finalités et Buts de l’Enseignement de la Langue Congolaise
L’enseignement de la langue congolaise au degré élémentaire poursuit des finalités précises, ancrées dans le développement intégral de l’enfant et son intégration sociale. L’objectif premier est de former un citoyen capable de communiquer efficacement dans son environnement immédiat, en utilisant la langue du milieu comme outil principal de pensée, d’expression et d’apprentissage. 🗣️ Il s’agit de préparer l’enfant à s’intégrer utilement dans la société en maîtrisant les codes de communication orale et écrite qui régissent sa communauté. Ce cours vise à donner un premier niveau de formation intellectuelle et sociale, enracinant l’enfant dans sa culture nationale tout en le préparant aux études ultérieures où le français prendra progressivement le relais. L’accent est mis sur la capacité à comprendre autrui et à se faire comprendre, que ce soit pour des besoins familiers, des échanges sociaux ou les premières acquisitions scolaires.
0.2. Profil de Sortie du Degré Élémentaire
Au terme des deux premières années de l’enseignement primaire, l’élève doit avoir développé un ensemble de compétences fondamentales. Il doit pouvoir communiquer oralement en langue congolaise dans les situations de la vie courante avec une aisance relative. 👂 Il est attendu de lui qu’il puisse lire, écrire et comprendre des mots, des phrases simples et des textes courts, démontrant ainsi une première autonomie face à l’écrit. De plus, l’élève doit être capable de réagir de manière pertinente, oralement ou gestuellement, à un message reçu. Ces compétences linguistiques sont le socle sur lequel se construiront tous les autres apprentissages, car la langue nationale ou du milieu est, à ce stade, à la fois une discipline enseignée et la langue d’enseignement pour toutes les autres matières.
0.3. Approche Pédagogique et Didactique
L’approche pédagogique privilégiée pour ce cours est active, participative et ancrée dans le contexte socioculturel de l’élève. La démarche didactique part systématiquement du concret et du vécu de l’enfant pour aller vers des notions plus structurées. ✍️ L’apprentissage de la langue n’est pas une simple acquisition de règles, mais une construction progressive de sens à travers des situations de communication réelles ou simulées. Le principe du partenariat linguistique bilingue est fondamental : la langue congolaise est la langue d’enseignement et la discipline enseignée, tandis que le français est introduit progressivement à l’oral. L’enseignant adopte un rôle d’accompagnateur, encourageant la spontanéité de l’élève et utilisant le patrimoine culturel congolais (contes, récits, fables) comme matière première pour alimenter la pensée et l’expression. L’évaluation est formative et intégrée, visant à suivre la progression de l’élève dans sa capacité à mobiliser ses acquis linguistiques pour traiter des situations significatives.
PARTIE 1 : FONDEMENTS DE LA COMMUNICATION ORALE
CHAPITRE 1 : L’UNIVERS DES SONS ET DE LA PAROLE 🔊
1.1. Identification et Production des Sons (Phonèmes)
Ce sous-chapitre constitue la base de toute compétence langagière, car il initie l’élève à la matière première de la langue : les sons. La démarche pédagogique commence par une phase d’écoute active où l’enseignant attire l’attention des enfants sur les sons de leur environnement proche : le bruit de la pluie sur le toit en tôle à Mbandaka, le chant d’un oiseau, le son du tam-tam. 🎶 Progressivement, l’élève apprend à distinguer ces sons, puis à identifier les phonèmes spécifiques de la langue congolaise enseignée. L’objectif est de l’amener à isoler un son dans un mot, à le reconnaître dans d’autres mots et, enfin, à le produire lui-même de manière claire et distincte. Des exercices ludiques, comme les jeux de rimes ou la répétition de virelangues, sont utilisés pour renforcer cette compétence de discrimination auditive et de production articulatoire, essentielle pour une parole intelligible.
1.2. Rythme et Intonation de la Phrase
La communication orale ne se limite pas à la production correcte des sons ; elle est également portée par une musicalité qui lui donne son sens et son expressivité. Ce volet du programme vise à sensibiliser l’élève au rythme et à l’intonation caractéristiques de la langue congolaise. L’enseignant utilise des comptines, des chants et des phrases simples pour faire découvrir aux élèves la mélodie montante d’une question, l’intonation descendante d’une affirmation ou le rythme particulier d’une exclamation. 📈📉 Des gestes de la main accompagnent la parole pour matérialiser ces variations prosodiques. L’objectif est que l’élève intègre naturellement ces schémas intonatifs pour que son expression orale devienne non seulement correcte, mais aussi vivante, naturelle et nuancée, lui permettant de transmettre des émotions et des intentions au-delà des mots eux-mêmes.
1.3. Articulation et Prononciation Correcte
Une bonne articulation est la clé d’une communication réussie. Ce sous-chapitre se concentre sur le travail mécanique de la production des sons, en veillant à ce que chaque phonème soit prononcé avec précision. L’enseignant identifie les difficultés articulatoires spécifiques à ses élèves, souvent liées aux interférences avec d’autres parlers locaux, et propose des exercices ciblés. 👄 Il peut s’agir de jeux de miroirs pour observer le mouvement des lèvres et de la langue, ou d’exercices de répétition de paires minimales (mots qui ne diffèrent que par un seul son). Une attention particulière est portée aux sons qui n’existent pas dans d’autres langues parlées par l’enfant. L’enseignant, par son propre langage clair et soigné, sert de modèle permanent. L’objectif final est d’assurer une diction claire qui rend le message de l’élève parfaitement compréhensible par son interlocuteur.
1.4. Jeux Phonologiques et Conscience Sonore
Le développement de la conscience phonologique, c’est-à-dire la capacité à percevoir, découper et manipuler les unités sonores de la langue (syllabes, rimes, phonèmes), est un prérequis fondamental à l’apprentissage de la lecture. Ce sous-chapitre aborde cette compétence de manière ludique et implicite. 🧩 L’enseignant organise des activités comme « le jeu du mot qui commence comme… », où les élèves doivent trouver des mots partageant le même son initial. D’autres jeux consistent à scander les syllabes d’un mot en tapant dans les mains, à identifier des mots qui riment ou à fusionner des sons pour former un mot. Ces jeux, menés dans une ambiance détendue, permettent à l’enfant de développer une sensibilité à la structure sonore de la langue, ce qui facilitera grandement le passage ultérieur à l’écrit en lui permettant de comprendre le principe alphabétique.
CHAPITRE 2 : S’EXPRIMER AU QUOTIDIEN 🤝
2.1. Les Salutations et Formules de Politesse
Ce volet est essentiel pour l’intégration sociale de l’enfant. Il s’agit de lui faire acquérir les codes de communication qui régissent les interactions quotidiennes. L’apprentissage ne se limite pas à la mémorisation de formules, mais à leur utilisation appropriée en fonction du contexte, de l’interlocuteur (un camarade, un aîné, une autorité) et du moment de la journée. 🌅 L’enseignant organise des mises en situation et des jeux de rôle où les élèves pratiquent les différentes structures de salutation. De même, les formules de politesse (« s’il vous plaît », « merci », « pardon ») sont enseignées en contexte, par exemple en simulant une situation de demande d’objet ou de service à l’intérieur de la classe. L’objectif est de développer chez l’élève des automatismes sociaux qui témoignent du respect de soi et d’autrui, une valeur fondamentale de l’éducation congolaise.
2.2. Se Présenter et Présenter Autrui
Savoir décliner son identité est une compétence de base de la communication. Ce sous-chapitre amène l’élève à pouvoir dire son nom, son post-nom, son prénom, son âge et, éventuellement, le nom de ses parents, en utilisant des structures de phrases simples et correctes. 🙋♂️ Au-delà de sa propre présentation, l’élève apprend également à présenter une autre personne, comme un ami ou un membre de sa famille. Des activités pratiques, telles que l’accueil d’un nouvel élève dans la classe à Kolwezi ou la présentation d’un ami à ses parents lors d’un jeu de rôle, sont mises en œuvre. L’enseignant veille à la correction des structures grammaticales et à la clarté de la prononciation. Cette compétence renforce la confiance en soi de l’enfant et sa capacité à établir des relations sociales.
2.3. Demander et Donner une Information Simple
La langue est un outil pour interagir avec le monde et obtenir des informations. Ce sous-chapitre a pour but de rendre l’élève capable de formuler des questions simples et de fournir des réponses pertinentes concernant son environnement immédiat. Les thèmes abordés sont concrets et utiles : demander des informations sur des personnes, des lieux (où se trouve le bureau du directeur ?), des objets (à quoi sert cet outil ?), ou sur des caractéristiques (quelle est la couleur de ta chemise ?). 📍 L’enseignant crée des situations-problèmes qui nécessitent un échange d’informations pour être résolues, comme un jeu de piste dans la cour de l’école ou la réalisation d’une tâche collective. L’élève apprend ainsi à utiliser le langage comme un moyen fonctionnel pour agir sur son environnement.
2.4. Exprimer un Sentiment ou une Opinion
Permettre à l’enfant d’exprimer son monde intérieur est un objectif crucial pour son développement personnel. Ce sous-chapitre vise à lui donner les outils linguistiques pour verbaliser ses émotions (la joie, la tristesse, la satisfaction), ses goûts (j’aime les mangues, je n’aime pas la pluie) et ses opinions simples (je suis d’accord, je ne suis pas d’accord). 😄😠 L’enseignant part de situations vécues en classe, d’histoires lues ou d’images observées pour susciter des réactions et encourager les élèves à mettre des mots sur ce qu’ils ressentent ou pensent. Il fournit les structures de phrases adéquates et valorise chaque tentative d’expression personnelle. L’objectif est de faire de la langue non seulement un outil d’échange d’informations, mais aussi un moyen d’expression de soi, renforçant l’estime de soi de l’élève.
CHAPITRE 3 : RACONTER ET DÉCRIRE 🖼️
3.1. Décrire une Image, une Photo ou un Objet
La description est une compétence fondamentale qui développe le sens de l’observation et la précision du vocabulaire. L’enseignant propose aux élèves des supports visuels variés (une photo de famille, une image d’un marché de Goma, un objet familier comme une calebasse) et les guide pour qu’ils puissent en parler de manière structurée. 묘 L’activité est progressive : l’élève commence par nommer ce qu’il voit, puis il apprend à localiser les éléments (« en haut », « à gauche »), à décrire leurs caractéristiques (couleur, forme, taille) et enfin à exprimer ce que la scène évoque. L’enseignant enrichit le vocabulaire des élèves en leur fournissant les mots justes. Cet exercice prépare à la fois à une expression orale plus riche et, plus tard, à la rédaction de textes descriptifs.
3.2. Raconter un Événement Vécu ou Entendu
La narration est au cœur de la transmission culturelle et du développement de la pensée logique. Ce sous-chapitre a pour but d’amener l’élève à organiser ses idées pour relater un fait simple, qu’il s’agisse d’un événement personnel (ce que j’ai fait hier soir), d’un fait observé dans la cour de récréation ou d’une petite histoire entendue. 📖 L’enseignant aide l’élève à structurer son récit en respectant une chronologie simple (d’abord, ensuite, enfin) et à utiliser des connecteurs temporels de base. Il encourage l’élève à donner des détails pour rendre son histoire plus vivante. L’objectif est de dépasser la simple énumération d’actions pour construire un récit cohérent et compréhensible, une compétence essentielle pour la structuration de la pensée.
3.3. Se Situer dans l’Espace et le Temps
Pour pouvoir décrire et raconter, l’enfant doit maîtriser les repères spatio-temporels de base. Ce sous-chapitre vise à lui faire acquérir et utiliser le vocabulaire nécessaire pour se situer et situer des objets ou des événements. 🗺️ Pour l’espace, il s’agit de maîtriser les prépositions et adverbes de lieu (« sur », « sous », « devant », « derrière », « à côté de », « loin de »). Pour le temps, l’élève apprend à nommer les moments de la journée (matin, midi, soir), les jours de la semaine, puis les mois et les saisons. Des activités pratiques et des rituels quotidiens (comme la date écrite au tableau chaque matin) ancrent cet apprentissage dans le réel. La maîtrise de ces repères est indispensable pour construire des récits et des descriptions précis.
3.4. Initiation à la Narration de Contes
Le conte est un support pédagogique exceptionnel, riche sur le plan linguistique, culturel et imaginaire. Ce sous-chapitre initie l’élève à l’art de la narration à travers les contes du patrimoine congolais. 🐢 L’enseignant raconte d’abord des contes simples, en utilisant une gestuelle et une intonation expressives pour capter l’attention des élèves. Ensuite, il les amène progressivement à participer à la narration, d’abord en répétant des formules rituelles (« il était une fois… »), puis en racontant de courts passages, et enfin en restituant l’ensemble du conte avec leurs propres mots. Cette activité développe la mémoire, l’imagination, le vocabulaire et la structuration du récit, tout en enracinant l’enfant dans son héritage culturel.
PARTIE 2 : INITIATION À L’ÉCRIT ET À LA LECTURE
CHAPITRE 4 : LES GESTES DE L’ÉCRITURE ✍️
4.1. Maîtrise de l’Espace Graphique
Avant de tracer des lettres, l’élève doit apprendre à se repérer et à organiser son geste dans l’espace délimité de la feuille de papier ou de l’ardoise. Ce sous-chapitre est dédié à l’acquisition des notions spatiales fondamentales : la gauche et la droite, le haut et le bas, ainsi que le respect des marges. ↔️ L’enseignant propose des activités de graphisme décoratif, comme le remplissage de zones délimitées ou la reproduction de frises, pour exercer l’élève à contrôler son geste et à occuper l’espace de manière organisée. Ces exercices, souvent ludiques, développent la motricité fine et préparent l’œil et la main à la discipline qu’exige l’écriture. La maîtrise de l’espace graphique est la condition sine qua non d’une écriture lisible et bien présentée.
4.2. Le Tracé des Formes Pré-scripturales
L’écriture des lettres de notre alphabet est une combinaison de formes de base : les lignes droites (verticales, horizontales, obliques), les courbes (ronds, ponts, coupes) et les boucles. Ce sous-chapitre, appelé pré-écriture, vise à faire acquérir à l’élève la maîtrise du tracé de ces formes fondamentales. 🔄 L’apprentissage est progressif : l’élève commence par des tracés amples à main levée, puis sur de grandes surfaces (tableau, sable), avant de passer à des supports plus petits comme la feuille de papier. L’enseignant veille à la fluidité et à la régularité du geste. Cette étape est cruciale car elle décompose le mouvement complexe de l’écriture en gestes simples, que l’élève pourra ensuite combiner pour former les lettres sans difficulté.
4.3. Tenue de l’Outil Scripteur et Posture Corporelle
Une bonne écriture dépend aussi d’une posture adéquate et d’une prise en main correcte de l’outil (craie, crayon, stylo). Ce volet du programme, souvent implicite mais essentiel, vise à inculquer de bonnes habitudes dès le départ. ✍️ L’enseignant montre et fait pratiquer la bonne manière de tenir le crayon (la « pince » avec le pouce et l’index, l’instrument reposant sur le majeur) et insiste sur une posture corporelle propice à l’écriture : le dos droit, les pieds au sol, l’avant-bras posé sur la table. Il corrige individuellement les mauvaises tenues qui pourraient entraîner fatigue, douleur et une écriture illisible. L’acquisition de ces automatismes posturaux et manuels garantit un confort d’écriture et favorise la qualité et la rapidité du tracé.
4.4. Coordination Oculo-manuelle et Contrôle du Geste
L’écriture est un acte qui exige une synchronisation parfaite entre ce que l’œil voit et ce que la main fait. Ce sous-chapitre se concentre sur le développement de cette coordination oculo-manuelle. 👀✋ Des activités de graphisme, comme suivre un chemin sans déborder (labyrinthes simples), relier des points pour former un dessin ou repasser sur des tracés en pointillés, sont proposées pour affiner le contrôle du geste. L’élève apprend à anticiper le tracé, à ajuster la pression de son outil et à diriger sa main avec précision. Cette compétence est fondamentale non seulement pour l’écriture, mais aussi pour de nombreuses autres activités scolaires et quotidiennes comme le dessin, le découpage ou le bricolage.
CHAPITRE 5 : DE LA LETTRE AU MOT 🔡
5.1. L’Écriture des Lettres Minuscules Cursives
Une fois les gestes de base maîtrisés, l’élève aborde l’apprentissage du tracé des lettres. Le programme préconise de regrouper les lettres minuscules cursives (« écriture attachée ») selon la forme de leur tracé, ce qui facilite leur mémorisation. 🅰️ Par exemple, après avoir appris la lettre « c », l’élève apprendra facilement les lettres « o », « a », « d », « g », qui partent du même geste initial. De même, le « l » est la lettre génératrice pour le « b », le « h », le « k ». L’enseignant guide l’élève pas à pas, en décomposant le tracé de chaque lettre et en veillant au bon sens de l’écriture. L’objectif est que l’élève puisse former correctement et de manière fluide chacune des lettres de l’alphabet.
5.2. L’Écriture des Lettres Majuscules
L’apprentissage des lettres majuscules intervient généralement en deuxième année, une fois que les minuscules sont bien acquises. Leur tracé est souvent différent et elles ne sont pas toujours liées entre elles. 🔠 Comme pour les minuscules, l’enseignant peut les regrouper par familles de formes pour en faciliter l’apprentissage (par exemple, le groupe des lettres droites : I, F, H, T, L, E). L’élève apprend leur tracé et leur usage spécifique, notamment au début des phrases et pour les noms propres. La maîtrise des deux casses (minuscule et majuscule) est indispensable pour une écriture conforme aux conventions.
5.3. L’Assemblage des Lettres en Syllabes et Mots
Savoir tracer les lettres ne suffit pas ; il faut pouvoir les lier entre elles pour former des syllabes puis des mots. Ce sous-chapitre est consacré à l’apprentissage du raccordement des lettres cursives. 🔗 L’enseignant montre comment enchaîner les lettres sans lever le crayon, en portant une attention particulière aux liaisons qui peuvent poser problème. L’élève s’exerce d’abord à écrire des syllabes simples (consonne-voyelle), puis des mots de plus en plus longs. Cette étape est essentielle pour acquérir une écriture fluide et rapide. L’élève prend conscience que l’écrit est une suite continue de signes qui correspondent à la chaîne parlée.
5.4. La Copie de Mots et de Phrases Courtes
La copie est un exercice fondamental pour consolider la formation des lettres, mémoriser l’orthographe des mots et développer la vitesse d’écriture. L’élève est amené à recopier des mots, puis des phrases courtes, d’abord à partir d’un modèle au tableau, puis d’un support papier. 📝 L’enseignant insiste sur la précision de la copie : l’élève doit reproduire fidèlement le modèle, en respectant la forme des lettres, les liaisons, les accents et la ponctuation. La copie n’est pas un exercice mécanique ; elle exige de l’attention, de la concentration et une bonne mémoire de travail, des compétences cognitives utiles pour tous les apprentissages.
CHAPITRE 6 : LES PREMIERS PAS EN LECTURE 👓
6.1. Reconnaissance Visuelle des Lettres et des Mots
Parallèlement à l’apprentissage de l’écriture, l’élève développe sa capacité à reconnaître les lettres et les mots. Il apprend à associer un nom et un son à chaque lettre de l’alphabet. 👁️ Des jeux d’identification (trouver une lettre donnée parmi d’autres, nommer une lettre montrée) sont organisés. Progressivement, l’élève commence à mémoriser la forme globale de certains mots très fréquents (son prénom, les jours de la semaine, des mots-outils), qu’il reconnaît instantanément sans avoir besoin de les déchiffrer. Cette reconnaissance globale, qui se développe avec la pratique, est l’une des composantes d’une lecture fluide.
6.2. Le Principe Alphabétique et le Déchiffrage Syllabique
Ce sous-chapitre est le cœur de l’apprentissage de la lecture. L’élève doit comprendre le principe alphabétique : les lettres (graphèmes) représentent les sons (phonèmes) de la langue. Il apprend à faire la correspondance entre une lettre écrite et le son qu’elle produit. 🧩 Le premier mécanisme de déchiffrage qu’il acquiert est la fusion syllabique : il apprend à combiner le son d’une consonne avec celui d’une voyelle pour lire une syllabe (par exemple, b + a → ba). Cet entraînement systématique et progressif, de la syllabe simple (CV) à des syllabes plus complexes, permet à l’élève de « craquer le code » et de devenir capable de déchiffrer des mots nouveaux qu’il n’a jamais rencontrés.
6.3. La Lecture de Mots et de Phrases Simples
Une fois le mécanisme de déchiffrage syllabique en place, l’élève s’exerce à lire des mots isolés, puis des suites de mots formant des phrases courtes. 📜 La progression est rigoureuse : les premiers mots et phrases proposés ne contiennent que les correspondances graphème-phonème déjà étudiées. L’objectif à ce stade est de développer la fluidité du déchiffrage. L’élève doit parvenir à lire les mots avec de moins en moins d’hésitation, en automatisant le processus de décodage. L’enseignant veille à ce que cet exercice reste motivant, en proposant des supports variés et ludiques.
6.4. La Compréhension de Mots et de Phrases Lus
Lire ne se résume pas à déchiffrer ; c’est avant tout comprendre. Dès les premières étapes, l’enseignant s’assure que l’élève accède au sens de ce qu’il lit. 🤔 Après la lecture d’un mot, il lui demande ce que ce mot représente (en montrant l’objet ou une image). Après la lecture d’une phrase, il pose des questions simples pour vérifier la compréhension (« De qui parle-t-on ? », « Que fait-il ? »). Cette articulation constante entre le décodage et la compréhension est essentielle pour former de véritables lecteurs et éviter une lecture purement mécanique et dépourvue de sens.
PARTIE 3 : STRUCTURATION DE LA LANGUE ET DU RÉCIT
CHAPITRE 7 : L’ORGANISATION DE LA PHRASE 🏛️
7.1. La Notion de Phrase et sa Structure de Base
Ce sous-chapitre vise à donner à l’élève une conscience intuitive de ce qu’est une phrase : une suite de mots qui a un sens. Partant de productions orales, l’enseignant montre comment organiser les mots pour former un message compréhensible. 🧱 Il introduit la structure la plus simple de la phrase (Sujet-Verbe-Complément) à travers des exemples concrets et des manipulations. Par des jeux de construction et de déconstruction, l’élève apprend à identifier les constituants essentiels d’une phrase et à comprendre que leur ordre n’est pas aléatoire. Cette première approche de la syntaxe est implicite et fonctionnelle, préparant le terrain pour une étude plus formelle de la grammaire dans les classes supérieures.
7.2. Les Signes de Ponctuation Fondamentaux
La ponctuation est la « respiration » de l’écrit ; elle organise le discours et guide la lecture. En deuxième année, l’élève est initié aux deux signes les plus fondamentaux : le point (.) et la virgule (,). Il apprend que le point marque la fin d’une phrase et qu’il est associé à une intonation descendante à l’oral et à une pause plus longue. 🛑 Il découvre que la virgule sert à séparer des éléments dans une liste ou à marquer une pause plus courte à l’intérieur de la phrase. L’enseignant utilise des textes simples pour montrer l’effet de ces signes sur le sens et le rythme, et fait pratiquer leur utilisation dans des exercices de copie et de petites dictées.
7.3. Les Types de Phrases Simples : Déclarative et Interrogative
L’élève apprend à reconnaître et à produire les deux types de phrases les plus courants, qui correspondent à des intentions de communication différentes. Il découvre la phrase déclarative, qui sert à affirmer quelque chose et se termine par un point. ❓ Il apprend également à construire la phrase interrogative, qui sert à poser une question. L’étude porte sur les différentes manières de marquer l’interrogation dans la langue congolaise (intonation montante, utilisation d’un mot interrogatif en début de phrase, etc.). Des jeux de questions-réponses et des dialogues simples permettent de pratiquer activement ces deux formes de phrases.
7.4. Initiation aux Fonctions Essentielles : Sujet et Verbe
Sans utiliser un métalangage complexe, ce sous-chapitre a pour but d’amener l’élève à identifier intuitivement les deux piliers de la phrase : le sujet (« de qui ou de quoi on parle ») et le verbe (« ce qu’il fait ou ce qu’il est »). 🚶♂️ L’enseignant utilise la manipulation et la substitution pour mettre en évidence ces fonctions. Par exemple, à partir de la phrase « Le garçon mange une banane », il pose les questions « Qui est-ce qui mange ? » pour trouver le sujet, et « Que fait le garçon ? » pour trouver le verbe. Cette première approche fonctionnelle de la grammaire aide l’élève à mieux comprendre la structure de la phrase et constitue une étape préparatoire indispensable à l’analyse grammaticale.
CHAPITRE 8 : ENRICHIR SON VOCABULAIRE 💡
8.1. Le Vocabulaire du Milieu Proche et Familier
L’acquisition du vocabulaire part du monde qui entoure l’enfant. Ce sous-chapitre se concentre sur les mots relatifs à son environnement immédiat : la famille (père, mère, frère, oncle), l’école (enseignant, élève, tableau, banc), la maison (chambre, cuisine, lit) et le village ou le quartier (marché, église, route). 🏡 L’enseignant utilise des objets réels, des images et des situations vécues pour introduire et fixer ce vocabulaire. L’objectif est de s’assurer que l’élève dispose des mots nécessaires pour parler de sa réalité quotidienne de manière précise.
8.2. Les Mots pour Décrire : Couleurs, Formes et Tailles
Pour aller au-delà de la simple nomination, l’élève a besoin d’un lexique qui lui permette de qualifier les êtres et les choses. Ce volet du programme est consacré à l’acquisition des adjectifs de base. 🎨 Il apprend à nommer les couleurs principales, à décrire les formes géométriques simples (rond, carré) et à utiliser les adjectifs de taille et de dimension (grand/petit, long/court, gros/mince). Des activités de tri, de classement et des jeux de devinettes (« je pense à quelque chose de rouge et de rond dans la classe, qu’est-ce que c’est ? ») rendent cet apprentissage actif et engageant.
8.3. Les Mots pour Agir : Verbes d’Action Courants
Les verbes sont le moteur de la phrase ; ils expriment les actions et les états. Ce sous-chapitre vise à doter l’élève d’un répertoire de verbes d’action courants, indispensables pour raconter et décrire ce qui se passe. 🏃♀️ Il apprend des verbes comme manger, boire, dormir, marcher, courir, jouer, parler, écouter, etc. L’enseignant privilégie l’apprentissage en situation, par le biais du mime, de l’exécution d’ordres simples (« Lève-toi », « Prends ton cahier ») et de la description d’actions observées. La maîtrise de ce vocabulaire verbal est essentielle pour construire des phrases dynamiques et informatives.
8.4. Les Mots pour Nommer : Animaux, Plantes et Objets
L’élargissement du vocabulaire nominal (les noms) est un objectif constant. Ce sous-chapitre propose d’explorer des champs lexicaux variés et pertinents pour l’enfant. 🐘 Il apprend à nommer les animaux domestiques et sauvages de sa région (la chèvre, le lion du parc de la Garamba), les plantes, les fruits et les légumes courants (le manguier, le manioc), ainsi qu’une variété d’objets du quotidien. L’enseignant peut organiser des classes promenades, utiliser des imagiers ou créer des collections en classe pour rendre cette acquisition lexicale concrète et signifiante.
CHAPITRE 9 : LE MONDE DES HISTOIRES ET DES CONTES 🌍
9.1. Écoute Active et Compréhension de Récits
L’écoute est une compétence qui se travaille. Ce sous-chapitre a pour but de développer la capacité de l’élève à écouter attentivement un récit lu ou raconté par l’enseignant et à en comprendre les éléments essentiels. 🎧 Après l’écoute, l’enseignant pose des questions de compréhension pour vérifier ce qui a été retenu : « Où se passe l’histoire ? », « Qu’a fait le personnage principal ? ». Il peut également demander aux élèves de dessiner une scène de l’histoire pour évaluer leur compréhension de manière non verbale. Cette pratique régulière de l’écoute de récits développe la concentration, la mémoire et les capacités d’inférence de l’élève.
9.2. Restitution Orale d’une Histoire Simple
Après avoir écouté et compris, l’élève est encouragé à reformuler l’histoire avec ses propres mots. La restitution orale est un exercice complet qui mobilise la mémoire, les compétences de structuration du récit et le vocabulaire. 🗣️ L’enseignant guide les élèves en leur rappelant les moments clés de l’histoire et en les aidant à utiliser les connecteurs logiques et temporels appropriés. La restitution peut se faire individuellement ou collectivement, la classe reconstruisant l’histoire ensemble. Cet exercice renforce la confiance de l’élève dans sa capacité à prendre la parole et à organiser un discours cohérent.
9.3. Identification des Personnages et du Cadre Spatio-temporel
Pour comprendre une histoire en profondeur, il est nécessaire d’en identifier les composantes structurelles. Ce sous-chapitre amène l’élève à repérer les éléments fondamentaux de tout récit : les personnages (qui ?), le lieu (où ?) et le moment (quand ?). 📍 L’enseignant pose des questions ciblées après la lecture pour guider cette identification. Il peut aussi proposer des activités de classement, comme dessiner tous les personnages sur une feuille et le décor sur une autre. Cette analyse, même simple, structure la compréhension de l’élève et lui donne des outils pour aborder plus tard des textes plus complexes.
9.4. Création Collective de Courtes Histoires
Ce sous-chapitre constitue une première étape vers la production d’écrits personnels. L’enseignant propose à la classe de créer une histoire ensemble. Il peut lancer le début de l’histoire (« Un jour, un petit singe qui se promenait près de la rivière Lulua… ») et chaque élève ajoute une phrase à tour de rôle. 🐵 L’enseignant agit comme un scribe, notant l’histoire au tableau, et comme un régulateur, veillant à la cohérence du récit. Cette activité de création collective est très motivante ; elle dédramatise l’acte d’écrire, stimule l’imagination et montre aux élèves qu’ils sont capables de produire un texte qui a du sens.
PARTIE 4 : COMPÉTENCES INTÉGRÉES ET VALORISATION CULTURELLE
CHAPITRE 10 : COMMUNIQUER EN SITUATION RÉELLE 💬
10.1. Dialoguer et Jouer des Scènes (Saynètes)
Ce sous-chapitre vise à mobiliser l’ensemble des compétences de communication orale acquises dans une activité intégrée et ludique : la saynète. L’enseignant propose des scénarios simples tirés de la vie quotidienne (une scène d’achat au marché, une visite chez le médecin, une discussion en famille) et distribue les rôles aux élèves. 🎭 Ceux-ci doivent alors improviser ou jouer un dialogue en utilisant les formules de politesse, les structures interrogatives et déclaratives, et le vocabulaire appropriés. Cette activité permet de travailler la spontanéité, l’écoute de l’autre, l’adaptation du langage à la situation et l’expressivité corporelle, rendant l’apprentissage de la langue vivant et fonctionnel.
10.2. Communiquer dans un Contexte Spécifique : le Marché
Le marché est un lieu de vie et de communication par excellence. L’enseignant peut organiser une simulation de marché dans la classe (le marché de Kananga, par exemple) pour faire pratiquer la langue dans un contexte authentique. Les élèves jouent les rôles de vendeurs et d’acheteurs. 🛍️ Ils doivent nommer les produits, demander les prix, négocier, remercier. Cette situation concrète les amène à utiliser des nombres, du vocabulaire spécifique (fruits, légumes, mesures) et des structures de phrases liées à la transaction commerciale. C’est une manière efficace d’ancrer l’apprentissage dans les réalités économiques et sociales du pays.
10.3. Participer à une Conversation Guidée en Classe
Savoir prendre part à une discussion collective est une compétence sociale et langagière importante. L’enseignant initie des conversations sur des thèmes simples et proches des intérêts des enfants (les jeux préférés, les animaux, une fête locale). 💬 Il joue un rôle de modérateur, veillant à ce que chacun puisse s’exprimer, apprenne à écouter les autres sans les interrompre et à réagir à ce qui a été dit. Il encourage les élèves à justifier leurs opinions (« Pourquoi aimes-tu ce jeu ? »). Ces moments d’échange régulés développent les compétences d’argumentation et de communication en groupe.
10.4. Formuler, Transmettre et Recevoir un Message Simple
La communication a souvent pour but de transmettre une information précise. Ce sous-chapitre entraîne l’élève à formuler un message clair et concis, à le transmettre oralement à un camarade, qui doit à son tour le recevoir et prouver qu’il l’a compris (par exemple, en exécutant une consigne). 📞 L’enseignant peut organiser un jeu du « téléphone arabe » pour montrer comment l’information peut être déformée et insister sur la nécessité d’une formulation précise. Il peut aussi donner des consignes à un élève qui devra les retransmettre à un groupe. Cet exercice développe la rigueur dans l’expression et l’écoute active.
CHAPITRE 11 : L’ÉCRIT FONCTIONNEL ET CRÉATIF 🖋️
11.1. Écrire des Informations Personnelles Essentielles
L’écrit a une fonction sociale et administrative fondamentale. Ce sous-chapitre apprend à l’élève à écrire les informations qui le concernent directement : son nom, son post-nom, son prénom, son âge, le nom de sa classe et de son école, et son adresse. 🆔 Il s’agit d’un savoir-faire pratique et indispensable. L’enseignant peut créer des fiches d’identité que chaque élève doit remplir. L’accent est mis sur la lisibilité et l’orthographe correcte de ces informations cruciales.
11.2. Composer une Courte Invitation ou un Message
Ce volet initie l’élève à la rédaction de textes courts ayant une visée communicative précise. Il apprend à rédiger une invitation pour son anniversaire à Lubumbashi, en y faisant figurer les informations essentielles (pourquoi, qui, où, quand). 💌 Il peut également s’exercer à écrire un petit mot pour remercier quelqu’un ou pour laisser un message simple. L’enseignant fournit des modèles et guide la rédaction, en insistant sur la clarté et la pertinence du message par rapport à l’objectif visé.
11.3. Rédiger une Liste ou une Énumération
L’écriture de listes est une forme d’écrit fonctionnel très courante. L’élève apprend à organiser l’information de manière verticale pour énumérer des éléments. 📝 Les applications sont nombreuses et concrètes : rédiger la liste des fournitures scolaires, la liste des courses pour sa maman, la liste des joueurs de son équipe de football. Cet exercice simple structure la pensée, entraîne à l’orthographe et montre l’utilité de l’écrit pour organiser et mémoriser l’information.
11.4. La Calligraphie comme Art de Bien Former les Lettres
Au-delà de la simple lisibilité, l’écriture peut être une source de plaisir esthétique. Le programme accorde une place à la calligraphie, qui vise à développer chez l’élève le goût du travail soigné et de la belle écriture. ✒️ Il ne s’agit pas d’une discipline à part, mais d’une attention constante portée à la qualité du tracé dans toutes les activités d’écriture. L’enseignant encourage les élèves à former leurs lettres avec régularité, à bien les lier et à présenter leur cahier proprement. Des séances dédiées peuvent être organisées pour s’exercer à la reproduction de modèles particulièrement soignés, faisant de l’écriture une activité à la fois fonctionnelle et artistique.
CHAPITRE 12 : LA LANGUE COMME VECTEUR DE CULTURE 🇨🇩
12.1. Les Contes, Mythes et Fables du Patrimoine Congolais
Ce sous-chapitre approfondit l’exploration du patrimoine oral congolais. L’enseignant sélectionne des contes, des mythes fondateurs ou des fables animalières représentatifs de la culture locale et nationale. 📜 Au-delà du plaisir de l’écoute, il amène les élèves à en comprendre le message, la morale ou la sagesse qu’ils véhiculent. La discussion en classe permet de faire le lien entre ces récits anciens et les valeurs de la société actuelle (la solidarité, l’honnêteté, la ruse, le respect des aînés). L’élève découvre ainsi que la langue est le dépositaire de la mémoire et de la vision du monde de son peuple.
12.2. Les Chants et Comptines en Langues Nationales
Le chant et la poésie enfantine sont des moyens privilégiés d’imprégnation linguistique et culturelle. L’enseignant constitue un répertoire de chants et de comptines traditionnels ou populaires en langue congolaise. 🎶 Ces textes, souvent rythmés et faciles à mémoriser, permettent de travailler la prononciation, le vocabulaire et les structures syntaxiques de manière ludique. Ils sont également porteurs de thèmes culturels (les travaux des champs, les jeux, les animaux) et contribuent à créer une ambiance de classe joyeuse et un sentiment d’appartenance collective.
12.3. Les Proverbes et Expressions Imagées
Les proverbes sont des concentrés de sagesse populaire qui enrichissent la langue et la pensée. L’enseignant initie les élèves à quelques proverbes simples et courants de leur région, en expliquant leur sens littéral et leur signification profonde. 🧠 Il les encourage à les utiliser à bon escient dans des situations de communication. De même, il attire leur attention sur les expressions imagées et les métaphores qui colorent la langue. Cette sensibilisation à la dimension poétique et métaphorique du langage développe la finesse de compréhension et d’expression des élèves.
12.4. La Langue dans les Jeux Traditionnels
De nombreux jeux traditionnels congolais sont accompagnés de formules verbales, de chants ou de dialogues spécifiques. Ce sous-chapitre propose d’utiliser ces jeux comme un contexte d’apprentissage linguistique authentique. 🎲 Qu’il s’agisse des formules pour jouer au « zango » ou des chants qui rythment un jeu de corde, l’élève apprend et utilise la langue dans un cadre motivant et signifiant. L’enseignant peut organiser des séances de jeux dans la cour et attirer l’attention sur le langage qui leur est associé. C’est une manière vivante de montrer que la langue est indissociable de la culture et des pratiques sociales.
ANNEXES
1. Grille d’Évaluation Formative
Cette section fournit aux enseignants un modèle de grille d’observation pour l’évaluation formative. L’outil est conçu pour suivre les progrès de chaque élève de manière continue, non pas pour noter, mais pour identifier les acquis et les difficultés. 📋 La grille se décompose en plusieurs domaines de compétences (compréhension orale, expression orale, conscience phonologique, geste graphique, etc.). Pour chaque compétence, des indicateurs observables sont proposés (par exemple, pour l’expression orale : « Participe spontanément », « Construit des phrases simples », « Prononce les sons correctement »). L’enseignant peut ainsi documenter ses observations au fil des semaines et ajuster ses stratégies pédagogiques pour répondre aux besoins spécifiques de chaque enfant, favorisant une différenciation efficace.
2. Suggestions d’Activités Intégratrices
Ce volet propose des idées de mini-projets ou d’activités complexes qui permettent aux élèves de mobiliser et d’intégrer plusieurs compétences linguistiques travaillées séparément. 🎨 Par exemple, l’organisation d’une « journée culturelle » dans la classe où les élèves doivent préparer une petite exposition d’objets locaux, présenter oralement leur objet, et chanter un chant traditionnel. Un autre exemple pourrait être la création collective d’un petit livre illustré, basé sur une histoire inventée par la classe, impliquant des compétences d’expression orale (pour créer l’histoire), d’écriture (pour la dicter à l’adulte ou copier les textes) et artistiques (pour les illustrations). Ces activités donnent du sens aux apprentissages et renforcent la motivation des élèves.
3. Répertoire de Comptines et Chants du Patrimoine
Afin de faciliter la mise en œuvre des chapitres liés à la culture, cette annexe offre une sélection de comptines, de chants et de jeux de doigts issus de différentes régions de la République Démocratique du Congo. 🎤 Pour chaque texte, une transcription simple est fournie, accompagnée d’une brève explication du contexte culturel ou de la gestuelle associée. Ce répertoire constitue une ressource pratique pour l’enseignant, lui permettant de varier les supports et d’enrichir le bain linguistique et culturel de sa classe. Il est conçu comme une base que chaque enseignant est encouragé à compléter avec les trésors du patrimoine local de sa propre région.
4. Glossaire des Termes Pédagogiques
Pour assurer une compréhension commune des concepts didactiques utilisés dans ce programme, un glossaire est proposé. Il définit de manière simple et claire les termes clés de la pédagogie de la langue au cycle élémentaire. 📖 Des termes comme « phonème », « graphème », « conscience phonologique », « motricité fine », « partenariat bilingue » ou « évaluation formative » y sont explicités. Ce lexique a pour but de fournir aux enseignants un langage professionnel partagé, de clarifier les intentions du programme national et de les outiller pour réfléchir à leurs pratiques et échanger avec leurs collègues de manière précise et constructive.


