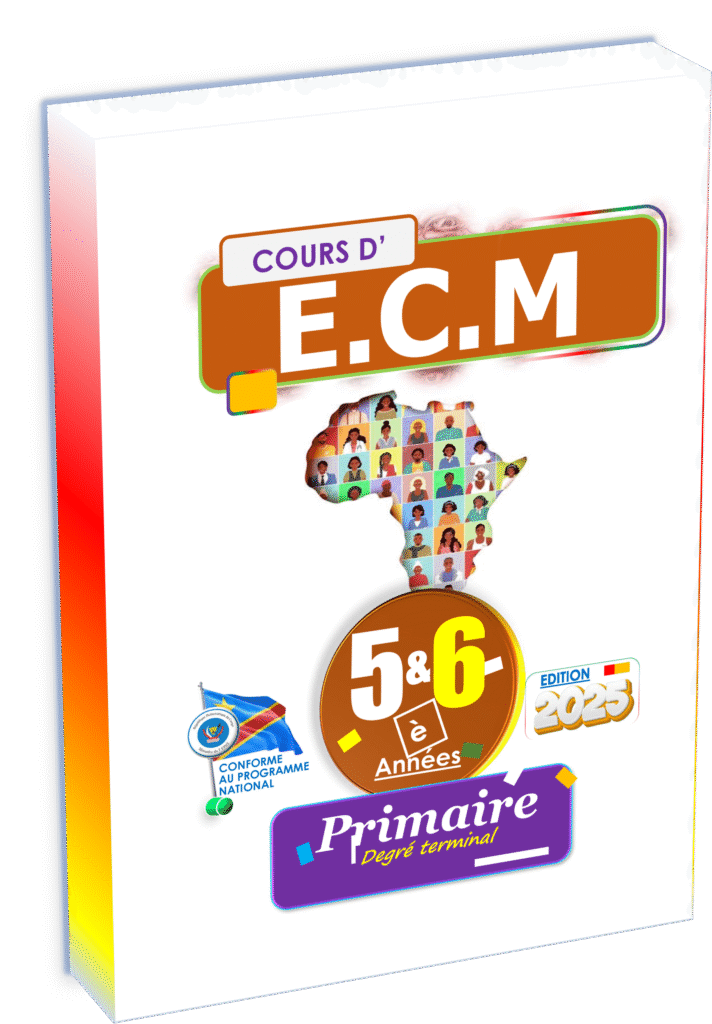
COURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE, 5ÈME ET 6ÈME ANNÉE PRIMAIRE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
PRÉLIMINAIRES
0.1. Finalités et Buts de l’Éducation Artistique
L’enseignement de l’Éducation Artistique au degré terminal a pour finalité de conduire l’élève à une pratique artistique réfléchie et maîtrisée, et de former un spectateur éclairé, capable d’apprécier la beauté et de porter un jugement esthétique argumenté. L’objectif principal est de dépasser la simple expression spontanée pour atteindre une représentation du réel qui allie observation, technique et sensibilité. 🎨 Ce cours vise à ce que l’élève puisse organiser des éléments divers pour créer des ensembles harmonieux, exprimer le beau dans le mouvement des formes et des lignes, et analyser des productions artistiques. Il s’agit de structurer sa pensée créatrice, d’affiner ses compétences techniques en arts plastiques et musicaux, et de consolider son ancrage dans le patrimoine culturel national tout en l’ouvrant à d’autres cultures.
0.2. Profil de Sortie du Degré Terminal
Au terme du cycle primaire, l’élève doit avoir développé des compétences artistiques qui manifestent une maturité dans sa perception et sa production. Il doit être capable de reconnaître et d’exprimer le beau à travers une production artistique personnelle. Il est attendu de lui qu’il puisse véhiculer un message ou une émotion de manière intentionnelle à travers le dessin, le modelage, le chant ou une saynète. 🎭 L’élève doit pouvoir analyser de manière simple une œuvre musicale ou plastique et apprécier la musique d’autres cultures. Il doit également être en mesure de participer activement à la conception et à la réalisation de projets collectifs comme une exposition ou un spectacle musical. Ce profil garantit qu’il a acquis les bases d’une culture artistique solide, un langage technique élémentaire et une capacité d’expression personnelle affirmée.
0.3. Approche Pédagogique et Didactique
L’approche pédagogique au degré terminal articule la pratique créative et l’analyse réflexive. La démarche didactique, tout en restant ancrée dans l’observation du milieu, vise à obtenir plus de réalisme, de vérité et de beauté dans les productions. L’enseignement est collectif, mais le suivi individualisé est renforcé pour accompagner chaque élève dans son cheminement technique et expressif. 🎼 L’enseignant agit comme un médiateur culturel, qui non seulement transmet des savoir-faire, mais donne également des clés de lecture pour analyser les œuvres et comprendre les principes simples de la composition. Les projets, individuels ou collectifs, sont le moyen privilégié pour intégrer les différentes compétences et pour donner un sens et une finalité aux apprentissages.
PARTIE 1 : LA MAÎTRISE DE LA REPRÉSENTATION RÉALISTE ET DOCUMENTAIRE
CHAPITRE 1 : LE DESSIN D’OBSERVATION APPROFONDI ✍️
1.1. La Représentation d’Objets Complexes et de Corps Géométriques
Ce sous-chapitre vise à complexifier la pratique du dessin d’après nature. L’élève apprend à observer et à dessiner non plus des objets isolés, mais des groupements d’objets (une nature morte simple avec une bouteille et un fruit) ou des objets évoquant des corps géométriques complexes (caisses, meubles). 🧊 Il s’exerce à représenter correctement les proportions relatives des objets entre eux et à traduire leur volume. Cette compétence exige une analyse visuelle plus fine et une plus grande maîtrise du trait pour rendre compte de la structure et de l’agencement des formes.
1.2. Le Croquis Rapide et Schématique du Vivant
L’élève perfectionne sa technique du croquis animalier et humain. L’objectif est de capter en quelques traits rapides et synthétiques l’attitude, le mouvement et les proportions caractéristiques d’un sujet vivant. Il s’entraîne à saisir la posture d’une chèvre qui broute dans la cour de l’école à Kikwit, le mouvement d’un canard qui nage, ou celui d’un camarade en pleine course. 🐐 Cet exercice développe une observation dynamique, une grande rapidité d’exécution et la capacité à extraire l’essentiel d’une scène.
1.3. L’Initiation à la Perspective Élémentaire pour Suggérer la Profondeur
Pour donner une illusion de profondeur et de réalisme à ses dessins, l’élève est initié aux règles de base de la perspective. Il découvre de manière intuitive puis guidée les principes suivants : les objets plus lointains apparaissent plus petits, et les lignes parallèles (comme les bords d’une route ou d’une voie ferrée à Lubumbashi) semblent converger vers un point de fuite à l’horizon. 🛤️ L’application de ces règles simples transforme radicalement la représentation de l’espace dans ses paysages et ses scènes.
1.4. La Représentation du Corps Humain et de ses Proportions
L’élève aborde de manière plus structurée le dessin du corps humain. Il est initié aux canons de proportions simples (la tête comme unité de mesure, la position des articulations). Il observe et dessine ses camarades dans différentes postures pour comprendre comment le corps s’articule et se meut. 🧍♂️ Cette étude, qui combine observation et connaissance de règles simples, lui permet de réaliser des personnages plus justes et plus expressifs dans ses compositions.
CHAPITRE 2 : LE DESSIN D’ILLUSTRATION ET DE DOCUMENTATION documenting
2.1. L’Illustration Précise de Sujets liés à la Faune et la Flore
Le dessin devient un outil d’étude scientifique. L’élève réalise des planches d’illustration sur des sujets liés à la faune et la flore locale. Il peut par exemple dessiner avec précision les différentes étapes de la métamorphose d’un papillon, ou représenter une plante médicinale de la région du Kivu en détaillant la forme de ses feuilles, de sa fleur et de son fruit. 🦋 Cette pratique du dessin documentaire exige rigueur, précision et développe une connaissance intime du patrimoine naturel.
2.2. Le Dessin Documentaire au Service des Autres Disciplines
Ce sous-chapitre systématise l’utilisation du dessin comme outil de documentation dans tous les apprentissages. En histoire, l’élève réalise des croquis d’outils anciens ou de costumes traditionnels. En géographie, il dessine des cartes schématiques ou des profils de relief. 🗺️ Le croquis documentaire, réalisé lors de recherches personnelles, de visites ou de classes promenades, devient une méthode de travail à part entière pour enregistrer, comprendre et communiquer l’information.
2.3. La Schématisation des Activités de la Vie Quotidienne
L’élève apprend à représenter de manière schématique des scènes de la vie quotidienne. Il ne s’agit plus seulement de dessiner des objets, mais de représenter des actions et des interactions. Il peut réaliser une séquence de dessins pour expliquer les étapes de la préparation du foufou, ou schématiser l’organisation du travail lors d’une pêche collective sur le fleuve près de Mbandaka. 🎣 Cette compétence développe sa capacité à analyser un processus et à le communiquer visuellement.
2.4. La Création de Planches Thématiques et Didactiques
En synthèse des compétences acquises, l’élève est amené à concevoir et à réaliser une planche thématique complète, à la manière d’une page d’encyclopédie. Sur une grande feuille, il organise plusieurs dessins, schémas et textes courts pour présenter un sujet de manière claire et didactique (par exemple, « Les différents types de pirogues du fleuve Congo »). 📜 Ce travail de composition et de mise en page développe des compétences de recherche, de synthèse et de communication visuelle.
CHAPITRE 3 : LA MAÎTRISE DE LA LUMIÈRE, DE LA COULEUR ET DU MODELÉ ✨
3.1. L’Application Systématique des Ombres et de la Lumière
L’élève approfondit sa maîtrise du modelé. Il apprend à utiliser une gamme de valeurs (du blanc au noir en passant par différents gris) pour rendre le volume des objets. Il étudie la manière dont la lumière sculpte les formes et crée des ombres propres (sur l’objet) et des ombres portées (sur la surface où il est posé). ⚪⚫ Il s’exerce à l’art du dégradé et du hachurage pour donner une impression de relief saisissante à ses dessins.
3.2. L’Harmonisation Consciente des Couleurs et des Nuances
L’élève apprend à utiliser la couleur de manière plus réfléchie et subtile. Il va au-delà des couleurs vives pour explorer les nuances, les tons rompus et les camaïeux. Il apprend à créer des harmonies de couleurs (harmonies chaudes, harmonies froides) pour donner une atmosphère particulière à ses compositions. 🎨 Il découvre que l’harmonisation des couleurs est un élément clé de la beauté et de l’équilibre d’une œuvre.
3.3. La Représentation Graphique des Textures et des Matières
Ce sous-chapitre vise à rendre les dessins plus réalistes en traduisant la texture des matériaux. L’élève apprend, par des jeux de graphisme (traits, points, frottages), à suggérer visuellement la rugosité de l’écorce d’un arbre, la brillance du métal, la transparence du verre ou le moelleux d’un tissu. 🪵 Cette compétence de traduction des sensations tactiles en langage visuel enrichit considérablement le réalisme de ses représentations.
3.4. La Maîtrise de la Représentation de Face et de Profil
Pour représenter le vivant de manière juste, l’élève doit maîtriser les vues fondamentales. Il s’exerce de manière rigoureuse à dessiner un visage ou un animal de face, en veillant scrupuleusement à la symétrie des éléments. Il apprend également à dessiner de profil, en étudiant la ligne caractéristique qui définit la silhouette. 👤 La maîtrise de ces deux vues canoniques est une étape essentielle de l’apprentissage du portrait et du dessin animalier.
PARTIE 2 : LA COMPOSITION PLASTIQUE ET L’ART DÉCORATIF
CHAPITRE 4 : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA COMPOSITION DÉCORATIVE 💠
4.1. La Utilisation Structurée de la Répétition, de l’Alternance et de la Symétrie
L’élève découvre les principes de base qui permettent d’organiser un décor. Il apprend à créer des rythmes visuels en utilisant la répétition d’un même motif. Il complexifie ce rythme en utilisant l’alternance de deux motifs ou de deux couleurs. Il explore la symétrie axiale comme un principe puissant d’équilibre et d’harmonie, très présent dans les arts décoratifs du monde entier. 🔷🔶
4.2. L’Exploration de l’Inversion et de la Superposition Partielle
Pour créer des motifs plus complexes et dynamiques, l’élève est initié à d’autres procédés de transformation. Il découvre l’inversion, qui consiste à reprendre un motif en miroir. Il explore également la superposition partielle, où les formes se chevauchent pour créer de nouvelles formes et une impression de profondeur. 🧩 L’expérimentation de ces procédés enrichit sa « grammaire » décorative.
4.3. La Création de Jeux de Fonds, de Frises, de Coins et de Cadres
L’élève applique les principes de composition pour créer différents types d’ornements. Il réalise des jeux de fonds (ou pavages) en recouvrant une surface de motifs répétitifs. Il conçoit des frises pour décorer des bordures. Il apprend à créer des motifs spécifiques pour les coins et à composer des cadres décoratifs pour mettre en valeur un dessin ou un texte. 🖼️ Cette pratique le familiarise avec les différentes fonctions de l’ornementation.
4.4. La Recherche de l’Équilibre et de l’Harmonie dans la Composition
Ce sous-chapitre de synthèse vise à développer le sens esthétique de l’élève. Au-delà de l’application mécanique des procédés, il est encouragé à juger de la qualité de ses propres compositions décoratives. Il apprend à évaluer l’équilibre des formes, l’harmonie des couleurs et le rythme général de son œuvre. ✨ L’objectif est de le rendre capable de faire des choix esthétiques conscients pour créer des décors qui soient non seulement organisés, mais aussi beaux.
CHAPITRE 5 : L’APPLICATION DES PRINCIPES À L’ART DÉCORATIF CONGOLAIS 🇨🇩
5.1. L’Analyse et la Réinterprétation des Motifs Décoratifs Kuba
L’art Kuba, notamment celui des tissus Shoowa, est célèbre pour la complexité et la beauté de ses motifs géométriques abstraits. L’élève est amené à observer et à analyser ces motifs. 🏛️ Il identifie les formes de base, les principes de répétition, de symétrie et de variation qui les régissent. Il est ensuite invité, non pas à copier servilement, mais à s’inspirer de cette esthétique pour créer ses propres compositions décoratives « à la manière Kuba ».
5.2. L’Inspiration des Arts Sculpturaux Luba et Pende
Bien que principalement sculpturaux, les arts Luba et Pende présentent des éléments décoratifs riches. L’élève peut observer les scarifications représentées sur les statues Luba ou les motifs graphiques peints sur certains masques Pende. 🎭 Il analyse ces éléments décoratifs (lignes, points, formes géométriques) et s’en inspire pour enrichir ses propres créations graphiques, en transposant des motifs de la sculpture vers le dessin.
5.3. La Pratique de la Décoration sur des Objets Usuels
L’art décoratif est un art appliqué. L’élève est invité à décorer des objets du quotidien. Il peut peindre des motifs géométriques sur un pot en argile qu’il a fabriqué, pyrograver un décor sur une cuillère en bois, ou décorer la couverture d’un cahier. 🏺 Cette pratique lui montre que l’art n’est pas seulement destiné aux musées, mais qu’il peut embellir la vie de tous les jours.
5.4. La Création de Modèles d’Ornement Personnels et Originaux
Après s’être nourri de l’observation des traditions, l’élève est encouragé à développer son propre langage décoratif. En combinant les différents principes et motifs qu’il a étudiés, il est invité à créer des modèles d’ornement personnels et originaux. 💡 L’objectif est de le faire passer du statut de reproducteur à celui de créateur, capable de développer un style qui lui est propre.
CHAPITRE 6 : LA COMMUNICATION VISUELLE ET LA NARRATION GRAPHIQUE 📢
6.1. La Conception d’Affiches et de Supports de Communication Visuelle
L’élève apprend à utiliser ses compétences artistiques à des fins de communication. Il est initié à la conception d’affiches pour des événements scolaires ou des campagnes de sensibilisation. Il apprend les règles de base d’une affiche efficace : un message clair, une image percutante, une typographie lisible et une composition qui attire le regard. 📰
6.2. L’Intégration Harmonieuse du Texte et de l’Image
Ce sous-chapitre approfondit les principes de la mise en page. L’élève apprend à organiser le texte et l’image sur une surface pour créer un ensemble cohérent et esthétique. Il expérimente différentes dispositions et apprend à hiérarchiser l’information en jouant sur la taille et le style des caractères. 📜 Il comprend que le texte peut devenir un élément graphique à part entière dans la composition.
6.3. Le Perfectionnement de la Création de Bandes Dessinées
L’élève développe ses compétences en narration graphique. Il apprend à créer des bandes dessinées plus longues et plus structurées. Il est initié à l’utilisation de différents plans (plan large, gros plan) pour dynamiser son récit, et à l’usage des onomatopées pour représenter les bruits. 💥 La création d’une bande dessinée de plusieurs pages est un projet intégrateur qui mobilise des compétences en dessin, en narration et en mise en page.
6.4. La Production et la Collecte d’Illustrations Décoratives et Documentaires
Ce volet du programme encourage l’élève à se constituer une « banque d’images » personnelle. Il est invité à collectionner des illustrations qui lui plaisent (découpées dans des magazines, par exemple) et à les classer. 📂 Il est également encouragé à produire régulièrement ses propres illustrations, qu’elles soient décoratives ou documentaires, pour enrichir son portfolio personnel et pour servir de ressource pour des projets futurs.
PARTIE 3 : L’EXPRESSION EN VOLUME : MODELAGE, SCULPTURE ET ARTISANAT
CHAPITRE 7 : LES TECHNIQUES AVANCÉES DE MODELAGE ET DE SCULPTURE 🗿
7.1. Le Perfectionnement du Modelage du Buste Humain
L’élève approfondit sa pratique du portrait en trois dimensions. Il apprend à modeler un buste humain en portant une attention accrue aux proportions, à la structure osseuse sous-jacente (crâne, mâchoire) et au rendu des traits caractéristiques du visage. 👤 Ce travail exigeant développe une perception très fine des volumes et des formes complexes du corps humain.
7.2. La Technique de Création de Bas-reliefs
Le bas-relief est une technique de sculpture à mi-chemin entre le dessin et la ronde-bosse. L’élève apprend à modeler une scène ou un portrait sur une plaque d’argile, en faisant ressortir les formes du fond sans les en détacher complètement. 🖼️ Cette technique l’oblige à penser en termes de plans successifs et de profondeur, développant ainsi une sensibilité particulière au jeu de la lumière sur les volumes.
7.3. Les Techniques de Finition et de Patine de l’Argile
Une sculpture en argile peut être sublimée par sa finition. L’élève découvre différentes techniques pour traiter la surface de ses modelages après séchage ou cuisson. Il peut la polir pour la rendre lisse et brillante, ou au contraire lui donner une texture. Il est initié à l’art de la patine, qui consiste à appliquer des pigments ou des cires pour donner à l’objet un aspect vieilli, métallique ou coloré. ✨
7.4. Le Passage du Modelage à la Réalisation d’une Pièce Durable
Ce sous-chapitre aborde la question de la pérennité de l’œuvre. L’élève peut être initié à des techniques simples de moulage (avec du plâtre) pour créer une copie durable de son modelage en argile. Cette démarche lui fait découvrir le processus qui permet de passer d’une ébauche fragile (le modèle) à une œuvre finale et solide (le tirage). 🔄
CHAPITRE 8 : L’INITIATION À LA SCULPTURE SUR DIVERS MATÉRIAUX 🔨
8.1. L’Identification des Matériaux et des Outils Spécifiques à la Sculpture
L’élève élargit sa connaissance des matériaux de la sculpture. Au-delà du bois tendre, il peut être initié à la sculpture sur d’autres matériaux comme la stéatite (pierre à savon) ou le plâtre durci. Il apprend à identifier et à nommer les outils spécifiques du sculpteur : les gouges, les ciseaux à bois, les gradines. 🛠️ L’accent est mis sur l’apprentissage des règles de sécurité liées à la manipulation de ces outils.
8.2. La Pratique de la Sculpture par Soustraction sur Matériaux Tendres
L’élève perfectionne sa technique de sculpture par taille directe (soustraction de matière). Il apprend à dégager progressivement une forme d’un bloc, en travaillant du général au particulier. Il apprend à penser en termes de volumes et à tourner autour de sa pièce pour la travailler sur toutes ses faces. 🗽 Cette approche développe la vision dans l’espace et la capacité d’anticipation.
8.3. La Sculpture par Assemblage de Matériaux Divers et de Récupération
En contrepoint de la taille, l’élève explore la sculpture par assemblage (addition de matière). Il collecte des matériaux variés (morceaux de bois, pièces métalliques, objets en plastique) et apprend à les assembler par clouage, vissage, collage ou ligature pour créer des compositions tridimensionnelles. ⚙️ Cette démarche, proche de celle de nombreux artistes contemporains, développe la créativité et l’ingéniosité.
8.4. Le Vernissage et la Finition des Pièces Sculptées
Comme pour le modelage, la finition est une étape cruciale de la sculpture. L’élève apprend à soigner la surface de ses œuvres. Il utilise le ponçage pour lisser le bois, la lime pour adoucir le métal. Il applique ensuite une couche de finition (vernis, cire, peinture) pour protéger sa sculpture et en mettre en valeur la matière ou la forme. 🖌️
CHAPITRE 9 : L’ARTISANAT D’ART ET LA CRÉATION D’OBJETS COMPLEXES 🎭
9.1. La Fabrication d’un Masque par des Techniques Mixtes
La création d’un masque est un projet complet qui permet de combiner de nombreuses techniques. L’élève conçoit un masque en s’inspirant des traditions Pende ou Yaka. Il en crée la structure de base par modelage sur un support ou par assemblage de carton. 👺 Il le décore ensuite en utilisant des techniques mixtes : peinture, collage de fibres de raphia, ajout de coquillages ou de perles.
9.2. La Création d’Objets Utilitaires Traditionnels (Pilon, Mortier)
Ce projet, mentionné dans le programme, connecte l’art à la vie quotidienne. L’élève participe à la fabrication d’objets utilitaires en bois, comme un pilon ou un petit mortier. Ce travail lui permet de mettre en pratique les techniques de sculpture tout en réfléchissant à la fonctionnalité et à l’ergonomie de l’objet. Il peut également s’exercer à y graver des motifs décoratifs. 🥣
9.3. La Marionnette comme Œuvre Plastique et Outil Scénique
L’élève découvre l’art de la marionnette. Il conçoit et fabrique une marionnette (à gaine, à tige ou à fils) en utilisant une variété de matériaux (tissu, bois, papier mâché). La création de la marionnette est un projet plastique complet. puppets Elle devient ensuite un outil d’expression théâtrale, l’élève apprenant à la manipuler pour lui donner vie et lui faire jouer un rôle dans une saynète.
9.4. L’Organisation d’une Exposition Thématique des Œuvres en Volume
Ce sous-chapitre est l’aboutissement des apprentissages en trois dimensions. La classe organise une exposition de toutes les sculptures, poteries et objets artisanaux réalisés. 🖼️ Les élèves prennent en charge la scénographie : ils réfléchissent à la manière de présenter les œuvres dans l’espace, en utilisant des socles, des éclairages simples, pour les mettre en valeur. Ils rédigent les cartels et accueillent les visiteurs, devenant ainsi les médiateurs de leur propre travail.
PARTIE 4 : L’UNIVERS MUSICAL : DE L’ANALYSE À L’INTERPRÉTATION
CHAPITRE 10 : LES FONDEMENTS DU LANGAGE ET DE LA NOTATION MUSICALE 🎼
10.1. La Distinction Fine entre Son, Bruit et Note de Musique
L’élève affine sa discrimination auditive. Il apprend à distinguer un bruit (son complexe et non organisé) d’un son musical (qui a une hauteur déterminée). Il apprend que la note de musique est le nom que l’on donne à un son musical d’une hauteur précise. 🔊 Il s’exerce à identifier ces différentes catégories de sons dans son environnement et dans des extraits musicaux.
10.2. L’Utilisation de la Portée et la Lecture des Notes (Do-Ré-Mi)
L’élève est initié aux bases du solfège. Il découvre la portée (les cinq lignes sur lesquelles on écrit la musique) et la clé de Sol. Il apprend à lire la position des notes de la gamme (Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si) sur la portée. 🎵 Des exercices ludiques de lecture de notes et de petites mélodies simples lui permettent de commencer à déchiffrer une partition.
10.3. La Compréhension et la Variation des Rythmes (2, 3, 4 temps)
L’élève approfondit sa maîtrise du rythme. Il apprend à reconnaître à l’oreille les mesures à 2, 3 et 4 temps. Il découvre les figures de notes de base (noire, blanche, croche) et leur durée relative. 🥁 Il s’exerce à lire et à frapper des formules rythmiques simples écrites sur une seule ligne, en utilisant la percussion corporelle ou des instruments.
10.4. L’Identification du Timbre des Instruments de l’Orchestre
Le timbre est la « couleur » du son, ce qui permet de distinguer deux instruments qui jouent la même note. L’élève est entraîné à reconnaître le timbre des principaux instruments de la musique congolaise (moderne et traditionnelle) et de l’orchestre occidental. 🎺 Des jeux d’écoute de type « blind test » lui permettent de développer son oreille et d’enrichir sa culture musicale.
CHAPITRE 11 : L’INTERPRÉTATION ET L’APPRÉCIATION MUSICALE 🎶
11.1. Le Perfectionnement du Chant Juste et Harmonieux en Groupe
La pratique de la chorale se poursuit et se complexifie. L’élève est entraîné à chanter avec une plus grande justesse et à maintenir sa voix dans un ensemble polyphonique simple. 🎤 L’enseignant travaille la qualité du son du groupe, l’équilibre entre les différentes voix et l’interprétation commune de l’œuvre.
11.2. L’Interprétation d’un Répertoire de Chansons Variées
Le répertoire de la chorale s’élargit pour inclure des chansons de styles et d’origines variés. En plus des chants patriotiques et traditionnels, l’élève peut aborder des chansons de la variété congolaise, des gospels ou des chants simples d’autres cultures. 🌍 Cet élargissement du répertoire développe sa flexibilité vocale et son ouverture culturelle.
11.3. L’Analyse Guidée de Courts Extraits d’Œuvres Musicales
L’élève apprend à écouter la musique de manière analytique. Guidé par l’enseignant, il apprend à commenter un court extrait musical. Il est invité à décrire ce qu’il entend : les instruments utilisés, le rythme, la mélodie (est-elle joyeuse ou triste ?), la structure du morceau (y a-t-il un refrain ?). 🎧 Cette écoute active lui donne des outils pour mieux comprendre et apprécier la musique qu’il entend.
11.4. L’Ouverture et l’Appréciation de la Musique d’Autres Cultures
Ce sous-chapitre vise à développer la curiosité et l’ouverture de l’élève à la diversité musicale du monde. L’enseignant lui fait découvrir des extraits de musiques d’autres régions d’Afrique ou d’autres continents. 🌐 L’objectif est de lui faire prendre conscience de la richesse et de la variété des expressions musicales humaines et de développer une attitude de respect et d’appréciation pour les cultures différentes de la sienne.
CHAPITRE 12 : LA CRÉATION ET LA PRATIQUE MUSICALE COLLECTIVE 🎸
12.1. L’Organisation et la Vie d’un Groupe Musical Scolaire
La création d’un groupe musical devient un projet mené par les élèves. Ils participent au choix du nom du groupe, du style de musique et du répertoire. Ils peuvent prendre en charge des aspects de l’organisation, comme la planification des répétitions ou la communication autour de leurs concerts. 👨🎤 Cette responsabilisation développe leur autonomie et leur esprit d’initiative.
12.2. L’Utilisation et l’Intégration d’Instruments du Milieu
Le groupe musical de l’école a pour vocation de valoriser les ressources locales. Les élèves sont encouragés à intégrer des instruments de musique traditionnels (tam-tams, likembes…) aux côtés d’instruments modernes (guitare, clavier). 🥁 Ils peuvent également fabriquer leurs propres instruments de percussion. Cette démarche favorise la créativité et un métissage musical original.
12.3. La Composition et l’Expression des Sentiments par la Musique
L’élève est encouragé à passer de l’interprétation à la création. En groupe, il peut être invité à composer une mélodie simple sur un poème qu’il a écrit, ou à créer une pièce instrumentale pour accompagner une saynète. 💡 Il apprend que la musique est un langage puissant pour exprimer des sentiments et des émotions qui ne peuvent pas toujours être dits avec des mots.
12.4. Le Montage et la Présentation d’un Spectacle Musical
Ce sous-chapitre est l’aboutissement de la pratique musicale collective. Le groupe prépare et présente un petit concert ou un spectacle musical complet devant un public. 🌟 La préparation de ce spectacle est un projet qui intègre toutes les compétences acquises : la maîtrise technique des instruments et des voix, l’interprétation expressive, la mise en scène et la gestion de projet. La confrontation avec le public est une expérience forte et valorisante.
ANNEXES
1. Guide des Techniques de Dessin et de Peinture
Cette section fournit des fiches techniques illustrées sur les principales techniques abordées au degré terminal. On y trouvera des guides pas-à-pas sur : la perspective à un point de fuite, les proportions du visage humain, les techniques de hachurage pour le modelé, et le mélange des couleurs pour obtenir des tons tertiaires et des nuances. 🎨 Ces fiches servent de support visuel pour l’enseignant et de mémorial pour les élèves, consolidant les apprentissages techniques.
2. Fiches sur les Arts Traditionnels de la RDC
Pour approfondir la connaissance du patrimoine national, cette annexe propose des fiches documentaires sur des traditions artistiques majeures du Congo. Chaque fiche, richement illustrée, est consacrée à un art spécifique (par exemple, la statuaire Hemba, les masques Luba, l’architecture Pende). Elle en décrit les caractéristiques stylistiques, la fonction rituelle ou sociale, et propose des pistes d’activités créatives à mener en classe. 🇨🇩 Ces fiches constituent une base de données culturelle précieuse pour l’enseignant.
3. Notions Élémentaires de Solfège et de Théorie Musicale
Afin de soutenir l’initiation au langage musical, cette section propose des fiches synthétiques sur les bases du solfège. Elles présentent de manière claire et visuelle la portée, les clés, les notes, les figures de notes (ronde, blanche, noire…) et leur durée, ainsi que la signification des mesures (2/4, 3/4, 4/4). 🎶 Ces fiches constituent un support théorique simple mais rigoureux pour accompagner la pratique musicale et la lecture de partitions.
4. Canevas pour l’Analyse d’une Œuvre d’Art
Pour guider les élèves dans leur pratique de l’appréciation critique, cette annexe propose un canevas d’analyse simple. La fiche, sous forme de questionnaire, invite l’élève à décrire ce qu’il voit (les sujets, les formes, les couleurs), à analyser comment l’œuvre est faite (la technique, la composition) et à interpréter ce que l’artiste a voulu exprimer et ce que l’œuvre lui fait ressentir. 🧐 Cet outil structure le regard et le discours de l’élève, l’amenant à dépasser une approche purement subjective pour entrer dans une véritable analyse esthétique.


