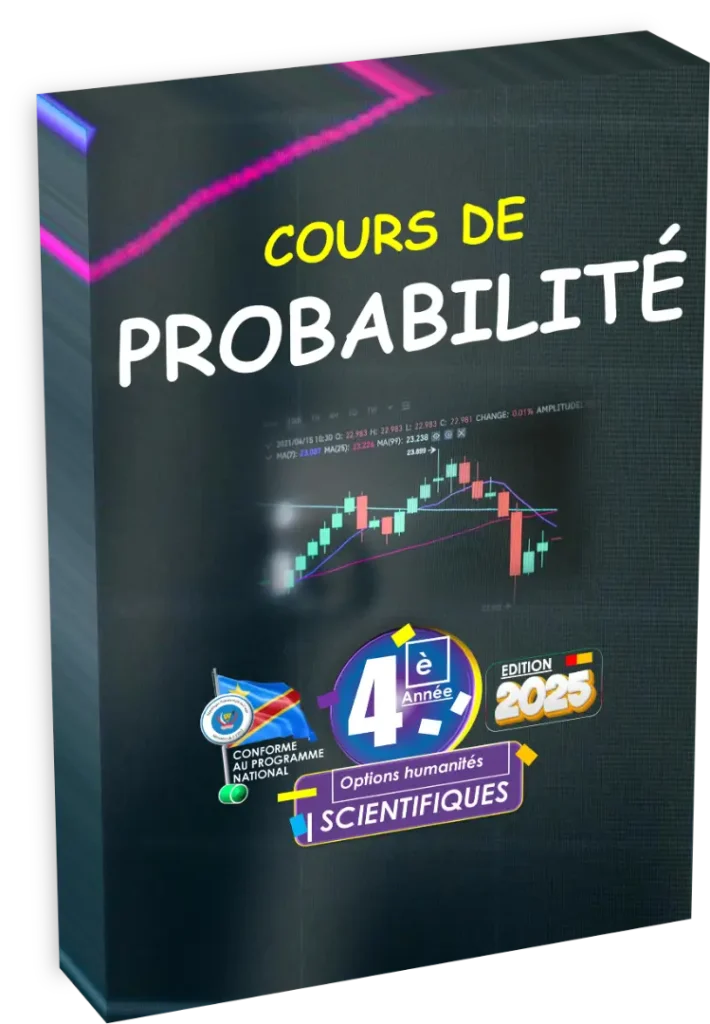
COURS DE PROBABILITÉ, 4ÈME ANNÉE, OPTION HUMANITES SCIENTIFIQUES
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC
1. PRÉLIMINAIRES
1.1. Objectifs Généraux du Cours
Ce cours vise la maîtrise des outils mathématiques nécessaires à la modélisation de l’incertitude et du hasard 🎲. L’élève développera une compréhension rigoureuse des phénomènes aléatoires, essentiels tant pour les sciences exactes que pour les sciences de la vie. L’enseignement permet l’acquisition de méthodes de quantification du risque et favorise la prise de décision rationnelle dans des contextes variés, allant de la génétique à la gestion des ressources naturelles en République Démocratique du Congo 🇨🇩. L’objectif ultime réside dans la capacité de l’apprenant à interpréter des données statistiques et à appliquer les lois de probabilité pour prédire des comportements futurs.
1.2. Compétences à Développer
À l’issue de cet enseignement, l’élève démontrera sa capacité à formaliser un problème aléatoire en définissant l’univers des possibles et les événements associés. Il calculera avec aisance les probabilités simples, conditionnelles et composées en mobilisant l’analyse combinatoire. L’apprenant manipulera les variables aléatoires pour déterminer l’espérance mathématique et l’écart-type, interprétant ces résultats dans des contextes concrets comme la démographie kinoise ou l’agronomie au Kongo Central. Il appliquera les lois de distribution, notamment la loi binomiale, et utilisera le test du Khi-carré pour valider des hypothèses génétiques, liant ainsi les mathématiques à la biologie 🧬.
1.3. Prérequis et Liens Interdisciplinaires
La réussite de ce module exige une maîtrise solide de la théorie des ensembles, de l’algèbre élémentaire et du calcul des puissances acquis lors des années précédentes (3ème année des Humanités). La manipulation des fractions et la compréhension des fonctions numériques constituent des atouts indispensables. Ce cours établit des ponts directs avec le programme de Biologie (Génétique, MSVT 6.17-6.19) pour l’étude de l’hérédité, et avec la Géographie pour l’analyse des données démographiques et climatiques.
1.4. Méthodologie et Évaluation
L’approche pédagogique privilégie la résolution de problèmes concrets ancrés dans les réalités congolaises avant la formalisation théorique. L’évaluation se fera de manière continue et sommative, vérifiant l’acquisition des savoirs essentiels et la compétence à traiter des situations complexes. Les critères d’évaluation incluront la justesse du raisonnement, la précision des calculs, et la pertinence de l’interprétation des résultats statistiques dans des situations de vie réelle.
PARTIE 1 : FONDEMENTS ET OUTILS DE DÉNOMBREMENT
Cette première partie établit les bases logiques et calculatoires nécessaires à la quantification du hasard. Elle débute par une consolidation des techniques de dénombrement, indispensables pour déterminer la cardinalité des ensembles finis, avant d’introduire le formalisme probabiliste. L’accent est mis sur la structuration de la pensée logique et la capacité à modéliser des expériences aléatoires simples. L’élève acquiert ici le vocabulaire et les théorèmes fondamentaux régissant les événements et leurs interactions.
Chapitre 1 : Analyse Combinatoire et Dénombrement
1.1. Principes Fondamentaux de Comptage Cette section expose les règles additives et multiplicatives du dénombrement. L’élève apprend à décomposer une expérience complexe en une succession d’étapes simples pour en déterminer le nombre total d’issues. Les exemples incluent le calcul des itinéraires possibles entre Lubumbashi et Kolwezi ou les configurations de plaques d’immatriculation à Kinshasa 🚗.
1.2. Permutations et Factorielles L’étude se concentre sur l’ordonnancement d’éléments distincts. L’élève maîtrise la notation factorielle () et l’applique pour calculer le nombre de manières d’organiser une file d’attente ou de classer des objets. La distinction entre permutations avec et sans répétition permet de résoudre des problèmes d’anagrammes ou de disposition d’objets.
1.3. Arrangements Ce point aborde la sélection ordonnée d’une partie des éléments d’un ensemble. L’élève différencie les arrangements des permutations par la notion de sous-ensemble. Les applications pratiques concernent l’attribution de postes distincts (président, secrétaire, trésorier) au sein d’un comité scolaire ou la formation de codes secrets.
1.4. Combinaisons et Triangle de Pascal Contrairement aux arrangements, les combinaisons traitent des sélections où l’ordre importe peu. L’élève utilise la formule des combinaisons () pour former des équipes ou sélectionner des échantillons. La construction et les propriétés du Triangle de Pascal introduisent les coefficients binomiaux, essentiels pour le développement ultérieur de la loi binomiale.
Chapitre 2 : Concepts Fondamentaux de Probabilité
2.1. Expériences Aléatoires et Univers L’élève définit rigoureusement l’expérience aléatoire, caractérisée par l’imprévisibilité du résultat individuel malgré une régularité statistique. La notion d’univers (), ensemble de tous les résultats possibles, est illustrée par des lancers de dés, des tirages de cartes ou des observations météorologiques dans la cuvette centrale 🌧️.
2.2. Événements et Opérations Ensemblistes Ce sous-chapitre formalise les événements comme des sous-ensembles de l’univers. L’élève manipule les opérations d’intersection (ET), d’union (OU) et de complémentarité (NON). L’utilisation des diagrammes de Venn facilite la visualisation des relations entre événements compatibles, incompatibles et contraires.
2.3. Définition et Axiomes de Probabilité La probabilité est introduite comme une mesure normalisée comprise entre 0 et 1. L’élève assimile les axiomes de Kolmogorov, notamment la positivité et l’additivité pour des événements disjoints. Cette formalisation mathématique ancre la théorie des probabilités dans une structure cohérente et rigoureuse.
2.4. Équiprobabilité et Formule de Laplace Dans le cas particulier où toutes les issues ont la même chance de se réaliser, l’élève applique la formule classique : nombre de cas favorables divisé par nombre de cas possibles. Cette section lie directement les compétences de dénombrement acquises au chapitre précédent au calcul probabiliste, avec des applications sur les jeux de hasard équitables 🎲.
Chapitre 3 : Probabilités Conditionnelles et Indépendance
3.1. Notion de Probabilité Conditionnelle L’élève analyse comment la réalisation d’un événement modifie la probabilité d’un autre. La formule est expliquée et appliquée à des contextes réels, tels que la probabilité d’avoir une maladie sachant qu’un test est positif. L’accent est mis sur la restriction de l’univers de référence.
3.2. Théorème de la Multiplication Ce point dérive directement de la définition conditionnelle pour calculer la probabilité de l’intersection de deux événements. L’élève utilise les arbres de probabilité pondérés pour résoudre des problèmes séquentiels, comme les tirages successifs sans remise d’urnes contenant des boules de couleurs différentes.
3.3. Théorème des Probabilités Totales et de Bayes L’élève apprend à décomposer un événement complexe en utilisant une partition de l’univers. Le théorème de Bayes permet d’inverser le conditionnement pour remonter des effets aux causes. Les applications incluent le diagnostic médical et l’analyse de fiabilité des systèmes industriels miniers du Katanga 🏭.
3.4. Indépendance des Événements La distinction conceptuelle entre événements indépendants et événements incompatibles est clarifiée. L’élève vérifie l’indépendance par le calcul () et comprend que la réalisation de l’un n’influence pas la probabilité de l’autre, concept clé pour les épreuves répétées.
Chapitre 4 : Variables Aléatoires Discrètes
4.1. Définition et Caractérisation Une variable aléatoire est présentée comme une fonction numérique associant un réel à chaque issue d’une expérience aléatoire. L’élève distingue les variables discrètes (valeurs dénombrables) des variables continues. Les exemples incluent le nombre de pièces défectueuses dans un lot ou le nombre d’enfants dans un ménage kinois.
4.2. Loi de Probabilité L’élève construit le tableau de distribution de probabilité associant chaque valeur possible de la variable à sa probabilité d’occurrence. Il vérifie que la somme des probabilités est égale à 1. Cette représentation synthétique permet de visualiser le comportement global du phénomène aléatoire.
4.3. Fonction de Répartition La fonction de répartition est introduite pour calculer la probabilité que la variable soit inférieure ou égale à une valeur donnée. L’élève trace la représentation graphique en escalier caractéristique des variables discrètes et apprend à lire les probabilités cumulées.
4.4. Transformation Affine d’une Variable Aléatoire Ce sous-chapitre étudie l’effet des opérations linéaires () sur une variable aléatoire. L’élève analyse comment le changement d’échelle ou d’origine affecte la distribution de probabilité, préparant le terrain pour l’étude des propriétés de l’espérance et de la variance.
PARTIE 2 : PARAMÈTRES ET LOIS DE DISTRIBUTION
La deuxième partie approfondit l’analyse statistique des phénomènes aléatoires. Elle dote l’élève d’outils puissants pour résumer l’information contenue dans une distribution de probabilité (tendance centrale et dispersion). Elle introduit ensuite les modèles théoriques majeurs, en particulier la loi binomiale, qui régissent les phénomènes binaires répétés. Cette partie constitue le cœur technique du cours, reliant la théorie abstraite aux applications pratiques de prédiction et d’estimation.
Chapitre 5 : Espérance Mathématique et Paramètres de Position
5.1. Concept d’Espérance Mathématique L’espérance est définie comme la valeur moyenne pondérée par les probabilités. L’élève interprète ce paramètre comme le gain moyen espéré sur un grand nombre de répétitions. Dans un contexte de jeu, il détermine si un jeu est équitable, favorable ou défavorable au joueur 🎰.
5.2. Propriétés de Linéarité L’élève maîtrise les propriétés algébriques de l’espérance, notamment et . Ces propriétés simplifient considérablement les calculs pour des variables composées, comme le chiffre d’affaires total de plusieurs succursales commerciales.
5.3. Le Mode et la Médiane Outre la moyenne, l’élève identifie le mode (valeur la plus probable) et la médiane (valeur partageant la distribution en deux probabilités égales). La comparaison de ces paramètres de position offre une vision nuancée de la distribution, révélant d’éventuelles asymétries dans les données étudiées.
5.4. Applications Économiques et Décisionnelles Ce point applique l’espérance à la théorie de la décision. L’élève résout des problèmes d’optimisation basés sur le critère de l’espérance de gain, pertinents pour les assurances, les investissements agricoles ou la gestion de stocks dans les entreprises de distribution.
Chapitre 6 : Variance et Paramètres de Dispersion
6.1. Notion de Dispersion et Écart à la Moyenne L’élève comprend la nécessité de mesurer la variabilité des résultats autour de l’espérance. La notion d’écart () est introduite pour quantifier la fluctuation du hasard et l’incertitude associée à une prévision.
6.2. Calcul de la Variance La variance est définie comme l’espérance du carré des écarts. L’élève applique la formule de Koenig-Huygens pour simplifier les calculs manuels. Il interprète une variance élevée comme synonyme d’un risque ou d’une imprévisibilité accrue.
6.3. L’Écart-Type : Unité et Interprétation L’écart-type , racine carrée de la variance, ramène la mesure de dispersion à l’unité de la variable originale. L’élève utilise cet indicateur pour comparer la dispersion de deux distributions différentes, par exemple la régularité des précipitations dans deux régions climatiques de la RDC 🌦️.
6.4. Propriétés et Variables Centrées Réduites L’élève étudie l’effet des transformations affines sur la dispersion (). Il apprend à centrer et réduire une variable aléatoire, opération fondamentale pour la standardisation des données statistiques et la comparaison de performances issues d’échelles différentes.
Chapitre 7 : Épreuve de Bernoulli et Loi Binomiale
7.1. L’Épreuve de Bernoulli Ce modèle de base décrit une expérience aléatoire n’admettant que deux issues : succès ou échec. L’élève identifie les paramètres (p pour le succès, q pour l’échec) et modélise des situations binaires simples comme le sexe d’un nouveau-né ou la germination d’une graine 🌱.
7.2. Schéma de Bernoulli et Indépendance La répétition de épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes constitue un schéma de Bernoulli. L’élève apprend à construire l’arbre de probabilité associé et à identifier la stabilité des conditions expérimentales nécessaire à l’application de ce modèle.
7.3. La Loi Binomiale : Formule et Calculs L’élève définit la variable aléatoire X comptant le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Il applique la formule pour calculer des probabilités précises. L’usage de la table de la loi binomiale ou de la calculatrice est intégré pour traiter des valeurs de élevées.
7.4. Paramètres de la Loi Binomiale L’élève détermine l’espérance () et la variance () d’une distribution binomiale sans recourir aux formules générales lourdes. Il interprète ces paramètres pour prédire, par exemple, le nombre moyen de patients guéris par un traitement dont le taux de succès est connu.
PARTIE 3 : APPLICATIONS INTERDISCIPLINAIRES ET GÉNÉTIQUE
La troisième partie concrétise l’approche interdisciplinaire prônée par le programme national. Elle connecte les mathématiques probabilistes aux sciences de la vie (SVT), démontrant l’unité du savoir scientifique. L’élève applique ses connaissances à la génétique mendélienne, à l’analyse de pedigrees et aux tests de conformité statistique. Cette section forme l’esprit critique nécessaire pour valider des hypothèses scientifiques et analyser des données expérimentales réelles.
Chapitre 8 : Probabilités Appliquées à la Génétique Formelle
8.1. Lois de Mendel et Probabilités L’élève revisite les lois de Mendel (ségrégation, indépendance) sous l’angle probabiliste. Il modélise la transmission des allèles comme des tirages aléatoires de gamètes. Le monohybridisme et le dihybridisme sont traités par le calcul de probabilités combinées, remplaçant ou complétant les échiquiers de Punnett.
8.2. Calculs de Probabilités dans les Croisements Ce point traite des prédictions de phénotypes et génotypes pour des croisements complexes. L’élève calcule la probabilité d’obtenir un profil spécifique (ex: homozygote récessif) dans une descendance, en appliquant les règles d’indépendance pour les gènes non liés et les probabilités conditionnelles pour les gènes liés.
8.3. Analyse de Pedigrees (Arbres Généalogiques) L’élève applique les probabilités conditionnelles pour analyser des arbres généalogiques humains. Il calcule le risque pour un individu d’être porteur d’une maladie génétique récessive (comme l’albinisme ou l’anémie SS) en fonction du phénotype de ses ascendants et collatéraux 👨👩👧👦.
8.4. Génétique des Populations (Introduction) L’élève aborde la loi de Hardy-Weinberg comme une application du développement binomial . Il calcule les fréquences alléliques et génotypiques dans une population idéale à l’équilibre, comprenant ainsi la stabilité mathématique des traits héréditaires au fil des générations.
Chapitre 9 : Tests Statistiques et Conformité (Le Khi-carré)
9.1. Principe des Tests d’Hypothèse L’élève est initié à la logique du test statistique : formuler une hypothèse nulle (), confronter les données observées aux prévisions théoriques et décider du rejet ou non de l’hypothèse. Ce cadre rigoureux est essentiel pour la démarche expérimentale en biologie et agronomie.
9.2. La Statistique du Khi-carré () L’élève apprend à calculer la valeur du en mesurant l’écart entre les effectifs observés et les effectifs théoriques attendus. La formule est appliquée à des données concrètes, telles que les résultats d’un croisement expérimental de drosophiles ou de pois.
9.3. Degré de Liberté et Lecture de Table Ce sous-chapitre explique la détermination du degré de liberté () en fonction du nombre de classes phénotypiques. L’élève apprend à utiliser la table de distribution du pour trouver la valeur seuil critique correspondant à un seuil de risque donné (généralement 5% en biologie).
9.4. Interprétation et Prise de Décision L’élève conclut le test en comparant la valeur calculée à la valeur critique. Il décide si les écarts observés sont dus aux simples fluctuations d’échantillonnage (acceptation de ) ou s’ils sont significatifs d’un autre phénomène (rejet de , par exemple pour suspecter un linkage génétique).
Chapitre 10 : Probabilités, Risques et Société
10.1. Analyse du Risque dans la Vie Quotidienne L’élève applique les concepts de probabilité pour évaluer des risques courants (accidents, maladies, échecs). Il apprend à distinguer la probabilité perçue de la probabilité réelle, développant une pensée critique face aux informations médiatiques et aux superstitions.
10.2. Jeux de Hasard et Espérance de Gain Une analyse mathématique rigoureuse des loteries et jeux de hasard démontre leur nature généralement défavorable au joueur sur le long terme (espérance négative). Cette section vise une éducation financière et citoyenne, démystifiant les mécanismes des jeux d’argent 🎰.
10.3. Probabilités Géométriques En lien avec le programme de géométrie, l’élève résout des problèmes où la probabilité est définie par le rapport de mesures (longueurs, aires, volumes). Les exemples incluent la probabilité d’impact sur une cible ou la rencontre de deux personnes dans un intervalle de temps donné.
10.4. Synthèse : Modélisation de Problèmes Complexes Ce dernier point intègre l’ensemble des acquis pour résoudre des problèmes de synthèse. L’élève modélise des situations réelles complexes combinant dénombrement, lois de probabilité et prise de décision, démontrant sa maîtrise globale de la compétence visée par le cours.
ANNEXES
Annexe 1 : Formulaire de Probabilités et Combinatoire
Ce récapitulatif synthétique regroupe toutes les formules essentielles du cours : arrangements, combinaisons, probabilités totales, Bayes, espérance, variance et loi binomiale. Il sert d’outil de référence rapide pour la résolution d’exercices et la préparation aux examens d’État.
Annexe 2 : Tables Statistiques
Cette section fournit les tables numériques indispensables : la table des coefficients binomiaux (Triangle de Pascal étendu), la table de la loi Normale centrée réduite (pour information et extension) et la table du Khi-carré nécessaire pour le chapitre 9.
Annexe 3 : Glossaire des Termes Techniques
Un lexique précis définit les concepts clés (aléatoire, stochastique, événement, variable, indépendance, etc.) pour lever toute ambiguïté sémantique. Il assure la maîtrise du langage mathématique spécifique aux probabilités.
Annexe 4 : Exercices d’Application Contextualisés RDC
Une banque d’exercices supplémentaires ancrés dans la réalité congolaise : gestion des stocks de minerais, prévisions de crues du fleuve Congo, génétique des plantes cultivées localement, et statistiques de santé publique, permettant un entraînement intensif et pertinent.



