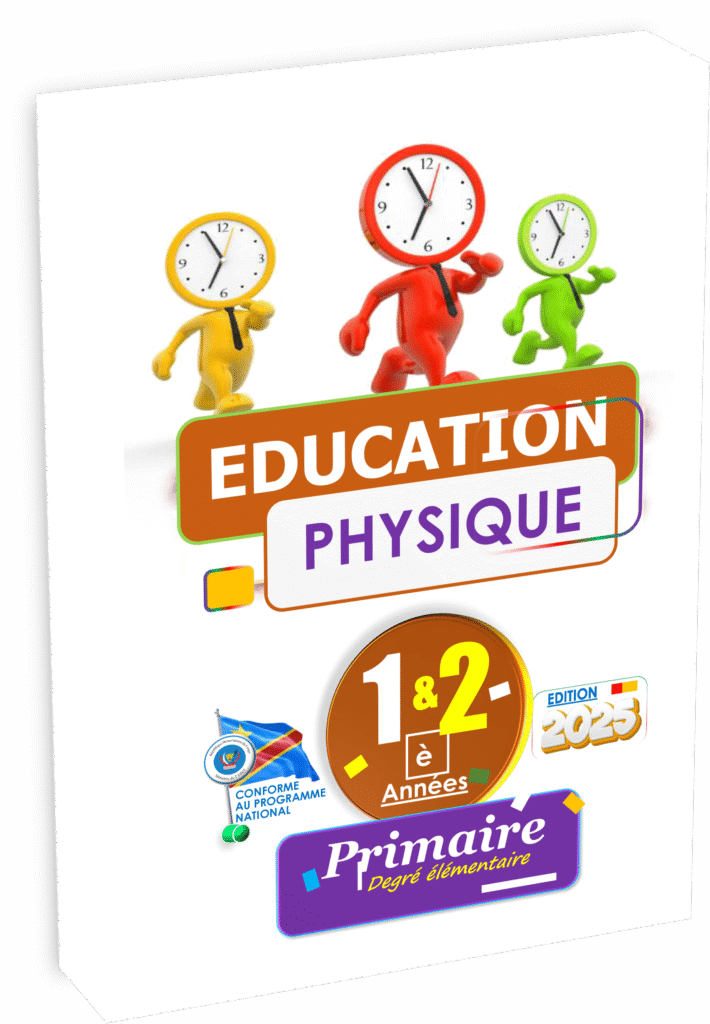
COURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTS, 1ERE ET 2EME ANNEE PRIMAIRE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC
PRÉLIMINAIRES
0.1. Avant-propos
Ce document pédagogique transpose le Programme National de l’Enseignement Primaire en un matériel didactique opérationnel pour le cours d’Éducation Physique et Sports (EPS) au premier degré. Il est spécifiquement conçu pour guider l’enseignant dans la mise en œuvre d’activités motrices, ludiques et sportives qui contribuent au développement intégral de l’enfant. L’objectif est de fournir un cadre structuré et progressif qui transforme les finalités du curriculum en compétences physiques, sociales et morales observables. [cite_start]Chaque section a été rigoureusement élaborée pour assurer une couverture complète des matières prévues, en proposant des situations d’apprentissage qui ancrent la pratique physique dans le contexte culturel et social de la République Démocratique du Congo[cite: 155]. [cite_start]Ce guide a pour ambition de faire de chaque séance d’EPS un moment privilégié pour stimuler les fonctions vitales de l’élève, développer son goût de l’effort, renforcer son esprit d’équipe et valoriser son patrimoine culturel à travers le jeu[cite: 154, 155].
0.2. Finalités et Buts du Cours d’EPS
L’Éducation Physique et Sports au degré élémentaire poursuit la finalité de contribuer au développement harmonieux et intégral de la personnalité de l’enfant. [cite_start]Son but principal est de stimuler les fonctions vitales et d’assurer une croissance saine par la pratique d’exercices physiques adaptés[cite: 154]. [cite_start]Le cours vise à développer les qualités physiques fondamentales, mais aussi les dimensions intellectuelles, civiques et morales de l’élève[cite: 1054]. [cite_start]Il a pour objectif d’inculquer le goût de l’effort et l’amour du travail bien fait, valeurs transposables à toutes les autres disciplines[cite: 158]. [cite_start]Un autre but essentiel est de promouvoir le patrimoine culturel congolais en valorisant les jeux et sports traditionnels, ancrant ainsi l’enfant dans sa culture[cite: 155]. [cite_start]Enfin, le cours prépare l’élève à l’intégration sociale en développant, par le jeu collectif, des compétences telles que la maîtrise de soi, l’esprit d’équipe et le respect des règles[cite: 630].
0.3. Profil de Sortie du Degré Élémentaire en EPS
Au terme du premier degré (deuxième année primaire), l’élève doit manifester un ensemble de compétences et de qualités observables. [cite_start]Sur le plan physique et sportif, il doit présenter les qualités attendues d’un enfant congolais de son âge, ce qui implique une maîtrise de base des habiletés motrices comme la marche, la course et le saut[cite: 188]. [cite_start]Il doit être capable de pratiquer des exercices et des jeux simples en exploitant sa spontanéité et en s’adaptant aux consignes[cite: 1053]. [cite_start]Sur le plan personnel et social, l’élève doit avoir développé des qualités civiques et morales à travers les activités ludiques et productives[cite: 189]. [cite_start]Cela signifie qu’il doit faire preuve d’esprit d’équipe, de respect des règles et de ses camarades, et manifester de l’intérêt pour les activités collectives[cite: 187]. Le profil de sortie intègre donc à la fois une dimension de performance motrice adaptée à son développement et une dimension comportementale qui jette les bases de sa future vie de citoyen.
0.4. Approche Méthodologique
L’approche méthodologique préconisée pour le cours d’EPS au premier degré est active, ludique et progressive. [cite_start]L’enseignant doit veiller à adapter tous les exercices à l’âge des élèves pour assurer un développement et une croissance harmonieux, en évitant toute surcharge ou mise en danger[cite: 629]. [cite_start]La méthode s’appuie sur une variante de la gymnastique scandinave-dynamique, dite « gymnastique à prédominance », qui intègre des exercices tonifiants, des sauts et des exercices d’équilibre pour inhiber l’instinct de conservation de l’enfant de manière sécuritaire[cite: 627, 628]. [cite_start]La progression pédagogique, c’est-à-dire la graduation des difficultés, est un principe fondamental à respecter[cite: 616]. [cite_start]La séance doit être structurée, mais toujours se terminer par un dérivatif psychologique, souvent un jeu, pour associer l’effort au plaisir[cite: 616]. [cite_start]L’utilisation de jeux compétitifs est encouragée, car ils permettent d’éveiller l’esprit d’équipe, la maîtrise de soi et le sens de l’abnégation[cite: 630]. L’enseignant agit comme un guide et un animateur, assurant la sécurité tout en encourageant la participation active de chaque enfant.
PARTIE I : DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS MOTRICES FONDAMENTALES 🤸
CHAPITRE 1 : LA MAÎTRISE DE LA MARCHE ET DE LA COURSE
1.1. Les Fondamentaux de la Marche Rythmée
Ce premier volet se concentre sur l’acquisition d’une habileté motrice de base : la marche coordonnée et rythmée. L’objectif est de dépasser la marche utilitaire pour en faire un exercice conscient qui développe la posture et la coordination. [cite_start]En première année, les élèves apprennent la marche rythmée au pas, en veillant à maintenir le corps droit et à balancer les bras de manière naturelle et synchronisée[cite: 1071]. [cite_start]L’enseignant utilise des supports sonores simples comme des claquements de mains, des coups de sifflet ou le rythme de bâtonnets métalliques pour guider les élèves[cite: 1071]. Cette activité, souvent réalisée en début de séance, sert d’échauffement général et permet de canaliser l’énergie du groupe. Elle vise à développer le sens du rythme, la conscience corporelle et la capacité à suivre une consigne collective, jetant ainsi les bases d’une motricité organisée et efficace.
1.2. L’Exploration des Marches Spécifiques et Variées
Après la maîtrise de la marche de base, le programme de deuxième année introduit des variations qui sollicitent davantage l’agilité, la force et la coordination. Ce sous-chapitre vise à amener l’élève à explorer différentes manières de se déplacer pour mieux connaître les capacités de son corps. [cite_start]Sont ainsi introduites la marche accroupie et la marche du canard, qui renforcent les muscles des jambes, et la marche en quadrupédie (à quatre pattes), qui développe la coordination entre les membres supérieurs et inférieurs ainsi que la musculature du tronc[cite: 1073]. Ces exercices, présentés sous forme de jeu, comme imiter la démarche d’un animal lors d’une séance à l’école de Mbandaka, permettent de travailler la force et la souplesse de manière ludique. Ils contribuent également à améliorer l’équilibre et préparent le corps à des mouvements plus complexes abordés ultérieurement en gymnastique.
1.3. L’Initiation aux Différentes Formes de Course
La course est une extension naturelle de la marche et une activité spontanée chez l’enfant. Ce sous-chapitre a pour but de structurer cette activité pour en faire un outil de développement physique. [cite_start]En première année, l’initiation se fait à travers des formes simples : la course de vitesse sur de très courtes distances pour développer l’explosivité, le trottinement pour l’endurance de base, et la course de relais pour introduire la notion de coopération et de passage de témoin[cite: 1071]. [cite_start]En deuxième année, la complexité augmente avec des courses qui exigent plus de contrôle moteur, comme la course en slalom entre des plots, ou le trottinement en variant les allures et les attitudes (par exemple, en levant les genoux ou en touchant les talons)[cite: 1077]. Ces activités améliorent la capacité cardiovasculaire, la coordination et l’agilité de l’élève.
1.4. Le Développement de la Vitesse et de l’Endurance
Ce dernier volet du chapitre synthétise les apprentissages sur la marche et la course en se focalisant sur le développement de deux qualités physiques essentielles : la vitesse et l’endurance. À travers des jeux de poursuite, des sprints en ligne et des courses de relais, l’enseignant travaille spécifiquement la capacité de l’élève à produire un effort intense sur une courte durée (vitesse). Parallèlement, des activités comme le trottinement prolongé, la marche rapide ou des jeux collectifs impliquant des déplacements constants visent à améliorer la capacité de l’enfant à maintenir un effort modéré sur une plus longue période (endurance). L’enseignant veille à adapter la durée et l’intensité des efforts à l’âge et aux capacités de chaque enfant, en s’assurant que le plaisir du jeu reste le principal moteur de l’activité. L’objectif est de construire une base physique solide qui sera bénéfique pour toutes les futures pratiques sportives.
CHAPITRE 2 : L’ACQUISITION DE L’ÉQUILIBRE ET DE L’AGILITÉ
2.1. Les Exercices Fondamentaux d’Équilibre Statique et Dynamique
L’équilibre est une compétence motrice fondamentale qui conditionne la réalisation de la plupart des gestes sportifs. Ce sous-chapitre est dédié à son développement systématique. L’équilibre statique est travaillé à travers des postures simples tenues pendant quelques secondes, comme se tenir sur un pied ou sur la pointe des pieds. L’équilibre dynamique est sollicité dans des exercices où l’enfant doit maintenir sa stabilité en mouvement, par exemple en marchant sur une ligne tracée au sol ou sur un banc bas. Ces activités, qui peuvent être intégrées dans des parcours ludiques, améliorent la proprioception (la conscience de la position de son corps dans l’espace) et renforcent les muscles stabilisateurs, notamment au niveau des chevilles et du tronc. Une bonne maîtrise de l’équilibre est un prérequis essentiel pour aborder en toute sécurité les sauts et les exercices de gymnastique.
2.2. L’Initiation aux Sauts et à la Réception
Le saut est une habileté motrice qui demande à la fois de la puissance et de la coordination. Cette section se concentre sur l’apprentissage des formes de sauts les plus élémentaires, en accordant une importance capitale à la sécurité de la réception. [cite_start]En première année, l’élève s’initie au saut sur un pied et au saut sur deux pieds à partir d’une position statique[cite: 1071]. L’enseignant insiste sur la phase d’amorti lors de la réception (fléchir les genoux) pour protéger les articulations. [cite_start]Des jeux comme le « saute-mouton » sont également introduits pour combiner le saut avec une coordination par rapport à un obstacle[cite: 1071]. L’objectif est que l’enfant apprenne à maîtriser l’impulsion et à contrôler son corps à l’atterrissage, développant ainsi sa puissance et sa conscience spatiale.
2.3. Les Sauts Spécifiques : Cloche-pied et Pieds Joints
S’appuyant sur les bases acquises, le programme de deuxième année introduit des formes de sauts plus complexes et codifiées. [cite_start]Le saut à cloche-pied est travaillé de manière plus systématique, en alternant les pieds et en réalisant de petites séries pour développer la force et l’équilibre sur un seul appui[cite: 1077]. Le saut à deux pieds joints est également perfectionné, en cherchant à gagner en distance (saut en longueur sans élan) ou en hauteur (saut par-dessus un petit obstacle). [cite_start]Des variations sont proposées, comme le saut en jambes écartées, qui demande une coordination différente[cite: 1077]. Ces exercices, souvent intégrés dans des jeux comme la marelle ou des parcours d’agilité, renforcent la musculature des membres inférieurs et améliorent la coordination inter-segmentaire, préparant l’élève aux disciplines de l’athlétisme.
2.4. Le Développement de l’Agilité par les Parcours d’Obstacles
L’agilité est la capacité à changer de direction rapidement et de manière contrôlée. Ce sous-chapitre propose de la développer de manière ludique et intégrée à travers la mise en place de parcours d’obstacles. L’enseignant utilise du matériel simple (plots, cerceaux, bancs, cordes) pour créer des circuits où l’élève doit enchaîner différentes actions motrices : courir en slalom, sauter par-dessus un obstacle bas, ramper sous un autre, marcher en équilibre sur un banc, etc. Ces parcours sollicitent et combinent toutes les habiletés vues précédemment (course, saut, équilibre) et exigent de l’enfant une adaptation constante. La réalisation de ces parcours, par exemple dans la cour de récréation d’une école de Kananga, permet d’améliorer la coordination générale, la vitesse de réaction et la planification motrice, tout en étant une activité extrêmement motivante pour les enfants.
CHAPITRE 3 : LES FONDEMENTS DE LA GYMNASTIQUE AU SOL
3.1. Les Exercices Préparatoires d’Assouplissement Articulaire
Toute pratique gymnique sécuritaire commence par une bonne préparation du corps. Ce sous-chapitre est consacré aux exercices d’assouplissement visant à améliorer la mobilité des articulations et à prévenir les blessures. [cite_start]Les élèves réalisent des mouvements doux et contrôlés pour chaque grande articulation du corps : rotations du cou, des épaules, des poignets, des hanches et des chevilles[cite: 1071]. L’enseignant guide la séance en montrant les mouvements et en s’assurant qu’ils sont exécutés sans forcer. Ces exercices préparent les muscles et les ligaments à l’effort, augmentent l’amplitude des mouvements et améliorent la conscience corporelle. Une routine d’assouplissement régulière est essentielle pour développer la flexibilité nécessaire aux figures de gymnastique et pour inculquer aux élèves la bonne habitude de s’échauffer avant tout effort physique.
3.2. Le Renforcement Musculaire du Tronc : Abdomen et Dos
Un tronc (abdomen et dos) solide est la base de toute posture et de tout mouvement contrôlé en gymnastique. Cette section se focalise sur le renforcement de cette « ceinture » musculaire. Des exercices simples et adaptés à l’âge des enfants sont proposés. Pour les abdominaux, il peut s’agir de relevés de buste légers, les genoux fléchis. [cite_start]Pour le dos, des exercices comme se mettre à plat ventre et soulever légèrement le buste et les jambes permettent de solliciter les muscles dorsaux[cite: 1073]. Ces activités de musculation sont toujours présentées de manière ludique et réalisées sur de courtes séries. L’objectif est d’améliorer la posture générale de l’élève, de lui donner une meilleure stabilité et de protéger sa colonne vertébrale, ce qui est fondamental pour aborder en toute sécurité des exercices comme les roulades ou les équilibres sur les mains.
3.3. L’Apprentissage de la Roulade et des Mouvements de Base
La roulade avant est souvent la première figure acrobatique enseignée en gymnastique. Ce sous-chapitre détaille son apprentissage progressif. L’enseignant commence par des exercices préparatoires, comme s’enrouler en boule ou basculer doucement sur le dos pour que l’élève se familiarise avec la sensation de rotation. La technique de la roulade (poser les mains, rentrer la tête, pousser sur les jambes et rouler sur le dos arrondi) est ensuite décomposée et travaillée étape par étape sur une surface souple (tapis, herbe). [cite_start]Le « saute-mouton » [cite: 1071] est également une activité de cette catégorie, car il combine impulsion, passage d’un obstacle et réception contrôlée. La maîtrise de ces mouvements de base développe la coordination, l’agilité et la confiance en soi, tout en enseignant à l’enfant comment chuter de manière sécuritaire.
3.4. Les Mouvements d’Appui et de Suspension
Ce dernier volet du chapitre introduit les élèves aux sensations d’appui sur les mains et de suspension. Les exercices d’appui consistent à supporter le poids de son corps sur les bras, comme dans la marche en quadrupédie (« marche de l’ours ») ou en tenant une position de « planche » pendant quelques secondes. La suspension est abordée si le matériel le permet (barre basse, branche solide), en s’accrochant simplement avec les mains pour sentir le poids de son corps. Ces activités, même très brèves, sont excellentes pour renforcer la ceinture scapulaire (épaules) et les bras. Elles sont fondamentales pour préparer le corps à des figures plus avancées comme le trépied ou les équilibres sur les mains. L’enseignant veille scrupuleusement à la sécurité, en assistant les élèves et en utilisant du matériel adapté.
CHAPITRE 4 : LA COORDINATION CORPORELLE ET LA RELAXATION
4.1. Les Exercices de Coordination des Membres Supérieurs et Inférieurs
La coordination est la capacité à faire travailler ensemble différentes parties du corps de manière harmonieuse et efficace. Ce sous-chapitre propose des exercices spécifiques pour la développer. Il s’agit de mouvements qui dissocient ou associent les actions des bras et des jambes. Par exemple, sauter sur place tout en faisant des cercles avec les bras, ou marcher en touchant alternativement son genou gauche avec sa main droite, et vice-versa. Ces exercices peuvent être complexifiés progressivement en variant le rythme ou la nature des mouvements. Ils améliorent la communication entre le cerveau et les muscles, affinent le schéma corporel de l’enfant et rendent ses gestes plus précis et plus fluides. Une bonne coordination est un atout majeur dans toutes les activités physiques et sportives, mais aussi dans de nombreuses tâches de la vie quotidienne.
4.2. Le Jeu de la Brouette et la Coordination en Duo
[cite_start]Le « jeu de la brouette » est une activité classique et très complète, introduite en deuxième année, qui développe à la fois la force, la gainage et la coordination en binôme[cite: 1073]. Un élève se met en appui sur les mains, tandis que son partenaire lui tient les jambes. Le premier doit alors avancer avec la force de ses bras. Ce jeu est excellent pour le renforcement des bras et des épaules de la « brouette », et il demande au porteur d’adapter sa vitesse et sa direction. Au-delà de l’aspect physique, cet exercice enseigne la coopération, la confiance en l’autre et la communication. Les deux partenaires doivent se coordonner pour réussir à avancer. Il s’agit d’une excellente introduction au travail en duo, qui est fondamental dans de nombreuses disciplines sportives et artistiques.
4.3. Les Techniques de Relaxation et de Retour au Calme
Une séance d’éducation physique ne se termine pas brusquement après l’effort. Ce sous-chapitre est dédié à l’apprentissage de techniques simples de relaxation, essentielles pour un retour au calme progressif du corps et de l’esprit. Après un effort intense, l’enseignant guide les élèves à travers des exercices de respiration lente et profonde, des étirements doux ou des moments de relâchement au sol. [cite_start]La marche lente en sifflant ou en chantant est une autre méthode efficace pour faire redescendre le rythme cardiaque[cite: 1071]. L’objectif est d’apprendre à l’enfant à écouter son corps, à reconnaître les signaux de fatigue et à utiliser des outils simples pour se détendre. Cette compétence est précieuse non seulement après le sport, mais aussi pour gérer le stress dans d’autres situations de la vie.
4.4. La Synchronisation du Mouvement avec un Rythme Extérieur
Cette section prolonge le travail sur la marche rythmée en l’étendant à d’autres mouvements. L’objectif est de développer la capacité de l’élève à synchroniser ses actions corporelles avec un signal extérieur, qu’il soit auditif (musique, tambourin, claquements de mains) ou visuel (gestes de l’enseignant). Des activités comme des petites chorégraphies simples, des enchaînements de gestes à reproduire en rythme, ou des jeux comme « Jacques a dit » en musique sont proposés. Cet apprentissage améliore le sens du rythme, la capacité d’écoute et la mémoire motrice. La synchronisation est une compétence clé dans des activités comme la danse, la gymnastique rythmique, mais aussi dans de nombreux sports collectifs où il faut coordonner ses actions avec celles de ses coéquipiers.
PARTIE II : INITIATION AUX PRATIQUES SPORTIVES ET LUDIQUES ⚽
CHAPITRE 5 : LA DÉCOUVERTE DES JEUX TRADITIONNELS
5.1. La Valorisation des Jeux du Patrimoine Culturel Congolais
[cite_start]Ce sous-chapitre met en lumière l’importance de la redécouverte et de la pratique des jeux traditionnels, qui constituent un élément vibrant du patrimoine culturel congolais[cite: 155]. L’objectif est de montrer aux élèves que le sport et le jeu ne sont pas uniquement des pratiques modernes ou importées, mais qu’il existe une richesse ludique dans leur propre culture. L’enseignant est invité à rechercher et à proposer des jeux typiques de sa région ou d’autres provinces de la RDC. La pratique de ces jeux permet de renforcer l’identité culturelle de l’enfant et de créer un lien intergénérationnel, car il peut ensuite partager ces jeux avec sa famille. En valorisant ces activités, l’école contribue à la sauvegarde de ce patrimoine immatériel et montre que le plaisir de jouer est universel et ancré dans l’histoire de sa propre communauté.
5.2. L’Apprentissage du « Nzango » et des Jeux de Rythme
Le « Nzango » est un jeu traditionnel emblématique, particulièrement populaire et codifié, qui combine chant, rythme et habileté motrice. Cette section est consacrée à son apprentissage. Les élèves apprennent les chants qui accompagnent le jeu, le rythme frappé par les mains et, surtout, les mouvements complexes des pieds. Le jeu demande une excellente coordination, de l’agilité et un sens aigu du rythme. Au-delà du « Nzango », d’autres jeux traditionnels basés sur le rythme et la chanson sont explorés. Ces activités sont complètes car elles développent simultanément les capacités physiques (coordination, endurance), cognitives (mémorisation des chants et des règles) et sociales (jeu en équipe, respect de l’adversaire). La pratique de ces jeux dans la cour d’une école de Mbuji-Mayi est une célébration de la culture et de la joie de vivre.
5.3. La Pratique de la Lutte Traditionnelle et des Jeux de Force
Dans de nombreuses cultures congolaises, la lutte est un jeu traditionnel qui permet aux jeunes de mesurer leur force et leur agilité dans un cadre réglementé. [cite_start]Ce sous-chapitre propose une initiation sécurisée à la lutte traditionnelle[cite: 1071]. L’enseignant établit des règles claires visant à éviter toute blessure : l’objectif n’est pas de faire mal, mais de déséquilibrer l’adversaire. La pratique se fait sur une surface souple (herbe, sable). D’autres jeux de force peuvent également être proposés, comme des jeux de traction à la corde par équipe. Ces activités, encadrées, permettent de canaliser l’énergie des enfants, de développer leur force physique, leur équilibre et leur respect de l’adversaire. Ils apprennent à gérer le contact physique de manière contrôlée et à accepter la victoire comme la défaite avec fair-play.
5.4. L’Exploration de la Marelle (« Kebo ») et des Jeux d’Adresse
[cite_start]La marelle, connue sous le nom de « Kebo » dans certaines régions du Congo, est un jeu d’adresse universel qui développe de multiples compétences[cite: 1071]. Ce sous-chapitre est dédié à sa pratique et à celle d’autres jeux similaires. Jouer à la marelle exige de l’équilibre (sauter à cloche-pied), de la précision (lancer le palet dans la bonne case) et de la planification motrice (suivre le parcours sans toucher les lignes). D’autres jeux d’adresse sont également au programme, comme les jeux de lancer d’objets vers une cible ou les jeux de construction et d’équilibre avec des cailloux ou des bâtonnets. Ces activités, calmes et individuelles ou en petits groupes, sont excellentes pour développer la coordination œil-main, la concentration et la patience des élèves.
CHAPITRE 6 : LES JEUX NON SPORTIFS ET COLLECTIFS
6.1. Le Développement de l’Adresse par les Jeux de Lancer
Cette section se concentre sur le développement de l’habileté fondamentale du lancer à travers des jeux variés et non codifiés. L’objectif est d’améliorer la coordination œil-main et la capacité de l’élève à doser sa force pour atteindre une cible. Les activités proposées incluent le lancer d’anneaux sur un piquet, le lancer de sacs de sable dans un cerceau posé au sol, ou encore le jeu de quilles. [cite_start]Ces jeux d’adresse [cite: 1071] sont progressifs : l’enseignant peut faire varier la distance de lancer, la taille de la cible ou le poids de l’objet à lancer. Ils permettent de travailler la précision du geste de manière ludique et motivante. Cette compétence de base est un prérequis pour de nombreux sports, comme le basketball, le handball ou le lancer en athlétisme.
6.2. Les Jeux de Vitesse et de Poursuite
Les jeux de poursuite sont une source de plaisir inépuisable pour les enfants et un excellent moyen de travailler la vitesse et la réactivité. Ce sous-chapitre propose d’utiliser ces jeux spontanés de manière structurée. Des jeux classiques comme « l’épervier » ou « le chat et la souris » sont organisés dans des espaces délimités et sécurisés. Ces activités développent la vitesse de course, mais aussi la vitesse de réaction (démarrer rapidement), l’agilité (changer de direction pour éviter d’être touché) et l’endurance. Ils enseignent également des notions stratégiques simples : comment anticiper la trajectoire du « chat », comment coopérer pour encercler les « proies ». L’enseignant veille à ce que les règles soient claires et respectées pour que le jeu se déroule dans un esprit de camaraderie.
6.3. Les Jeux Collectifs de Précision et de Stratégie
Au-delà de la force et de la vitesse, certains jeux collectifs exigent de la précision et une réflexion stratégique. Ce sous-chapitre explore cette catégorie de jeux. Il peut s’agir de jeux de ballon où l’objectif est de toucher les joueurs de l’équipe adverse (« ballon prisonnier »), ce qui demande de la précision dans le lancer et de la stratégie pour se déplacer et se protéger. D’autres jeux, comme « la passe à dix », se concentrent sur la capacité d’une équipe à coopérer pour conserver le ballon sans le faire tomber, en réalisant des passes précises. Ces jeux développent le sens de l’anticipation, la communication non verbale entre les joueurs et la prise de décision rapide. Ils sont une excellente introduction à la complexité tactique des grands sports collectifs.
6.4. Les Jeux de Compétition en Équipe : Course en Sac et Autres
La compétition, lorsqu’elle est saine, est un formidable moteur d’apprentissage et de dépassement de soi. Cette section utilise des jeux de compétition simples pour développer l’esprit d’équipe. [cite_start]La course en sac [cite: 1077] est un exemple parfait : elle est amusante, demande de l’équilibre et de la coordination, et se pratique souvent sous forme de relais, ce qui renforce la cohésion de l’équipe. [cite_start]D’autres jeux, comme le « remplissage de bouteille avec de l’eau ou du sable » en relais[cite: 1077], mettent l’accent sur la coopération et l’efficacité collective. Ces activités enseignent à l’élève à donner le meilleur de lui-même pour son équipe, à encourager ses partenaires et à accepter le résultat final, qu’il s’agisse de la victoire ou de la défaite. Elles sont un puissant outil pour forger les qualités de solidarité et d’abnégation.
CHAPITRE 7 : L’INITIATION AUX SPORTS COLLECTIFS À BALLON
7.1. Les Premiers Pas en Mini-Football : Passe et Tir
Le football est le sport le plus populaire en RDC, et son initiation commence dès le plus jeune âge. [cite_start]Ce sous-chapitre se concentre sur les deux gestes fondamentaux du mini-football[cite: 1071, 1077]. L’apprentissage de la passe (avec l’intérieur du pied) est prioritaire, car il est à la base du jeu collectif. Les élèves s’exercent en binômes, puis en petits groupes, à se faire des passes précises. Le tir au but est ensuite abordé, en insistant sur la précision plutôt que sur la puissance. Des jeux simples sont organisés pour mettre ces compétences en application dans des situations proches du match. L’objectif est de faire comprendre à l’enfant que le football est un jeu de coopération où la passe est souvent plus importante que le dribble individuel, jetant ainsi les bases d’un jeu intelligent et collectif.
7.2. La Découverte du Mini-Basketball et du Dribble
Le mini-basketball est un sport très complet qui développe la coordination des mains et des pieds. [cite_start]Cette section initie les élèves aux bases de ce sport[cite: 1077]. L’habileté centrale est le dribble : l’élève apprend à faire rebondir le ballon avec une main sans le regarder, d’abord sur place, puis en marchant et enfin en courant. C’est un exercice exigeant qui améliore considérablement la coordination et la dissociation des mouvements. L’initiation à la passe (à deux mains, à hauteur de poitrine) et au tir vers un panier (ou un cerceau) placé à une hauteur adaptée complète cette première approche. Le mini-basketball est excellent pour développer l’adresse, la vision du jeu et la capacité à se déplacer dans un espace restreint.
7.3. L’Introduction au Mini-Volleyball et au Lancer de Balle
[cite_start]Le mini-volleyball, introduit en deuxième année[cite: 1077], est un sport collectif sans contact qui met l’accent sur la coopération et la technique de frappe de balle. L’initiation commence non pas par la manchette ou le service, mais par des jeux de lancer et de réception de balle par-dessus un filet (ou une corde). Cela permet à l’élève de se familiariser avec la trajectoire de la balle, d’apprendre à se placer correctement et de communiquer avec ses partenaires pour savoir qui va attraper la balle. Progressivement, le lancer peut être remplacé par une frappe simple à deux mains. L’objectif est de développer le sens de l’anticipation et la communication au sein de l’équipe, qui sont les clés de la réussite dans ce sport.
7.4. Le Jeu du Frisbee et la Maîtrise du Lancer Rotatif
Le frisbee (disque en plastique) offre une alternative intéressante aux sports de ballon traditionnels. [cite_start]Sa pratique, introduite en deuxième année[cite: 1077], est axée sur l’apprentissage d’un geste technique spécifique : le lancer rotatif. L’élève découvre comment tenir le disque et comment utiliser le mouvement du poignet pour lui imprimer une rotation qui lui assure une trajectoire stable et planante. Le jeu se pratique d’abord en binômes, avec des lancers et des réceptions à courte distance, puis peut évoluer vers des jeux collectifs simples comme une « passe à dix » avec le frisbee. Cette activité développe la coordination fine, la précision et la capacité à anticiper une trajectoire de vol qui est très différente de celle d’une balle.
CHAPITRE 8 : LES FONDAMENTAUX DE L’ATHLÉTISME
8.1. La Technique de Départ et la Course de Vitesse sur Courte Distance
L’athlétisme est la base de nombreux sports. Ce sous-chapitre se concentre sur la discipline reine : la course de vitesse. L’objectif n’est pas la performance chronométrique, mais l’acquisition d’une technique de course efficace. Les élèves apprennent les bases d’une bonne posture de course : le buste droit, les bras utilisés comme balanciers, et une foulée dynamique. Une initiation simple à la technique de départ peut être proposée (position « à vos marques, prêts, partez »). Les courses se déroulent sur des distances très courtes (20 à 30 mètres) pour se concentrer sur l’accélération et le maintien de la vitesse maximale. Cet apprentissage permet d’améliorer la puissance, la coordination et l’efficacité de la course de l’élève.
8.2. L’Initiation à la Course de Relais et à la Transmission du Témoin
[cite_start]La course de relais [cite: 1071] est la seule épreuve collective en athlétisme, ce qui en fait un outil pédagogique particulièrement riche. Elle développe non seulement la vitesse individuelle de chaque coureur, mais aussi et surtout la coordination et la synchronisation au sein de l’équipe. Ce sous-chapitre est dédié à l’apprentissage de ce travail d’équipe. L’élément clé est la transmission du témoin. Les élèves apprennent à passer et à recevoir le témoin sans ralentir et sans le faire tomber. Des exercices spécifiques sont réalisés, d’abord à l’arrêt, puis en marchant et enfin en courant. La course de relais enseigne des valeurs essentielles comme la confiance en ses partenaires, le sens des responsabilités (ne pas faire échouer l’équipe) et l’importance de la synchronisation des efforts pour atteindre un objectif commun.
8.3. Le Saut en Longueur avec et sans Élan
Le saut en longueur est une discipline athlétique qui développe la puissance explosive des jambes et la coordination. L’initiation commence par le saut en longueur sans élan (saut pieds joints), qui permet à l’élève de se concentrer sur la phase d’impulsion et d’équilibre. Progressivement, une petite course d’élan est introduite. L’enseignant met l’accent sur les différentes phases du saut : la course d’élan régulière, l’impulsion sur un pied, le vol et la réception équilibrée dans une zone sécurisée (bac à sable, tapis). L’objectif n’est pas de mesurer la performance, mais de faire en sorte que l’élève enchaîne ces différentes phases de manière fluide et contrôlée, améliorant ainsi sa détente et sa capacité à se projeter dans l’espace.
8.4. Le Saut en Hauteur et le Franchissement d’Obstacles Bas
Le saut en hauteur initie l’élève à la notion de franchissement d’un obstacle vertical. Pour des raisons de sécurité, l’apprentissage se fait avec des obstacles très bas et souples (élastique, baguette légère). Ce sous-chapitre vise à développer la détente verticale et la coordination nécessaire pour franchir l’obstacle sans le faire tomber. Différentes techniques d’approche et de franchissement simples peuvent être explorées. Cette activité est complétée par des exercices de franchissement d’obstacles en course, qui sont à la base des courses de haies. L’élève apprend à ajuster sa foulée et à coordonner son saut pour passer au-dessus d’une série de petits obstacles. Ces exercices développent le rythme, l’agilité et la capacité à surmonter les difficultés.
PARTIE III : EXPLORATION DE NOUVEAUX MILIEUX ET DÉPASSEMENT DE SOI 🌊
CHAPITRE 9 : L’ADAPTATION AU MILIEU AQUATIQUE
9.1. La Familiarisation avec l’Eau : Immersion et Respiration
[cite_start]Ce sous-chapitre constitue la toute première étape de l’initiation à la natation[cite: 1077], une compétence essentielle dans un pays traversé par un fleuve majestueux et parsemé de lacs. L’objectif est de vaincre l’appréhension de l’eau et de se familiariser avec ce nouvel élément. Dans un plan d’eau peu profond et sécurisé (pataugeoire, bord de lac calme près de Kalemie), l’élève apprend à s’immerger progressivement, d’abord le visage, puis la tête entière. Le travail sur la respiration est fondamental : il apprend à souffler dans l’eau (faire des bulles) pour maîtriser son expiration aquatique. Ces premiers contacts, menés sous forme de jeux, sont cruciaux pour construire une relation positive et confiante avec l’eau, condition indispensable à tout apprentissage ultérieur de la nage.
9.2. L’Apprentissage de la Flottaison Statique (Planche)
Une fois la peur de l’immersion surmontée, l’élève peut découvrir une propriété magique de l’eau : elle porte. [cite_start]Ce sous-chapitre est dédié à l’apprentissage de la flottaison[cite: 1077]. L’élève expérimente la flottaison ventrale (« faire l’étoile de mer ») et la flottaison dorsale, en apprenant à se relâcher et à laisser l’eau le soutenir. L’enseignant l’assiste pour trouver la bonne position, horizontale et détendue. La découverte de la flottaison est une étape clé, car elle permet à l’enfant de comprendre qu’il n’a pas besoin de lutter constamment pour rester à la surface. Elle développe la confiance en soi et en l’élément aquatique, et constitue la base de toutes les techniques de nage, car nager, c’est avant tout glisser sur l’eau en flottant.
9.3. L’Initiation aux Premières Propulsions : Battements de Jambes
Après avoir appris à flotter, l’élève peut commencer à se déplacer. La première source de propulsion travaillée est celle des jambes. [cite_start]Ce sous-chapitre se concentre sur l’apprentissage des battements de jambes[cite: 1077]. En se tenant au bord du bassin ou à une planche, l’élève effectue des battements réguliers, les jambes tendues mais souples, en partant des hanches. L’objectif est de créer une propulsion efficace sans s’épuiser. L’enseignant corrige la position des pieds (pointes tendues) et le rythme des battements. Cet exercice, qui constitue la base du crawl et du dos crawlé, permet à l’enfant de ressentir ses premières sensations de glisse et de déplacement autonome dans l’eau.
9.4. La Coordination des Bras et des Jambes pour le Déplacement
[cite_start]Le stade final de l’initiation est la synchronisation des actions des bras et des jambes[cite: 1077]. Ce sous-chapitre vise à combiner les battements de jambes avec un mouvement simple des bras. Il ne s’agit pas encore d’apprendre une nage codifiée comme le crawl, mais plutôt de trouver une coordination naturelle qui permet un déplacement efficace sur une très courte distance. Par exemple, l’élève peut effectuer des battements de jambes tout en réalisant des mouvements de « petit chien » avec les bras. L’enseignant encourage l’expérimentation pour que l’enfant trouve son propre équilibre et son propre rythme. L’objectif de fin de cycle n’est pas de savoir nager parfaitement, mais d’être autonome et en sécurité sur quelques mètres, marquant ainsi une adaptation réussie au milieu aquatique.
CHAPITRE 10 : LA GYMNASTIQUE ACROBATIQUE ÉLÉMENTAIRE
10.1. Le Saut Roulé et ses Progressions Pédagogiques
Le saut roulé est une figure de gymnastique qui combine une impulsion et une roulade avant. [cite_start]Ce sous-chapitre, destiné à la sixième année, détaille son apprentissage progressif pour garantir la sécurité et la réussite[cite: 2035]. [cite_start]La première étape consiste à rouler après avoir été doucement poussé par un camarade, pour bien intégrer la mécanique de la rotation[cite: 2035]. [cite_start]Ensuite, l’élève peut prendre appui avec ses pieds sur un mur bas ou un escalier pour générer sa propre impulsion et rouler[cite: 2036]. La progression amène l’élève à réaliser la figure de manière autonome. Cette compétence développe la conscience spatiale, la coordination et la capacité à gérer son corps dans un mouvement acrobatique simple.
10.2. L’Exercice de « la Grenouille » pour la Puissance des Jambes
L’exercice de « la grenouille » est un mouvement de gymnastique qui développe la puissance des membres inférieurs et la coordination. Il consiste, à partir d’une position accroupie, à sauter vers l’avant en se réceptionnant à nouveau en position accroupie, imitant ainsi le saut d’une grenouille. [cite_start]Ce sous-chapitre propose d’enseigner cet exercice à travers ses progressions[cite: 2036]. On commence par de petits sauts sur place, puis en avançant, en insistant sur la qualité de l’amorti à la réception. C’est un excellent exercice pour renforcer les cuisses et les mollets, améliorer la détente et préparer à des sauts plus complexes. Il peut être intégré dans des parcours d’agilité pour le rendre plus ludique.
10.3. L’Apprentissage du « Trépied » : Équilibre sur les Mains et la Tête
Le « trépied » est une figure d’équilibre statique sur trois appuis : les deux mains et la tête. C’est une étape fondamentale avant d’aborder l’équilibre sur les mains. [cite_start]Ce sous-chapitre se concentre sur son apprentissage par graduation[cite: 2036]. L’élève apprend d’abord à placer correctement ses mains et sa tête au sol pour former un triangle stable. Ensuite, il pose ses genoux sur ses coudes pour trouver son équilibre. Enfin, il essaie de décoller progressivement ses pieds du sol. Cet exercice développe la force des bras et du cou, le sens de l’équilibre et la confiance en soi. L’enseignant assure une parade constante pour garantir la sécurité de l’élève.
10.4. Le Saut de Lion : Combinaison de la Roulade et du Saut
Le « saut de lion » est une variante spectaculaire du saut roulé, où l’élève doit franchir un petit obstacle avant d’exécuter sa roulade. [cite_start]Ce sous-chapitre est le point culminant de l’initiation à la gymnastique acrobatique au degré terminal[cite: 2036]. [cite_start]La progression est essentielle : on commence par une roulade simple, puis on introduit un obstacle très bas (un camarade agenouillé, mains au sol) par-dessus lequel il faut sauter avant de rouler[cite: 2036]. Cette figure exige de la puissance dans l’impulsion, une bonne maîtrise de la roulade et une excellente conscience de son corps dans l’espace. Elle est très valorisante pour l’élève qui réussit à l’exécuter et témoigne d’une bonne maîtrise des fondamentaux de la gymnastique au sol.
CHAPITRE 11 : LE DÉVELOPPEMENT DES QUALITÉS PHYSIQUES
11.1. L’Endurance par le Trottinement et la Course Lente
Ce sous-chapitre vise à développer de manière systématique l’endurance, c’est-à-dire la capacité à soutenir un effort prolongé. L’outil principal est la course à allure modérée, comme le trottinement ou la course lente. Plutôt que de se focaliser sur la distance ou la durée, l’enseignant propose des jeux d’endurance, comme le « jeu du foulard » où les élèves doivent courir en continu pendant plusieurs minutes. L’objectif est d’habituer le système cardiovasculaire et respiratoire à l’effort, d’améliorer la gestion de la respiration et d’apprendre à l’élève à trouver son propre rythme de course. Le développement de l’endurance est fondamental pour la santé et constitue la base de la performance dans la plupart des sports.
11.2. La Flexibilité par les Exercices d’Étirement
La flexibilité, ou souplesse, est la capacité à réaliser des mouvements de grande amplitude. Ce sous-chapitre est dédié à son amélioration par des exercices d’étirement. Après un échauffement adéquat, l’enseignant guide les élèves à travers des postures d’étirement simples pour les principaux groupes musculaires (jambes, dos, épaules). Il insiste sur le fait que l’étirement doit être doux, progressif et maintenu sans douleur. Ces exercices, pratiqués régulièrement, permettent de préserver la mobilité des articulations, de prévenir les blessures et d’améliorer la qualité du geste sportif. Ils contribuent également à la relaxation et au bien-être général du corps.
11.3. La Force par des Exercices de Musculation Adaptés
Le développement de la force chez l’enfant ne se fait pas avec des charges, mais par des exercices utilisant le poids du corps. Ce sous-chapitre propose des activités ludiques pour renforcer la musculature de l’élève. Il peut s’agir de jeux de traction et de poussée en duo, d’exercices comme la « brouette », de sauts répétés ou de port de petits objets. L’objectif est un renforcement musculaire global et harmonieux, qui améliore la posture et la capacité à réaliser des gestes puissants comme lancer ou sauter. L’enseignant veille à proposer des exercices variés et à ne jamais demander d’efforts excessifs.
11.4. La Vitesse de Réaction par des Jeux de Signal
La vitesse de réaction est la capacité à répondre le plus rapidement possible à un stimulus. Ce sous-chapitre vise à développer cette qualité essentielle dans tous les sports. L’enseignant utilise des jeux basés sur des signaux, qui peuvent être auditifs (un coup de sifflet, un mot) ou visuels (un geste, une couleur). Par exemple, au signal, les élèves doivent démarrer un sprint, se mettre dans une certaine position ou attraper un objet. Ces jeux améliorent la concentration, la vigilance et la rapidité de la connexion entre la perception et l’action motrice. Ils sont très motivants et permettent de travailler cette qualité nerveuse de manière amusante et efficace.
CHAPITRE 12 : LES VALEURS CIVIQUES ET MORALES DANS LE SPORT
12.1. L’Esprit d’Équipe et l’Abnégation
Les sports collectifs et les jeux en équipe sont un terrain privilégié pour développer des valeurs sociales fondamentales. Ce sous-chapitre met l’accent sur l’esprit d’équipe, c’est-à-dire la capacité à faire passer l’intérêt du groupe avant son intérêt personnel. L’élève apprend à coopérer, à communiquer et à faire confiance à ses partenaires. [cite_start]L’abnégation, la capacité à faire des efforts pour le bien de l’équipe, est également valorisée[cite: 630]. L’enseignant encourage les élèves à s’entraider, à se féliciter mutuellement et à comprendre que la victoire est toujours le fruit d’un effort collectif. Il apprend que dans une équipe, chaque joueur a un rôle important à jouer, et que le succès dépend de la solidarité de tous.
12.2. Le Respect des Règles, de l’Adversaire et de l’Arbitre
Il n’y a pas de jeu ni de sport sans règles. Ce sous-chapitre est consacré à l’apprentissage du respect des règles, présentées comme un cadre nécessaire qui garantit l’équité et la sécurité pour tous. L’élève apprend qu’il est interdit de tricher. Le respect s’étend à l’adversaire, qui n’est pas un ennemi mais un partenaire de jeu, sans qui le jeu ne pourrait exister. On lui serre la main avant et après la rencontre. Enfin, le respect de l’arbitre (qui peut être l’enseignant ou un autre élève) et de ses décisions est fondamental. L’élève apprend à accepter une décision même s’il n’est pas d’accord, et à comprendre que l’arbitre est indispensable au bon déroulement du jeu.
12.3. La Maîtrise de Soi dans la Victoire et la Défaite
Le sport est une école d’émotions. [cite_start]Ce sous-chapitre vise à développer la maîtrise de soi [cite: 630] face aux deux issues possibles de la compétition : la victoire et la défaite. L’élève apprend à célébrer la victoire avec joie mais sans arrogance ni moquerie envers l’adversaire. Il apprend surtout à accepter la défaite avec dignité, sans colère, sans chercher de fausses excuses et en sachant reconnaître la supériorité de l’adversaire. Il comprend que la défaite fait partie du jeu et qu’elle est une occasion d’analyser ses erreurs pour progresser. La maîtrise de soi est une qualité morale essentielle qui se forge dans l’expérience de la compétition et qui est transposable à toutes les situations de la vie.
12.4. La Compétition Saine et le Sens de la Performance
La compétition n’est pas une fin en soi, mais un moyen de progresser et de se dépasser. Ce dernier sous-chapitre explique la notion de compétition saine. L’objectif n’est pas d’écraser l’autre, mais de donner le meilleur de soi-même dans le respect des règles et de l’adversaire. [cite_start]La pratique du sport développe le sens de la performance[cite: 2021], c’est-à-dire le désir de s’améliorer, de faire mieux que la fois précédente. L’enseignant encourage chaque élève à se fixer de petits objectifs personnels et à se réjouir de ses propres progrès. L’élève comprend que le plus important n’est pas toujours de gagner, mais de participer avec engagement et de chercher constamment à améliorer ses propres capacités, une attitude qui est la clé de la réussite dans tous les domaines.
ANNEXES
ANNEXE 1 : Exemples de Jeux Traditionnels Congolais
Cette annexe fournit des fiches descriptives pour plusieurs jeux traditionnels congolais mentionnés dans le programme, afin d’aider les enseignants à les mettre en pratique. Chaque fiche détaille les règles du jeu, le matériel nécessaire (souvent très simple), le nombre de joueurs et les compétences développées. [cite_start]Des jeux comme le Nzango, la marelle (Kebo) [cite: 1071] [cite_start]et la course en sac [cite: 1077] sont expliqués pas à pas. [cite_start]L’objectif est de donner aux enseignants des outils concrets pour intégrer facilement ces jeux dans leurs séances, contribuant ainsi à la valorisation du patrimoine culturel [cite: 155] tout en atteignant des objectifs pédagogiques précis en termes de motricité, de rythme et de socialisation. Des variantes régionales, si connues, peuvent être proposées pour enrichir la pratique.
ANNEXE 2 : Modèle de Séance d’Éducation Physique
Pour guider les enseignants, en particulier les moins expérimentés, cette annexe propose un canevas-type pour une séance d’EPS de 45 minutes au premier degré. [cite_start]La séance est structurée en trois parties claires, conformément aux principes de la « gymnastique à prédominance »[cite: 627].
- [cite_start]Mise en train (Échauffement – 10 min) : Une phase d’activation cardiovasculaire et d’assouplissement articulaire, souvent sous forme de marches rythmées et d’exercices doux[cite: 1071].
- Partie principale (Corps de la leçon – 25 min) : Le cœur de la séance, où l’objectif du jour est travaillé (par exemple, l’apprentissage de la roulade, un jeu de mini-football, un parcours d’agilité).
- [cite_start]Retour au calme (Dérivatif psychologique – 10 min) : Une phase de décélération de l’effort, avec des jeux calmes, des étirements ou des exercices de relaxation pour terminer la séance sur une note positive et apaisée[cite: 616]. Ce modèle flexible peut être adapté en fonction du thème de la leçon et des conditions matérielles.
ANNEXE 3 : Guide de Sécurité pour les Activités Physiques
La sécurité est la priorité absolue en EPS. Cette annexe présente une liste de consignes de sécurité essentielles que l’enseignant doit respecter avant, pendant et après chaque séance. Les points abordés incluent :
- Vérification de l’aire de jeu : s’assurer que le terrain est dégagé, sans objets dangereux (pierres, trous).
- Tenue des élèves : encourager le port de vêtements adaptés à la pratique physique et éviter les chaussures ou objets qui pourraient blesser.
- Échauffement obligatoire : ne jamais commencer une activité intense sans une préparation adéquate du corps.
- Consignes claires et respectées : s’assurer que tous les élèves ont compris les règles du jeu ou de l’exercice avant de commencer.
- Surveillance constante : l’enseignant doit superviser activement l’ensemble du groupe pendant toute la durée de la séance.
- Gestion de la fatigue : savoir reconnaître les signes de fatigue chez un enfant et lui permettre de se reposer.
ANNEXE 4 : Lexique des Termes d’Éducation Physique
Ce lexique a pour but de clarifier le vocabulaire technique utilisé dans le programme d’EPS du premier degré. Il fournit des définitions simples et concrètes pour des termes que les enseignants pourraient ne pas maîtriser. Les mots définis incluent :
- Assouplissement : Ensemble d’exercices visant à augmenter la flexibilité des articulations.
- Coordination : Capacité à réaliser un mouvement de manière harmonieuse en utilisant différentes parties du corps.
- Cloche-pied : Sauter et se déplacer sur un seul pied.
- Quadrupédie : Se déplacer à quatre pattes (sur les mains et les pieds).
- Trottinement : Courir à une allure très lente et régulière.
- Agilité : Capacité à changer de position ou de direction rapidement et avec contrôle. Cet outil vise à assurer que tous les enseignants partagent une compréhension commune des termes techniques pour une application correcte et efficace du programme.


