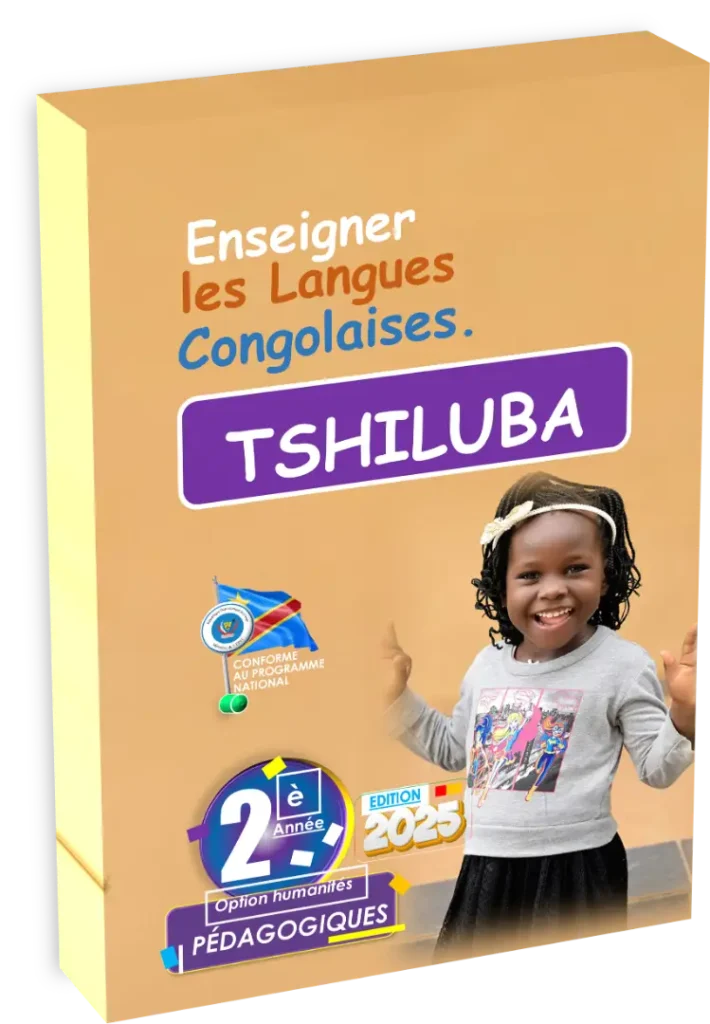
ENSEIGNEMENT DE TSHILUBA, 2ÈME ANNÉE, OPTION HUMANITÉS PÉDAGOGIQUES
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC
Préliminaires
1. Contexte et justification
La deuxième année de l’option Humanités Pédagogiques consolide les acquis fondamentaux en Tshiluba pour orienter l’apprenant vers une maîtrise avancée, indispensable à sa future profession d’enseignant. Le programme approfondit les structures complexes de la langue et renforce sa dimension culturelle, assurant que le futur maître puisse l’utiliser comme un outil précis d’analyse et de transmission des savoirs. Tshidimu tshibidi etshi tshidi bua kukolesha mayele onso a muakulu, bua mulongeshi wa matuku atshilualua ikale ne dimanya dia bungi.
2. Objectifs spécifiques de la 2ᵉ année
Cette année vise à développer la capacité des élèves à analyser et produire des discours complexes et argumentés en Tshiluba. Les objectifs incluent la maîtrise des nuances phonologiques, la compréhension fine de la morphosyntaxe, l’enrichissement du lexique disciplinaire et culturel, et l’application des techniques de la didactique bilingue. Tshipatshila ntshia se: mulongi afike ku diakula ne kufunda mu mushindu mulumbuluile ne wa meji.
3. Références légales et alignement SSEF 2016-2025
Le contenu de ce programme est rigoureusement aligné sur les directives de la Loi-cadre n°14/004 de l’Enseignement National et les axes stratégiques de la Stratégie Sectorielle de l’Éducation et de la Formation (SSEF). Il met en œuvre la politique de promotion des langues nationales comme piliers d’une éducation de qualité et vecteurs d’identité culturelle.
4. Méthodologie APS et transition bilingue
L’Approche Par les Situations (APS) demeure la pierre angulaire, en contextualisant chaque apprentissage dans des scénarios de la vie réelle, comme une négociation au grand marché de Kananga ou l’analyse d’un discours d’un chef coutumier à Kabeya Kamuanga. Cette approche est couplée à une stratégie de transition bilingue structurée, qui utilise le Tshiluba comme tremplin pour un apprentissage solide du français.
Partie I – Renforcement du système graphique et phonologique 🗣️
Chapitre 1 – Révision de l’alphabet et digrammes
1.1. Lettres et graphies complexes
Cette section revient sur les graphèmes du Tshiluba en se focalisant sur les difficultés orthographiques potentielles. L’étude approfondit la distinction entre des sons proches et leurs transcriptions, comme la différence de prononciation et d’écriture entre les mots contenant p et ceux contenant mp.
1.2. Différenciation digrammes/trigrammes
L’analyse se porte sur la reconnaissance et l’écriture correcte des groupes de lettres représentant un son unique. Les élèves apprennent à distinguer clairement un digramme comme sh d’une séquence de deux consonnes, et à identifier les rares trigrammes qui peuvent apparaître, notamment dans les mots d’emprunt.
1.3. Allographes en contextes lexicalisés
L’étude explore les variations de graphie d’un même son (allographes) selon le contexte phonétique ou l’origine du mot. Tudi tulonga mudibu mua kufunda dîyi dimue mu mishindu mishilangane bituadijile pa muaba wadi. Par exemple, la réalisation d’un son peut légèrement varier et être notée différemment dans des documents plus anciens ou des transcriptions régionales.
1.4. Exercices de repérage visuel
Des activités ciblées sont mises en place pour entraîner l’œil de l’élève à repérer rapidement et sans erreur les graphies complexes au sein d’un texte. Ces exercices incluent la surbrillance de digrammes spécifiques dans un article de presse ou la classification de mots selon leur structure graphique.
Chapitre 2 – Nuances phonétiques et tons 🎶
2.1. Tons primaires vs secondaires
Ce point va au-delà de la simple reconnaissance des tons haut et bas en introduisant les tons dérivés ou secondaires. Les élèves apprennent à identifier les tons modulés (montant, descendant) et à comprendre comment ils résultent de la combinaison de tons primaires à la jonction de deux morphèmes.
2.2. Alternances vocaliques en position ouverte/fermée
Une analyse fine des phénomènes d’harmonie vocalique est menée. Il s’agit de comprendre pourquoi la voyelle d’un suffixe peut changer pour s’harmoniser avec la voyelle du radical verbal, par exemple dans la formation du causatif. Dîyi didi dishintuluka bua kumvuangana bimpe ne dikuabu.
2.3. Consonnes labiales et vélaire en variation
Les variations contextuelles de certaines consonnes sont examinées. L’étude se penche sur la manière dont une consonne comme /k/ peut se prononcer différemment (par exemple, palatalisée) lorsqu’elle est suivie d’une voyelle antérieure comme /i/, un phénomène observable dans le parler rapide de la jeunesse de Mbuji-Mayi.
2.4. Ateliers d’écoute ciblée
Des ateliers pratiques sont organisés avec des enregistrements audio de locuteurs de différentes régions (par exemple, du Kasaï-Oriental et du Kasaï-Central). Les élèves s’entraînent à discriminer les nuances de prononciation et les schémas tonals subtils, affinant ainsi leur compétence de compréhension orale.
Partie II – Approfondissement morphologique 🧩
Chapitre 3 – Classes nominales avancées
3.1. Préfixes de classe et sème sémantique
L’étude des classes nominales est approfondie en liant chaque classe à un champ sémantique dominant. Par exemple, la classe bu- (cl. 14) est souvent associée à des concepts abstraits (bumuntu: humanité) et la classe lu- (cl. 11) à des objets longs ou à des notions étendues (lukàsu: une longue machette).
3.2. Pluriels irréguliers et extensions
Ce point examine les cas de formation du pluriel qui dévient des paires régulières, notamment les noms qui changent complètement de classe au pluriel ou ceux qui n’ont qu’une seule forme. Les extensions nominales (suffixes qui modifient le sens du nom) sont également étudiées. Mêna makuabu kaena alonda njila umue wa kuenza bungi.
3.3. Dérivations agglutinantes
Le processus de dérivation est exploré plus en détail, en montrant comment plusieurs suffixes peuvent s’agglutiner à un radical pour créer des mots nouveaux et complexes. À partir du verbe ku-longa (étudier), on peut former mu-long-eshi (enseignant) puis bu-long-eshi (la profession d’enseignant).
3.4. Travaux de segmentation complexe
Les élèves sont mis au défi de décomposer des mots longs et complexes en leurs morphèmes constitutifs. Cette compétence analytique leur permet de déduire le sens de termes inconnus en identifiant le radical, le préfixe de classe et les différents suffixes dérivationnels.
Chapitre 4 – Morphologie verbale complexe ⚙️
4.1. Affixes aspectuels et modaux
Cette section se concentre sur les affixes (infixes et suffixes) qui ne marquent pas le temps, mais l’aspect (action achevée, habituelle, en cours) et la modalité (possibilité, obligation). Par exemple, le suffixe -angà peut indiquer une action répétitive ou habituelle.
4.2. Formes négatives et interrogatives
La construction des formes verbales négatives et interrogatives est systématiquement étudiée pour tous les temps et modes. Les élèves apprennent à manipuler les différents marqueurs de négation (comme le préfixe ka-) et les structures syntaxiques de l’interrogation. Tudi tulonga mua kuamba « Tòo » ne mua kuebeja lukonko.
4.3. Constructions causatives et réciproques
L’étude porte sur les suffixes verbaux qui modifient la valence du verbe. Le causatif (-isha) ajoute un agent qui fait faire l’action (ex: kudia [manger] → kudiisha [faire manger]), tandis que le réciproque (-angana) indique une action mutuelle (ex: kumona [voir] → kumonangana [se voir mutuellement]).
4.4. Tableaux de conjugaison approfondis
Des tableaux de conjugaison plus complexes sont utilisés pour systématiser la maîtrise des formes verbales. Ces tableaux incluent les formes passives, appliquées, causatives et réciproques pour un ensemble de verbes représentatifs à tous les temps et modes.
Partie III – Syntaxe et structuration du discours 🔗
Chapitre 5 – Syntaxe des phrases complexes
5.1. Subordonnées circonstancielles
L’analyse porte sur les propositions subordonnées qui expriment les circonstances de l’action : le temps, le lieu, la cause, le but, la manière. Les élèves apprennent à utiliser les conjonctions de subordination appropriées, comme bua (pour que) ou pavua (quand).
5.2. Concessives et conditionnelles
Les structures exprimant la concession (nansha mudi…: même si…) et la condition (biobi…: si…) sont étudiées. La maîtrise de ces constructions est essentielle pour formuler un raisonnement hypothétique et nuancé, par exemple lors d’un débat en classe sur le développement de la province du Sankuru.
5.3. Juxtaposition et alternance codique
Cette section examine comment la juxtaposition de phrases simples peut créer des effets de sens complexes. Elle analyse également comment l’alternance codique (le passage stratégique au français au sein d’une phrase en Tshiluba) est utilisée par les locuteurs pour des raisons pragmatiques et stylistiques.
5.4. Exercices de transformation
Des exercices de transformation syntaxique avancés sont proposés. Les élèves s’entraînent à combiner plusieurs phrases simples en une phrase complexe, ou à reformuler une idée en utilisant différentes structures subordonnées (par exemple, transformer une subordonnée causale en subordonnée concessive).
Chapitre 6 – Connecteurs avancés et cohésion ➡️
6.1. Connecteurs logiques multiples
Un inventaire des connecteurs logiques plus rares ou plus spécialisés est dressé. L’objectif est d’enrichir la palette d’outils de l’élève pour lui permettre d’articuler sa pensée avec une plus grande précision, en utilisant des articulateurs pour la réfutation, la reformulation ou l’illustration.
6.2. Structuration du discours argumentatif
Les élèves apprennent à organiser un texte argumentatif en Tshiluba. Kulongolola meji bua kukoka muntu ku diebe. Cela inclut la formulation d’une thèse claire, le développement d’arguments soutenus par des exemples, et l’utilisation de connecteurs pour assurer une progression logique du raisonnement.
6.3. Enchaînements narratifs sophistiqués
Ce point va au-delà de la chronologie simple pour explorer des techniques narratives plus élaborées. Les élèves étudient l’utilisation de retours en arrière (flashbacks) ou d’anticipations (prolepses) dans des récits, en analysant les marqueurs linguistiques qui permettent ces ruptures temporelles.
6.4. Rédaction de courts discours
En guise d’application, les élèves sont amenés à rédiger et à prononcer de courts discours sur des thèmes variés (allocution de bienvenue, plaidoyer pour un projet communautaire). Cet exercice synthétise les compétences en structuration du discours et en utilisation des connecteurs.
Partie IV – Lexique et domaines d’usage 🗃️
Chapitre 7 – Terminologie disciplinaire
7.1. Lexique scientifique et technique
Cette section vise à doter les futurs enseignants du vocabulaire Tshiluba nécessaire pour aborder des concepts scientifiques de base (biologie, physique) et techniques (agriculture, artisanat). Il s’agit de leur donner les moyens d’expliquer ces notions dans la langue nationale.
7.2. Termes administratifs et civiques
Le vocabulaire relatif à l’administration, à la citoyenneté et à l’organisation de l’État congolais est présenté. Mêyi a malu a Bena ditunga ne a Mbulamatadi. Les élèves se familiarisent avec des termes comme « élection » (mapòna), « loi » (mukenji) ou « province » (tshidi).
7.3. Néologismes et calques
L’étude analyse les processus de création de mots nouveaux (néologismes) pour désigner des réalités modernes, ainsi que le phénomène de calque sémantique où un mot Tshiluba existant prend un nouveau sens par contact avec le français.
7.4. Ateliers de classement terminologique
Des ateliers pratiques sont organisés pour que les élèves s’approprient activement ce vocabulaire spécialisé. Ils créent des glossaires thématiques, des fiches terminologiques ou des cartes conceptuelles pour organiser et mémoriser les termes appris.
Chapitre 8 – Champs sémantiques culturels 🌍
8.1. Proverbes et formules statutaires
Une analyse approfondie des proverbes (nsona) et de leur sagesse est menée. Les élèves étudient également les formules de politesse et les expressions statutaires utilisées pour s’adresser aux aînés, aux chefs ou lors de cérémonies, reflétant la structure sociale. Kasumu ka balela: « Ufùma munda, kuîshi ufùma ku mêsu. »
8.2. Chants et littérature orale
Des extraits de la riche tradition orale Luba (contes, épopées, chants) sont étudiés non seulement pour leur valeur culturelle, mais aussi comme corpus pour l’analyse linguistique. Le vocabulaire poétique, les figures de style et les structures narratives spécifiques y sont identifiés.
8.3. Lexique patrimonial provincial
Ce point explore les variations lexicales et les termes spécifiques liés au patrimoine naturel et culturel des différentes provinces où le Tshiluba est parlé. Par exemple, le vocabulaire de la pêche sur la rivière Lubilanji diffère de celui de l’exploitation minière artisanale.
8.4. Analyse de corpus authentiques
Les élèves travaillent directement sur des corpus authentiques : enregistrements de discours, transcriptions de contes, articles de journaux en langue locale. Ils y analysent l’usage concret du lexique culturel et des structures idiomatiques en contexte.
Partie V – Compréhension et production textuelles 📖✍️
Chapitre 9 – Lecture critique de textes variés
9.1. Stratégies d’analyse critique
Les élèves sont formés à aller au-delà de la compréhension littérale pour développer une lecture critique. Ils apprennent à identifier le point de vue de l’auteur, à déceler les implicites, à évaluer la pertinence des arguments et à distinguer les faits des opinions.
9.2. Textes descriptifs et explicatifs
La lecture analytique de textes descriptifs (portraits, paysages) et explicatifs (articles de vulgarisation) est pratiquée. L’accent est mis sur le repérage de la structure du texte, du vocabulaire spécifique et des procédés utilisés pour décrire ou expliquer.
9.3. Textes argumentatifs et poétiques
Ce point se concentre sur des genres textuels plus complexes. L’analyse de textes argumentatifs vise à démonter la stratégie de persuasion de l’auteur, tandis que l’étude de poèmes en Tshiluba explore le langage figuré, le rythme et la musicalité. Kumvua meji adi musokome mu mukanda.
9.4. Fiches-guides de lecture
Des fiches de lecture spécifiques à chaque type de texte sont élaborées. Ces outils guident les élèves dans leur analyse en leur proposant une série de questions ciblées sur la structure, le style, le lexique et l’intention du texte.
Chapitre 10 – Techniques de production écrite
10.1. Conception de plans détaillés
Les élèves apprennent à élaborer des plans de rédaction sophistiqués (dialectique, thématique, analytique) en fonction du type de texte à produire. Cette étape de structuration de la pensée est présentée comme un prérequis à toute rédaction de qualité.
10.2. Rédaction de dissertations courtes
La pratique de la dissertation est introduite. Les élèves s’exercent à rédiger des textes argumentatifs courts sur des sujets de société ou de culture, en mobilisant leurs connaissances linguistiques et leurs capacités d’analyse. Kufunda mukanda mulumbuluile pa tshiena-bualu tshipeshangana.
10.3. Révision collaborative et auto-correction
Des techniques de relecture par les pairs (révision collaborative) sont mises en place. Les élèves apprennent à donner et à recevoir un feedback constructif sur leurs productions écrites, en complément des stratégies d’auto-correction guidées par des grilles de critères.
10.4. Portfolio de productions
Chaque élève constitue un portfolio rassemblant une sélection de ses travaux écrits. Cet outil permet de visualiser sa progression sur l’année, de prendre conscience de ses points forts et de ses axes d’amélioration en matière de production écrite.
Partie VI – Didactique bilingue et évaluation 🇨🇩🇫🇷
Chapitre 11 – Séquences d’alternance codique
11.1. Phases de transition franco-tshiluba
Des modèles de séquences didactiques sont présentés pour gérer la transition d’une discipline enseignée en Tshiluba vers le français. Ces séquences sont phasées pour introduire progressivement la terminologie française tout en s’appuyant sur la compréhension acquise en langue nationale.
11.2. Activités d’immersion ciblée
Ce point propose des stratégies pour créer des moments d’immersion linguistique ciblée en classe. Par exemple, un débat sur un sujet scientifique peut être mené entièrement en Tshiluba pour activer le lexique disciplinaire, avant de passer à une synthèse en français.
11.3. Outils de suivi bilinguo
Des outils spécifiques sont développés pour permettre à l’enseignant de suivre la progression des élèves dans les deux langues. Il s’agit de grilles d’observation qui évaluent la capacité de l’élève à passer d’une langue à l’autre et à transférer ses compétences. Bintu bia kudienzeja bua kumona mudi balongi benda bakola mu miakulu ibidi.
11.4. Études de progression
Les enseignants sont initiés à mener de petites études de cas dans leurs propres classes pour analyser l’impact des stratégies bilingues sur les apprentissages des élèves. Cette démarche réflexive contribue à l’amélioration continue des pratiques pédagogiques.
Chapitre 12 – Évaluation formative et sommative 📊
12.1. Grilles d’évaluation par compétence
Des grilles d’évaluation détaillées, basées sur les compétences (comprendre, parler, lire, écrire), sont fournies. Elles permettent une évaluation objective et transparente des performances des élèves, tant pour l’évaluation formative (en cours d’apprentissage) que sommative (en fin de séquence).
12.2. Tests oraux et écrits
Différents formats de tests sont proposés pour évaluer l’ensemble des compétences. Cela inclut des épreuves écrites (dissertation, analyse de texte) et des épreuves orales (exposé, entretien) qui mesurent la fluidité et la correction de l’expression.
12.3. Auto-évaluation et remédiation
Les élèves sont outillés pour s’auto-évaluer à l’aide de grilles simplifiées. Cette démarche métacognitive leur permet de prendre conscience de leurs propres lacunes et de s’engager activement dans les activités de remédiation proposées par l’enseignant. Muan’a kalasa udi uditangila yeye muine bua kumona padiye ne bua kukolesha.
12.4. Portfolio d’évaluation
Le portfolio est utilisé non seulement comme un outil d’apprentissage, mais aussi comme un instrument d’évaluation. Il permet d’évaluer la progression de l’élève sur le long terme et de prendre en compte une diversité de productions qui reflètent l’étendue de ses compétences.
Partie VII – Intégration culturelle et citoyenne 🏛️
Chapitre 13 – Projets culturels et patrimoniaux
13.1. Organisation de veillées orales
Les élèves sont amenés à organiser des « veillées culturelles » au sein de l’école, où ils présentent des contes, des proverbes et des chants recueillis auprès de leur communauté. Ce projet pratique les ancre dans leur rôle de passeurs de culture.
13.2. Récits historiques provinciaux
Ce point encourage la recherche et la restitution de récits historiques locaux. Enquêter sur l’histoire de leur village ou de leur ville (par exemple, l’histoire de la chefferie de Bakwanga) et la présenter en Tshiluba renforce à la fois leurs compétences linguistiques et leur conscience historique.
13.3. Événements festifs et rituels
L’étude du lexique et des pratiques associés aux grands événements de la vie (naissance, mariage, deuil) est menée. Comprendre le déroulement et la signification de ces rituels est essentiel pour saisir les soubassements culturels de la société. Malu a bibelu ne a masanka a mu nsombelu wetu.
13.4. Journal de bord de l’élève
Chaque élève tient un journal de bord où il consigne ses découvertes culturelles, ses réflexions sur les liens entre langue et société, et ses expériences lors des projets patrimoniaux. C’est un outil de développement personnel et de réflexion citoyenne.
Chapitre 14 – Formation continue des enseignants 👨🏾🏫👩🏾🏫
14.1. Ateliers de co-enseignement
Des ateliers sont organisés pour former les enseignants aux techniques du co-enseignement. Cette modalité leur permet de planifier et d’animer des leçons à deux, favorisant l’échange de pratiques et le soutien mutuel en temps réel.
14.2. Techniques de supervisation
Ce point outille les chefs d’établissement et les conseillers pédagogiques avec des techniques de supervision constructive. L’accent est mis sur l’observation de classe suivie d’un entretien de feedback qui vise à valoriser les points forts et à co-construire des pistes d’amélioration.
14.3. Cercles de pratique réflexive
La mise en place de « cercles de réflexion » entre enseignants est encouragée. Kubuela mu kasumbu ka balami bua kuakula pa mudimu. Ces rencontres régulières leur permettent de discuter de leurs défis pédagogiques, de partager des solutions et de réfléchir collectivement à leur pratique professionnelle.
14.4. Plans d’amélioration
Chaque enseignant est accompagné dans l’élaboration de son propre plan de développement professionnel. Sur la base de l’auto-évaluation et du feedback reçu, il identifie des objectifs d’amélioration précis et les actions à mettre en place pour les atteindre.
Annexes
Annexe A – Bibliographie et manuels officiels 📚
Cette annexe fournit la liste actualisée des manuels scolaires agréés par le ministère, ainsi qu’une bibliographie complémentaire d’ouvrages de référence en linguistique et culture Luba. Elle constitue une base documentaire essentielle pour l’enseignant qui souhaite approfondir ses connaissances.
Annexe B – Modèles de grilles et fiches pédagogiques 📋
Une série de documents pédagogiques standardisés est proposée : modèles de fiches de préparation de leçon, grilles d’observation pour le co-enseignement, et exemples de fiches d’activités pour les élèves. Ces outils visent à faciliter le travail quotidien de l’enseignant et à harmoniser les pratiques.
Annexe C – Glossaire avancé de linguistique appliquée 🔍
Ce glossaire va au-delà des termes de base en définissant des concepts plus pointus de linguistique appliquée, de sociolinguistique et de didactique des langues. Mukanda wa miaku ya meji a ndongeshelu. Il sert de référence terminologique de haut niveau pour les formateurs et les enseignants désireux de parfaire leur expertise.



