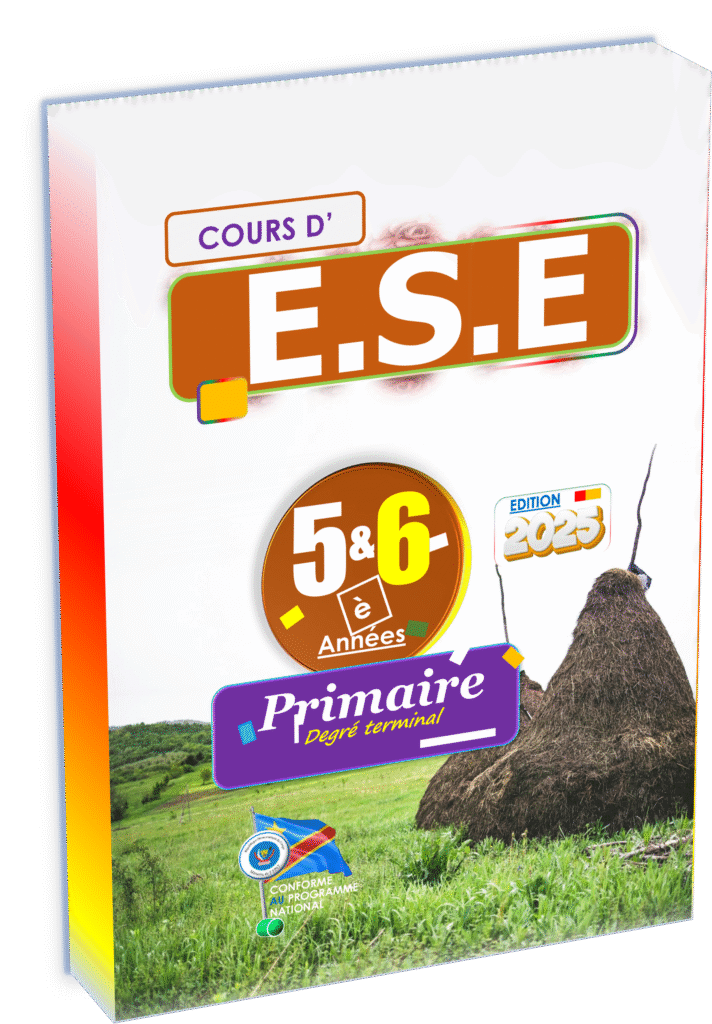
COURS D’ÉDUCATION POUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT, 5ÈME ET 6ÈME ANNÉE PRIMAIRE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
PRÉLIMINAIRES
0.1. Finalités et Buts de l’Enseignement pour la Santé et l’Environnement
L’enseignement de l’Éducation pour la Santé et l’Environnement (ESE) au degré terminal a pour finalité de former un citoyen éclairé, proactif et responsable, capable de prendre des décisions judicieuses pour sa santé, celle de sa communauté et la pérennité de l’environnement. L’objectif principal est de doter l’élève d’une compréhension approfondie des interactions complexes entre les comportements humains, la santé et l’équilibre écologique. 
0.2. Profil de Sortie du Degré Terminal
Au terme du cycle primaire, l’élève doit manifester une autonomie et une créativité affirmées dans la promotion de la santé individuelle et collective. Il doit pouvoir mettre en pratique les gestes de secourisme élémentaire en cas d’accidents domestiques et expliquer les modes de prévention des maladies transmissibles, y compris les IST/VIH-SIDA. Il est attendu de lui qu’il puisse analyser les enjeux de l’alimentation, identifier les carences et les tabous alimentaires et en déduire les conséquences sur la santé. 
0.3. Approche Pédagogique et Didactique
L’approche pédagogique en ESE est centrée sur l’enquête, le projet et l’engagement citoyen. La démarche didactique part de situations-problèmes complexes et authentiques, souvent issues de l’actualité sanitaire ou environnementale, pour amener les élèves à investiguer, analyser et proposer des solutions. L’enseignant agit comme un médiateur du savoir, qui encourage la recherche documentaire, le débat argumenté, l’expérimentation et l’action sur le terrain. 
PARTIE 1 : LA SANTÉ INDIVIDUELLE : PRÉVENTION, HYGIÈNE APPROFONDIE ET SECOURISME
CHAPITRE 1 : L’HYGIÈNE PERSONNELLE APPROFONDIE ET LA PRÉVENTION DES RISQUES 
1.1. La Prévention des Maladies des Organes Sensoriels
Ce sous-chapitre vise à doter l’élève des connaissances nécessaires pour protéger ses organes sensoriels. Il étudie les maladies courantes de l’œil (conjonctivite, cataracte), du nez (sinusite, rhinite) et de l’oreille (otite, oreillons). Pour chaque organe, il apprend les mesures préventives spécifiques : éviter de se frotter les yeux avec des mains sales, se moucher correctement, ne pas introduire d’objets dans le conduit auditif et éviter l’exposition à des bruits excessifs. 
1.2. L’Hygiène Bucco-dentaire et la Prévention des Caries
La santé bucco-dentaire est un aspect fondamental de la santé générale. L’élève approfondit sa connaissance de l’hygiène des dents. Il étudie la carie dentaire, en comprenant son processus (attaque de l’émail par les acides produits par les bactéries à partir du sucre). 
1.3. La Lutte contre l’Automédication et le Bon Usage des Médicaments
Ce volet du programme aborde un enjeu de santé publique majeur. L’élève apprend les dangers de l’automédication, qui consiste à prendre des médicaments sans l’avis d’un professionnel de santé. Il comprend que cette pratique peut masquer les symptômes d’une maladie grave, entraîner des effets secondaires indésirables ou créer des résistances aux traitements. 
1.4. La Prévention des Intoxications et des Dépendances (Alcool, Tabac)
L’élève est sensibilisé aux risques liés à la consommation de substances toxiques. Il étudie les méfaits de l’alcool et du tabac sur la santé (maladies du foie, des poumons, du cœur). Il est également alerté sur le danger de l’intoxication médicamenteuse, due à une mauvaise utilisation ou à un surdosage. 
CHAPITRE 2 : LES PRINCIPES DE LA VACCINATION ET DE L’IMMUNITÉ 
2.1. Le Rôle Fondamental et le Mécanisme d’Action du Vaccin
L’élève approfondit sa compréhension du vaccin. Il apprend qu’un vaccin est une préparation contenant des microbes tués ou affaiblis, ou des fragments de microbes, qui, une fois introduits dans l’organisme, ne provoquent pas la maladie mais stimulent le système immunitaire. 
2.2. Les Grandes Maladies Évitables par la Vaccination
Ce sous-chapitre passe en revue les principales maladies ciblées par les programmes de vaccination. L’élève revoit les maladies déjà étudiées (rougeole, tétanos, polio…) et en découvre d’autres, comme la fièvre jaune ou l’hépatite B. Pour chaque maladie, une description simple des symptômes et de la gravité potentielle est faite, afin de souligner l’importance capitale de la prévention vaccinale.
2.3. L’Importance du Respect du Calendrier Vaccinal
L’élève apprend que l’efficacité de la vaccination repose sur le respect d’un calendrier précis, avec des âges spécifiques pour chaque vaccin et la nécessité de doses de rappel. Il comprend que ce calendrier est conçu par les scientifiques pour garantir la meilleure protection possible tout au long de l’enfance et de la vie. 
2.4. La Notion d’Immunité Individuelle et Collective
L’élève est initié à la notion d’immunité. Il apprend que l’immunité est la capacité du corps à résister à une infection. Il découvre qu’elle peut être acquise naturellement (après avoir eu la maladie) ou artificiellement (grâce à la vaccination). 
CHAPITRE 3 : L’INITIATION AUX GESTES DE SECOURISME 
3.1. Les Premiers Gestes face aux Accidents Domestiques Courants
Ce sous-chapitre vise à rendre l’élève capable de réagir de manière appropriée face à un accident domestique. Il apprend la chaîne de l’urgence : Protéger (éviter le suraccident), Alerter (prévenir un adulte ou les secours) et Secourir (effectuer les gestes de premiers secours). Il apprend à identifier les situations à risque à la maison pour mieux les prévenir.
3.2. La Conduite à Tenir face à une Blessure et une Hémorragie
L’élève apprend les gestes spécifiques pour prendre en charge une blessure. Il revoit le nettoyage d’une plaie simple. Il apprend à reconnaître une hémorragie (un saignement abondant) et à pratiquer le geste qui sauve : la compression manuelle directe sur la plaie avec un tissu propre pour arrêter ou limiter le saignement en attendant les secours. 
3.3. La Prise en Charge Initiale d’une Fracture ou d’une Brûlure
L’élève apprend à reconnaître les signes d’une fracture (douleur vive, déformation, impossibilité de bouger un membre) et la conduite à tenir : ne surtout pas déplacer la victime et immobiliser le membre fracturé du mieux possible. Pour une brûlure, il apprend le réflexe essentiel : refroidir immédiatement et longuement la zone brûlée sous l’eau froide pour limiter la gravité de la lésion.
3.4. Les Techniques de Réanimation Élémentaires
Ce volet du programme, plus avancé, initie l’élève aux gestes de survie. Il apprend à vérifier la conscience et la respiration d’une victime. Il est initié à la Position Latérale de Sécurité (PLS), une technique qui permet de maintenir libres les voies respiratoires d’une personne inconsciente qui respire. 
PARTIE 2 : LA SANTÉ COMMUNAUTAIRE : LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES
CHAPITRE 4 : LES MALADIES LIÉES À L’HYGIÈNE DU MILIEU 
4.1. L’Étude des Maladies Hydriques Majeures (Choléra, Typhoïde)
L’élève étudie de manière plus approfondie les maladies transmises par l’eau contaminée. Il découvre le choléra et la fièvre typhoïde, deux maladies diarrhéiques graves. Il apprend leurs modes de transmission (ingestion d’eau ou d’aliments souillés par des matières fécales) et leurs principaux symptômes. 
4.2. Les Verminoses Intestinales : Cycles de Vie et Stratégies de Prévention
Ce sous-chapitre approfondit la connaissance des vers parasites. L’élève étudie le cycle de vie de vers comme l’ascaris ou le ténia, pour mieux comprendre comment l’infestation se produit. Il revoit et systématise les mesures de prévention qui permettent de rompre ce cycle : hygiène fécale (usage des latrines), hygiène des mains, hygiène alimentaire (bonne cuisson de la viande de porc pour éviter le ténia) et port de chaussures.
4.3. L’Importance Sanitaire de la Gestion des Latrines
Les latrines sont présentées comme un bouclier sanitaire pour la communauté. L’élève apprend les caractéristiques de bonnes latrines : elles doivent être propres, munies d’un couvercle pour empêcher les mouches d’entrer et de sortir, et construites à une distance suffisante d’un point d’eau pour éviter la contamination. 
4.4. Les Risques liés aux Eaux de Baignade et la Lutte contre la Bilharziose
L’élève est sensibilisé aux maladies que l’on peut contracter par simple contact avec de l’eau douce contaminée. Il étudie la bilharziose (ou schistosomiase), une maladie parasitaire dont le cycle de vie passe par un petit mollusque d’eau douce. 
CHAPITRE 5 : LA LUTTE CONTRE LES MALADIES INFECTIEUSES COURANTES 
5.1. L’Identification des Symptômes et des Signes d’Alerte des Maladies
Pour réagir vite et bien face à une maladie, il faut savoir en reconnaître les premiers signes. L’élève apprend à identifier les symptômes des maladies les plus courantes dans son environnement : la fièvre, les maux de tête, les maux de ventre, la diarrhée, la toux, le rhume. 
5.2. Les Modes de Transmission et de Prévention de la Tuberculose
La tuberculose est une maladie infectieuse grave qui touche les poumons. L’élève apprend qu’elle se transmet par voie aérienne, par les gouttelettes de salive projetées lorsqu’une personne malade tousse. 
5.3. Les Modes de Transmission et de Prévention de la Rougeole et du Paludisme
L’élève étudie deux autres maladies endémiques majeures. Pour la rougeole, il apprend qu’elle est très contagieuse et se transmet par voie aérienne, et que la vaccination est le meilleur moyen de s’en protéger. Pour le paludisme (malaria), il revoit qu’il est transmis par la piqûre du moustique anophèle femelle et que la prévention repose sur la lutte contre les moustiques (destruction des gîtes, utilisation de moustiquaires).
5.4. La Compréhension de la Relation entre Nutrition et Maladies Infectieuses
Ce sous-chapitre établit un lien crucial entre deux domaines de la santé. L’élève apprend qu’un état de malnutrition affaiblit les défenses de l’organisme et le rend beaucoup plus vulnérable aux infections. Inversement, une maladie infectieuse peut aggraver la malnutrition. 
CHAPITRE 6 : LA SENSIBILISATION AUX INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (IST) 
6.1. L’Identification des Principales IST et de leurs Conséquences
L’élève est initié à la connaissance des Infections Sexuellement Transmissibles. Il apprend à nommer les plus courantes, comme la syphilis et la gonococcie. Il découvre leurs principaux signes et leurs conséquences graves sur la santé si elles ne sont pas traitées (stérilité, malformations congénitales…). 
6.2. Les Modes de Transmission et les Moyens de Prévention du VIH/SIDA
Un focus particulier est mis sur le Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH), responsable du SIDA. L’élève apprend les trois modes de transmission du virus : par voie sexuelle, par voie sanguine (transfusions, objets tranchants souillés) et de la mère à l’enfant. Il apprend également les gestes qui ne transmettent PAS le virus. HIV Il découvre les moyens de prévention efficaces : l’abstinence sexuelle, la fidélité, l’utilisation de matériel à usage unique ou stérilisé, et le dépistage du sang.
6.3. L’Analyse Critique des Comportements à Risque
Ce volet du programme vise à développer les compétences de l’élève à identifier et à éviter les situations qui l’exposent au risque de contracter une IST ou le VIH. Il analyse les comportements à risque comme les rapports sexuels non protégés, la prostitution, le viol, le harcèlement sexuel, ou le partage d’objets tranchants. 
6.4. L’Adoption de Comportements Respectueux envers les Personnes vivant avec le VIH
La lutte contre le SIDA passe aussi par la lutte contre la discrimination. L’élève apprend que le VIH ne se transmet pas par les gestes de la vie quotidienne (serrer la main, partager un repas, jouer ensemble). 
PARTIE 3 : NUTRITION APPROFONDIE ET ENJEUX ALIMENTAIRES
CHAPITRE 7 : LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET LA SÉCURITÉ SANITAIRE 
7.1. Le Parcours des Aliments : de la Production à la Consommation
L’élève étudie la chaîne alimentaire dans son ensemble. Il apprend à identifier les différentes étapes du parcours d’un aliment : la production (au champ, à la ferme), la transformation éventuelle (mouture du maïs à Bukavu), la conservation, le transport, la commercialisation et enfin la consommation. 
7.2. Les Techniques Approfondies de Conservation et de Transformation
Ce sous-chapitre revoit et approfondit les techniques de conservation des aliments. En plus du séchage, du fumage et de la salaison, l’élève peut être initié à d’autres techniques comme la réfrigération (si le contexte le permet) ou la fermentation (pour la préparation de la chikwangue). 
7.3. Les Précautions d’Hygiène Fondamentales avant la Consommation
L’élève systématise les règles d’hygiène alimentaire. Il comprend que chaque étape de la chaîne alimentaire comporte des risques de contamination et que la vigilance est de mise. 
7.4. L’Identification et la Gestion des Biens Consommables Périssables
L’élève apprend à identifier les aliments qui se conservent mal et qui présentent un risque sanitaire élevé s’ils ne sont pas frais (viande, poisson, lait, etc.). Il est sensibilisé à la lecture et au respect des dates de péremption sur les produits emballés. perishable Il apprend les règles de base de la conservation au frais et de la gestion des restes pour éviter les intoxications alimentaires et le gaspillage.
CHAPITRE 8 : LA LUTTE CONTRE LES CARENCES NUTRITIONNELLES SPÉCIFIQUES 
8.1. La Malnutrition Protéino-énergétique : Kwashiorkor et Marasme
L’élève approfondit sa connaissance de la malnutrition. Il apprend à distinguer deux formes sévères de malnutrition chez l’enfant : le kwashiorkor, principalement dû à une carence en protéines et caractérisé par des œdèmes, et le marasme, dû à une carence globale en énergie et en protéines et caractérisé par une maigreur extrême. 
8.2. L’Analyse de l’Anémie Nutritionnelle et de ses Causes
L’anémie est une maladie très fréquente due à une carence en fer. L’élève apprend que le fer est indispensable à la fabrication des globules rouges qui transportent l’oxygène dans le sang. Il découvre les signes de l’anémie (pâleur, fatigue) et ses causes (alimentation pauvre en fer, pertes de sang, parasites intestinaux). 
8.3. Les Troubles Graves dus à la Carence en Iode (Goitre, Crétinisme)
Dans de nombreuses régions de la RDC, les sols sont pauvres en iode. L’élève étudie les conséquences graves de la carence en iode sur la santé. Il découvre le goitre (gonflement de la glande thyroïde au niveau du cou) et le crétinisme (retard mental grave et irréversible chez les enfants nés de mères carencées). 
8.4. L’Identification des Aliments Riches en Iode et des Aliments Goitrigènes
Pour lutter contre la carence en iode, l’élève apprend les stratégies alimentaires. Il apprend à identifier les aliments naturellement riches en iode, comme les poissons de mer. Il découvre surtout l’importance capitale de la consommation de sel iodé, qui est le moyen le plus efficace de prévention. 
CHAPITRE 9 : LES DIMENSIONS CULTURELLES ET SOCIALES DE L’ALIMENTATION 
9.1. L’Identification et la Définition des Tabous et Interdits Alimentaires
L’alimentation n’est pas seulement une question biologique, elle est aussi culturelle. L’élève découvre la notion de tabou ou d’interdit alimentaire, qui sont des règles culturelles ou religieuses qui proscrivent la consommation de certains aliments pour certaines personnes ou à certains moments. 
9.2. L’Analyse Critique des Conséquences des Tabous sur la Santé
Ce sous-chapitre amène l’élève à porter un regard critique sur ces pratiques culturelles. Il est guidé pour analyser les conséquences de certains interdits alimentaires sur la santé. 
9.3. La Promotion d’une Alimentation Équilibrée et Culturellement Adaptée
La promotion de la santé passe par le respect de la culture. L’élève apprend qu’il est possible de composer des repas parfaitement équilibrés en utilisant les aliments et les recettes de la cuisine locale. 
9.4. La Valorisation des Produits Locaux et des Circuits Courts
Ce volet du programme a une dimension économique et écologique. L’élève est sensibilisé à l’importance de consommer les produits de l’agriculture locale. Il comprend que consommer local permet de soutenir les agriculteurs de sa région (comme ceux du Nord-Kivu), de garantir la fraîcheur et la qualité des produits, et de réduire la pollution liée au transport des marchandises sur de longues distances. 
PARTIE 4 : CITOYENNETÉ ENVIRONNEMENTALE : GESTION DES RESSOURCES ET DÉFIS GLOBAUX
CHAPITRE 10 : LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES 
10.1. L’Inventaire et la Cartographie des Ressources Naturelles du Milieu
L’élève réalise un inventaire approfondi des ressources naturelles de son environnement local. Il apprend à les cartographier de manière simple. Il identifie le sol, l’eau (rivières, lacs), la forêt, le sous-sol (minerais) comme un capital naturel collectif. 
10.2. L’Analyse des Conséquences de la Mauvaise Gestion des Ressources
À travers des études de cas, l’élève analyse les conséquences de la surexploitation ou de la mauvaise gestion des ressources. Il peut étudier l’impact de l’exploitation minière non contrôlée sur la pollution des rivières près de Kolwezi, les effets de la déforestation sur l’érosion des sols, ou les conséquences de la surpêche sur la raréfaction du poisson. 
10.3. La Pratique du Respect et de la Protection Active des Écosystèmes
La connaissance des dangers doit déboucher sur l’action. L’élève est encouragé à s’engager dans des actions concrètes de protection des écosystèmes. Il peut participer à des campagnes de reboisement, à des actions de nettoyage des berges d’une rivière, ou à la création d’une zone protégée dans l’enceinte de l’école. 
10.4. La Prévention des Risques liés à la Faune Sauvage (Morsures, Piqures)
Vivre à proximité d’écosystèmes riches implique aussi des risques. L’élève apprend les comportements de prudence pour éviter les accidents avec la faune sauvage. Il revoit les dangers liés aux serpents, aux scorpions ou aux insectes venimeux. 
CHAPITRE 11 : LA LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES 
11.1. La Définition et la Classification des Différents Types de Pollution
L’élève apprend à définir la pollution comme l’introduction dans un milieu d’éléments qui nuisent à la santé et à l’équilibre des écosystèmes. Il apprend à classifier les pollutions selon le milieu touché : la pollution de l’air (fumées), la pollution de l’eau (rejets d’eaux usées, déchets), la pollution des sols (décharges sauvages, pesticides) et la pollution sonore (bruits excessifs).
11.2. L’Évaluation des Conséquences de la Pollution sur la Santé et l’Environnement
Pour chaque type de pollution, l’élève en étudie les conséquences. Il apprend que la pollution de l’air peut causer des maladies respiratoires, que la pollution de l’eau peut transmettre des maladies comme le choléra, et que la pollution sonore peut générer du stress et des troubles de l’audition. 
11.3. Les Mesures Préventives et Correctives contre les Pollutions
Ce sous-chapitre est axé sur les solutions. L’élève recherche et discute des mesures de lutte contre la pollution à différents niveaux. Au niveau individuel, il apprend les gestes éco-citoyens. Au niveau communautaire, il peut proposer la mise en place de poubelles publiques ou de systèmes de collecte des déchets. 
11.4. L’Analyse des Dangers de l’Utilisation de Produits Toxiques pour la Pêche
Un focus particulier est mis sur une pratique de pollution extrêmement destructrice. L’élève étudie les dangers de la pêche à l’aide de produits toxiques (poisons végétaux, pesticides). Il apprend que cette méthode non sélective tue non seulement les gros poissons, mais aussi les alevins et tous les autres organismes aquatiques, stérilisant ainsi la rivière pour de longues années. 
CHAPITRE 12 : LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX GLOBAUX ET L’ACTION CITOYENNE 
12.1. La Compréhension des Causes et des Conséquences du Changement Climatique
L’élève est initié à l’un des plus grands défis de l’humanité. Il apprend que le climat de la Terre se réchauffe en raison de l’accumulation de « gaz à effet de serre » dans l’atmosphère, principalement due aux activités humaines (combustion d’énergies fossiles, déforestation). 
12.2. Le Rôle Négatif des Feux de Brousse et des Gaz à Effet de Serre
Ce sous-chapitre détaille les causes du changement climatique. L’élève revoit le rôle dévastateur des feux de brousse, qui non seulement détruisent la végétation mais libèrent aussi d’énormes quantités de gaz carbonique. Il est initié à la notion de gaz à effet de serre, en comprenant que les fumées des usines, des voitures et la décomposition des déchets contribuent à ce phénomène global.
12.3. L’Importance Vitale des Espaces Verts et du Reboisement
Face au changement climatique, les arbres sont nos meilleurs alliés. L’élève apprend que les forêts et les espaces verts jouent un rôle crucial de « poumon de la planète » en absorbant le gaz carbonique et en produisant de l’oxygène. 
12.4. L’Action Citoyenne Locale pour la Protection de la Planète
Ce dernier volet du programme vise à traduire la conscience globale en action locale. L’élève comprend que même s’il ne peut pas résoudre seul le problème du changement climatique, il peut agir à son niveau. 
ANNEXES
1. Guide de Premiers Secours Illustré pour l’École
Cette section met à la disposition des enseignants et des élèves un guide visuel et simple des gestes de premiers secours. Le guide présente, sous forme de fiches illustrées, la conduite à tenir face aux situations les plus courantes : plaie simple, saignement de nez, brûlure, malaise, perte de connaissance. 
2. Fiches Nutritionnelles sur les Aliments Locaux
Pour faciliter la promotion d’une alimentation équilibrée, cette annexe propose des fiches d’information sur les principaux aliments locaux de la RDC. Chaque fiche est consacrée à un aliment (manioc, maïs, patate douce, haricot, feuilles de manioc, huile de palme, poisson fumé…) et en détaille la composition nutritionnelle principale (riche en énergie, en protéines, en vitamines…), les bienfaits pour la santé et les meilleures manières de le préparer pour en préserver les qualités. 
3. Canevas pour une Enquête de Santé Communautaire
Afin d’outiller les élèves pour la démarche d’enquête, cette section fournit un canevas méthodologique. Il propose un modèle de questionnaire simple pour investiguer un problème de santé ou d’environnement dans le quartier de l’école (par exemple, sur la gestion des déchets, l’accès à l’eau potable, la prévalence du paludisme). 
4. Charte pour un « Éco-citoyen »
Cette annexe propose un modèle de « Charte de l’Éco-citoyen », un texte d’engagement que les élèves peuvent élaborer, discuter et adopter collectivement. La charte énonce, sous forme d’articles, les engagements que les élèves prennent pour protéger l’environnement au quotidien, à l’école et à la maison. 







