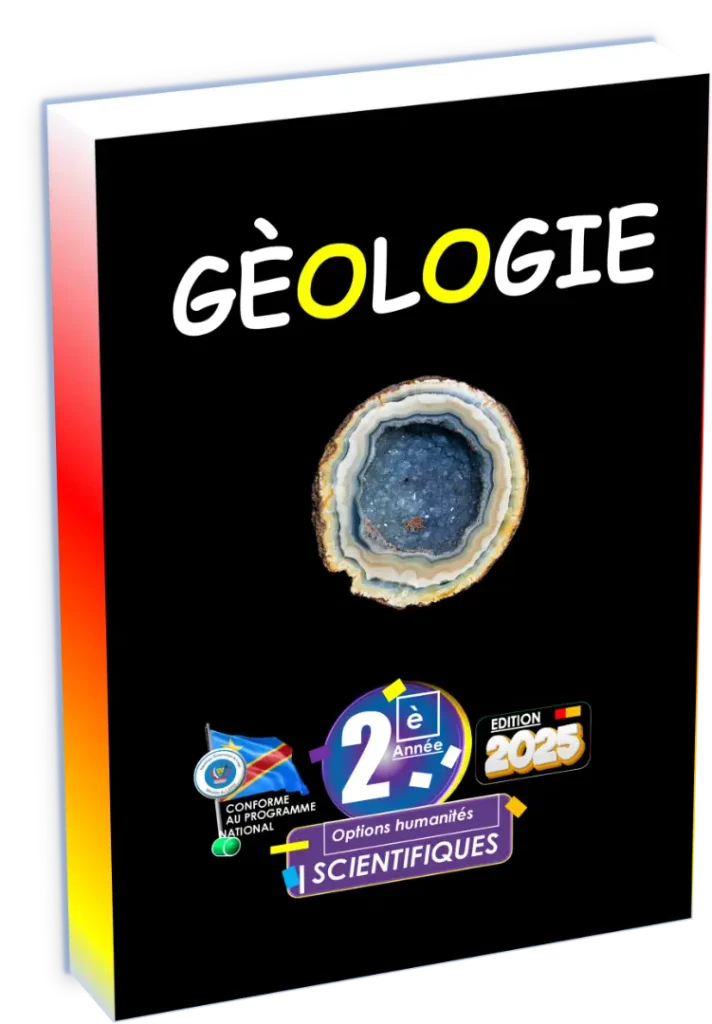
COURS DE GEOLOGIE, 2ème année, option HUMANITES SCIENTIFIQUES
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC
📑 PRÉLIMINAIRES
0.1. Note introductive à l’usage de l’enseignant
Ce cours de Géologie pour la deuxième année des Humanités Scientifiques s’inscrit dans la continuité du Domaine d’Apprentissage des Sciences (DAS). Il opérationnalise le savoir essentiel MSVT 4.13 du programme national, spécifiquement axé sur le volcanisme et la géodynamique interne. L’enseignant doit privilégier l’approche par compétences, en plaçant l’élève devant des situations concrètes liées à l’environnement géologique de la République Démocratique du Congo. L’objectif est de dépasser la simple mémorisation pour atteindre une compréhension systémique des phénomènes telluriques.
0.2. Profil d’entrée et prérequis
L’élève abordant ce cours doit maîtriser les notions élémentaires de la structure de la Terre acquises au cycle terminal de l’éducation de base. Il doit posséder des connaissances fondamentales en chimie (états de la matière, réactions exothermiques) et en physique (chaleur, pression, mécanique des fluides) pour appréhender les mécanismes du magmatisme. Une familiarité avec la géographie physique de l’Afrique Centrale, notamment la position du Rift Est-Africain, constitue un atout indispensable pour la contextualisation des apprentissages.
0.3. Compétences visées et profil de sortie
Au terme de ce module, l’apprenant sera capable de traiter avec succès des situations complexes liées à la géodynamique. Il devra expliquer l’origine et le mécanisme des éruptions volcaniques, identifier les types de volcans présents en RDC, et évaluer les risques associés. La compétence finale réside dans la capacité de l’élève à participer activement à la prévention des risques naturels et à valoriser les ressources géologiques (sols fertiles, matériaux de construction) dans une perspective de développement durable.
0.4. Méthodologie et matériel didactique
L’enseignement privilégiera l’observation directe (sorties de terrain si possible, échantillons de roches) et indirecte (cartes géologiques, imagerie satellitaire, documentaires). L’utilisation des TIC est recommandée pour la modélisation des phénomènes éruptifs. Le matériel didactique inclura des cartes tectoniques de l’Afrique, des échantillons de laves (basalte, trachyte), des maquettes de volcans et des données sismiques récentes fournies par l’Observatoire Volcanologique de Goma (OVG).
🌍 PARTIE 1 : LA GÉODYNAMIQUE INTERNE ET LA GENÈSE DES MAGMAS
Cet ensemble pédagogique pose les fondements théoriques nécessaires à la compréhension du volcanisme. Il situe les phénomènes volcaniques dans le cadre global de la tectonique des plaques et analyse les processus physico-chimiques à l’origine de la formation du magma. L’élève découvrira que le volcan n’est que la manifestation de surface d’une activité interne intense régie par la thermodynamique terrestre.
Chapitre 1 : Structure interne du globe et contexte géodynamique
Ce premier chapitre décortique l’architecture de la Terre pour localiser les zones de production magmatique. Il établit le lien causal entre la dissipation de l’énergie thermique interne et les mouvements de surface.
1.1. Le modèle sismologique de la Terre
Cette section analyse la structure en couches concentriques de la Terre révélée par la propagation des ondes sismiques. L’enseignement détaille les propriétés rhéologiques de la lithosphère (rigide) et de l’asthénosphère (ductile). L’accent est mis sur le gradient géothermique et l’origine de la chaleur interne, moteur indispensable de la géologie endogène.
1.2. La théorie de la Tectonique des Plaques
L’étude se concentre sur la dynamique de la lithosphère fragmentée en plaques mobiles. Les élèves examinent les trois types de frontières : divergentes (accrétion), convergentes (subduction/collision) et transformantes. Ce sous-chapitre est crucial pour comprendre la distribution non aléatoire des volcans à la surface du globe.
1.3. Les contextes géodynamiques du volcanisme
Il s’agit ici de classifier le volcanisme selon son environnement tectonique. On distinguera le volcanisme de dorsale (invisible mais volumineux), le volcanisme de subduction (explosif et dangereux), et le volcanisme de point chaud (intraplaque). Une attention particulière sera portée au volcanisme de rift continental, contexte spécifique de la RDC.
1.4. Le Rift Est-Africain : un laboratoire naturel
Ce sous-chapitre contextualise la géologie congolaise. Il décrit le système de fracture qui traverse l’Afrique de l’Est, séparant la plaque somalienne de la plaque nubienne. L’élève étudiera la branche occidentale du Rift (Albertin), où se logent les grands lacs et les volcans des Virunga, expliquant ainsi l’amincissement crustal et la remontée du manteau dans cette région.
Chapitre 2 : La magmatogenèse et les propriétés des magmas
Ce chapitre explore la « cuisine » interne de la Terre. Il explique comment une roche solide peut fondre pour donner un liquide (magma) et comment les propriétés de ce liquide déterminent le style éruptif futur.
2.1. Les mécanismes de fusion partielle
Contrairement à une idée reçue, le manteau n’est pas liquide. Cette section détaille les trois mécanismes physiques permettant la fusion des roches : la décompression adiabatique (remontée du manteau sous les rifts), l’ajout de volatils (hydratation dans les zones de subduction) et l’augmentation de température (points chauds).
2.2. Composition chimique et minéralogique des magmas
L’enseignement se focalise sur la teneur en silice () comme facteur déterminant. On classifie les magmas en acides (riches en silice, rhyolitiques) et basiques (pauvres en silice, basaltiques). L’élève apprendra à relier la chimie du magma à sa couleur et aux minéraux qu’il cristallise (olivine, pyroxène, feldspaths).
2.3. La viscosité et la teneur en gaz
Ce point est fondamental pour prédire le comportement d’un volcan. On explique que la viscosité dépend de la température et de la polymérisation de la silice. Le rôle moteur des gaz dissous (, , ) est analysé : leur exsolution lors de la remontée magmatique est le moteur de l’éruption explosive.
2.4. Différenciation et évolution magmatique
Le magma change de composition entre sa genèse et son éruption. Ce sous-chapitre aborde la cristallisation fractionnée dans la chambre magmatique, l’assimilation crustale et le mélange de magmas. Ces processus expliquent la diversité des roches volcaniques observées dans une même province géologique.
Chapitre 3 : L’appareil volcanique et sa mise en place
Avant d’étudier l’éruption elle-même, il est nécessaire de comprendre l’infrastructure géologique qui permet au magma d’atteindre la surface et les formes que prend l’édifice volcanique.
3.1. Réservoirs et chambres magmatiques
Cette section décrit les zones de stockage du magma dans la croûte terrestre. On étudie la géométrie des chambres magmatiques, leur profondeur et les méthodes géophysiques permettant de les détecter. Le concept de temps de résidence du magma est abordé pour comprendre les cycles éruptifs.
3.2. Les conduits d’alimentation : Dykes et Sills
L’ascension du magma vers la surface se fait via des fractures. L’élève apprendra à distinguer les dykes (intrusions verticales recoupant les couches géologiques) et les sills (intrusions horizontales s’insérant entre les couches). Ces structures constituent l’ossature interne des édifices volcaniques.
3.3. Morphologie des édifices volcaniques
La forme d’un volcan dépend de la nature des matériaux émis. On étudiera les volcans boucliers (larges et plats, laves fluides), les stratovolcans (cônes pointus, alternance laves/cendres), les dômes de lave (magma visqueux) et les cônes de scories. Des exemples locaux et internationaux illustreront chaque type.
3.4. Structures d’effondrement : Caldeiras et Maars
Le volcanisme ne construit pas seulement des montagnes, il crée aussi des dépressions. Ce sous-chapitre explique la formation des caldeiras par vidange de la chambre magmatique et effondrement du toit, ainsi que les maars résultant d’explosions phréatomagmatiques (rencontre magma-eau).
🌋 PARTIE 2 : VOLCANOLOGIE ET DYNAMISME ÉRUPTIF
Cette partie constitue le cœur du programme MSVT 4.13. Elle décrit les phénomènes observables en surface, classifie les éruptions et dresse un inventaire détaillé du volcanisme en République Démocratique du Congo. L’approche est descriptive et phénoménologique, visant à donner à l’élève les clés de lecture des paysages volcaniques.
Chapitre 4 : Les produits volcaniques
Une éruption libère de la matière sous trois états physiques. Ce chapitre dresse l’inventaire exhaustif de ces produits, qui constituent les archives géologiques permettant de reconstituer l’histoire d’un volcan.
4.1. Les laves : coulées et dômes
L’étude porte sur les produits liquides émis par le volcan. On décrira les différents types de coulées : laves cordées (pahoehoe), laves en blocs (aa), et laves en coussins (pillow lavas) caractéristiques des éruptions sous-lacustres ou sous-marines. La notion de vitesse d’écoulement en fonction de la pente et de la viscosité sera analysée.
4.2. Les produits pyroclastiques (Téphras)
Cette section traite des fragments solides projetés lors des explosions. On classifie ces projections par taille : les cendres (fines), les lapillis (taille de gravier), et les bombes ou blocs volcaniques. L’élève apprendra à reconnaître les roches résultant de leur consolidation, comme les tufs et les brèches volcaniques.
4.3. Les gaz volcaniques et les aérosols
Bien que invisibles ou éphémères, les gaz sont le moteur de l’éruption. On analysera la composition chimique des panaches volcaniques (majoritairement vapeur d’eau, dioxyde de carbone, dioxyde de soufre). L’impact de ces gaz sur l’atmosphère locale et le climat global sera évoqué.
4.4. Les dépôts volcanoclastiques remaniés
Les matériaux volcaniques sont souvent repris par l’érosion ou l’eau. Ce sous-chapitre aborde les lahars (coulées boueuses volcaniques) qui se forment lors de la fonte des neiges ou de pluies intenses sur des cendres meubles, constituant un danger majeur loin du centre éruptif.
Chapitre 5 : Classification des types d’éruptions
Ce chapitre systématise la diversité des phénomènes éruptifs. Il utilise la classification internationale basée sur l’indice d’explosivité volcanique (VEI) et les modèles historiques de référence.
5.1. Le dynamisme effusif : Type Hawaïen
L’analyse porte sur les éruptions calmes caractérisées par l’émission de laves très fluides, de fontaines de lave et la formation de lacs de lave permanents ou temporaires. C’est le modèle de référence pour comprendre le fonctionnement habituel du volcan Nyiragongo.
5.2. Le dynamisme mixte : Type Strombolien
Ce type se caractérise par une activité rythmique modérément explosive. L’élève étudiera le mécanisme des bulles de gaz qui éclatent en surface, projetant des scories et des lambeaux de lave, construisant ainsi les cônes de scories fréquents dans la chaîne des Virunga (ex : Nyamulagira).
5.3. Le dynamisme explosif : Types Vulcanien et Péléen
On aborde ici les éruptions violentes liées à des magmas visqueux. Le type vulcanien implique le débouchage explosif d’un conduit obstrué. Le type péléen (référence à la Montagne Pelée) se caractérise par la croissance de dômes et la génération de nuées ardentes (écoulements pyroclastiques) destructrices.
5.4. Le dynamisme paroxysmique : Type Plinien et Ultra-Plinien
Ce sous-chapitre décrit les éruptions cataclysmiques produisant d’immenses colonnes éruptives atteignant la stratosphère, dispersant des cendres sur des milliers de kilomètres carrés. Bien que rares en RDC à l’échelle historique, leur trace géologique existe et doit être comprise.
Chapitre 6 : Le volcanisme en République Démocratique du Congo
Ce chapitre est l’application directe du programme national MSVT 4.13 au contexte local. Il offre une étude monographique détaillée de la province volcanique des Virunga et d’autres manifestations géologiques du pays.
6.1. La province volcanique des Virunga
Située au Nord-Kivu, cette chaîne contient 8 volcans majeurs. L’élève localisera sur une carte les volcans éteints (Mikeno, Karisimbi, Visoke, Sabinyo, Gahinga, Muhavura) et les volcans actifs. On insistera sur leur alignement perpendiculaire au Rift et leur importance géomorphologique.
6.2. Le Nyiragongo : Un volcan exceptionnel
Étude monographique du Nyiragongo. Caractéristiques spécifiques : lac de lave quasi-permanent (le plus grand du monde), lave à très faible viscosité (mélilite-néphélinite), vitesse d’écoulement extrême (jusqu’à 100 km/h). Historique des éruptions majeures (1977, 2002, 2021) et leurs impacts sur la ville de Goma.
6.3. Le Nyamulagira : Le géant prolifique
Étude du volcan le plus actif d’Afrique. Comparaison avec le Nyiragongo : éruptions plus fréquentes mais souvent situées dans le parc national, loin des zones densément peuplées. Analyse de ses éruptions fissurales et de sa contribution massive aux émissions de dioxyde de soufre dans l’atmosphère.
6.4. Autres manifestations volcaniques et thermales en RDC
Le volcanisme ne se limite pas aux grands cônes. Ce sous-chapitre explore les sources thermales (eaux chaudes) présentes au Katanga (ex: Kiubo), au Nord-Kivu (May-ya-moto) et dans le Kongo Central, témoins d’un gradient géothermique élevé. On évoquera aussi les anciennes provinces volcaniques (kimberlites du Kasaï).
🛡️ PARTIE 3 : IMPACTS, RISQUES ET GESTION DU VOLCANISME
Cette dernière partie répond aux exigences de compétence de vie courante. Elle dépasse la géologie pure pour intégrer des notions d’environnement, de sécurité civile et d’économie. Elle vise à transformer l’élève en acteur conscient des enjeux de son territoire.
Chapitre 7 : Utilité et importance du volcanisme
Loin d’être uniquement une source de destruction, le volcanisme est un facteur de développement. Ce chapitre analyse les services écosystémiques et économiques fournis par l’activité magmatique, justifiant la forte densité de population dans les zones volcaniques.
7.1. Fertilité des sols volcaniques (Andosols)
L’enseignement explique comment l’altération rapide des cendres et laves basiques libère des nutriments essentiels (phosphore, potassium, calcium) pour l’agriculture. On établira le lien entre le volcanisme des Virunga et la productivité agricole du Nord-Kivu (café, pommes de terre, légumes).
7.2. Les ressources en matériaux de construction
Les produits volcaniques sont des matières premières. L’élève identifiera l’usage des scories (pouzzolane) pour la fabrication du ciment, des basaltes pour le pavage des routes et la construction de murs (très visible à Goma), et des pierres ornementales.
7.3. Le potentiel géothermique
Ce sous-chapitre explore la géothermie comme source d’énergie renouvelable. On expliquera le principe de production d’électricité à partir de la vapeur d’eau souterraine chauffée par le magma. On évaluera le potentiel énergétique de la branche occidentale du Rift pour l’électrification rurale et urbaine.
7.4. Tourisme et biodiversité
Les reliefs volcaniques créent des écosystèmes uniques (étagement de la végétation sur les flancs des volcans). L’étude portera sur l’attrait touristique du Parc National des Virunga (trekking au Nyiragongo, gorilles de montagne) comme source de revenus économiques pour le pays et les communautés locales.
Chapitre 8 : Les risques et aléas volcaniques
Ce chapitre détaille les dangers potentiels mentionnés dans le programme. Il s’agit d’identifier précisément la nature de la menace pour mieux s’en prémunir.
8.1. Les coulées de lave et les incendies
Analyse du risque lié à l’envahissement des zones habitées et agricoles par les laves fluides. Étude des dégâts matériels (infrastructures, habitations) et des mécanismes de propagation des incendies lors des éruptions du Nyiragongo. Notion de « risque » versus « aléa ».
8.2. Les gaz toxiques et les « Mazuku »
Focus spécifique sur un danger invisible et mortel en RDC : les « Mazuku » (souffle du diable en Swahili). Explication de l’accumulation de d’origine magmatique dans les dépressions, causant l’asphyxie des hommes et du bétail. Cartographie des zones à risque.
8.3. Les risques liés au Lac Kivu : Éruptions limniques
Étude du gaz dissous ( et Méthane) dans les eaux profondes du lac Kivu. Analyse du risque d’une interaction entre une éruption volcanique sous-lacustre et la stabilité des strates d’eau, pouvant mener à un dégagement gazeux massif (comparaison avec le Lac Nyos).
8.4. Les retombées de cendres et pluies acides
Examen des impacts des panaches volcaniques sur la santé respiratoire, la qualité de l’eau (acidification des citernes), l’aviation et l’agriculture (fluorose, brûlure des cultures par les pluies acides).
Chapitre 9 : Surveillance, prévision et protection civile
Ce chapitre final, axé sur la compétence, traite de la gestion de crise. Il présente les institutions scientifiques et les protocoles de sécurité pour vivre avec le risque volcanique.
9.1. Les méthodes de surveillance instrumentale
Présentation du travail de l’Observatoire Volcanologique de Goma (OVG). Description des outils : sismographes (détection des tremblements), inclinomètres et GPS (déformation du sol), analyse géochimique des gaz, et satellites thermiques. Comment interpréter les signes précurseurs ?
9.2. Cartographie des aléas et zonage
L’élève apprendra à lire une carte de risques. On expliquera comment les scientifiques délimitent les zones rouges (haut risque), oranges et vertes en se basant sur l’histoire éruptive et la topographie. Importance de l’urbanisme réglementé dans les zones volcaniques.
9.3. Plans d’urgence et évacuation
Étude des procédures de protection civile. Les systèmes d’alerte (sirènes, codes couleurs), les itinéraires d’évacuation, les kits de survie, et les comportements à adopter avant, pendant et après une éruption. Analyse critique de la gestion de l’éruption de 2021.
9.4. Éducation et résilience des populations
Le rôle de l’école et de la communauté dans la réduction des risques. Comment vivre durablement au pied d’un volcan actif ? Ce sous-chapitre synthèse encourage une culture du risque qui intègre la mémoire collective et les connaissances scientifiques pour minimiser la vulnérabilité.
📎 ANNEXES
A.1. Travaux Pratiques (TP) suggérés
Cette annexe propose des protocoles expérimentaux adaptés aux écoles congolaises : modélisation de la viscosité avec des liquides usuels (miel, eau, huile), simulation d’une éruption avec vinaigre et bicarbonate, observation microscopique de cendres ou de roches volcaniques.
A.2. Cartes géologiques et volcanologiques de la RDC
Recueil de cartes simplifiées montrant le Rift Albertin, la position des volcans des Virunga, les coulées historiques de 1977 et 2002 sur la ville de Goma, et les zones de fractures tectoniques actives.
A.3. Glossaire technique
Lexique définissant les termes clés du cours (Accrétion, Asthénosphère, Bombe volcanique, Caldeira, Dyke, Fumerolle, Lapilli, Magma, Pyroclastique, Subduction, Viscosité, etc.) pour assurer une maîtrise précise du langage scientifique.
A.4. Fiches de sécurité « Mazuku »
Guide illustré pratique pour identifier les zones à risque de gaz (végétation jaunie, animaux morts, dépressions), les symptômes d’intoxication et les premiers secours à apporter en cas d’accident, spécifiquement adapté au contexte local.



