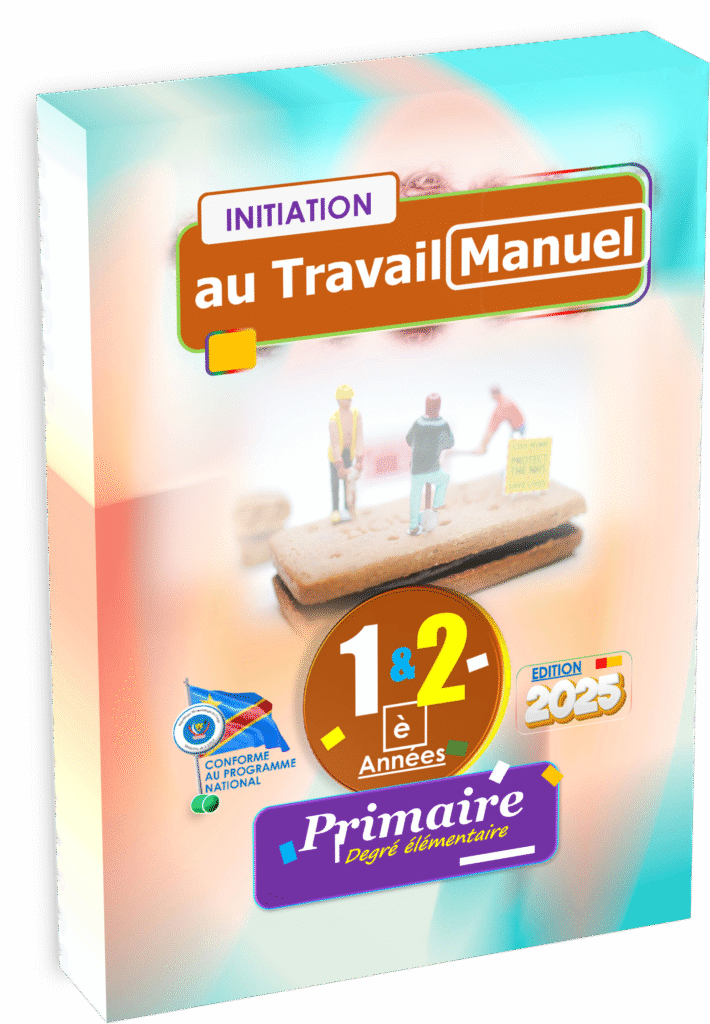
COURS D’INITIATION AU TRAVAIL MANUEL, 1ERE ET 2EME ANNEE PRIMAIRE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC
PRÉLIMINAIRES
0.1. Avant-propos
Ce document pédagogique constitue la transposition opérationnelle du Programme National de l’Enseignement Primaire pour le cours d’Initiation au Travail Manuel (ITM) au premier degré. Il est élaboré pour servir de guide de référence à l’enseignant, avec pour mission de transformer les objectifs curriculaires en activités d’apprentissage structurées, pratiques et significatives. L’ambition de ce manuel est de faire de l’ITM une discipline fondamentale qui éveille chez l’élève le goût de l’effort, l’amour du travail bien fait et le sens de l’utilité sociale. Chaque section est conçue pour développer de manière progressive l’habileté manuelle, la créativité et l’esprit d’initiative de l’enfant, en ancrant chaque activité dans les réalités et les ressources du contexte congolais. Il s’agit de fournir un cadre méthodologique clair pour que chaque séance devienne une occasion concrète pour l’élève de produire, d’entretenir et de contribuer positivement à son environnement familial et scolaire.
0.2. Finalités et Buts du Cours d’ITM
La finalité principale du cours d’Initiation au Travail Manuel est de contribuer au développement intégral de l’enfant en valorisant le travail comme une dimension essentielle de la personne humaine et comme moteur du progrès social. Les buts de cet enseignement sont à la fois pratiques, éducatifs et moraux. Il s’agit premièrement de développer l’habileté manuelle et la coordination des gestes à travers la manipulation d’outils simples et la transformation de divers matériaux. Deuxièmement, le cours vise à cultiver la créativité et l’esprit d’invention, en encourageant l’élève à fabriquer des objets utiles ou esthétiques. Troisièmement, il a pour but d’inculquer des valeurs fondamentales telles que la patience, la persévérance, le soin et la fierté du travail accompli. Enfin, il cherche à préparer à l’intégration sociale et économique en initiant l’élève aux travaux utilitaires de son milieu et en développant son intérêt pour les activités productives, individuelles et collectives.
0.3. Profil de Sortie du Degré Élémentaire en ITM
Au terme du premier degré (deuxième année primaire), l’élève doit avoir acquis un ensemble de compétences pratiques et d’attitudes positives vis-à-vis du travail manuel. Il est attendu de lui qu’il manifeste de l’intérêt pour les travaux de production, qu’ils soient individuels ou collectifs. Il doit être capable de s’initier aux travaux utilitaires organisés au sein de sa famille et de son école, en participant activement aux tâches adaptées à son âge. Sur le plan technique, il doit pouvoir utiliser de manière appropriée le matériel simple mis à sa disposition pour exécuter des tâches de production et d’entretien. L’élève doit également démontrer sa créativité en étant capable de fabriquer des jouets simples à l’aide de divers matériaux locaux et objets familiers. Enfin, il doit avoir développé des qualités civiques et morales à travers le travail, comme le sens de la collaboration et le respect des biens communs.
0.4. Approche Méthodologique
L’approche méthodologique pour l’ITM est résolument active, participative et concrète. Le cours ne doit jamais être perçu comme une corvée, mais comme un moyen de développer le goût du travail et le sens des responsabilités. L’enseignant adopte une posture de guide et de modèle, en participant lui-même aux travaux manuels pour en montrer la noblesse. La démarche pédagogique part de l’observation du milieu et des activités des artisans locaux, que la classe est encouragée à visiter. L’apprentissage se fait par l’action : l’élève manipule, expérimente, construit et répare. Il est crucial de veiller à ce que tous les élèves participent aux mêmes activités sans discrimination de genre. La valorisation des productions des élèves, par des expositions par exemple, est un élément de motivation essentiel. L’école doit s’efforcer de disposer d’un minimum d’outils nécessaires, souvent fabriqués à partir de ressources locales.
PARTIE I : FONDEMENTS DU TRAVAIL MANUEL : OBSERVATION ET TECHNIQUES DE BASE 🛠️
CHAPITRE 1 : LA DÉCOUVERTE DU MONDE DU TRAVAIL
1.1. L’Identification des Activités Manuelles du Milieu
Ce volet initial ancre l’apprentissage dans l’environnement le plus proche de l’élève : sa propre communauté. L’objectif est de l’amener à observer, identifier et nommer les diverses activités manuelles qui structurent la vie quotidienne. En première année, l’accent est mis sur les catégories générales : les travaux domestiques (vaisselle, lessive), agricoles (sarclage), et pastoraux (soin du petit bétail). En deuxième année, le champ d’observation s’élargit à des métiers plus spécifiques comme la menuiserie, la maçonnerie, la couture ou la coiffure. L’enseignant organise des discussions en classe et des classes promenades, par exemple dans un quartier de Lubumbashi, pour que les élèves voient directement les artisans à l’œuvre. Cette démarche éveille la curiosité de l’enfant et lui fait prendre conscience de la diversité et de l’importance des métiers manuels qui l’entourent.
1.2. La Valeur du Travail pour la Famille et la Société
La reconnaissance des activités manuelles doit s’accompagner d’une compréhension de leur valeur. Ce sous-chapitre vise à faire le lien entre le travail et le développement familial et social. L’enseignant explique de manière simple comment le travail du cultivateur nourrit la famille, comment celui du maçon construit les maisons, et comment celui de la couturière habille la communauté. L’élève comprend que chaque travail, même le plus humble en apparence, contribue au bien-être de tous. Il prend conscience que le confort et les nécessités de la vie quotidienne sont le fruit de l’effort et du savoir-faire des membres de la société. Cette leçon inculque le respect pour tous les travailleurs et jette les bases d’une compréhension de l’interdépendance économique et sociale.
1.3. La Visite d’Artisans Locaux : Observation et Apprentissage
L’apprentissage le plus efficace se fait par le contact direct avec le réel. Conformément aux directives méthodologiques, ce volet préconise l’organisation de visites guidées chez les artisans du voisinage de l’école. Qu’il s’agisse d’un potier près de la rivière Ruki, d’un sculpteur sur bois dans le Kasaï ou d’un forgeron, ces rencontres sont des moments d’apprentissage privilégiés. L’élève peut observer les gestes techniques, découvrir les outils spécifiques à chaque métier et se familiariser avec le vocabulaire technique. Ces visites permettent de concrétiser les notions vues en classe, de susciter des vocations et de créer un pont entre l’école et le monde du travail. Elles sont une source d’inspiration inestimable pour les projets pratiques qui seront menés en classe.
1.4. La Noblesse du Travail : L’Exemple de l’Enseignant
Pour que les élèves intègrent pleinement la valeur du travail manuel, l’attitude de l’enseignant est déterminante. Ce sous-chapitre souligne le rôle de modèle que doit jouer le maître. Il est fondamental que l’enseignant participe lui-même activement aux activités manuelles avec ses élèves. En prenant part au désherbage, au nettoyage de la classe ou à la fabrication d’un objet, il démontre par l’exemple que le travail manuel n’est pas une tâche inférieure ou une punition, mais une activité noble et valorisante. Cette implication de l’enseignant brise les préjugés et crée une atmosphère de respect et d’enthousiasme autour de la discipline. Elle transforme la séance d’ITM en un moment de partage et de collaboration, renforçant ainsi la cohésion du groupe-classe.
CHAPITRE 2 : LA MAÎTRISE DES MATÉRIAUX ET GESTES FONDAMENTAUX
2.1. Le Travail du Papier et du Carton : Pliage et Découpage
Le papier et le carton sont les premiers matériaux abordés en raison de leur accessibilité et de leur facilité de manipulation. Ce sous-chapitre est dédié à l’acquisition des techniques de base du pliage et du découpage. L’élève apprend d’abord à réaliser des plis nets et précis, une compétence fondamentale pour la construction de volumes. Ensuite, il s’initie à l’utilisation sécuritaire des ciseaux pour découper des formes simples, d’abord des lignes droites, puis des courbes et enfin des figures plus complexes. Ces gestes, qui développent la motricité fine, la coordination œil-main et la concentration, sont à la base de nombreuses réalisations ultérieures, de la fabrication de guirlandes à la construction de maquettes.
2.2. Le Modelage de l’Argile et des Pâtes Naturelles
Le modelage est une activité sensorielle et créative qui permet une approche directe de la matière et du volume. Cette section se concentre sur le travail de l’argile, un matériau abondant dans de nombreuses régions du Congo, ou d’autres pâtes à modeler. L’élève apprend les gestes fondamentaux : pétrir la matière pour la rendre homogène, former des boules, des colombins (petits rouleaux), et assembler ces éléments pour créer des formes simples. Il s’exerce à modeler des statuettes, des animaux ou de petits objets. Cette pratique développe non seulement la dextérité et la force des mains, mais aussi la perception des formes en trois dimensions et la capacité à traduire une idée en volume.
2.3. L’Assemblage : Techniques de Collage et de Ligature
Créer un objet complexe nécessite souvent d’assembler plusieurs parties. Ce sous-chapitre est consacré aux techniques d’assemblage les plus simples. L’élève s’initie d’abord au collage, en apprenant à appliquer la bonne quantité de colle (à base de farine de manioc, par exemple) pour joindre des éléments en papier ou en carton de manière propre et solide. Parallèlement, il découvre la ligature, qui consiste à attacher des éléments ensemble à l’aide de fil, de ficelle ou de petites lianes. Cette technique est particulièrement utile pour assembler des matériaux plus rigides comme des brindilles ou des morceaux de bambou. La maîtrise de ces techniques d’assemblage est essentielle pour passer de la création de formes simples à la construction d’objets structurés.
2.4. La Finition : Coloriage et Décoration de Surfaces
La fabrication d’un objet ne s’arrête pas à sa construction ; sa finition est une étape cruciale qui lui donne sa valeur esthétique. Cette section vise à développer le sens artistique de l’élève à travers les techniques de décoration. Le coloriage de dessins, de paysages ou d’objets fabriqués est une activité de base qui apprend à l’enfant à respecter les contours et à harmoniser les couleurs. Progressivement, il est initié à d’autres formes de décoration, comme le collage de motifs, l’impression avec des tampons végétaux, ou le traçage de graphismes. L’élève apprend que la décoration n’est pas un simple ajout, mais une partie intégrante du processus de création qui demande du soin, de la précision et de l’imagination.
CHAPITRE 3 : LA CONSTRUCTION DE FORMES ET DE STRUCTURES
3.1. La Réalisation de Formes Géométriques Bidimensionnelles
Ce sous-chapitre fait le lien entre l’ITM et les mathématiques en se concentrant sur la construction manuelle des formes géométriques de base. En utilisant les techniques de traçage, de découpage et de pliage, l’élève apprend à réaliser avec précision un carré, un rectangle, un triangle et un cercle. Cet exercice pratique renforce sa compréhension des propriétés de ces figures (nombre de côtés, angles) de manière beaucoup plus concrète qu’un simple dessin. Il apprend également à assembler ces formes pour créer des pavages ou des frises décoratives, développant ainsi son sens de l’organisation spatiale et de l’esthétique géométrique.
3.2. L’Initiation aux Structures Tridimensionnelles Simples
Après les formes planes, l’élève est initié à la construction de volumes. Ce volet vise à lui faire comprendre comment passer de la 2D à la 3D. En utilisant des patrons simples, il apprend à construire un cube ou un pavé droit par pliage et collage. Il découvre également comment assembler des éléments linéaires (brindilles, fil de fer) pour créer des structures spatiales comme des pyramides ou des charpentes de maison miniature. Cette initiation à la construction en volume est fondamentale pour développer la vision dans l’espace, une compétence cognitive essentielle qui est sollicitée dans de nombreux domaines techniques et artistiques.
3.3. L’Utilisation de Matériaux Locaux (Bambou, Rameaux, Lianes)
Ce sous-chapitre ancre la pratique de la construction dans l’utilisation des ressources naturelles locales. L’élève apprend à identifier et à utiliser des matériaux comme les rameaux de palmier, les tiges de bambou, les lianes souples ou la paille. Il découvre leurs propriétés (rigidité, flexibilité) et apprend les techniques spécifiques pour les travailler : les fendre, les tresser, les ligaturer. La construction d’objets comme une petite nasse de pêche miniature, un panier ou la structure d’une case permet de mettre en pratique ces savoir-faire. Cette démarche valorise les ressources de l’environnement immédiat et transmet des techniques artisanales traditionnelles, renforçant ainsi l’identité culturelle de l’élève.
3.4. Le Recyclage Créatif : Travailler avec des Matériaux de Récupération
Introduit en deuxième année, ce volet sensibilise l’élève à la gestion des déchets et au recyclage par une approche créative. L’objectif est de lui apprendre à voir les matériaux de récupération non comme des ordures, mais comme une ressource pour la création. Il est encouragé à collecter et à transformer des bouteilles en plastique, des boîtes de conserve, des sachets, des bouchons ou du fil de fer usagé. Il apprend à les nettoyer, à les découper et à les assembler pour fabriquer des jouets, des objets décoratifs ou des outils simples. Cette pratique développe l’ingéniosité, la créativité et la conscience écologique, en montrant qu’il est possible de créer de la valeur à partir de ce qui était destiné à être jeté.
PARTIE II : CRÉATION ET FABRICATION D’OBJETS 🎨
CHAPITRE 4 : LA FABRICATION DE JOUETS
4.1. La Conception de Jouets à partir de l’Imagination et de Modèles
La fabrication de jouets est une activité particulièrement motivante qui canalise la créativité de l’enfant. Ce sous-chapitre se concentre sur la première étape : la conception. L’élève est encouragé à imaginer ses propres jouets ou à s’inspirer de modèles existants. Il apprend à faire un dessin simple de l’objet qu’il souhaite réaliser et à penser aux matériaux dont il aura besoin. L’enseignant le guide dans cette phase de planification, en l’aidant à anticiper les étapes de la fabrication et à s’assurer que son projet est réalisable avec les moyens disponibles. Cette démarche développe la capacité de l’élève à passer d’une idée abstraite à un projet concret, une compétence fondamentale dans tout processus de création.
4.2. La Création de Véhicules Miniatures (Voiturettes, Pirogues)
Ce volet est consacré à la fabrication d’un type de jouet très apprécié : les véhicules. En utilisant des matériaux locaux et de récupération, l’élève apprend à construire des voiturettes avec des boîtes de conserve pour la carrosserie et des bouchons pour les roues, ou des pirogues sculptées dans du bois tendre. L’enseignant le guide dans les différentes étapes : la construction du châssis, la fabrication et la fixation des roues, et la décoration finale. Cette activité permet de mettre en œuvre de nombreuses techniques apprises (découpage, assemblage, perçage) et développe la compréhension de principes mécaniques simples, comme la rotation d’un axe.
4.3. La Fabrication de Poupées et de Marionnettes
La création de personnages est une autre source inépuisable d’expression pour l’enfant. Cette section se focalise sur la fabrication de poupées et de marionnettes. Les poupées peuvent être réalisées à partir de divers matériaux : épis de maïs, tissu, argile ou pâte à modeler. Les marionnettes simples (à doigt ou à gaine) peuvent être confectionnées avec des chaussettes usagées ou des sacs en papier. L’élève apprend à donner une forme humaine ou animale à la matière, à ajouter des détails comme les yeux ou les cheveux, et à confectionner de petits vêtements. Cette activité stimule l’imagination, la créativité et la motricité fine, et peut déboucher sur des activités d’expression théâtrale.
4.4. La Construction de Jeux d’Extérieur (Cerfs-volants)
Ce dernier volet du chapitre sur les jouets s’oriente vers la fabrication d’objets destinés au jeu en plein air. La construction de cerfs-volants est un projet particulièrement complet. L’élève apprend à construire une armature légère et symétrique avec des baguettes, à tendre et à coller le papier, à fixer la bride pour l’équilibre et à attacher la queue. Ce projet intègre des compétences de mesure, de géométrie, d’assemblage et une compréhension intuitive des principes de l’aérodynamisme. La satisfaction de voir voler un objet que l’on a fabriqué soi-même est une récompense immense qui valorise le travail manuel et l’application.
CHAPITRE 5 : LA CRÉATION D’OBJETS UTILES
5.1. La Confection de Petits Paniers et de Contenants
Ce sous-chapitre initie l’élève à la fabrication d’objets qui ont une fonction pratique. La confection de petits paniers ou de contenants est un excellent exercice pour cela. En utilisant des techniques de tressage simples avec du papier journal roulé, du raphia ou des lianes souples, l’élève apprend à créer un volume creux et solide. Il peut également fabriquer des pots à crayons en décorant une boîte de conserve vide. Cette activité lui montre que le travail manuel ne sert pas uniquement à créer des jouets, mais aussi des objets qui peuvent être utilisés au quotidien pour ranger, transporter ou organiser.
5.2. La Fabrication de Matériel de Classe Simple
L’ITM peut directement contribuer à l’amélioration des conditions d’apprentissage. Ce volet vise à impliquer les élèves dans la fabrication de leur propre matériel didactique. Ils peuvent, par exemple, confectionner des jetons en argile pour le calcul, découper des lettres et des chiffres dans du carton, ou fabriquer des règles graduées. La création de ce matériel a un double avantage : elle permet de pallier le manque de ressources de l’école et, surtout, elle implique l’élève dans la construction de ses propres outils de savoir, ce qui renforce son appropriation des apprentissages.
5.3. La Réalisation d’Objets Domestiques (Sets de table, Porte-crayons)
Prolongeant l’idée de l’objet utile, cette section se concentre sur la création d’articles qui peuvent être utilisés à la maison. L’élève peut réaliser des sets de table en tressant des fibres végétales ou en décorant des morceaux de carton plastifié. Il peut fabriquer des porte-crayons, des petites boîtes de rangement ou des cadres photo simples. Ces projets sont conçus pour être à la fois fonctionnels et esthétiques. En rapportant à la maison un objet qu’il a fabriqué lui-même et qui trouve une utilité dans la vie familiale, l’élève ressent une grande fierté et voit la reconnaissance concrète de la valeur de son travail.
5.4. L’Initiation à la Vannerie Simple
La vannerie est un art ancestral et une activité économique importante dans de nombreuses régions du Congo. Ce sous-chapitre propose une initiation très simple à ses principes de base. En utilisant des matériaux faciles à manipuler comme des bandes de papier ou de larges feuilles, l’élève apprend le principe du tressage dessus-dessous pour créer une surface plane et solide. Il peut ainsi réaliser des nattes miniatures ou des sets de table. Cette activité, inspirée par l’observation des artisans vanniers de la province de l’Équateur, développe la dextérité, la patience et le sens de la géométrie, tout en le connectant à un savoir-faire culturel essentiel.
CHAPITRE 6 : LA PRODUCTION D’ÉLÉMENTS DÉCORATIFS
6.1. La Confection d’Objets pour la Décoration de la Classe
Ce sous-chapitre vise à impliquer les élèves dans l’embellissement de leur propre environnement d’apprentissage. L’objectif est de leur faire réaliser divers objets destinés à décorer les murs et les espaces de la salle de classe. Il peut s’agir de mobiles suspendus, de frises murales thématiques (sur les saisons, les animaux, etc.), de fleurs en papier ou de petits tableaux. Cette activité collective renforce le sentiment d’appartenance à la classe et la rend plus accueillante et stimulante. Les élèves apprennent à travailler ensemble sur un projet commun et sont fiers de voir leurs créations exposées et valorisées au quotidien.
6.2. La Réalisation de Guirlandes et d’Ornements de Fête
Le travail manuel est souvent associé aux moments festifs. Cette section apprend à l’élève à confectionner des décorations spécifiques pour les fêtes (Noël, fin d’année scolaire, fête de l’indépendance). La réalisation de guirlandes en papier crépon, de chaînes d’anneaux en papier coloré ou de petits ornements à suspendre sont des activités classiques qui développent la motricité fine et la créativité. L’élève apprend à produire en série des éléments simples et à les assembler pour créer un effet décoratif d’ensemble. Cette pratique montre l’utilité sociale du travail manuel, qui contribue à la beauté et à la joie des célébrations collectives.
6.3. La Création d’Affiches et de Tableaux Illustrés
Ce volet, particulièrement pertinent en deuxième année, combine le travail manuel et la communication visuelle. L’élève participe à la création d’affiches ou de grands tableaux illustrés pour la classe. Il peut s’agir de supports pour d’autres cours (la carte de la province, le cycle de l’eau) ou d’affiches de sensibilisation (sur l’hygiène, la protection de l’environnement). L’élève apprend à organiser l’espace d’une affiche, à collecter et à coller des images, et à réaliser des titres et des dessins. Cette activité développe des compétences de mise en page, de synthèse de l’information et de travail en équipe.
6.4. Le Montage d’une Exposition des Œuvres Réalisées
Ce dernier sous-chapitre de la deuxième partie est une étape de valorisation essentielle. Il s’agit d’apprendre aux élèves à organiser une exposition de leurs propres travaux. L’enseignant les guide dans la sélection des plus belles pièces, leur classification par thème ou par technique, et leur mise en scène dans un espace de l’école. Les élèves participent à l’installation, à la fabrication des étiquettes et, éventuellement, à la présentation de leurs œuvres aux visiteurs (autres classes, parents). Cette activité conclut le cycle de production en offrant aux élèves la reconnaissance de leurs efforts et de leur talent. Elle développe des compétences d’organisation, de communication et renforce considérablement leur estime de soi.
PARTIE III : LE TRAVAIL AU SERVICE DU CADRE DE VIE 🏫
CHAPITRE 7 : L’ENTRETIEN ET L’ASSAINISSEMENT DE L’ÉCOLE
7.1. Les Tâches de Propreté dans la Salle de Classe
Ce sous-chapitre met en application le principe selon lequel chaque élève est responsable de la propreté de son environnement d’apprentissage. Il ne s’agit plus seulement d’identifier les tâches, mais de les exécuter de manière régulière et organisée. L’enseignant met en place un système de roulement pour des responsabilités comme le balayage de la classe, l’époussetage des bancs et du tableau, et le rangement du matériel commun. L’élève apprend à accomplir ces tâches avec soin et efficacité. Cette pratique quotidienne transforme la propreté en une habitude et développe le sens du service et de la responsabilité envers le groupe.
7.2. L’Entretien de la Cour de Récréation
L’effort de propreté s’étend à l’extérieur de la salle de classe. Cette section est consacrée à l’entretien des espaces communs de l’école, et en particulier de la cour de récréation. Les élèves participent, sous la supervision de l’enseignant, à des activités de ramassage des papiers et autres détritus qui peuvent joncher le sol. Ils apprennent que garder la cour propre la rend plus sûre et plus agréable pour les jeux. Cette activité, souvent menée collectivement, renforce la cohésion et le sentiment d’appartenance à l’école. Elle est une manifestation concrète du civisme et du respect des biens communs.
7.3. La Gestion Collective des Déchets Scolaires
Ce volet aborde de manière pratique la question des déchets générés à l’école. L’objectif est de mettre en place un système simple de gestion collective. Les élèves participent à l’installation et à l’utilisation correcte des poubelles dans la classe et dans la cour. Ils sont responsables de vider régulièrement ces poubelles à l’endroit désigné (trou à ordures, composteur). L’enseignant peut initier une démarche de tri simple, en séparant par exemple les déchets organiques (restes de fruits) des déchets secs (papiers). Cette pratique responsable de la gestion des déchets est une leçon d’écologie appliquée qui a un impact direct et visible sur la propreté de l’école.
7.4. Le Désherbage et le Soin des Abords de l’École
L’entretien de l’école inclut également la maîtrise de la végétation spontanée. Ce sous-chapitre initie les élèves aux tâches de désherbage. Munis d’outils simples et adaptés (petites houes, mains gantées), ils apprennent à enlever les mauvaises herbes qui peuvent pousser le long des murs ou dans la cour. L’enseignant leur montre comment distinguer les « mauvaises herbes » des plantes qui ont été intentionnellement plantées. Cette activité physique, menée collectivement, développe l’endurance et l’esprit d’entraide. Elle contribue de manière significative à l’esthétique et à la propreté de l’établissement scolaire, renforçant la fierté des élèves pour leur école.
CHAPITRE 8 : LE JARDINAGE SCOLAIRE
8.1. L’Aménagement d’un Jardin Potager et Floral
Ce sous-chapitre est le point de départ d’un des projets les plus complets et les plus riches de l’ITM : la création d’un jardin scolaire. L’enseignant et les élèves choisissent ensemble un petit lopin de terre dans l’enceinte de l’école pour y aménager un jardin. Ils participent à la délimitation de l’espace et à la conception simple du jardin, en prévoyant des parcelles pour les légumes (jardin potager) et pour les fleurs (jardin floral). Cette phase de planification est essentielle pour développer la capacité à concevoir un projet et à organiser l’espace. Le jardin devient alors un laboratoire à ciel ouvert pour de nombreux apprentissages.
8.2. La Préparation du Sol et des Semis
Une fois l’espace délimité, vient le travail de la terre. L’élève apprend les gestes fondamentaux de la préparation du sol. Il participe au désherbage de la parcelle, puis au labour ou au binage pour ameublir la terre. Il apprend l’importance d’enrichir le sol, par exemple en y incorporant du compost fabriqué à partir des déchets organiques de l’école. Ensuite, il est initié aux techniques de semis, en apprenant à faire des sillons et à y déposer les graines à la bonne profondeur et au bon espacement. Cette activité concrète lui enseigne la patience, l’effort physique et les premières étapes du cycle de la vie végétale.
8.3. L’Entretien des Plantations : Arrosage et Sarclage
Planter ne suffit pas, il faut ensuite prendre soin des cultures. Ce sous-chapitre est consacré aux tâches d’entretien régulier du jardin. L’arrosage est une activité quotidienne essentielle, qui apprend à l’élève l’importance de l’eau pour les plantes. Le sarclage, qui consiste à enlever les mauvaises herbes qui concurrencent les cultures, est une autre tâche fondamentale. L’élève apprend à reconnaître les jeunes plants de ses cultures pour ne pas les arracher par erreur. Cet entretien constant développe le sens des responsabilités, la régularité et la persévérance. L’élève observe jour après jour la croissance des plantes dont il s’occupe, ce qui est une source de grande satisfaction.
8.4. La Plantation d’Arbres Fruitiers et Ornementaux
En plus du potager, le programme encourage la plantation d’arbres et de fleurs, une action à plus long terme pour l’amélioration du cadre de vie. Ce volet, approfondi en deuxième année, guide les élèves dans la plantation d’arbres fruitiers (manguier, avocatier) ou de plantes ornementales dans la cour de l’école. Ils participent à creuser les trous, à mettre en terre les jeunes plants et à les arroser. L’enseignant explique que ces plantations contribueront à l’avenir à donner de l’ombre, des fruits pour la cantine, et à embellir l’école. Cette activité est une leçon sur l’importance de se projeter dans le futur et de poser des gestes dont les bénéfices seront récoltés par les générations suivantes.
CHAPITRE 9 : LA GESTION DE L’EAU ET DES RESSOURCES
9.1. L’Entretien des Points d’Eau de l’École
L’accès à l’eau propre est un enjeu sanitaire majeur. Ce sous-chapitre vise à responsabiliser les élèves dans la gestion et l’entretien des points d’eau de leur école (robinet, borne-fontaine, puits). Ils apprennent que ces installations sont des biens communs précieux et qu’il est de leur devoir de les garder propres. Ils participent au nettoyage des abords du point d’eau pour éviter la formation de boue et de flaques d’eau stagnante, qui peuvent devenir des gîtes à moustiques. Ils apprennent également à ne pas gaspiller l’eau et à signaler toute fuite ou panne à un adulte.
9.2. La Fabrication de Systèmes Simples de Collecte d’Eau de Pluie
Dans de nombreuses régions, l’eau de pluie est une ressource précieuse. Ce volet, plus technique, initie les élèves à la fabrication de systèmes très simples pour la collecter. En utilisant une grande bâche tendue ou en adaptant une gouttière à un petit abri, les élèves peuvent apprendre à canaliser l’eau de pluie vers un récipient propre (un fût, une grande bassine). L’enseignant explique que cette eau, bien que non potable sans traitement, est très utile pour l’arrosage du jardin ou pour le nettoyage. Cette activité développe l’ingéniosité et la conscience de la valeur de l’eau, en montrant comment une ressource naturelle peut être captée et utilisée intelligemment.
9.3. L’Économie des Matériaux et la Lutte contre le Gaspillage
Ce sous-chapitre développe l’esprit d’économie et la gestion rationnelle des ressources matérielles. L’enseignant sensibilise les élèves à la nécessité de ne pas gaspiller le matériel fourni par l’école ou par leurs parents. Pour le papier, ils apprennent à utiliser les deux côtés de la feuille. Pour le matériel de travail manuel (colle, peinture, argile), ils apprennent à ne prendre que la quantité nécessaire. Cette attitude de lutte contre le gaspillage est présentée comme une forme de respect pour le travail de ceux qui ont fourni ces ressources et comme une habitude de gestion responsable qui leur sera utile toute leur vie.
9.4. La Maintenance du Petit Mobilier Scolaire
Le travail manuel peut aussi servir à entretenir et à réparer. Ce volet initie les élèves à des tâches de maintenance très simples sur le mobilier de la classe. Ils peuvent apprendre à nettoyer en profondeur leur banc, à resserrer une vis qui se déloge, ou à signaler une latte cassée qui pourrait être dangereuse. Bien qu’ils ne fassent pas de réparations complexes, cette implication les rend plus attentifs à l’état du matériel et plus respectueux de celui-ci. Ils comprennent que l’entretien régulier permet de prolonger la durée de vie des objets et de conserver un environnement de travail fonctionnel et agréable.
PARTIE IV : INITIATION AUX ACTIVITÉS PRODUCTIVES SPÉCIFIQUES 🌱
CHAPITRE 10 : L’INITIATION À L’ÉLEVAGE
10.1. La Découverte de l’Élevage de la Volaille
L’élevage est une activité productive essentielle. Ce sous-chapitre, au programme de la deuxième année, initie les élèves à l’élevage de la volaille, comme les poules et les canards. L’apprentissage commence par l’observation : les élèves apprennent à reconnaître les animaux, leur mode de vie, leur alimentation et leur reproduction. L’enseignant explique l’intérêt de cet élevage pour la production d’œufs et de viande, qui contribuent à une meilleure alimentation. Si les conditions le permettent, la mise en place d’un petit poulailler scolaire est le projet idéal pour concrétiser ces apprentissages.
10.2. La Construction d’une Basse-cour Simple
La pratique de l’élevage nécessite un abri adéquat pour les animaux. Ce volet est consacré à la participation des élèves à la construction d’une basse-cour simple. En utilisant des matériaux locaux (bois, grillage, paille), les élèves peuvent aider à monter la structure, à construire les perchoirs et les pondoirs. Cette activité de construction collective met en application de nombreuses compétences manuelles et développe l’esprit d’équipe. Elle permet aux élèves de comprendre les besoins des animaux (un abri contre les intempéries et les prédateurs) et de s’impliquer concrètement dans la mise en place d’un projet productif.
10.3. L’Élevage du Petit Bétail (Lapins, Cobayes)
En plus de la volaille, le programme propose l’initiation à l’élevage du petit bétail, comme les lapins ou les cobayes. Ces animaux présentent l’avantage de se reproduire rapidement et de nécessiter peu d’espace. Ce sous-chapitre explore les spécificités de cet élevage. Les élèves apprennent à construire un clapier adapté, qui protège les animaux tout en étant facile à nettoyer. Ils découvrent l’alimentation spécifique de ces herbivores (herbes, feuilles, tubercules). La gestion d’un petit élevage de lapins à l’école de Gemena, par exemple, serait une excellente leçon pratique de biologie et de responsabilité.
10.4. Les Soins Quotidiens aux Animaux : Alimentation et Hygiène
L’élevage est avant tout une responsabilité quotidienne. Ce sous-chapitre insiste sur les soins réguliers à apporter aux animaux. Les élèves, par rotation, sont chargés de l’alimentation et de l’abreuvement des animaux de l’école. Ils apprennent à leur donner la bonne quantité de nourriture et de l’eau propre. Ils participent également à l’hygiène des abris, en nettoyant régulièrement les clapiers ou la basse-cour pour éviter les maladies. Cette prise de responsabilité quotidienne enseigne à l’enfant la régularité, le respect des êtres vivants qui dépendent de lui, et les bases de l’hygiène vétérinaire.
CHAPITRE 11 : LES TÂCHES MÉNAGÈRES FONDAMENTALES
11.1. L’Apprentissage de la Lessive et du Séchage du Linge
Ce sous-chapitre aborde une tâche ménagère essentielle : la lessive. L’élève est initié aux étapes du lavage du linge à la main : le trempage, le savonnage, le brossage ou le frottement, et le rinçage. Il apprend à laver de petites pièces personnelles, comme ses chaussettes ou son mouchoir. L’étape du séchage est également importante : il apprend à bien essorer le linge et à l’étendre au soleil pour qu’il sèche rapidement et sans mauvaises odeurs. Cette compétence de base, enseignée sans distinction de genre, contribue à l’autonomie de l’enfant et à sa participation à la vie familiale.
11.2. L’Initiation au Repassage et au Pliage des Vêtements
Faisant suite à la lessive, ce volet introduit l’élève au repassage et au rangement du linge. L’initiation au repassage se fait avec la plus grande prudence, sous la surveillance stricte de l’enseignant et avec un fer à repasser non branché ou une « makala » (fer à braises) froide, pour apprendre le geste. L’accent est mis sur le repassage de pièces simples comme un mouchoir. L’étape du pliage des vêtements est également enseignée, comme une compétence d’ordre et de soin. L’élève apprend qu’un vêtement bien plié et rangé reste propre plus longtemps et est plus agréable à porter.
11.3. Les Techniques de Raccommodage Élémentaire
Prendre soin de ses vêtements, c’est aussi savoir les réparer. Cette section initie l’élève aux techniques de raccommodage les plus simples. Il apprend à enfiler une aiguille et à faire un nœud. La première compétence enseignée est la pose d’un bouton. Il apprend également à réaliser une reprise simple pour fermer un petit trou ou une couture décousue. Ces gestes, qui prolongent la durée de vie des vêtements, sont une leçon d’économie et de lutte contre le gaspillage. Ils développent la motricité fine et la patience, tout en donnant à l’enfant le sentiment de pouvoir prendre soin de ses propres affaires.
11.4. La Pratique de la Vaisselle et de l’Entretien des Ustensiles
Ce dernier volet des tâches ménagères se concentre sur l’hygiène dans la cuisine. L’élève apprend la méthode correcte pour faire la vaisselle : enlever les restes de nourriture, laver avec du savon ou de la cendre, et rincer abondamment à l’eau propre. L’importance de laisser sécher la vaisselle à l’air libre sur un séchoir est soulignée pour éviter la recontamination par un chiffon sale. L’entretien général des ustensiles de cuisine est également abordé. Cette compétence est directement liée à la santé, car une vaisselle propre est indispensable pour éviter la transmission de maladies.
CHAPITRE 12 : LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE DE BASE
12.1. La Préparation de Jus à partir de Fruits Locaux
Ce sous-chapitre, au programme de la deuxième année, initie les élèves à une forme simple de transformation alimentaire : la fabrication de jus de fruits. En utilisant des fruits locaux de saison (mangues, ananas, oranges, maracujas), les élèves apprennent, sous la direction de l’enseignant, les différentes étapes : laver et éplucher les fruits, en extraire le jus (en pressant ou en mixant), filtrer et éventuellement ajouter un peu de sucre et d’eau. Cette activité pratique et savoureuse est une excellente leçon sur l’hygiène alimentaire et la nutrition. Elle valorise les produits locaux et montre comment transformer une matière première en un produit fini et délicieux.
12.2. Le Séchage des Légumes et des Produits de Cueillette
Le séchage est une technique de conservation ancestrale. Ce volet apprend à l’élève à appliquer cette méthode à des produits comme les légumes-feuilles (feuilles de manioc, amarantes) ou les produits de cueillette comme les champignons ou les chenilles. Il apprend qu’il faut d’abord nettoyer les produits, puis les étaler en fine couche sur une natte propre et les exposer au soleil pendant plusieurs jours. L’enseignant explique que cette technique, en enlevant l’eau, empêche les microbes de se développer et permet de conserver les aliments pendant de longs mois. C’est une compétence précieuse pour la sécurité alimentaire des familles.
1.3. L’Initiation au Fumage ou au Salage du Poisson
Dans les régions lacustres ou fluviales comme près du Lac Tanganyika, le fumage et le salage sont des techniques quotidiennes de conservation du poisson. Ce sous-chapitre propose une initiation à ces méthodes. L’élève observe le processus : le nettoyage et le salage du poisson, puis son exposition à la fumée d’un feu de bois. L’enseignant explique comment la fumée et le sel protègent le poisson de la décomposition. Même si les élèves ne réalisent pas l’opération eux-mêmes pour des raisons de sécurité, l’observation et l’explication de cette technique font partie intégrante de la compréhension des savoir-faire productifs de leur milieu.
12.4. La Préparation de Crèmes ou de Pâtes Simples
Ce dernier sous-chapitre explore d’autres formes de transformation alimentaire simple. Il peut s’agir de la préparation d’une crème d’avocat, d’une pâte d’arachide (Mwamba) ou d’autres préparations locales qui ne nécessitent pas de cuisson complexe. Les élèves participent à piler, écraser ou mélanger les ingrédients. Cette activité pratique est une occasion de parler de nutrition, d’hygiène et de valorisation des recettes locales. Elle conclut le programme d’ITM en montrant que le travail manuel est au cœur de l’une des activités humaines les plus essentielles : se nourrir.
ANNEXES
ANNEXE 1 : Fiches Techniques pour la Fabrication d’Objets
Cette annexe propose une série de fiches techniques illustrées, « pas à pas », pour guider la fabrication de certains objets clés du programme. Chaque fiche présente un projet (par exemple : « Fabriquer une voiturette en boîte de conserve », « Construire un cerf-volant », « Tresser un set de table en papier ») et détaille :
- La liste du matériel nécessaire.
- Les étapes de la construction, expliquées simplement et illustrées par des dessins clairs.
- Des conseils de sécurité spécifiques au projet. Ces fiches sont conçues comme des supports prêts à l’emploi pour l’enseignant, lui permettant de mener des projets de fabrication complexes de manière structurée et sécurisée.
ANNEXE 2 : Calendrier des Activités Agricoles Scolaires
Pour aider à la planification des activités de jardinage tout au long de l’année, cette annexe propose un calendrier agricole simplifié, adaptable aux différentes zones climatiques de la RDC. Le calendrier suggère, pour chaque mois ou saison, les tâches appropriées :
- Saison sèche : Préparation du terrain, fabrication du compost, entretien des outils.
- Début de la saison des pluies : Semis et plantations (maïs, haricots, amarantes).
- Pleine saison des pluies : Sarclage, binage, tuteurage.
- Fin de la saison des pluies / Début de saison sèche : Récoltes, séchage des produits, préparation des semences pour la saison suivante. Cet outil aide l’enseignant à intégrer le jardin scolaire dans le rythme des saisons et à planifier ses leçons de manière cohérente.
ANNEXE 3 : Guide pour la Visite d’un Artisan Local
La visite d’un artisan est un moment pédagogique fort, mais qui nécessite une préparation. Cette annexe fournit un guide pour aider l’enseignant à organiser une telle visite de manière efficace. Elle propose :
- Une check-list de préparation (contacter l’artisan, obtenir l’autorisation des parents, préparer les consignes de sécurité).
- Une grille d’observation pour les élèves, avec des questions simples pour guider leur regard : Quels sont les matériaux utilisés ? Quels sont les outils ? Quelles sont les étapes de la fabrication ? Quel est le produit fini ?
- Des pistes d’exploitation après la visite (dessin, rédaction d’un petit compte rendu oral, fabrication d’un objet inspiré de la visite).
ANNEXE 4 : Lexique des Outils et des Gestes Techniques
Ce lexique a pour but de clarifier le vocabulaire de base du travail manuel. Il fournit des définitions simples et, si possible, des dessins pour les outils et les gestes techniques essentiels du programme.
- Outils : La houe, le râteau, la machette, les ciseaux, le marteau, l’aiguille.
- Gestes et Techniques :
- Sarcler : Enlever les mauvaises herbes avec une houe.
- Biner : Casser la croûte superficielle de la terre pour l’aérer.
- Tresser : Entrecroiser des brins (de paille, de papier) pour faire une natte ou une corde.
- Ligaturer : Attacher solidement deux éléments avec une ficelle ou une liane.
- Modeler : Donner une forme à une matière molle comme l’argile. Ce glossaire assure une compréhension commune du vocabulaire et facilite la transmission de consignes claires et précises.


