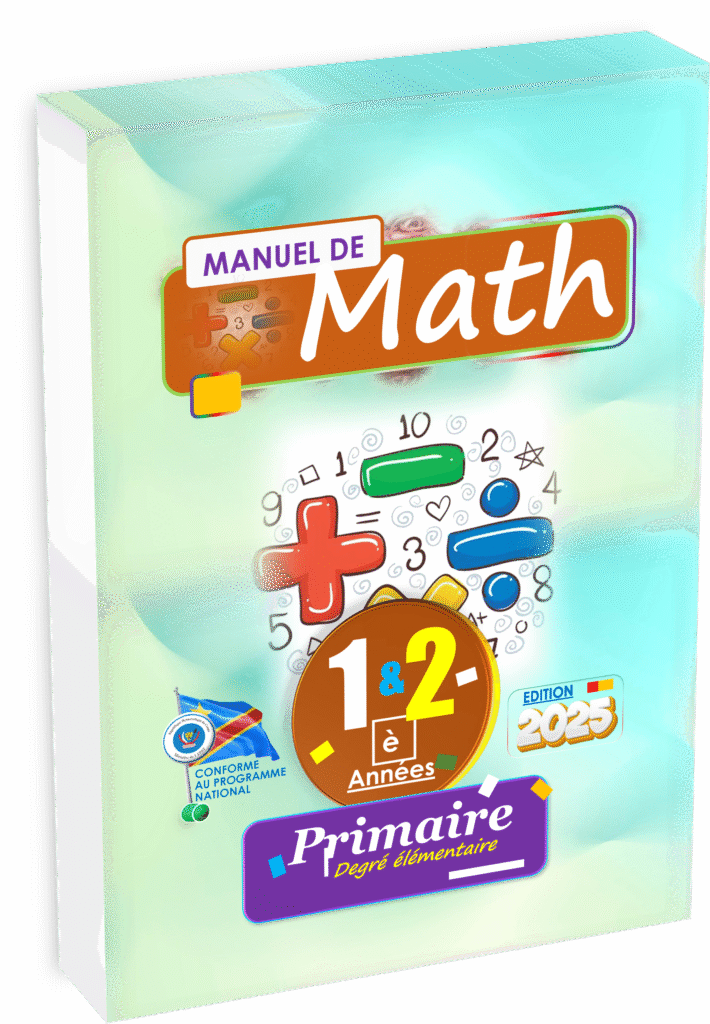
COURS DE MATHÉMATIQUES, 1ÈRE ET 2ÈME ANNÉE PRIMAIRE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
PRÉLIMINAIRES
0.1. Finalités et Buts de l’Enseignement des Mathématiques
L’enseignement des mathématiques au degré élémentaire vise à équiper l’élève des outils intellectuels fondamentaux pour comprendre et interagir avec son environnement. L’objectif principal est de développer un raisonnement logique, une rigueur intellectuelle et la capacité de résoudre les problèmes concrets de la vie courante. 🎯 Il s’agit de former un individu capable de mobiliser des notions arithmétiques, géométriques et de mesure pour analyser une situation, organiser sa pensée et trouver une solution adéquate. Ce cours prépare l’enfant à s’intégrer utilement dans la société en lui donnant les moyens de quantifier, d’estimer, de comparer et de se repérer dans l’espace. La finalité est de faire des mathématiques une discipline vivante, ancrée dans le réel, et de développer chez l’élève le sens pratique, la curiosité et la confiance en ses capacités à réfléchir par lui-même.
0.2. Profil de Sortie du Degré Élémentaire
Au terme des deux premières années du cycle primaire, l’élève doit avoir atteint un seuil de compétences mathématiques qui lui confère une première autonomie. Il doit être capable de comprendre et d’utiliser les nombres jusqu’à 100 dans le cadre des quatre opérations arithmétiques simples pour traiter des situations de la vie quotidienne, comme calculer le total de ses achats ou partager équitablement des objets. 💯 Il doit pouvoir utiliser des unités de mesure naturelles et conventionnelles pour apprécier des grandeurs telles que la longueur, la masse ou la capacité. Sur le plan spatial, l’élève doit savoir se situer, s’orienter et repérer des objets familiers ou des formes géométriques simples. Ce profil de sortie garantit que l’élève a acquis les bases indispensables pour aborder les apprentissages plus complexes du degré moyen et pour utiliser les mathématiques comme un outil fonctionnel dans son quotidien.
0.3. Approche Pédagogique et Didactique
L’approche pédagogique pour ce cours est résolument active, concrète et participative, conformément aux directives nationales. La démarche didactique part systématiquement de la manipulation d’objets concrets et de situations-problèmes tirées du vécu de l’enfant pour aboutir à l’abstraction. 👐 L’enseignant agit comme un guide qui aide l’élève à construire ses propres connaissances. Le processus d’apprentissage respecte une progression rigoureuse : de la rencontre avec une quantité par la manipulation, à sa symbolisation par un chiffre, puis à son utilisation dans des opérations. L’induction et la déduction sont sollicitées en permanence. Le matériel didactique, souvent fabriqué à partir de ressources locales (bouchons, bâtonnets, boîtes de conserve), est au cœur de la pratique pédagogique. L’erreur est considérée comme une étape normale et constructive de l’apprentissage. L’évaluation est formative et intégrée, visant à réguler l’enseignement en fonction des progrès réels des élèves.
PARTIE 1 : LA CONSTRUCTION DU NOMBRE ET DES PREMIÈRES OPÉRATIONS
CHAPITRE 1 : DES OBJETS AUX NOMBRES (0 À 20) 🔢
1.1. Tri, Classement et Sériation d’Objets
Avant même de savoir compter, l’enfant doit apprendre à organiser le monde qui l’entoure. Ce sous-chapitre développe les premières structures logiques de la pensée en amenant les élèves à manipuler des collections d’objets de leur environnement (cailloux, feuilles, bouchons). 🍃 Ils apprennent à trier ces objets en fonction d’un critère simple (par exemple, séparer les feuilles vertes des feuilles jaunes), à les classer en constituant des groupes selon une ou deux propriétés communes (les bouchons rouges et petits), et à les sérier en les rangeant selon une progression logique (du plus petit au plus grand caillou). Ces activités de manipulation, fondamentales et ludiques, structurent l’esprit de l’enfant et le préparent à comprendre que le nombre est une manière de classer et d’organiser des quantités.
1.2. Dénombrement et Constitution de Collections
Le dénombrement est l’acte fondateur de l’arithmétique. Il s’agit d’apprendre à associer un mot-nombre à chaque objet d’une collection, sans en oublier et sans en compter un plusieurs fois. L’élève apprend la comptine numérique jusqu’à 20. 🗣️ Il s’exerce à dénombrer des collections d’objets réels, puis des ensembles dessinés. Inversement, il apprend à constituer une collection correspondant à un nombre donné (« Apporte-moi 5 crayons »). Cette double compétence, dénombrer et constituer, assure une compréhension solide de la quantité que représente chaque nombre. L’enseignant insiste sur la coordination du geste (pointer chaque objet) et de la parole pour garantir l’exactitude du comptage.
1.3. Lecture et Écriture Chiffrée des Nombres de 0 à 20
Après la maîtrise orale des nombres, l’élève doit apprendre à les lire et à les écrire en utilisant leur représentation symbolique : les chiffres. Ce sous-chapitre est dédié à l’association entre le mot-nombre, la quantité et le chiffre correspondant. ✍️ L’enseignant présente chaque chiffre en l’associant à une collection d’objets bien visible. L’élève s’entraîne ensuite à reconnaître les chiffres, à les nommer et à les tracer correctement, en respectant le sens du tracé. Des activités variées comme les jeux de loto des nombres, les dictées de chiffres ou l’étiquetage de collections permettent de consolider cette compétence essentielle, qui marque le passage de l’oral à l’écrit mathématique.
1.4. Représentation et Comparaison des Nombres de 0 à 20
Pour que les nombres ne soient pas qu’une suite de symboles, l’élève doit pouvoir se les représenter et les situer les uns par rapport aux autres. Il apprend à représenter les nombres sur une ligne numérique (la « bande numérique »), ce qui lui donne une image mentale de l’ordre des nombres et de leur succession. 📊 Il s’initie également à la comparaison des quantités, d’abord par manipulation directe (mise en correspondance terme à terme de deux collections), puis en utilisant les symboles de comparaison : = (égal à), > (plus grand que), < (plus petit que). L’objectif est qu’il puisse comparer deux nombres jusqu’à 20 et les ranger en ordre croissant (du plus petit au plus grand) ou décroissant.
CHAPITRE 2 : L’ADDITION ET LA SOUSTRACTION (NOMBRES DE 0 À 20) ➕➖
2.1. Le Sens de l’Addition : Ajouter, Réunir
L’addition est la première opération arithmétique abordée. Son sens est construit à partir d’actions concrètes. L’élève découvre que l’addition correspond à deux types de situations : l’ajout d’une quantité à une autre (j’avais 3 mangues, on m’en donne 2 de plus) et la réunion de deux collections distinctes (il y a 4 filles et 5 garçons dans le groupe, combien d’enfants en tout ?). 🥭 L’enseignant propose de nombreuses manipulations et situations-problèmes issues de la vie de la classe pour que l’élève s’approprie ce double sens. Le signe « + » et le signe « = » sont introduits comme des symboles qui traduisent ces actions en langage mathématique.
2.2. Le Sens de la Soustraction : Retirer, Chercher ce qui Manque
La soustraction est introduite en parallèle de l’addition. Son sens est également construit à partir de manipulations concrètes. L’élève apprend que la soustraction permet de résoudre deux types de problèmes : enlever une quantité à une collection existante (j’avais 7 biscuits, j’en ai mangé 3, combien m’en reste-t-il ?) et chercher ce qu’il manque pour atteindre une certaine quantité (je veux 8 crayons, j’en ai déjà 5, combien m’en manque-t-il ?). 🍪 L’enseignant veille à présenter ces deux aspects de la soustraction à travers des scénarios variés. Le signe « – » est introduit pour symboliser l’action de retirer ou de chercher une différence.
2.3. Composition et Décomposition Additive des Nombres
Une compréhension approfondie des nombres passe par la capacité à les voir comme des assemblages de plus petits nombres. Ce sous-chapitre est consacré à la composition et à la décomposition des nombres jusqu’à 20. 🎲 L’élève apprend, par exemple, que le nombre 7 peut être obtenu de plusieurs manières : 6+1, 5+2, 4+3, etc. Des jeux avec des jetons bicolores ou des dominos sont utilisés pour explorer systématiquement toutes les décompositions d’un nombre. Cette compétence est cruciale pour le calcul mental ; elle permet de développer des stratégies de calcul flexibles et prépare à la compréhension de la retenue dans les opérations posées. Un focus particulier est mis sur la recherche du complément à 10.
2.4. Mémorisation des Tables d’Addition et de Soustraction
L’automatisation des résultats des additions et soustractions simples est un objectif majeur du degré élémentaire, car elle libère la mémoire de travail de l’élève pour la résolution de problèmes plus complexes. Après avoir bien compris le sens des opérations, l’élève est amené à mémoriser progressivement les tables d’addition (de 1+1 à 10+10) et leurs correspondances soustractives (si 3+4=7, alors 7-4=3). 🧠 La mémorisation n’est pas un apprentissage par cœur mécanique ; elle s’appuie sur la compréhension des relations entre les nombres (commutativité de l’addition, lien addition/soustraction) et est favorisée par des jeux de calcul mental quotidiens, rapides et rythmés (le « furet », les calculs à l’ardoise, etc.).
CHAPITRE 3 : EXTENSION DE LA NUMÉRATION ET DES OPÉRATIONS (JUSQU’À 100) 💯
3.1. Le Système Décimal : Groupements par Dix
Le passage de 20 à 100 nécessite la compréhension du principe fondamental de notre système de numération : le groupement par dix. Ce sous-chapitre est crucial. À travers la manipulation de matériel de numération (bûchettes, cubes, etc.), l’élève découvre que dix unités forment un nouveau groupe appelé « dizaine ». 📦 Il apprend à grouper des objets par paquets de dix pour faciliter leur dénombrement. Il comprend que le nombre 34, par exemple, représente 3 paquets de dix et 4 objets isolés. Cette compréhension de la valeur de position (un chiffre vaut dix fois plus s’il est au rang des dizaines) est la clé de voûte de toute la numération de position.
3.2. Lecture, Écriture et Décomposition des Nombres de 0 à 100
Une fois le principe de la dizaine compris, l’élève étend ses compétences de lecture et d’écriture à tous les nombres jusqu’à 100. Il apprend à nommer les familles de dizaines (vingt, trente, quarante…). 🗣️ Il s’exerce à lire et à écrire en chiffres les nombres dictés. La décomposition des nombres est systématisée : 76 = 7 dizaines et 6 unités, ce qui s’écrit 70 + 6. Le tableau de numération (avec les colonnes « dizaines » et « unités ») est utilisé comme un outil visuel pour aider à la compréhension de la structure des nombres et pour placer correctement les chiffres.
3.3. L’Addition et la Soustraction Posées (avec et sans Retenue)
Les compétences en calcul s’étendent aux nombres à deux chiffres. L’élève apprend d’abord à poser les opérations en colonnes, en alignant correctement les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. Il effectue d’abord des additions et des soustractions sans retenue (« sans passage à la dizaine »). ➕ Puis, le concept de la retenue est introduit, toujours en lien avec la manipulation : lorsque le total des unités dépasse neuf, on forme un nouveau paquet de dix (une dizaine) que l’on « retient » et que l’on ajoute à la colonne des dizaines. Le même principe de l’emprunt ou de l’échange est abordé pour la soustraction.
3.4. Comparaison, Ordre et Encadrement des Nombres jusqu’à 100
L’élève affine sa connaissance de la suite des nombres jusqu’à 100. Il apprend à comparer deux nombres à deux chiffres en regardant d’abord le chiffre des dizaines, puis, en cas d’égalité, celui des unités. 📊 Il consolide l’utilisation des signes >, <, =. Il s’entraîne à ranger des séries de nombres en ordre croissant ou décroissant. La compétence d’encadrement est introduite : trouver le nombre juste avant et juste après un nombre donné, ou encadrer un nombre entre deux dizaines consécutives (par exemple, 47 est compris entre 40 et 50). Ces exercices renforcent la maîtrise de la suite numérique et la compréhension de la structure des nombres.
PARTIE 2 : L’EXPLORATION DU MONDE MESURABLE
CHAPITRE 4 : LES GRANDEURS ET LEURS MESURES 📏
4.1. La Mesure des Longueurs
Ce sous-chapitre initie l’élève à la notion de longueur et à sa mesure. La démarche est progressive. L’élève commence par comparer des longueurs de manière directe (en superposant deux objets). Puis, il utilise des unités de mesure non conventionnelles, dites « naturelles » (l’empan de la main, le pied, un bâton), pour mesurer la longueur d’un banc ou la largeur de la classe à Bukavu. 👣 Il prend ainsi conscience de la nécessité d’une unité de mesure commune et stable. L’enseignant introduit alors les unités conventionnelles du système métrique : le mètre (m), le décimètre (dm) et le centimètre (cm). L’élève apprend à utiliser les instruments de mesure correspondants (mètre-ruban, règle graduée) pour mesurer des objets concrets.
4.2. La Mesure des Masses
De manière analogue à la longueur, l’élève explore la notion de masse. Il commence par des comparaisons directes en soupesant deux objets pour déterminer « le plus lourd » et « le plus léger ». ⚖️ Il utilise ensuite une balance simple (à plateaux) pour effectuer des comparaisons plus précises. L’enseignant introduit alors l’unité de mesure conventionnelle, le kilogramme (kg), et ses sous-multiples courants comme le gramme (g). L’élève apprend à utiliser une balance pour déterminer la masse d’objets variés (un sac de riz, un fruit) en utilisant des masses marquées. Cette approche pratique lui permet de se construire des repères concrets sur la masse des objets qui l’entourent.
4.3. La Mesure des Capacités
La capacité, ou le contenu d’un récipient, est une autre grandeur fondamentale du quotidien. La démarche pédagogique est similaire. L’élève commence par comparer les capacités de deux récipients par transvasement. 💧 Il utilise ensuite des unités non conventionnelles (« un verre », « une bouteille ») pour mesurer le contenu d’un seau, par exemple. Il prend conscience des limites de ces unités et de la nécessité d’une unité standard. L’enseignant introduit alors le litre (l) et ses sous-multiples comme le décilitre (dl). L’élève s’exerce à mesurer des quantités de liquide à l’aide de récipients gradués, ce qui ancre la notion de capacité dans des actions concrètes et utiles.
4.4. Premières Approches de la Notion d’Aire
L’aire, ou la surface, est une notion plus abstraite qui est abordée de manière intuitive au degré élémentaire. L’élève est amené à comparer des surfaces par superposition (comparer la surface de deux feuilles d’arbre). checkered_flag: Il découvre ensuite le principe du pavage : il apprend qu’on peut mesurer une surface en la recouvrant entièrement, sans trou ni chevauchement, avec une unité de surface choisie (des carrés de papier, des dominos). Cette activité de recouvrement lui permet de comprendre que l’aire d’une figure est le nombre d’unités nécessaires pour la couvrir. C’est une première étape essentielle avant l’introduction des formules de calcul d’aire dans les classes supérieures.
CHAPITRE 5 : SE REPÉRER DANS LE TEMPS ⏳
5.1. Les Moments de la Journée
La structuration du temps commence par le repérage des grands moments qui rythment la journée de l’enfant. Il apprend à nommer et à associer à ses activités les différents moments : le matin (le réveil, le départ pour l’école), l’avant-midi, le midi (le repas), l’après-midi, le soir (le retour à la maison, le coucher) et la nuit. ☀️🌙 L’enseignant s’appuie sur des rituels quotidiens et sur le dialogue en classe (« Qu’as-tu fait ce matin avant de venir à l’école ? ») pour fixer ce vocabulaire temporel. La maîtrise de ces premiers repères est indispensable pour que l’enfant puisse commencer à organiser ses souvenirs et à anticiper les événements.
5.2. Les Jours, les Semaines et les Mois
L’élève étend son repérage temporel à des durées plus longues. Il apprend à nommer dans l’ordre les jours de la semaine. La notion de semaine comme un cycle de sept jours qui se répète est construite à travers des rituels et l’utilisation d’un calendrier de la semaine affiché en classe. 🗓️ Progressivement, il découvre les mois de l’année et les saisons spécifiques à sa région (saison sèche, saison des pluies). Il apprend à situer des événements importants (son anniversaire, les fêtes nationales, les congés scolaires) dans ce cadre temporel plus large. Cela lui permet de se construire une ligne du temps personnelle et sociale.
5.3. La Lecture de l’Heure
La lecture de l’heure sur une horloge à aiguilles est une compétence complexe qui est abordée progressivement. En première année, l’élève apprend à lire les heures justes (« il est trois heures »). 🕒 En deuxième année, il affine sa lecture en apprenant à reconnaître la demi-heure (« trois heures et demie ») et le quart d’heure (« trois heures et quart »). L’enseignant utilise une horloge en carton à aiguilles mobiles pour permettre aux élèves de manipuler et de visualiser le passage du temps. Cet apprentissage est toujours lié à des situations concrètes (« À quelle heure commence la récréation ? »).
5.4. L’Utilisation du Calendrier
Le calendrier est un outil social de repérage dans le temps que l’élève doit apprendre à utiliser. Il apprend à identifier sur un calendrier le jour de la semaine, la date (le numéro dans le mois) et le mois. 📅 Il s’exerce à trouver des dates importantes, à calculer des durées simples (« Dans combien de jours sera la fête ? ») et à comprendre la structure du calendrier (les semaines qui se suivent, le nombre de jours dans un mois). L’utilisation du calendrier de la classe et du calendrier civil permet à l’élève de se connecter à un temps social et partagé, au-delà de son propre vécu.
CHAPITRE 6 : LES MATHÉMATIQUES DANS LA VIE SOCIALE 🏙️
6.1. La Monnaie Congolaise : le Franc Congolais
Ce sous-chapitre est consacré à la familiarisation avec la monnaie nationale. L’élève apprend à reconnaître les différentes pièces et les différents billets de Francs Congolais en circulation. 💵 Il apprend la valeur de chaque pièce et de chaque billet et s’exerce à constituer une somme donnée en utilisant différentes combinaisons. L’enseignant utilise de la monnaie factice pour permettre des manipulations en toute sécurité. La maîtrise de cet outil est une compétence civique et pratique indispensable à la vie en société.
6.2. Simulations d’Achat et de Vente
Pour rendre l’apprentissage de la monnaie fonctionnel, l’enseignant organise des situations de jeu qui simulent des actes de la vie économique. Le coin « marchande » ou « boutique » dans la classe est un dispositif pédagogique très efficace. 🛒 Les élèves, jouant les rôles de vendeurs et de clients, doivent afficher des prix, calculer le montant des achats, payer, et rendre la monnaie. Ces jeux de rôle, par exemple la simulation d’un achat de beignets à un marché de Matadi, permettent de mobiliser de nombreuses compétences mathématiques (dénombrement, addition, soustraction) dans un contexte motivant et chargé de sens.
6.3. La Notion de Température
La température est une grandeur physique que l’enfant expérimente quotidiennement (le chaud, le froid). Ce sous-chapitre, abordé en deuxième année, vise à lui faire découvrir l’instrument qui permet de la mesurer : le thermomètre. 🌡️ L’élève apprend à lire la température sur un thermomètre (médical ou d’ambiance) et à comprendre l’unité de mesure, le degré Celsius (°C). L’enseignant peut organiser des relevés de la température de la classe à différents moments de la journée pour montrer ses variations. C’est une première initiation à une mesure scientifique et une ouverture sur les phénomènes météorologiques.
6.4. Le Partage Équitable et Inéquitable
La notion de partage est au cœur de nombreuses situations sociales et est une porte d’entrée intuitive vers la division. Ce sous-chapitre amène l’élève à réaliser des partages concrets d’une collection d’objets (bonbons, crayons) entre plusieurs personnes. 🍬 Il découvre ce qu’est un partage équitable (chacun reçoit la même quantité) et apprend la procédure pour y parvenir (distribution un par un). Il explore également la notion de « reste » (ce qu’on ne peut pas partager équitablement). Cette activité de manipulation prépare la compréhension conceptuelle de l’opération de division qui sera étudiée plus tard.
PARTIE 3 : LA DÉCOUVERTE DE L’ESPACE ET DES FORMES
CHAPITRE 7 : LES LIGNES ET LES POSITIONS DANS L’ESPACE 🗺️
7.1. Le Tracé et la Reconnaissance des Lignes
La géométrie commence par l’étude de son élément le plus simple : la ligne. L’élève apprend à identifier, nommer et tracer les différents types de lignes : la ligne droite, la ligne courbe, la ligne brisée. 〰️ Il découvre également les concepts de ligne ouverte et de ligne fermée. L’enseignant propose des activités de graphisme et de dessin à main levée ou à la règle pour que l’élève s’approprie ces notions. La reconnaissance de ces lignes dans l’environnement (une route est une ligne, le contour d’un lac est une ligne fermée) permet de faire le lien entre la géométrie et le monde réel.
7.2. Se Situer dans l’Espace : Repères Fondamentaux
La maîtrise du vocabulaire spatial est essentielle pour se repérer, décrire et suivre des consignes. Ce sous-chapitre consolide et enrichit le lexique de la localisation. L’élève apprend à utiliser avec précision les couples de notions spatiales : sur/sous, devant/derrière, à l’intérieur/à l’extérieur, à droite/à gauche. ⬆️⬇️ L’enseignant organise des jeux moteurs (« place le cube sur la chaise ») et des activités sur fiche (« colorie l’oiseau qui est à l’intérieur de la cage ») pour systématiser l’emploi de ces termes. Une attention particulière est portée à la distinction droite/gauche, d’abord sur son propre corps, puis sur autrui ou sur une feuille.
7.3. Repérage sur Quadrillage
Le quadrillage est un outil structurant qui prépare à la lecture de plans et aux systèmes de coordonnées. L’élève apprend à se repérer sur une surface quadrillée. Il s’exerce d’abord à décrire la position d’un objet en utilisant un vocabulaire simple (« le jeton est dans la case en haut à droite »). 🏁 Puis, il apprend à se déplacer sur le quadrillage en suivant un code (par exemple, un code de flèches). Cette activité développe la rigueur du repérage et la capacité à suivre un programme de déplacement, des compétences utiles dans de nombreux domaines.
7.4. Itinéraires et Déplacements Codés
Ce sous-chapitre applique les compétences de repérage à des situations dynamiques. L’élève est amené à décrire un itinéraire simple (« pour aller de la porte au tableau, tu avances tout droit puis tu tournes à gauche ») ou à suivre un parcours codé dans la classe ou dans la cour. ↪️ Des jeux comme les chasses au trésor, où il faut suivre une série d’instructions pour trouver un objet caché, sont particulièrement adaptés. Ces activités ludiques permettent de travailler la planification d’un déplacement et la compréhension de consignes spatiales complexes, tout en développant l’orientation.
CHAPITRE 8 : LES FIGURES GÉOMÉTRIQUES PLANES 🔵
8.1. Le Carré et le Rectangle
L’étude des formes commence par les quadrilatères les plus courants. Par la manipulation, l’observation et le dessin, l’élève apprend à reconnaître le carré et le rectangle. 🟨 Il découvre leurs propriétés de manière intuitive : ils ont quatre côtés, quatre sommets et quatre angles droits. Il apprend à les différencier (le carré a quatre côtés égaux, tandis que le rectangle a des côtés égaux deux à deux). Il s’exerce à les tracer à main levée, puis en utilisant une règle et les lignes d’un quadrillage.
8.2. Le Triangle
Le triangle est une autre figure fondamentale que l’élève explore. Il apprend qu’un triangle est une figure fermée qui a trois côtés et trois sommets. 🔺 Par des activités de découpage, de pliage et de construction avec des bâtonnets, il découvre qu’il existe différentes sortes de triangles (sans que les noms spécifiques comme « isocèle » ou « équilatéral » ne soient forcément introduits à ce stade). L’objectif est qu’il puisse reconnaître un triangle parmi d’autres formes et le construire de manière simple.
8.3. Le Cercle
Le cercle est introduit comme une ligne courbe fermée dont tous les points sont à la même distance d’un point central. L’élève apprend à le reconnaître et à le distinguer d’autres formes arrondies. 🟢 Il s’exerce à tracer des cercles à main levée, puis en utilisant des gabarits (comme le contour d’un verre ou d’une pièce de monnaie). La distinction entre le cercle (la ligne) et le disque (la surface intérieure) est abordée de manière concrète.
8.4. Construction et Reproduction de Figures
Au-delà de la reconnaissance, l’élève est amené à produire lui-même des figures géométriques. Il apprend à utiliser les instruments de base comme la règle pour tracer des segments de droite et construire des carrés ou des rectangles sur papier quadrillé. ✏️ Il s’entraîne également à reproduire un assemblage simple de figures (comme une maison faite d’un carré et d’un triangle) en observant un modèle. Ces activités de construction et de reproduction développent la précision du geste et la capacité d’analyse visuelle.
CHAPITRE 9 : PROPRIÉTÉS ET TRANSFORMATIONS DES FIGURES 🧩
9.1. Description des Figures : Côtés, Sommets, Angles
L’élève affine son analyse des figures géométriques en apprenant à utiliser le vocabulaire spécifique pour les décrire. Il apprend à identifier et à compter les côtés (les segments qui forment la figure), les sommets (les « pointes » où les côtés se rencontrent) et les angles. 📐 L’enseignant utilise une équerre pour introduire la notion d’angle droit et l’élève s’exerce à vérifier si les angles d’un carré ou d’un rectangle sont droits. Cette approche analytique permet de passer d’une reconnaissance globale des formes à une compréhension de leurs propriétés constitutives.
9.2. Le Concept de Périmètre
Le périmètre est abordé de manière concrète comme étant le « contour » ou la « longueur du tour » d’une figure. L’élève découvre cette notion en mesurant le pourtour d’objets réels (une table, un cahier) avec une ficelle qu’il déplie et mesure ensuite avec une règle. 📏 Pour les polygones, il comprend que le périmètre est la somme des longueurs de tous ses côtés. Il s’exerce à calculer le périmètre de carrés et de rectangles en mesurant leurs côtés et en additionnant les longueurs.
9.3. La Symétrie par Pliage et Miroir
La symétrie est une propriété géométrique très présente dans la nature et dans l’art. L’élève découvre l’axe de symétrie de manière très concrète, par le pliage. Il apprend qu’une figure est symétrique si, en la pliant le long d’une ligne, les deux parties se superposent parfaitement. ✨ Il recherche les axes de symétrie de figures simples comme le carré, le rectangle, ou d’images comme un papillon. L’utilisation d’un miroir est également un moyen efficace pour visualiser et compléter une figure symétrique.
9.4. Pavages et Frises Géométriques
Ce sous-chapitre explore l’agencement des formes dans l’espace. Le pavage consiste à recouvrir un plan avec une ou plusieurs formes géométriques, sans laisser de vide et sans que les formes ne se chevauchent, à l’image d’un carrelage. L’élève manipule des carrés, des rectangles, des triangles pour créer ses propres pavages. Tile Il découvre également les frises, qui sont des motifs géométriques qui se répètent de manière linéaire. Ces activités développent le sens de l’organisation spatiale et la créativité, tout en montrant comment la géométrie peut être esthétique.
PARTIE 4 : VERS LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES ET L’ABSTRACTION
CHAPITRE 10 : INTRODUCTION À LA MULTIPLICATION ET À LA DIVISION ✖️➗
10.1. Le Double et la Moitié
Les notions de double et de moitié sont les premières approches intuitives de la multiplication par deux et de la division par deux. À partir de collections d’objets, l’élève apprend que prendre le double d’une quantité, c’est prendre la même quantité une deuxième fois. ✌️ Inversement, prendre la moitié, c’est partager la collection en deux parts égales. Ces notions sont travaillées à travers des manipulations et du calcul mental sur de petits nombres. La relation entre les deux (« le double de 3 est 6, la moitié de 6 est 3 ») est mise en évidence.
10.2. Le Triple et le Tiers, le Quadruple et le Quart
Sur le même principe que le double et la moitié, l’élève explore les notions de triple/tiers et de quadruple/quart. Il apprend que le triple d’un nombre correspond à 3 fois ce nombre, et que le tiers correspond à un partage en 3 parts égales. 🍀 De même pour le quadruple (4 fois) et le quart (partage en 4). Ces concepts sont abordés de manière concrète, en constituant des groupes d’objets ou en effectuant des partages. Ils enrichissent le répertoire de relations entre les nombres et préparent à une compréhension plus générale des opérations de multiplication et de division.
10.3. Approche de la Multiplication par l’Addition Répétée
La multiplication est introduite comme une manière plus rapide d’effectuer une addition répétée. L’élève découvre que pour calculer le nombre total de biscuits dans 4 paquets de 3 biscuits, au lieu de faire 3+3+3+3, on peut dire « 4 fois 3 ». 💡 L’enseignant utilise des situations où des groupes d’objets de même taille sont réunis. L’élève apprend à traduire ces situations en additions réitérées, puis à les écrire sous forme de multiplication avec le signe « x ». Cette approche, qui s’appuie sur une connaissance déjà solide de l’addition, permet de construire le sens de la multiplication.
10.4. Approche de la Division par Partages et Groupements
La division est abordée selon ses deux significations principales. La première est la division-partage : on a une quantité totale et on veut savoir combien chacun recevra si on la partage équitablement (partager 12 mangues entre 3 enfants). 🥭 La seconde est la division-groupement : on a une quantité totale et on veut savoir combien de groupes d’une taille donnée on peut former (avec 12 mangues, combien de paquets de 3 mangues peut-on faire ?). L’élève explore ces deux situations par la manipulation, ce qui lui permet de construire une compréhension intuitive et complète de l’opération de division.
CHAPITRE 11 : LES FRACTIONS SIMPLES 🍕
11.1. Partager une Unité Continue
La notion de fraction est introduite à partir du partage d’une unité continue, c’est-à-dire un objet que l’on peut couper, comme un gâteau, une galette, une feuille de papier, une barre de chocolat, ou le pain « kwanga » typique de la région de l’Équateur. 🥖 L’élève est confronté à la nécessité de partager un objet unique en plusieurs parts égales. Cette première approche est concrète et manipulatoire. Il apprend, par le pliage ou le découpage, ce que signifie « partager en parts égales » et comprend que chaque part est une « partie de l’unité ».
11.2. La Fraction un Demi (1/2)
La première fraction étudiée est la plus simple et la plus courante : la moitié, notée 1/2. L’élève apprend qu’on obtient des demis en partageant une unité en deux parts parfaitement égales. 🌗 Il s’exerce à produire des demis en pliant des feuilles, en coupant des fruits ou de la pâte à modeler. Il apprend à nommer (« un demi ») et à reconnaître l’écriture fractionnaire 1/2. Il découvre également la relation fondamentale : deux demis reforment l’unité entière.
11.3. La Fraction un Tiers (1/3)
Après le partage en deux, l’élève aborde le partage en trois parts égales. Il apprend que chacune de ces parts s’appelle « un tiers » et s’écrit 1/3. 🥧 La production de tiers par le pliage ou le découpage est plus complexe et demande de la précision. L’élève s’exerce à identifier des tiers et à comprendre que trois tiers sont nécessaires pour reconstituer l’unité. La comparaison intuitive (« un tiers est plus petit qu’un demi ») est initiée par la manipulation et l’observation.
11.4. La Fraction un Quart (1/4)
Le partage en quatre est ensuite étudié. L’élève apprend que « un quart » (noté 1/4) est l’une des quatre parts égales d’une unité. 🧇 Il découvre qu’on peut obtenir des quarts facilement en pliant une feuille en deux, puis encore en deux. Il consolide le vocabulaire et l’écriture fractionnaire. La relation entre les fractions est explorée : il peut visualiser que deux quarts forment un demi. Cette exploration concrète des fractions 1/2, 1/3 et 1/4 constitue la base de toute la compréhension future des nombres rationnels.
CHAPITRE 12 : LA MÉTHODOLOGIE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 🔎
12.1. Lire et Comprendre un Énoncé Simple
La première étape de la résolution de tout problème est la lecture attentive et la compréhension de l’énoncé. Ce sous-chapitre vise à développer cette compétence. L’élève apprend à lire l’énoncé plusieurs fois, à identifier les mots-clés et à se représenter mentalement la situation décrite. 📖 L’enseignant l’aide à reformuler le problème avec ses propres mots pour s’assurer qu’il a bien compris le contexte et ce qui se passe dans la petite histoire racontée par l’énoncé. La manipulation d’objets ou la réalisation d’un dessin schématique sont des stratégies encouragées pour faciliter cette phase de compréhension.
12.2. Identifier les Données Utiles et la Question Posée
Une fois l’énoncé compris, l’élève doit apprendre à extraire les informations pertinentes. Il s’entraîne à repérer les nombres présents dans le texte (les données numériques) et à comprendre ce qu’ils représentent. 📌 Il doit également identifier avec précision la question qui est posée, car c’est elle qui guide toute la recherche de la solution. L’enseignant l’habitue à surligner les données et à encadrer la question pour matérialiser ce repérage. Distinguer les informations utiles des informations superflues (parfois présentes dans des problèmes plus complexes) est une compétence clé du raisonnement.
12.3. Choisir la Bonne Opération ou la Bonne Stratégie
C’est le cœur du raisonnement mathématique. L’élève doit faire le lien entre la situation décrite dans le problème et l’opération mathématique qui permet de la modéliser. 🤔 Il apprend à se poser les bonnes questions : « Est-ce que je dois ajouter des choses ? Enlever ? Partager ? Répéter la même quantité ? ». Il choisit l’opération (addition, soustraction, etc.) qui correspond à l’action de l’énoncé. Pour les problèmes qui ne se résolvent pas par une simple opération, il apprend à utiliser d’autres stratégies comme le dessin, le schéma ou l’essai-erreur.
12.4. Effectuer le Calcul et Formuler une Phrase-Réponse
La dernière étape consiste à effectuer le calcul choisi et à présenter le résultat de manière compréhensible. L’élève pose et effectue l’opération, en utilisant les techniques qu’il a apprises. ✅ Après avoir trouvé le résultat numérique, il doit apprendre à ne pas s’arrêter là. Il doit formuler une phrase-réponse qui reprend les mots de la question et donne un sens concret au résultat. Par exemple, à la question « Combien de mangues reste-t-il ? », la réponse n’est pas juste « 4 », mais « Il reste 4 mangues. ». Cette dernière étape assure que l’élève a bien fait le lien entre le monde mathématique et la situation de départ.
ANNEXES
1. Grille d’Évaluation des Compétences
Cette section met à la disposition de l’enseignant un outil d’évaluation formative structuré pour suivre l’évolution des compétences mathématiques de chaque élève. La grille est organisée autour des grands domaines du programme (Numération, Opérations, Grandeurs, Géométrie, Résolution de problèmes). ✅ Pour chaque domaine, des indicateurs observables précis sont listés, par exemple, pour la numération : « Dénombre une collection jusqu’à 100 sans erreur », « Compare deux nombres à deux chiffres en utilisant le bon signe », « Écrit correctement les nombres dictés ». Cet instrument permet à l’enseignant de porter un regard analytique sur les acquis de ses élèves, d’identifier les obstacles spécifiques et de mettre en place des activités de remédiation ciblées.
2. Banque de Situations-Problèmes Contextualisées
Pour ancrer l’enseignement des mathématiques dans la réalité congolaise, cette annexe propose une série de situations-problèmes adaptées au vécu des enfants des différentes provinces. 🇨🇩 On y trouvera, par exemple, un problème sur le calcul de la superficie d’un petit champ de manioc dans le Kwilu en utilisant le pavage, un problème sur la gestion de la monnaie lors d’un achat au marché de la Liberté à Masina (Kinshasa), un problème de partage des poissons après une pêche sur le lac Tanganyika, ou encore un problème de mesure de longueur pour la construction d’une petite case. Ces énoncés variés visent à donner du sens aux concepts mathématiques et à développer la capacité des élèves à les appliquer dans des contextes authentiques.
3. Guide pour la Fabrication de Matériel Didactique Local
Conformément à l’approche pédagogique concrète du programme, cette section offre un guide pratique pour la fabrication de matériel didactique à faible coût, en utilisant des matériaux de récupération et des ressources locales. 🛠️ Il contient des fiches techniques pour réaliser, par exemple, une balance à plateaux avec du bois et des boîtes de conserve, du matériel de numération (dizaines et unités) avec des bouchons et des bâtonnets, des figures géométriques en carton, ou une horloge mobile pour l’apprentissage de l’heure. Ce guide a pour but de rendre chaque enseignant autonome dans la création de ses propres outils pédagogiques, favorisant ainsi une pédagogie active et manipulatoire même dans des conditions matérielles modestes.
4. Progression Annuelle Indicative
Afin d’aider l’enseignant à planifier son enseignement sur l’ensemble de l’année scolaire, une proposition de répartition des matières est fournie. Cette progression est indicative et doit être adaptée au rythme d’apprentissage réel de la classe. 📈 Elle organise les chapitres du programme en une séquence logique, en suggérant une chronologie et un dosage équilibré des différents domaines (Numération, Géométrie, etc.) au fil des trimestres. Elle veille à l’articulation entre les notions et à une révision régulière des acquis. Cet outil de planification a pour objectif d’assurer une couverture complète et cohérente du programme national sur les deux années du degré élémentaire.


