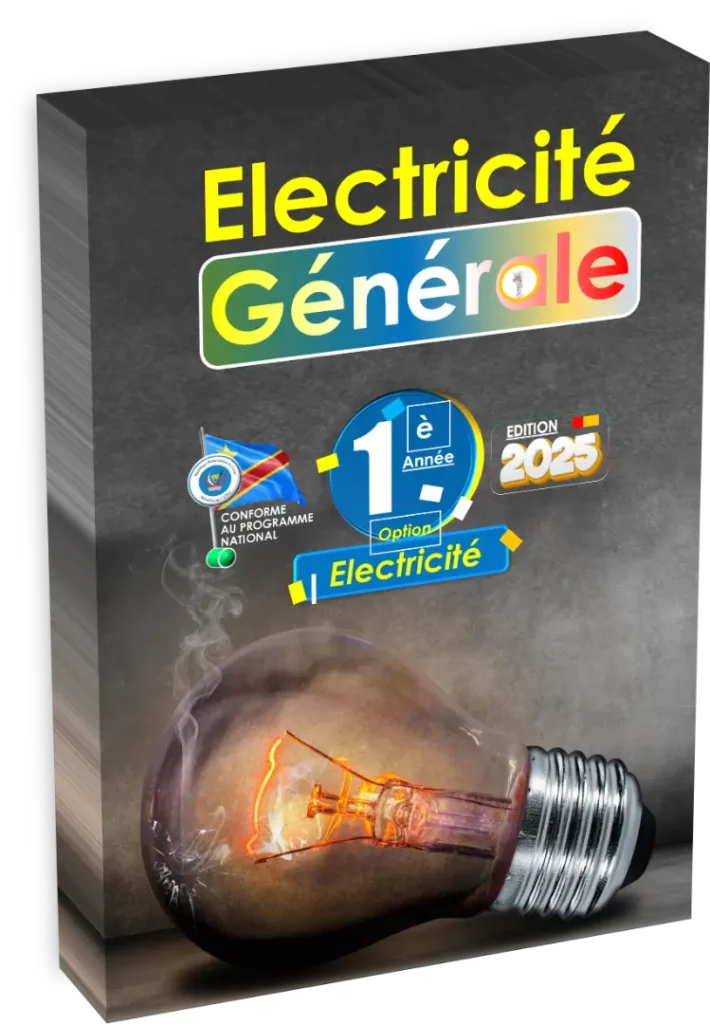
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
PRÉLIMINAIRES
1. Objectifs Généraux du Cours 🎯
Ce cours fondamental a pour mission de construire le socle de connaissances sur lequel reposera toute la formation du technicien électricien. L’objectif est de permettre à l’élève de maîtriser les lois physiques qui gouvernent les phénomènes électriques en courant continu, depuis l’échelle atomique jusqu’aux circuits complexes. À l’issue de ce module, l’apprenant doit être capable d’identifier les grandeurs électriques fondamentales, d’analyser un circuit simple, de comprendre l’interaction entre électricité et magnétisme, et de reconnaître les principaux effets et sources de l’énergie électrique.
2. Approche Pédagogique Recommandée 🧑🏫
Une pédagogie active, centrée sur l’expérimentation, est indispensable pour ce cours. Chaque loi ou principe théorique doit être précédé ou suivi d’une manipulation en laboratoire pour en vérifier la validité et en saisir la portée concrète. L’enseignant doit s’efforcer de contextualiser chaque notion en utilisant des exemples tirés de l’environnement socio-économique congolais : l’analyse d’un circuit de charge de téléphone dans un petit commerce à Matadi, le calcul de la résistance d’un bobinage de moteur utilisé dans une minoterie à Kikwit, ou la compréhension des batteries au plomb pour un système d’éclairage solaire dans le Grand Kasaï. La résolution de problèmes pratiques et le développement du raisonnement logique doivent primer sur la mémorisation de formules.
3. Prérequis du Cours 📚
L’élève doit posséder des compétences solides en mathématiques, notamment en algèbre élémentaire pour la manipulation des équations. Une compréhension des notions de base en physique, telles que la force, le travail et l’énergie, facilitera l’assimilation des concepts d’énergie et de puissance électriques. La familiarité avec le Système International d’unités est également essentielle.
PARTIE 1 : PHÉNOMÈNES FONDAMENTAUX ET GRANDEURS ÉLECTRIQUES
Cette première partie établit les bases conceptuelles de l’électricité. Elle part de la structure microscopique de la matière pour expliquer la nature de la charge électrique et explore les phénomènes d’interaction entre charges immobiles (électrostatique). Elle définit ensuite les grandeurs fondamentales qui décrivent le mouvement de ces charges dans un circuit.
Chapitre 1 : La Nature Électrique de la Matière
1.1. Structure de l’Atome et Charge Électrique
Ce sous-chapitre explore la constitution de l’atome (protons, neutrons, électrons) pour introduire la notion de charge électrique comme une propriété fondamentale de la matière. La quantification de la charge, avec le Coulomb (C) comme unité, et la charge élémentaire de l’électron sont définies.
1.2. Conducteurs, Isolants et Semi-conducteurs
Une classification des matériaux selon leur capacité à laisser circuler les charges électriques est établie. Cette distinction est expliquée par la disponibilité des électrons libres dans la structure atomique de chaque matériau, illustrant pourquoi le cuivre est utilisé pour les câbles et le plastique pour les gaines.
1.3. L’Électrisation des Corps
Les trois méthodes d’électrisation (par frottement, par contact et par influence) sont décrites et expliquées par le transfert ou la redistribution des électrons. Des expériences simples avec des matériaux courants permettent d’illustrer concrètement ces phénomènes.
1.4. Loi de Coulomb
La loi fondamentale de l’électrostatique est énoncée, quantifiant la force d’attraction ou de répulsion entre deux charges ponctuelles. Des exercices d’application permettent de calculer cette force et de comprendre son influence en fonction de la distance et de la quantité de charge.
Chapitre 2 : Le Circuit Électrique et ses Grandeurs
2.1. Le Circuit Électrique Simple
Les composants essentiels d’un circuit électrique (générateur, récepteur, conducteurs, interrupteur) sont identifiés. La nécessité d’une boucle fermée pour permettre la circulation du courant est établie comme un principe de base.
2.2. L’Intensité du Courant Électrique
L’intensité du courant est définie comme le débit de charges électriques à travers une section du conducteur, mesurée en Ampères (A). Le sens conventionnel du courant (du + vers le -) est distingué du sens réel de déplacement des électrons, une convention cruciale pour l’analyse de circuits.
2.3. La Tension Électrique ou Différence de Potentiel
La tension est présentée comme la « force » qui pousse les charges à se déplacer, représentant une différence d’état électrique entre deux points d’un circuit. Son unité, le Volt (V), est définie, et la mesure de la tension aux bornes des composants est expliquée.
2.4. La Résistance Électrique
La résistance est introduite comme la propriété d’un matériau à s’opposer au passage du courant électrique, mesurée en Ohms (Ω). Le concept de résistance est illustré par l’analogie hydraulique et son rôle dans la limitation du courant et la conversion d’énergie est souligné.
PARTIE 2 : LOIS ET ANALYSE DES CIRCUITS EN COURANT CONTINU
Cette section est consacrée à l’étude des outils mathématiques et des lois qui permettent d’analyser et de prédire le comportement des circuits en courant continu. La maîtrise de ces lois est une compétence opérationnelle indispensable pour tout technicien.
Chapitre 3 : La Loi d’Ohm et la Loi de Pouillet
3.1. Énoncé et Vérification Expérimentale de la Loi d’Ohm
La relation de proportionnalité entre la tension, l’intensité et la résistance () pour un récepteur passif est formulée. Un protocole expérimental simple est proposé pour tracer la caractéristique d’une résistance et vérifier la loi.
3.2. Applications de la Loi d’Ohm
Des exercices concrets montrent comment utiliser la loi d’Ohm pour calculer l’une des trois grandeurs connaissant les deux autres. Les applications pratiques incluent le calcul du courant dans un appareil, la tension nécessaire pour l’alimenter, ou la valeur de résistance requise dans un montage.
3.3. La Loi de Pouillet
La résistance d’un fil conducteur est étudiée en fonction de ses caractéristiques physiques. La loi de Pouillet () est introduite, reliant la résistance à la résistivité du matériau (), à sa longueur (L) et à sa section (S).
3.4. Influence de la Température sur la Résistance
L’effet de la température sur la résistivité des conducteurs métalliques est analysé. Le concept de coefficient de température est présenté pour calculer la variation de résistance d’un bobinage de moteur qui s’échauffe lors de son fonctionnement dans une usine textile de Lubumbashi.
Chapitre 4 : Associations de Résistances
4.1. L’Association en Série
Le montage de résistances en série est analysé, où les composants sont traversés par le même courant. La méthode de calcul de la résistance équivalente () est démontrée. Le concept de diviseur de tension est introduit comme une application directe.
4.2. L’Association en Parallèle
Le montage en parallèle, où les composants sont soumis à la même tension, est étudié. La formule de calcul de la résistance équivalente () est établie. Le principe du diviseur de courant est expliqué.
4.3. Associations Mixtes
Des circuits plus complexes combinant des branches en série et en parallèle sont analysés. Une méthodologie de résolution par réduction successive du circuit à sa résistance équivalente unique est développée à travers des exercices progressifs.
4.4. Lois de Kirchhoff (Introduction)
Pour l’analyse de circuits plus complexes (multi-mailles), une introduction aux lois de Kirchhoff est proposée. La loi des nœuds (conservation du courant) et la loi des mailles (conservation de la tension) sont énoncées comme des outils plus puissants qui seront approfondis ultérieurement.
Chapitre 5 : Énergie et Puissance en Courant Continu
5.1. Le Travail et l’Énergie Électrique
L’énergie électrique est définie comme le travail fourni par les forces électriques pour déplacer les charges dans un circuit (). Son unité, le Joule (J), est présentée, ainsi que l’unité pratique, le kilowatt-heure (kWh), utilisée par la SNEL pour la facturation de la consommation.
5.2. La Puissance Électrique
La puissance, mesurée en Watts (W), est définie comme l’énergie consommée ou fournie par unité de temps (). La distinction entre la puissance générée par une source et la puissance dissipée par un récepteur est clarifiée.
5.3. L’Effet Joule
La conversion de l’énergie électrique en chaleur dans un conducteur résistif est étudiée. La loi de Joule () est établie, expliquant pourquoi les câbles électriques s’échauffent et comment fonctionnent les appareils de chauffage (fers à repasser, chauffe-eau).
5.4. Rendement Énergétique
Le concept de rendement est introduit comme le rapport entre la puissance utile fournie par un appareil et la puissance totale qu’il absorbe. Les pertes, souvent dues à l’effet Joule, sont identifiées, soulignant l’importance de l’efficacité énergétique dans les systèmes électriques.
PARTIE 3 : MAGNÉTISME ET ÉLECTROMAGNÉTISME
Cette partie explore le lien intime et fondamental entre les phénomènes électriques et magnétiques. Elle commence par l’étude des aimants permanents pour ensuite démontrer que tout courant électrique produit un champ magnétique, et réciproquement, qu’un champ magnétique variable peut induire un courant.
Chapitre 6 : Le Magnétisme
6.1. Les Aimants Permanents et leurs Propriétés
Les propriétés des aimants naturels et artificiels sont décrites : existence de deux pôles (Nord et Sud), attraction et répulsion, indivisibilité des pôles. Le concept de champ magnétique est introduit comme la région de l’espace où s’exercent les forces magnétiques.
6.2. Le Champ Magnétique et les Lignes de Champ
Le champ magnétique est visualisé à l’aide de lignes de champ, dont l’orientation (du Nord vers le Sud à l’extérieur de l’aimant) et la densité représentent respectivement la direction et l’intensité du champ. Le spectre magnétique d’un aimant droit et d’un aimant en U est tracé.
6.3. Le Champ Magnétique Terrestre
L’existence du champ magnétique terrestre est présentée, expliquant le fonctionnement de la boussole. La distinction entre les pôles géographiques et les pôles magnétiques de la Terre est précisée.
6.4. Le Flux Magnétique
Le flux magnétique (), mesuré en Webers (Wb), est défini comme une grandeur qui quantifie le « nombre de lignes de champ » traversant une surface donnée. Cette notion est préparatoire à l’étude de l’induction électromagnétique.
Chapitre 7 : L’Électromagnétisme
7.1. Le Champ Magnétique créé par un Courant
L’expérience d’Oersted est décrite, démontrant qu’un courant électrique génère un champ magnétique. La forme des lignes de champ autour d’un conducteur rectiligne (cercles concentriques) est étudiée, et la règle du tire-bouchon est donnée pour en déterminer le sens.
7.2. Champ Magnétique d’une Bobine (Solénoïde)
Le champ magnétique créé par un enroulement de fil (spire, solénoïde) est analysé. Il est montré qu’un solénoïde se comporte comme un aimant droit, avec un champ intense et quasi uniforme à l’intérieur, dont l’intensité est proportionnelle au courant et au nombre de spires.
7.3. Force Électromagnétique (Force de Laplace)
L’action d’un champ magnétique sur un conducteur parcouru par un courant est étudiée. La force de Laplace, perpendiculaire à la fois au courant et au champ, est définie. La règle des trois doigts de la main droite permet de déterminer sa direction, principe de base du fonctionnement des moteurs électriques.
7.4. L’Électro-aimant et ses Applications
Le principe de l’électro-aimant (une bobine enroulée autour d’un noyau de fer doux) est expliqué. Ses applications sont nombreuses et variées : relais, contacteurs, sonnettes, serrures électriques, et puissants dispositifs de levage utilisés dans les ports comme celui de Boma.
Chapitre 8 : L’Induction Électromagnétique
8.1. Découverte du Phénomène d’Induction
Les expériences de Faraday sont présentées, montrant qu’un courant électrique (courant induit) apparaît dans un circuit lorsqu’il est soumis à une variation de flux magnétique. Ce principe révolutionnaire établit qu’on peut créer de l’électricité à partir du magnétisme.
8.2. La Loi de Lenz
La loi de Lenz est énoncée comme une règle qui permet de déterminer le sens du courant induit : il s’oppose, par ses effets, à la cause qui lui a donné naissance. Cette loi est une manifestation du principe de conservation de l’énergie.
8.3. Création d’une Force Électromotrice (f.é.m.) Induite
La variation de flux magnétique crée une tension aux bornes du circuit, appelée force électromotrice (f.é.m.) induite. La loi de Faraday relie la valeur de cette f.é.m. à la rapidité de la variation du flux ().
8.4. Principe de la Dynamo et de l’Alternateur
L’application la plus importante de l’induction est la génération de courant électrique. Le fonctionnement d’un générateur simple (une spire tournant dans un champ magnétique) est expliqué, montrant comment l’énergie mécanique est convertie en énergie électrique, le principe derrière les grandes centrales hydroélectriques d’Inga.
PARTIE 4 : SOURCES CHIMIQUES ET SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Cette dernière partie se concentre sur les sources d’énergie qui convertissent l’énergie chimique en énergie électrique, un pilier de l’alimentation des appareils portables et des systèmes de secours. Elle se conclut par un chapitre essentiel sur la sécurité, une préoccupation de premier ordre pour tout intervenant sur des installations électriques.
Chapitre 9 : Les Générateurs Électrochimiques
9.1. L’Effet Chimique du Courant : L’Électrolyse
Le processus inverse de la pile est étudié : l’électrolyse, où un courant électrique provoque une réaction chimique. Le principe de la décomposition de l’eau ou du dépôt de métal (cuivrage) est expliqué, avec des applications industrielles importantes dans le secteur minier du Katanga.
9.2. Les Piles Électriques
Le fonctionnement d’une pile (ex: Leclanché) est décrit comme une conversion d’énergie chimique en énergie électrique via une réaction d’oxydo-réduction. Les grandeurs caractéristiques (f.é.m., résistance interne, capacité) sont définies.
9.3. Les Accumulateurs
La différence entre une pile (non rechargeable) et un accumulateur (rechargeable) est établie. L’étude de l’accumulateur au plomb (utilisé dans les véhicules) est détaillée, en décrivant les réactions chimiques lors de la charge et de la décharge et l’importance du contrôle de la densité de l’électrolyte.
9.4. Association de Générateurs
Les montages de piles ou d’accumulateurs en série (pour augmenter la tension) et en parallèle (pour augmenter la capacité et le courant disponible) sont analysés. Les formules pour calculer la f.é.m. et la résistance interne du générateur équivalent sont établies.
Chapitre 10 : Sécurité et Prévention des Risques Électriques
10.1. Les Dangers du Courant Électrique
Les effets du courant électrique sur le corps humain (tétanisation, brûlures, fibrillation cardiaque) sont décrits en fonction de l’intensité et de la durée de passage. Les seuils de danger sont précisés pour sensibiliser à la gravité du risque.
10.2. Les Contacts Directs et Indirects
La distinction est faite entre le contact direct (avec une partie normalement sous tension) et le contact indirect (avec une masse métallique mise accidentellement sous tension). Des exemples pour chaque cas sont donnés pour une meilleure compréhension du risque.
10.3. La Protection des Personnes
Les dispositifs de protection contre les chocs électriques sont présentés. L’importance de l’isolation, de la mise à la terre des masses métalliques et de l’utilisation de disjoncteurs différentiels est expliquée comme un ensemble de mesures complémentaires et indispensables.
10.4. La Protection des Biens : Surcharges et Courts-circuits
La protection des installations contre les surintensités est abordée. Le rôle des fusibles et des disjoncteurs magnéto-thermiques pour interrompre le circuit en cas de surcharge ou de court-circuit est détaillé, prévenant ainsi les risques d’incendie.
ANNEXES
Les annexes fournissent des supports de référence essentiels. Elles comprennent un tableau des symboles électriques normalisés pour les schémas, une table de résistivité des principaux matériaux conducteurs, ainsi qu’un guide des premiers secours en cas d’accident électrique. Un lexique définissant les termes techniques majeurs du cours est également inclus pour renforcer la maîtrise du vocabulaire professionnel.



