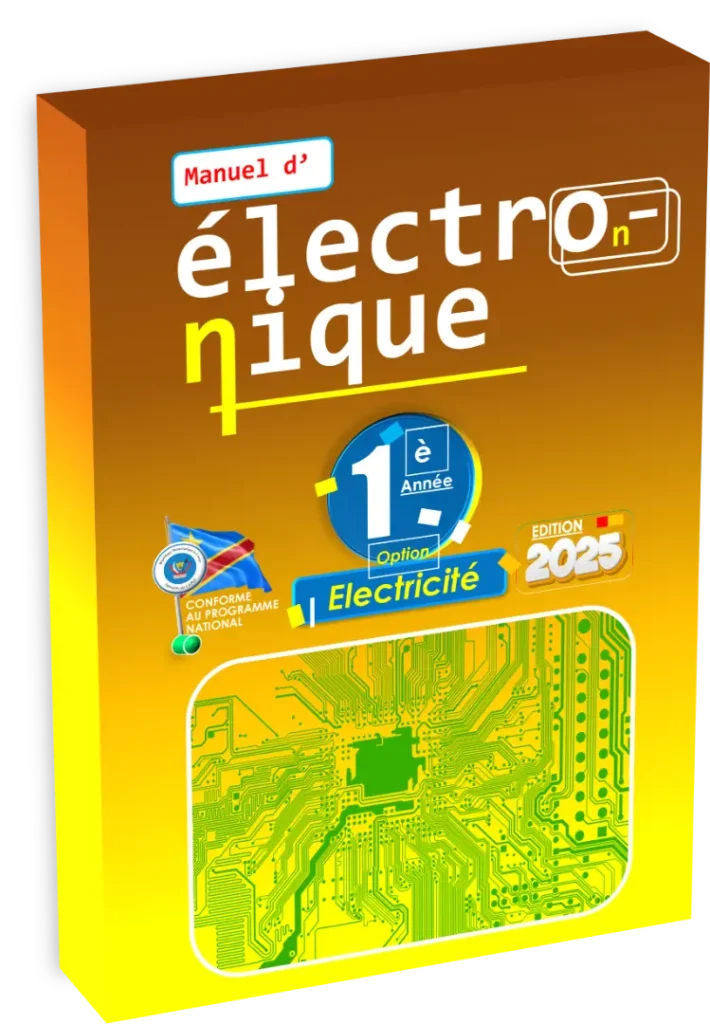
ÉLECTRONIQUE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
PRÉLIMINAIRES
1. Objectifs Généraux du Cours 🎯
Ce module a pour but de doter l’élève technicien des connaissances fondamentales sur les composants électroniques et leurs applications de base. L’objectif est de construire un socle de compétences solides qui prépare l’apprenant à aborder les systèmes électroniques plus complexes des années supérieures. Il s’agit de lui permettre de comprendre le comportement du courant électrique dans les semi-conducteurs, d’identifier les composants actifs et passifs, et de réaliser des montages simples mais fonctionnels. L’accent est mis sur la transition entre l’électricité générale et le contrôle fin du flux d’électrons, caractéristique de l’électronique.
2. Approche Pédagogique Recommandée 🧑🏫
Une approche combinant théorie rigoureuse et pratique intensive est préconisée. Chaque concept théorique doit être immédiatement illustré par des manipulations en laboratoire et des simulations. L’enseignant favorisera une pédagogie active où l’élève est au centre de l’apprentissage, en le confrontant à des problèmes techniques concrets. L’analyse de schémas, le montage de circuits sur plaquettes d’expérimentation (breadboards) et l’utilisation d’appareils de mesure sont au cœur de la démarche. La contextualisation s’appuiera sur des exemples locaux, comme la réparation d’une petite radio à Lubumbashi ou la conception d’un simple chargeur solaire adapté aux réalités de l’électrification rurale dans la province de la Tshuapa.
3. Prérequis du Cours 📚
L’élève doit maîtriser les concepts fondamentaux du cours d’électricité de première année, notamment la loi d’Ohm, les lois de Kirchhoff, ainsi que les notions de tension, de courant et de résistance. Une compréhension de base des circuits en courant continu est indispensable. Des compétences en mathématiques, particulièrement en algèbre élémentaire, sont également requises pour la résolution des équations de circuits.
PARTIE 1 : DES FONDEMENTS DE L’ÉLECTRICITÉ AUX SEMI-CONDUCTEURS
Cette première partie établit le pont entre les connaissances en électricité générale et le domaine spécifique de l’électronique. Elle explore la nature de la matière au niveau atomique pour expliquer les phénomènes de conduction et introduit le concept révolutionnaire des matériaux semi-conducteurs, qui sont à la base de toute la technologie électronique moderne.
Chapitre 1 : Introduction au Monde de l’Électronique
1.1. Nature et Portée de l’Électronique
L’électronique est définie comme la science du contrôle des électrons pour traiter et transmettre l’information ou l’énergie. Ce sous-chapitre explore la distinction fondamentale avec l’électrotechnique, en se concentrant sur les faibles courants et tensions utilisés pour la commande et le traitement du signal. Des exemples concrets, allant du simple poste de radio à l’ordinateur, illustrent l’omniprésence de l’électronique dans la vie quotidienne à travers la RDC.
1.2. L’Électron et la Structure de la Matière
Un rappel approfondi de la structure de l’atome est effectué, en insistant sur le rôle des électrons de valence dans les liaisons chimiques et la conduction électrique. La théorie des bandes d’énergie est introduite de manière qualitative pour expliquer visuellement pourquoi certains matériaux conduisent l’électricité et d’autres non.
1.3. Courants et Tensions en Électronique
Ce point précise les ordres de grandeur des courants (milliampères, microampères) et des tensions (souvent inférieures à 24V) typiquement rencontrés en électronique. La notion de courant conventionnel et de sens de déplacement des électrons est solidifiée pour éviter toute confusion dans l’analyse des circuits à venir.
1.4. Aperçu Historique et Évolution
Une brève chronologie retrace les grandes étapes de l’électronique, depuis la découverte de l’électron, l’invention du tube à vide, jusqu’à la révolution du transistor et l’avènement du circuit intégré. L’impact de cette évolution sur la société est souligné, en projetant ses implications pour le développement technologique en Afrique et en RDC.
Chapitre 2 : Les Matériaux de l’Électronique
2.1. Les Conducteurs
Les propriétés des matériaux conducteurs comme le cuivre et l’aluminium sont revues sous l’angle de la structure atomique et de la bande de conduction. Leur rôle dans la connexion des composants électroniques est mis en évidence, en insistant sur les limitations comme la résistance et l’effet Joule à petite échelle.
2.2. Les Isolants
L’étude des isolants (plastique, céramique, verre) se concentre sur leur bande d’énergie interdite très large, qui empêche le flux d’électrons. Leur fonction essentielle dans la prévention des courts-circuits et la sécurité des montages électroniques est expliquée à travers des exemples pratiques.
2.3. Les Semi-conducteurs Intrinsèques
Le silicium (Si) et le germanium (Ge) sont présentés comme les matériaux fondamentaux de l’électronique. Leur structure cristalline et leur comportement électrique à mi-chemin entre les conducteurs et les isolants sont détaillés. Le concept de paires électron-trou comme porteurs de charge est introduit.
2.4. Le Dopage des Semi-conducteurs
Le processus de dopage est expliqué comme l’introduction contrôlée d’impuretés pour modifier les propriétés électriques des semi-conducteurs. La création de semi-conducteurs de type N (excès d’électrons) par dopage avec des atomes pentavalents et de type P (excès de trous) avec des atomes trivalents est rigoureusement décrite.
Chapitre 3 : Le Signal Électronique et ses Formes
3.1. Définition et Nature d’un Signal
Un signal est défini comme une grandeur physique (généralement une tension ou un courant) qui varie dans le temps pour transporter une information. Des exemples variés sont analysés, tels que le signal audio d’un microphone ou le signal vidéo d’une caméra.
3.2. Le Signal Analogique
Le signal analogique est caractérisé par une variation continue de son amplitude dans le temps, pouvant prendre une infinité de valeurs. Sa représentation graphique (sinusoïde, signal triangulaire) et ses grandeurs caractéristiques (amplitude, période, fréquence) sont étudiées en détail.
3.3. Le Signal Numérique
Le signal numérique est présenté comme une succession de valeurs discrètes, généralement deux niveaux logiques (0 et 1). La supériorité du numérique en termes de résistance au bruit et de facilité de traitement est expliquée, justifiant sa domination dans les technologies modernes.
3.4. Conversion Analogique-Numérique et Numérique-Analogique
Le besoin de convertir les signaux du monde réel (analogiques) en un format traitable par les machines (numérique) est établi. Le principe de l’échantillonnage, de la quantification et du codage est introduit de manière conceptuelle, posant les bases pour des études futures.
PARTIE 2 : LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES FONDAMENTAUX
Cette section constitue le cœur du cours. Elle dissèque les composants qui forment la base de tous les circuits électroniques. L’étude se concentre sur leur structure, leur principe de fonctionnement, leur symbole, et leurs applications les plus directes, en commençant par la diode puis en abordant le transistor, la pierre angulaire de l’électronique.
Chapitre 4 : La Diode à Jonction P-N
4.1. Constitution de la Jonction P-N
La formation d’une jonction en mettant en contact un semi-conducteur de type P et un de type N est décrite. Le phénomène de diffusion des porteurs majoritaires crée une « zone de déplétion » et une barrière de potentiel, dont le rôle est crucial pour le fonctionnement de la diode.
4.2. Polarisation de la Diode
Le comportement de la diode est analysé sous deux régimes. En polarisation directe (positif sur l’anode, négatif sur la cathode), la barrière de potentiel est réduite et le courant passe. En polarisation inverse, la barrière est renforcée et le courant est quasiment bloqué, faisant de la diode un interrupteur unidirectionnel.
4.3. Caractéristique Tension-Courant
La courbe caractéristique de la diode est tracée et analysée. Les concepts de tension de seuil (environ 0,7V pour le silicium), de courant de fuite en inverse et de tension de claquage sont définis. L’utilisation de cette courbe pour prédire le comportement de la diode dans un circuit est démontrée.
4.4. Modèles de la Diode et Diodes Spéciales
Pour simplifier l’analyse des circuits, des modèles de la diode sont introduits : la diode idéale (interrupteur parfait) et le modèle avec tension de seuil. Un aperçu des diodes spéciales comme la diode Zener (pour la régulation), la LED (pour l’éclairage) et la photodiode (pour la détection de lumière) est donné.
Chapitre 5 : Applications Typiques de la Diode
5.1. Le Redressement Mono-alternance
Le circuit le plus simple utilisant une diode pour convertir un courant alternatif en courant continu pulsé est étudié. Le montage, le chronogramme des tensions et le calcul de la valeur moyenne de la tension de sortie sont détaillés. Un cas pratique pourrait être la conception d’une alimentation très simple pour un projet scolaire à Kananga.
5.2. Le Redressement Double-alternance
Deux montages plus efficaces sont présentés : le redresseur avec transformateur à point milieu et le pont de Graetz (pont de diodes). L’avantage d’utiliser les deux alternances du signal d’entrée pour obtenir une tension de sortie de meilleure qualité et de valeur moyenne plus élevée est démontré.
5.3. Le Filtrage par Condensateur
Pour lisser la tension redressée et se rapprocher d’un courant continu stable, un condensateur est ajouté en parallèle de la charge. Son rôle de « réservoir d’énergie » qui se charge pendant les pics et se décharge lentement est expliqué. Le concept de « taux d’ondulation » est introduit pour quantifier la qualité du filtrage.
5.4. Circuits de Protection et de Découpage
L’utilisation de diodes pour protéger des circuits contre les inversions de polarité est illustrée. Les circuits « écrêteurs » ou « clippers », qui permettent de limiter l’amplitude d’un signal à une valeur définie, sont également étudiés comme une application fondamentale.
Chapitre 6 : Le Transistor à Jonction Bipolaire (BJT)
6.1. Structure et Types de Transistors BJT
Le transistor BJT est présenté comme une structure à trois couches de semi-conducteurs dopés, formant deux jonctions P-N. Les deux types, NPN et PNP, sont décrits, avec leurs symboles respectifs. Les trois bornes (Émetteur, Base, Collecteur) et leurs rôles sont définis.
6.2. Principe de Fonctionnement
Le mécanisme fondamental du transistor est expliqué : un petit courant injecté dans la base () contrôle un courant beaucoup plus grand circulant entre le collecteur et l’émetteur (). Cette « amplification de courant », caractérisée par le gain (ou ), est le concept clé à maîtriser.
6.3. Réseaux de Caractéristiques
Les deux principaux réseaux de courbes sont analysés. Le réseau d’entrée ( en fonction de ) montre que la jonction base-émetteur se comporte comme une diode. Le réseau de sortie ( en fonction de pour différents ) permet de visualiser les zones de fonctionnement du transistor.
6.4. Droite de Charge et Point de Repos
Pour analyser un circuit à transistor, la droite de charge est tracée sur le réseau de caractéristiques de sortie. L’intersection de cette droite avec la courbe correspondant au courant de base définit le « point de repos » ou « point de polarisation » (Q-point), qui détermine l’état du transistor en l’absence de signal.
Chapitre 7 : Le Transistor en Régime de Commutation
7.1. Le Transistor comme Interrupteur
Le fonctionnement du transistor dans ses deux états extrêmes est exploré. En l’absence de courant de base (régime de blocage), il se comporte comme un interrupteur ouvert. Avec un fort courant de base (régime de saturation), il agit comme un interrupteur fermé, permettant de commander des charges de puissance.
7.2. Région de Blocage
L’analyse détaillée du régime de blocage () montre que le courant de collecteur est quasi nul () et que la tension est maximale, égale à la tension d’alimentation. Le transistor isole la charge de l’alimentation.
7.3. Région de Saturation
L’analyse du régime de saturation montre que pour un courant de base suffisant, le courant de collecteur atteint son maximum, limité uniquement par le circuit externe. La tension devient très faible (), connectant efficacement la charge à la masse.
7.4. Application : Commande d’un Relais ou d’une LED
Un montage pratique est étudié où un transistor est utilisé pour commander un relais électromécanique à partir d’un signal de faible puissance. L’importance de la diode de « roue libre » pour protéger le transistor des surtensions lors de la coupure du relais est soulignée, un enjeu critique dans la maintenance des automates industriels de la Gecamines à Likasi.
PARTIE 3 : MISE EN ŒUVRE ET MESURES EN ÉLECTRONIQUE
Cette dernière partie vise à rendre les connaissances opérationnelles. Elle initie l’élève aux circuits intégrés les plus simples, aborde la conception d’une alimentation complète et, surtout, développe les compétences pratiques essentielles liées à l’utilisation des instruments de mesure et au respect des normes de sécurité.
Chapitre 8 : Introduction aux Circuits Logiques
8.1. Le Concept de Logique Binaire
La logique de Boole est introduite comme un outil mathématique utilisant deux états (VRAI/FAUX ou 1/0) pour décrire des opérations logiques. Ce système est la base de tous les circuits numériques et ordinateurs.
8.2. La Porte Logique NON (Inverseur)
La fonction logique la plus simple est l’inversion. Sa table de vérité est établie, et un circuit de base réalisant cette fonction à l’aide d’un transistor en commutation est analysé pour faire le lien avec les chapitres précédents.
8.3. Les Portes Logiques ET (AND) et OU (OR)
Les fonctions ET (la sortie est à 1 si et seulement si toutes les entrées sont à 1) et OU (la sortie est à 1 si au moins une entrée est à 1) sont définies par leurs tables de vérité et leurs symboles. De petites applications, comme un système d’alarme simple, sont proposées.
8.4. Familles de Circuits Intégrés Logiques
Une introduction aux circuits intégrés (CI) est faite, en expliquant qu’ils contiennent des milliers de transistors sur une seule puce de silicium. Les familles TTL et CMOS sont brièvement présentées, avec leurs niveaux de tension respectifs et leurs brochages typiques.
Chapitre 9 : L’Alimentation Continue Stabilisée
9.1. Chaîne Complète d’une Alimentation
La structure complète d’une alimentation linéaire est décomposée en quatre blocs fonctionnels : la transformation (abaissement de la tension secteur), le redressement (conversion AC/DC), le filtrage (lissage) et la régulation (stabilisation de la tension de sortie).
9.2. Régulation par Diode Zener
Le principe de la régulation de tension « shunt » à l’aide d’une diode Zener est détaillé. Le calcul de la résistance de limitation de courant est expliqué pour garantir que la Zener fonctionne correctement dans sa zone de claquage inverse.
9.3. Régulation par Transistor et Zener
Pour fournir plus de courant à la charge, un montage « série » utilisant un transistor « ballast » commandé par une diode Zener est étudié. Le transistor absorbe les variations de tension, offrant une meilleure performance. Ce type de montage est courant dans les petits appareils électroniques.
9.4. Les Régulateurs de Tension Intégrés
Les régulateurs intégrés de la série 78xx (pour les tensions positives) et 79xx (négatives) sont présentés comme une solution simple, robuste et économique pour obtenir une tension de sortie fixe et stable. Leur facilité de mise en œuvre est démontrée par un schéma de câblage type.
Chapitre 10 : Instruments de Mesure et Dépannage
10.1. Le Multimètre : Fonctions et Utilisation
L’utilisation correcte du multimètre numérique est une compétence fondamentale. Les mesures de tension continue et alternative, de courant (en insérant l’appareil en série) et de résistance (circuit hors tension) sont expliquées pas à pas, avec les précautions d’usage pour ne pas endommager l’appareil ou le circuit.
10.2. Initiation à l’Oscilloscope
L’oscilloscope est présenté comme « les yeux » de l’électronicien, permettant de visualiser la forme d’un signal en fonction du temps. Les réglages de base (base de temps, calibre vertical, couplage AC/DC) sont expliqués pour permettre la mesure de l’amplitude et de la fréquence d’un signal.
10.3. Le Générateur de Basses Fréquences (GBF)
Le GBF est l’outil qui permet de créer des signaux de test (sinusoïdal, carré, triangulaire) pour les injecter dans un circuit et analyser sa réponse. Son utilisation en tandem avec l’oscilloscope est la base de l’expérimentation en électronique.
10.4. Méthodologie de Base du Dépannage
Une approche systématique du dépannage est enseignée : inspection visuelle, vérification des alimentations, suivi du signal, tests de composants. Cette logique permet de localiser une panne de manière efficace, que ce soit sur un circuit à Kinshasa ou dans un atelier à Bukavu.
Chapitre 11 : Sécurité et Bonnes Pratiques d’Atelier
11.1. Les Risques du Courant Électrique
Un rappel sur les dangers du courant électrique pour le corps humain est effectué, en précisant les seuils de dangerosité en termes de courant et les effets physiologiques. Les règles de sécurité de base (travailler hors tension, utiliser des outils isolés) sont martelées.
11.2. Protection des Composants Électroniques
La sensibilité de nombreux composants, notamment les circuits intégrés CMOS, aux décharges électrostatiques (ESD) est expliquée. L’utilisation de bracelets antistatiques et de tapis de travail spécifiques est présentée comme une bonne pratique indispensable.
11.3. Techniques de Soudage et de Dessoudage
La réalisation d’une soudure de qualité (« brillante et lisse ») sur circuit imprimé est enseignée comme un savoir-faire essentiel. Le choix du fer à souder, de l’étain et les techniques pour ne pas surchauffer les composants sont détaillés, ainsi que l’utilisation de la tresse à dessouder.
11.4. Lecture de Schémas et de Fiches Techniques (Datasheets)
La capacité à lire et interpréter un schéma électronique normalisé est développée. L’importance de consulter la fiche technique (datasheet) d’un composant pour connaître ses caractéristiques exactes, son brochage et ses limites d’utilisation est mise en avant comme un réflexe professionnel.
ANNEXES
Les annexes fournissent des outils de référence rapides pour l’élève et l’enseignant. Elles incluent un tableau complet des symboles normalisés pour tous les composants étudiés, des exemples de fiches techniques (datasheets) de composants courants comme la diode 1N4007 et le transistor BC547, ainsi qu’un lexique définissant les termes techniques clés du cours pour faciliter la compréhension et la mémorisation.



