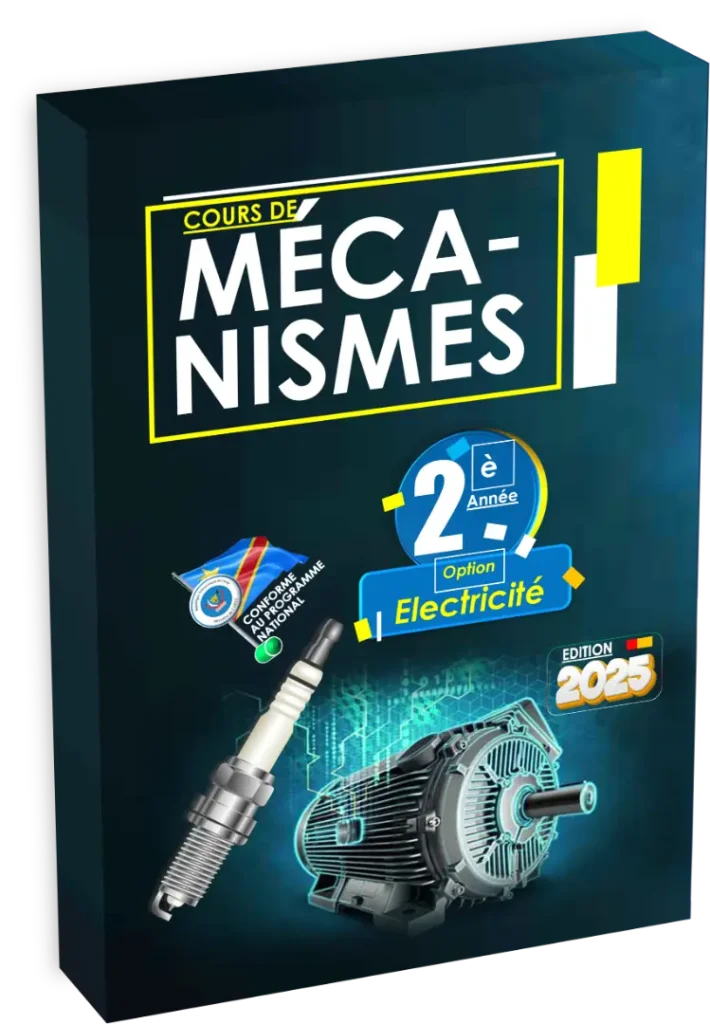
MÉCANISMES, 2ÈME ANNÉE, OPTION ÉLECTRICITÉ
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
PRÉLIMINAIRES
1. Objectifs Généraux du Cours 🎯
Ce cours a pour objectif de fournir à l’élève électricien une compréhension approfondie des dispositifs mécaniques qui transmettent et transforment le mouvement et la puissance. Il s’agit d’appliquer les principes de la cinématique et de la statique à l’analyse de systèmes réels tels que les engrenages, les courroies et les cames. L’ambition est de former un technicien capable de comprendre l’architecture mécanique d’un système électromécanique, d’en analyser le fonctionnement, de calculer les rapports de transmission et de diagnostiquer les pannes d’origine mécanique. Cette compétence est cruciale pour intervenir sur des machines tournantes, des automates industriels ou des systèmes de production d’énergie.
2. Approche Pédagogique Recommandée 🧑🏫
La pédagogie de ce cours sera centrée sur l’analyse de systèmes concrets. Chaque type de mécanisme sera introduit par des maquettes didactiques ou des systèmes réels démontés. L’étude théorique, s’appuyant sur les outils de la cinématique graphique et analytique, visera à modéliser le comportement de ces mécanismes. Des projets d’analyse et de conception simples seront proposés, comme le calcul d’un réducteur de vitesse pour un moteur électrique destiné à un convoyeur à l’aéroport de Ndjili, ou l’étude du mécanisme de commande d’un disjoncteur haute tension. L’enseignant doit constamment lier l’analyse mécanique à la performance du système électrique global (vitesse de rotation du générateur, couple du moteur).
3. Prérequis du Cours 📚
Une maîtrise totale des cours de Mécanique Générale et de Dessin Technique de première année est indispensable. L’élève doit être à l’aise avec l’analyse vectorielle des forces et des vitesses, les principes de la statique, et la lecture de plans techniques. Des compétences solides en trigonométrie et en algèbre sont nécessaires pour l’analyse cinématique et la résolution des problèmes de transmission.
PARTIE 1 : FONDEMENTS DE L’ANALYSE DES MÉCANISMES
Cette partie introductive établit le langage et les outils fondamentaux de la théorie des mécanismes. Elle décompose les systèmes complexes en éléments simples (liaisons et solides) et fournit les méthodes pour analyser leur mobilité et les efforts qu’ils subissent au repos. C’est la grammaire de l’ingénierie mécanique.
Chapitre 1 : Introduction aux Systèmes Mécaniques
1.1. Définition d’un Mécanisme
Un mécanisme est défini comme un assemblage de pièces (solides) reliées entre elles par des liaisons, conçu pour transmettre ou transformer des mouvements et des efforts. Sa fonction principale est de réaliser une tâche mécanique précise.
1.2. Solides, Liaisons et Chaînes Cinématiques
Les concepts de base sont introduits : le solide (pièce supposée indéformable), la liaison (connexion entre deux solides qui supprime certains mouvements relatifs) et la chaîne cinématique (ensemble de solides et de liaisons).
1.3. Les Différents Types de Liaisons Normalisées
Une classification des liaisons mécaniques les plus courantes est présentée à l’aide de leurs symboles normalisés : la liaison pivot (rotation seule), la liaison glissière (translation seule), la liaison pivot-glissant, l’encastrement (aucun mouvement), etc.
1.4. Degrés de Liberté d’un Mécanisme
Le concept de degré de liberté est introduit comme le nombre de paramètres indépendants nécessaires pour décrire la position du mécanisme. Des formules simples sont données pour calculer la mobilité d’une chaîne cinématique plane, permettant de déterminer si un système est mobile, isostatique ou hyperstatique.
Chapitre 2 : Analyse de la Cinématique des Mécanismes
2.1. Le Mouvement de Translation et de Rotation
Les deux mouvements plans de base d’un solide sont définis. La translation (rectiligne ou curviligne) où tous les points ont le même vecteur vitesse, et la rotation autour d’un centre fixe où les vitesses des points sont proportionnelles à leur distance au centre.
2.2. Le Mouvement Plan Général
Le mouvement le plus complexe d’un solide est présenté comme la superposition d’une translation et d’une rotation. Le concept de Centre Instantané de Rotation (CIR) est introduit comme un outil puissant pour l’analyse des vitesses.
2.3. Composition des Vitesses
La loi de composition des vitesses dans un mouvement relatif est étudiée. Elle permet de déterminer la vitesse d’un point dans un repère fixe en connaissant sa vitesse dans un repère mobile et la vitesse du repère mobile lui-même.
2.4. Méthode Graphique de l’Équiprojectivité
La méthode graphique de l’équiprojectivité est enseignée comme un outil simple et visuel pour déterminer le vecteur vitesse de n’importe quel point d’un solide en mouvement plan, connaissant la vitesse d’un autre point et la vitesse de rotation.
Chapitre 3 : Analyse Statique des Forces dans les Liaisons
3.1. Le Principe Fondamental de la Statique (PFS)
Le PFS est rappelé comme l’outil central de l’analyse des efforts : pour qu’un solide soit en équilibre, la somme vectorielle des forces extérieures qui lui sont appliquées doit être nulle, et la somme des moments de ces forces par rapport à un point doit également être nulle.
3.2. L’Isolement d’un Solide
La méthodologie de l’isolement est enseignée : pour déterminer les efforts dans une liaison, on « coupe » mentalement le mécanisme à cet endroit et on remplace la liaison par les efforts (forces et/ou couples) qu’elle transmet.
3.3. Modélisation des Actions de Liaison
Chaque type de liaison est modélisé par les efforts qu’il est capable de transmettre. Une liaison pivot peut transmettre une force dans les deux directions, mais pas de couple. Une glissière peut transmettre une force perpendiculaire au mouvement, mais pas de force parallèle (sans frottement).
3.4. Résolution de Problèmes de Statique
La méthode complète est appliquée sur des mécanismes simples (pince, levier articulé) : isolement successif des pièces, application du PFS sur chaque pièce, et résolution du système d’équations pour trouver les efforts inconnus dans les liaisons.
PARTIE 2 : MÉCANISMES DE TRANSMISSION DE ROTATION
Cette section est consacrée à l’étude des mécanismes dont la fonction principale est de transmettre un mouvement de rotation d’un arbre à un autre, en modifiant éventuellement sa vitesse et son couple. Ce sont les composants clés de toutes les chaînes de puissance motorisées.
Chapitre 4 : Transmission par Engrenages Cylindriques
4.1. Principe et Caractéristiques des Engrenages
Le principe de la transmission par obstacle (dents) qui garantit l’absence de glissement est expliqué. Les caractéristiques géométriques d’une denture (module, pas, diamètre primitif) sont définies, constituant le langage de base de l’engrenage.
4.2. Rapport de Transmission et Inversion du Sens
Le rapport de transmission (ou de réduction/multiplication) est calculé à partir du rapport des nombres de dents ou des diamètres primitifs. La règle de l’inversion du sens de rotation pour un engrenage extérieur est établie.
4.3. Condition d’Engrènement et Entraxe
Les conditions pour que deux roues puissent engrener sont précisées (même module). La formule de calcul de l’entraxe (distance entre les axes) est établie à partir des diamètres primitifs.
4.4. Forces et Couple sur la Denture
L’effort transmis par une dent est analysé et décomposé en une composante tangentielle (qui transmet le couple) et une composante radiale (qui charge les axes). Cette analyse est cruciale pour le dimensionnement des arbres et des roulements.
Chapitre 5 : Les Trains d’Engrenages
5.1. Les Trains d’Engrenages Simples
Un train simple est une succession d’engrenages où chaque arbre ne porte qu’une seule roue. Le calcul du rapport de transmission global est expliqué comme étant le produit des rapports de chaque étage.
5.2. Les Trains d’Engrenages Composés
Un train composé utilise des arbres intermédiaires portant plusieurs roues (un pignon et une roue solidaires). Cette configuration permet d’obtenir de grands rapports de réduction dans un faible encombrement, comme dans les boîtes de vitesses ou les réducteurs de moteurs utilisés dans l’industrie brassicole à Boma.
5.3. Le Train Épicycloïdal
Le principe du train épicycloïdal, où des axes de roues (les satellites) tournent autour d’un autre axe (le planétaire), est introduit. Sa capacité à fournir de très grands rapports de réduction et des fonctions complexes (inverseur) est soulignée.
5.4. Formule de Willis
La formule de Willis est présentée comme l’outil analytique permettant de déterminer le rapport de transmission de n’importe quel train épicycloïdal en étudiant les vitesses relatives des différents éléments (planétaires, satellites, porte-satellites).
Chapitre 6 : Transmission par Courroies et Chaînes
6.1. Transmission par Courroies Plates et Trapézoïdales
Le principe de la transmission par adhérence (friction) entre la courroie et les poulies est expliqué. La courroie trapézoïdale est présentée comme une solution plus performante grâce à l’effet de coinçage.
6.2. Rapport de Transmission et Glissement
Le rapport de transmission est calculé à partir du rapport des diamètres des poulies. Le phénomène de glissement, qui entraîne une légère perte de vitesse, est introduit comme une caractéristique de ce type de transmission.
6.3. Avantages et Inconvénients
Les avantages (souplesse, silence, grandes distances entre axes) et les inconvénients (glissement, tension nécessaire, durée de vie limitée) de la transmission par courroie sont discutés, la positionnant comme un choix idéal pour des applications comme l’entraînement d’un alternateur de véhicule.
6.4. Transmission par Chaînes
La transmission par chaîne et pignons est présentée comme une solution combinant les avantages des engrenages (pas de glissement) et des courroies (grandes distances). Elle est très utilisée lorsque des couples importants doivent être transmis, comme sur les machines agricoles dans la plaine de la Ruzizi.
PARTIE 3 : MÉCANISMES DE TRANSFORMATION DE MOUVEMENT
Cette section explore les mécanismes qui réalisent une fonction plus complexe que la simple transmission : la transformation d’un type de mouvement en un autre, par exemple une rotation continue en une translation alternative. Ce sont les briques de base de l’automatisation.
Chapitre 7 : Le Système Bielle-Manivelle
7.1. Description et Rôle des Composants
Le mécanisme est décomposé en ses quatre pièces principales : la manivelle (ou le vilebrequin), la bielle, le piston (ou la crosse) et le bâti. Sa fonction principale est de transformer une rotation continue en une translation alternative, ou inversement.
7.2. Analyse Cinématique
La relation entre la position du piston et l’angle de la manivelle est établie. Les vitesses et accélérations du piston sont analysées, montrant qu’elles ne sont pas sinusoïdales. La méthode du CIR est appliquée pour trouver la vitesse du piston.
7.3. Analyse des Efforts
Les efforts dans le mécanisme (pression des gaz sur le piston, force dans la bielle, couple sur la manivelle) sont analysés. Le concept de « couple résistant » ou « couple moteur » variable au cours d’un cycle est introduit.
7.4. Applications : Moteurs et Compresseurs
Les deux applications majeures sont étudiées. Dans un moteur à combustion, la translation du piston crée la rotation du vilebrequin. Dans un compresseur, la rotation d’un moteur électrique entraîne la translation du piston pour comprimer un fluide.
Chapitre 8 : Les Mécanismes à Cames
8.1. Principe de la Came et du Galet Suiveur
Le principe de la came est expliqué : un profil spécialement conçu, en rotation, impose un mouvement précis à un suiveur (tige, galet). C’est un moyen simple de créer des lois de mouvement complexes et répétitives.
8.2. Diagramme du Mouvement
La loi de mouvement souhaitée pour le suiveur est d’abord représentée sur un diagramme (déplacement en fonction de l’angle de la came). Ce diagramme est la base de la conception du profil de la came.
8.3. Construction du Profil de la Came
Une méthode graphique simple pour tracer le profil de la came à partir du diagramme de mouvement est enseignée, en utilisant le principe de l’inversion cinématique.
8.4. Applications en Électromécanique
Les applications des cames dans le domaine électrique sont illustrées : programmateurs de machines à laver, interrupteurs de position, automates mécaniques, où la came assure la séquence d’ouverture et de fermeture de contacts électriques.
Chapitre 9 : Les Mécanismes à Vis et Écrou
9.1. Principe de la Transformation de Mouvement
Le système vis-écrou est présenté comme un mécanisme qui transforme un mouvement de rotation (de la vis ou de l’écrou) en un mouvement de translation. Le concept de « pas » de la vis est fondamental.
9.2. Réversibilité et Irréversibilité
La condition d’irréversibilité (ou de non-retour) est étudiée en fonction de l’angle d’hélice et du coefficient de frottement. Un mécanisme irréversible peut être utilisé pour des applications de levage sécurisées, comme les crics de voiture.
9.3. Rapport de Réduction et Avantage Mécanique
Le très grand rapport de réduction de ce système est mis en évidence, permettant d’obtenir des forces de translation très importantes à partir de faibles couples de rotation.
9.4. Applications : Actionneurs et Appareils de Levage
Les applications sont nombreuses : actionneurs linéaires pour vannes motorisées, systèmes de positionnement précis sur des machines-outils, et tous les appareils de levage et de serrage (étaux, presses) où la démultiplication de l’effort est recherchée.
PARTIE 4 : ASPECTS PRATIQUES ET SYNTHÈSE
Cette partie finale se concentre sur les aspects technologiques et pratiques qui conditionnent la performance et la durée de vie des mécanismes. Elle se conclut par l’analyse de systèmes complets où plusieurs mécanismes sont combinés pour réaliser une fonction électromécanique.
Chapitre 10 : Frottement, Usure et Lubrification
10.1. Le Frottement dans les Liaisons
Le frottement sec et fluide dans les liaisons pivot et glissière est analysé comme une source de pertes d’énergie (chute de rendement) et d’échauffement. Le calcul des efforts de frottement est abordé.
10.2. Les Paliers Lisses et les Roulements
Pour minimiser le frottement dans les liaisons pivot, deux technologies sont comparées : les paliers lisses (coussinets) et les roulements à billes ou à rouleaux. Le choix de la technologie dépend de la vitesse, de la charge et de la précision requise.
10.3. Le Phénomène d’Usure
Les principaux types d’usure des pièces mécaniques (abrasion, corrosion, fatigue) sont décrits. L’importance du choix des matériaux et des traitements de surface pour augmenter la durée de vie des composants est soulignée.
10.4. Rôle et Choix des Lubrifiants
La lubrification est présentée comme la solution principale pour réduire le frottement et l’usure. Les différents types de lubrifiants (huiles, graisses) et leurs propriétés (viscosité) sont étudiés pour permettre un choix éclairé en fonction de l’application.
Chapitre 11 : Analyse de Systèmes Électromécaniques Combinés
11.1. Chaîne de Puissance d’un Système Motorisé
La structure typique d’une chaîne de puissance est décomposée : moteur électrique (source de puissance), accouplement, réducteur de vitesse (train d’engrenages), et machine réceptrice. L’analyse de la transmission du couple et de la vitesse à travers cette chaîne est effectuée.
11.2. Étude de Cas : Un Treuil Électrique
Un treuil de levage est analysé comme un système complet. L’étude implique le choix du moteur, le calcul du rapport de réduction nécessaire du train d’engrenages, et le dimensionnement du frein de sécurité, une problématique courante dans les installations portuaires de Boma.
11.3. Étude de Cas : Un Aiguillage Électrique
Le mécanisme de commande d’un aiguillage de chemin de fer (comme ceux de la SNCC) est étudié. Il combine un moteur électrique, un réducteur à vis sans fin (irréversible), et un système de bielles et de leviers pour déplacer les rails.
11.4. Introduction à la Maintenance des Mécanismes
Les bases de la maintenance préventive des systèmes mécaniques sont introduites : inspection visuelle, contrôle des niveaux d’huile, graissage périodique, surveillance des bruits et vibrations anormaux, et resserrage des fixations.
ANNEXES
Les annexes fournissent des outils et des données pour l’analyse et la conception. Elles comprennent un catalogue des liaisons normalisées avec leurs degrés de liberté, un formulaire pour le calcul des engrenages, des abaques pour le choix de courroies, et un guide de sélection des lubrifiants. Un glossaire des termes techniques des mécanismes est également inclus.



