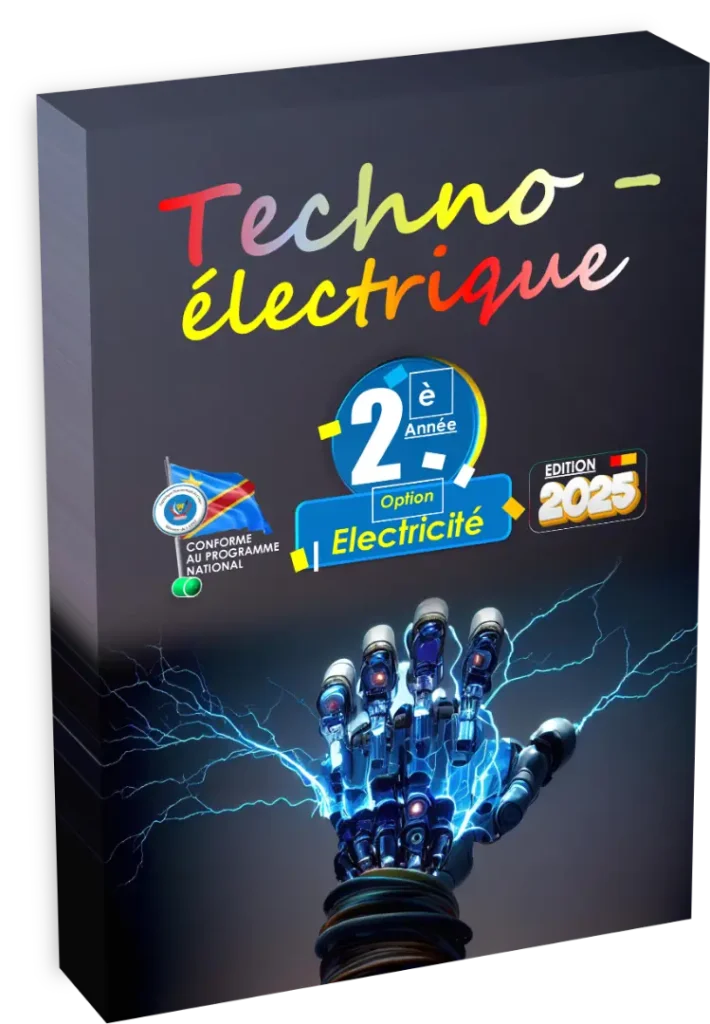
TECHNOLOGIE ÉLECTRIQUE, 2ÈME ANNÉE, OPTION ÉLECTRICITÉ
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
PRÉLIMINAIRES
1. Objectifs Généraux du Cours 🎯
Ce cours de deuxième année a pour but de construire un répertoire technologique solide, permettant à l’élève de comprendre la constitution, le fonctionnement et les critères de choix de l’ensemble des matériaux et appareils d’une installation électrique basse tension. L’objectif est de dépasser la simple reconnaissance des composants pour en maîtriser les principes physiques, les limites d’emploi et les règles de mise en œuvre. Au terme de ce module, l’apprenant doit être capable d’identifier un câble par ses marquages, de choisir le dispositif de protection adéquat pour un circuit, de comprendre la technologie interne d’un interrupteur ou d’une source lumineuse et de maîtriser les techniques d’assemblage permanent.
2. Approche Pédagogique Recommandée 🧑🏫
La pédagogie sera éminemment concrète, basée sur l’observation, le démontage et l’analyse de matériel électrique réel. Chaque composant étudié fera l’objet d’une dissection en atelier pour en examiner la technologie interne. La lecture de catalogues de fabricants et de fiches techniques (datasheets) sera une activité récurrente pour habituer les élèves à rechercher l’information technique. Des manipulations pratiques, comme la réalisation de soudures ou la sélection et le câblage d’appareils sur des panneaux didactiques, renforceront les apprentissages. L’enseignant doit constamment lier la technologie du composant à son usage dans une installation, en s’appuyant sur des cas pratiques, comme le choix d’un disjoncteur pour une boutique à Kisangani ou la réparation d’un appareil de chauffage domestique à Lubumbashi.
3. Prérequis du Cours 📚
Une maîtrise complète du programme de Technologie Électrique de première année est requise, notamment l’outillage de base, les techniques de connexion et la connaissance des conducteurs. L’élève doit également posséder des connaissances solides en Électricité Générale pour comprendre les phénomènes de surintensité, de tension et de puissance qui justifient la technologie des appareils de protection et de commande.
PARTIE 1 : PROCÉDÉS D’ASSEMBLAGE ET DE CONNEXION PERMANENTS
Cette partie est consacrée aux techniques d’assemblage métallique qui requièrent un apport d’énergie important. Ces compétences, bien que relevant de la métallurgie, sont fondamentales pour l’électricien qui doit souvent fabriquer ou réparer des supports, des armoires ou réaliser des connexions de puissance non démontables.
Chapitre 1 : Sécurité et Techniques de Brasage (Tendre et Fort)
1.1. Sécurité lors des Opérations de Chauffe
Les risques spécifiques aux procédés de brasage et de soudage sont identifiés : brûlures, incendie, inhalation de fumées toxiques. Les mesures de prévention sont établies, incluant l’utilisation d’écrans, de gants en cuir, de tabliers et la ventilation adéquate de la zone de travail.
1.2. Le Brasage Tendre à l’Étain
Le principe du brasage tendre, déjà vu en 1ère année, est approfondi. L’accent est mis sur la préparation minutieuse des surfaces et le choix du bon flux décapant comme clés de la réussite. La technique de la « mise à l’étain » préalable des pièces est enseignée pour garantir un mouillage parfait.
1.3. Le Brasage Fort (Brasure)
Le brasage fort est présenté comme un procédé à plus haute température, utilisant des métaux d’apport à base de cuivre ou d’argent, qui offre une résistance mécanique bien supérieure. Il est utilisé pour assembler des pièces de structure ou des canalisations en cuivre.
1.4. Le Soudobrasage au Chalumeau
La technique du soudobrasage, qui permet d’assembler des pièces en acier sans les fondre, est enseignée. Elle utilise un chalumeau oxyacétylénique et une baguette de laiton comme métal d’apport. C’est une méthode polyvalente pour les réparations et les fabrications légères.
Chapitre 2 : Technologie du Soudage à l’Arc Électrique
2.1. Principe du Soudage à l’Arc
Le principe de l’arc électrique, générant une température très élevée (plus de 3000°C) capable de fondre le métal de base et le métal d’apport, est expliqué. La structure d’un poste de soudage (transformateur ou onduleur) est décrite.
2.2. Les Électrodes Enrobées
La double fonction de l’électrode enrobée est détaillée : l’âme métallique sert de métal d’apport, tandis que l’enrobage fond pour créer un laitier protecteur et stabiliser l’arc. Les différents types d’enrobage (rutile, basique) et leur influence sur la soudure sont présentés.
2.3. Mise en Œuvre du Soudage
La procédure complète est enseignée : réglage de l’intensité du poste en fonction du diamètre de l’électrode, amorçage de l’arc, maintien de la bonne longueur d’arc et de la bonne vitesse d’avance pour créer un cordon de soudure régulier.
2.4. Applications pour l’Électricien
Les applications pratiques pour un électricien sont mises en avant : fabrication de supports de chemins de câbles, soudage de pattes de fixation sur des poteaux métalliques, ou réparation de structures métalliques d’armoires électriques, des tâches courantes sur les chantiers de construction à travers la RDC.
PARTIE 2 : FONDEMENTS TECHNOLOGIQUES DE L’ÉLECTRICIEN
Cette section regroupe les connaissances de base transversales qui forment le socle du métier. Elle couvre la science des matériaux utilisés en électricité, la technologie des conducteurs qui transportent l’énergie, et le cadre réglementaire qui garantit la sécurité et la qualité des installations.
Chapitre 3 : Matériaux Conducteurs et Isolants en Électricité
3.1. Approfondissement sur les Conducteurs
Les caractéristiques physiques et électriques du cuivre et de l’aluminium sont comparées en détail (conductivité, masse volumique, résistance à la corrosion, coût). Les problématiques de connexion entre ces deux métaux (couple galvanique) sont abordées.
3.2. Les Isolants Solides
Une revue des isolants solides est effectuée : les polymères (PVC, PE, XLPE) pour les câbles, les céramiques et le verre pour les isolateurs de lignes aériennes, et les matériaux composites pour l’appareillage moderne. Leurs propriétés (rigidité diélectrique, résistance thermique) sont comparées.
3.3. Les Isolants Liquides et Gazeux
L’existence et l’utilisation d’isolants non solides sont présentées. L’huile minérale est étudiée pour son double rôle d’isolant et de fluide de refroidissement dans les transformateurs de puissance. L’air et l’hexafluorure de soufre (SF6) sont présentés comme des isolants gazeux pour l’appareillage haute tension.
3.4. Les Matériaux Magnétiques
Les matériaux ferromagnétiques, essentiels à la construction des machines électriques et transformateurs, sont étudiés. La distinction est faite entre les matériaux magnétiques « doux » (tôles au silicium, pour canaliser le flux) et « durs » (pour les aimants permanents).
Chapitre 4 : Technologie des Fils et Câbles Électriques
4.1. Constitution et Classification
La terminologie précise est établie : fil (conducteur unique), câble (plusieurs fils isolés dans une gaine commune). La distinction entre âme massive et âme souple (câblée) est expliquée en fonction des applications (installations fixes vs. appareils mobiles).
4.2. Désignation Normalisée des Câbles
L’élève apprend à décoder la désignation d’un câble (ex: VVB 3G2.5), qui renseigne sur la nature de l’isolant, le type de gaine, le nombre de conducteurs et leur section. Cette compétence est indispensable pour passer des commandes et vérifier des livraisons.
4.3. Critères de Choix de la Section d’un Câble
Les deux critères principaux qui déterminent la section (surface en mm²) d’un conducteur sont expliqués. Le critère de l’échauffement maximal admissible (courant maximal) et le critère de la chute de tension maximale admissible pour les grandes longueurs.
4.4. Les Câbles Spéciaux
Un aperçu des câbles pour applications spécifiques est donné : câbles armés pour la pose enterrée, câbles résistants au feu pour les installations de sécurité, câbles de communication (coaxial, paires torsadées) et fibre optique.
Chapitre 5 : Normes et Règlements Techniques
5.1. Le Rôle de la Normalisation
L’importance des normes techniques est expliquée. Elles garantissent la sécurité des personnes et des biens, l’interopérabilité des matériels et la qualité des installations.
5.2. Les Organismes de Normalisation
Les principaux organismes sont présentés : la Commission Électrotechnique Internationale (CEI) au niveau mondial, les organismes européens (CENELEC), et l’importance de se référer aux règlements techniques en vigueur en République Démocratique du Congo.
5.3. Le Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE)
Les grands principes du règlement de référence sont introduits. Ce document fixe les règles de l’art pour la conception et la réalisation de toutes les installations électriques afin d’en assurer la sécurité.
5.4. Le Rapport de Contrôle de Conformité
Le rôle des organismes de contrôle agréés est expliqué. L’élève est sensibilisé à la nécessité de faire contrôler une nouvelle installation par un organisme tiers pour obtenir une attestation de conformité avant la mise en service par la société de distribution, une procédure standard à Kinshasa.
PARTIE 3 : TECHNOLOGIE DE L’APPAREILLAGE BASSE TENSION
Cette partie constitue le cœur technologique du cours. Chaque famille d’appareils constituant une installation électrique est disséquée pour en comprendre la construction interne, le principe de fonctionnement, les variantes et les critères de sélection.
Chapitre 6 : Appareillage de Connexion et de Commande Manuelle
6.1. Boîtes de Dérivation et de Jonction
La technologie des boîtes de connexion est étudiée : matériaux (plastique, métal), degrés de protection (IP) contre l’eau et la poussière, et types de borniers de raccordement.
6.2. Prises de Courant et Fiches
Les différents types de prises de courant domestiques et industrielles sont présentés (tension, courant, nombre de pôles). La constitution interne d’une prise, avec ses contacts et sa borne de terre, est examinée.
6.3. Interrupteurs et Boutons-poussoirs
Le mécanisme interne d’un interrupteur est démonté pour analyser son contact mobile et son pouvoir de coupure. La différence technologique entre un interrupteur (contact maintenu) et un bouton-poussoir (contact momentané) est clarifiée.
6.4. Commutateurs et Inverseurs
La technologie des appareils permettant de modifier le chemin du courant est étudiée. Le commutateur va-et-vient est analysé, ainsi que les commutateurs rotatifs utilisés pour les sélections de fonction ou le changement de vitesse de moteurs.
Chapitre 7 : Technologie des Sources Lumineuses
7.1. La Lampe à Incandescence et Halogène
Le principe de l’incandescence (filament de tungstène chauffé à blanc) est expliqué. La technologie de la lampe halogène, qui améliore le rendement et la durée de vie, est présentée.
7.2. Le Tube Fluorescent
Le principe de la décharge dans un gaz à basse pression (vapeur de mercure) créant un rayonnement UV converti en lumière visible par des poudres fluorescentes est détaillé. Le rôle du ballast et du starter dans l’amorçage est expliqué.
7.3. La Lampe Fluocompacte (CFL)
La lampe fluocompacte est présentée comme une miniaturisation du tube fluorescent, intégrant un ballast électronique dans son culot pour un remplacement direct des lampes à incandescence.
7.4. La Diode Électroluminescente (LED)
La technologie des LED, basée sur l’émission de lumière par un semi-conducteur, est introduite comme la source la plus efficace et durable. Son fonctionnement en basse tension continue et la nécessité d’un « driver » électronique pour l’alimenter depuis le secteur sont expliqués.
Chapitre 8 : Appareillage de Protection contre les Surintensités
8.1. Les Cartouches Fusibles
La technologie du fusible est étudiée : un fil calibré conçu pour fondre et couper le circuit en cas de surintensité. Les différents types (gG, aM) et leur rapidité de fusion sont expliqués.
8.2. Le Disjoncteur Magnéto-Thermique
Le disjoncteur est présenté comme un interrupteur réarmable assurant une double protection. Son déclencheur thermique (bilame) protège contre les surcharges, tandis que son déclencheur magnétique (bobine) assure une protection instantanée contre les courts-circuits.
8.3. Courbes de Déclenchement des Disjoncteurs
Les différentes courbes de déclenchement (B, C, D) des disjoncteurs sont expliquées. Le choix de la courbe dépend de l’application : courbe B pour les circuits résistifs, C pour les circuits courants, D pour les circuits à fort appel de courant (moteurs), un critère de choix important pour les installations industrielles de la zone de Maluku.
8.4. Le Sectionneur et l’Interrupteur-Sectionneur
La fonction de sectionnement, qui consiste à isoler visiblement et en toute sécurité un circuit de sa source, est définie. La différence entre un simple sectionneur (qui ne coupe pas en charge) et un interrupteur-sectionneur (qui a un pouvoir de coupure) est clarifiée.
Chapitre 9 : Technologie des Appareils Domestiques
9.1. Les Appareils de Chauffage à Effet Joule
La technologie des appareils basés sur l’effet Joule est étudiée en démontant un fer à repasser ou un réchaud électrique. Les composants clés sont identifiés : la résistance chauffante, le thermostat de régulation (à bilame) et le fusible thermique de sécurité.
9.2. Le Chauffe-eau Électrique à Accumulation
La constitution d’un chauffe-eau est analysée : la cuve, la résistance blindée (« thermoplongeur »), le thermostat de régulation et l’anode en magnésium pour la protection contre la corrosion.
9.3. Les Moteurs Universels dans l’Électroménager
Le moteur universel, capable de fonctionner en alternatif et en continu, est présenté comme le cœur de nombreux appareils électroménagers (aspirateurs, perceuses, mixeurs). Sa technologie (collecteur, balais) est examinée.
9.4. Technologie des Piles et Accumulateurs
Les différentes technologies de générateurs électrochimiques sont comparées : piles salines et alcalines, accumulateurs au plomb (pour les véhicules et onduleurs), et accumulateurs modernes (Ni-MH, Li-Ion) pour l’électronique portable, dont la gestion est un enjeu majeur pour les systèmes hors-réseau dans des provinces comme le Maniema.
ANNEXES
Les annexes regroupent des documents technologiques de référence. Elles contiennent des fiches de synthèse sur les matériaux, des tableaux de choix de câbles et de dispositifs de protection, des extraits de catalogues de fabricants d’appareillage, et des guides de maintenance pour les appareils domestiques courants. Un glossaire des termes technologiques complète cette section.



