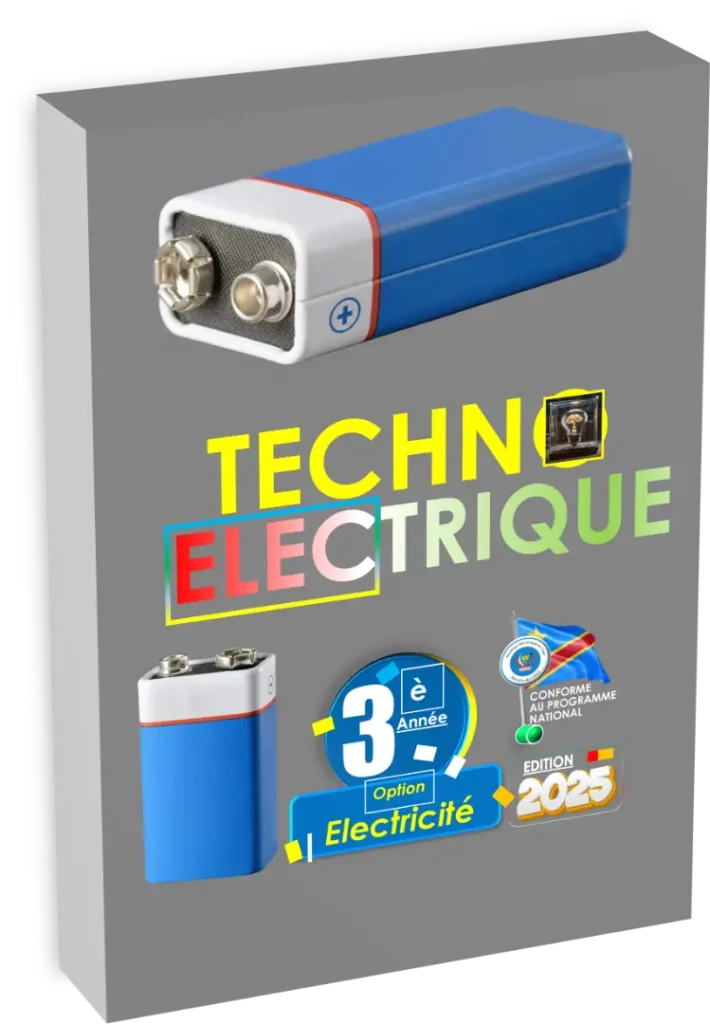
TECHNOLOGIE ÉLECTRIQUE, 3ÈME ANNÉE, OPTION ÉLECTRICITÉ
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
PRÉLIMINAIRES
1. Objectifs Généraux du Cours 🎯
Ce cours de troisième année a pour objectif de faire passer l’élève de la technologie des composants domestiques à celle des équipements et systèmes industriels et de distribution basse tension. L’ambition est de lui faire maîtriser la technologie des appareils de protection, de commande et de signalisation qui constituent le cœur des armoires et tableaux électriques de puissance. Une attention particulière est portée à l’étude approfondie des relais, qui sont la base des automatismes câblés et des logiques de protection. Au terme de ce module, l’apprenant doit être capable de choisir un disjoncteur de puissance, de comprendre le fonctionnement d’un contacteur, d’analyser un circuit de commande à relais et de connaître les règles de mise en œuvre des canalisations de puissance.
2. Approche Pédagogique Recommandée 🧑🏫
La pédagogie de ce cours doit allier l’analyse technologique détaillée à la mise en situation fonctionnelle. Le démontage d’appareillages industriels (disjoncteurs, contacteurs, relais) sera une pratique systématique pour en comprendre la constitution interne. La lecture de schémas de commande complexes et la recherche d’informations dans des catalogues de constructeurs seront des compétences activement développées. Les séances de laboratoire se concentreront sur le câblage et le test de circuits de commande et de protection sur des platines didactiques. L’enseignant doit illustrer chaque concept par des cas d’application concrets, comme l’analyse du système de protection d’un transformateur de quartier à Matadi ou la conception d’un circuit de commande pour une machine-outil dans un atelier de Kinshasa.
3. Prérequis du Cours 📚
Une maîtrise complète des programmes de Technologie et de Schémas Électriques des années précédentes est fondamentale. L’élève doit connaître l’appareillage domestique, savoir lire des schémas de commande de base et comprendre les principes du courant alternatif triphasé. Une aptitude à la logique et à l’analyse systémique est essentielle pour aborder l’étude des relais et des circuits de commande.
PARTIE 1 : TECHNOLOGIE DES INFRASTRUCTURES DE DISTRIBUTION BT
Cette première partie est consacrée à la technologie des « autoroutes de l’énergie » en basse tension. Elle couvre les câbles de puissance, les lignes aériennes et les systèmes de mise à la terre, qui sont les infrastructures physiques garantissant le transport fiable et sécurisé de l’électricité depuis la source jusqu’aux points d’utilisation.
Chapitre 1: Technologie des Lignes Aériennes Basse Tension
1.1. Constitution d’une Ligne Aérienne en Conducteurs Torsadés
La technologie des lignes aériennes BT modernes, utilisant des câbles torsadés autoportants, est étudiée. La composition du faisceau (conducteurs de phase isolés, conducteur neutre porteur) et ses avantages par rapport aux anciennes lignes en conducteurs nus sont analysés.
1.2. Les Supports et Armements
Les différents types de poteaux (bois, béton, métallique) et les armements (consoles, ferrures) qui permettent de fixer et de supporter les lignes sont présentés. Les règles de distance et d’isolement sont précisées.
1.3. Les Isolateurs Basse Tension
La fonction et les matériaux des isolateurs (céramique, verre, composite) utilisés pour fixer les conducteurs aux supports tout en garantissant l’isolement électrique sont étudiés.
1.4. Accessoires de Ligne
Les accessoires indispensables à la construction d’une ligne sont examinés : les pinces d’ancrage pour la terminaison, les pinces de suspension pour le support, et les connecteurs de dérivation pour le raccordement des abonnés, des composants visibles sur tout le réseau de la SNEL.
Chapitre 2: Technologie des Câbles Souterrains et Industriels
2.1. Les Câbles à Isolation Synthétique
La constitution des câbles de puissance souterrains (type VFV, XVB) est détaillée : âmes en cuivre ou en aluminium, isolation en PVC ou XLPE, gaine de protection.
2.2. Les Câbles Armés
Pour les environnements industriels sévères ou la pose en pleine terre, la technologie des câbles armés est présentée. Le rôle de l’armure métallique (feuillard ou fils d’acier) dans la protection mécanique du câble est expliqué.
2.3. Les Boîtes de Jonction et de Dérivation Souterraines
Les techniques pour réaliser des connexions fiables et étanches sur les câbles souterrains sont étudiées, notamment l’utilisation de boîtes de jonction remplies de résine coulée pour garantir la continuité de l’isolation et de la protection.
2.4. Les Manchons et Souliers de Câbles
Pour le raccordement des câbles de grosse section sur les jeux de barres des tableaux, la technologie des cosses (souliers) à sertir ou à visser est détaillée. Les manchons de jonction thermorétractables sont présentés comme une solution moderne pour garantir une isolation parfaite.
Chapitre 3: Technologie des Systèmes de Mise à la Terre (Régimes de Neutre)
3.1. Objectifs de la Mise à la Terre
Les deux objectifs fondamentaux de la mise à la terre sont expliqués : la protection des personnes contre les contacts indirects et la protection des biens en assurant un chemin de retour pour les courants de défaut, ce qui permet le fonctionnement des dispositifs de protection.
3.2. Constitution d’une Prise de Terre
La technologie d’une prise de terre est étudiée : le piquet de terre (matériaux, dimensions), le conducteur de terre, la barrette de mesure (ou de coupure) et les conducteurs de protection qui relient les masses métalliques à la terre.
3.3. Les Schémas de Liaison à la Terre (Régimes de Neutre)
Les trois régimes de neutre normalisés (TT, TN, IT) sont définis en fonction du mode de raccordement du neutre du transformateur et des masses de l’installation. Leur choix impacte directement la conception des systèmes de protection.
3.4. Mesure de la Résistance de Terre
La méthode de mesure de la résistance d’une prise de terre (méthode des 3 piquets) à l’aide d’un telluromètre est expliquée. L’importance d’obtenir une faible valeur de résistance pour garantir l’efficacité de la protection est soulignée, un enjeu particulièrement complexe dans les sols rocheux de certaines régions du Kivu.
PARTIE 2 : TECHNOLOGIE DE L’APPAREILLAGE DE PUISSANCE ET D’ÉCLAIRAGE
Cette section dissèque les appareils qui assurent la coupure, la commande et l’utilisation de l’énergie électrique dans les installations de moyenne et grande puissance, en s’attardant sur les technologies de disjoncteurs et sur l’éclairage à décharge.
Chapitre 4: Les Disjoncteurs de Puissance (Automatiques)
4.1. Le Pouvoir de Coupure
Le concept de pouvoir de coupure est défini comme le courant de court-circuit maximal qu’un disjoncteur peut interrompre en toute sécurité. C’est la caractéristique la plus importante pour le choix d’un disjoncteur en tête d’installation.
4.2. La Technologie de Coupure de l’Arc Électrique
Le principal défi technologique d’un disjoncteur est d’éteindre l’arc électrique qui se forme à l’ouverture des contacts. Les différentes techniques sont présentées : allongement de l’arc, soufflage (magnétique ou par air) et division de l’arc dans des chambres de coupure.
4.3. Les Déclencheurs Magnéto-thermiques Réglables
La technologie des déclencheurs pour les disjoncteurs industriels (type « boîtier moulé ») est étudiée. Leur seuil de déclenchement thermique (surcharge) et magnétique (court-circuit) est souvent réglable pour s’adapter précisément au circuit à protéger.
4.4. Les Déclencheurs Électroniques (Micrologic)
Les disjoncteurs modernes sont équipés de déclencheurs électroniques (ou numériques) qui offrent une protection beaucoup plus sophistiquée et précise : réglages fins, protection contre les défauts à la terre, et même des fonctions de mesure et de communication.
Chapitre 5: Technologie de l’Éclairage à Décharge
5.1. Le Tube Fluorescent : Ballast et Starter
Le rôle détaillé des auxiliaires du tube fluorescent est analysé. Le starter crée la surtension d’amorçage, tandis que le ballast ferromagnétique a une double fonction : limiter le courant après l’amorçage et générer l’impulsion de tension avec le starter.
5.2. Les Ballasts Électroniques
Le ballast électronique est présenté comme la technologie moderne pour alimenter les tubes fluorescents. Il fonctionne à haute fréquence, ce qui élimine l’effet de scintillement, améliore le rendement lumineux et permet la gradation de la lumière.
5.3. Les Lampes à Décharge Haute Pression
La technologie des lampes à vapeur de mercure et à vapeur de sodium, utilisées pour l’éclairage public et industriel, est étudiée. Leur principe de fonctionnement et leur efficacité lumineuse élevée sont expliqués.
5.4. L’Amorçage des Lampes à Décharge
L’amorçage de ces lampes nécessite des tensions élevées (plusieurs kilovolts). La technologie des amorceurs électroniques, qui génèrent des impulsions de haute tension, est présentée comme un composant clé de ces systèmes d’éclairage, visibles dans tous les grands centres urbains comme Lubumbashi ou Mbuji-Mayi.
PARTIE 3 : TECHNOLOGIE ET APPLICATIONS DES RELAIS
Cette partie constitue une étude approfondie et systématique du relais, composant fondamental de l’automatisme câblé et de la protection des réseaux. Chaque fonction du relais est analysée à travers les technologies qui permettent de la réaliser.
Chapitre 6: Principes et Typologies des Relais Électromécaniques
6.1. Le Relais Électromagnétique : Principe et Constitution
Le relais est présenté comme un interrupteur commandé électriquement. Sa constitution est disséquée : la bobine (circuit de commande), le circuit magnétique, l’armature mobile et les contacts (circuit de puissance).
6.2. Technologie des Contacts
Les caractéristiques des contacts sont étudiées : nature (NO, NF, inverseur), pouvoir de coupure, matériaux (argent, or) et usure. La notion de contacts auto-nettoyants est introduite.
6.3. Les Relais Statiques (à Semi-conducteurs)
Les relais statiques, qui utilisent des composants électroniques (thyristors, triacs) pour réaliser la commutation sans aucune pièce mobile, sont introduits. Leurs avantages (vitesse, silence, durée de vie) et inconvénients (échauffement) sont comparés à ceux des relais électromécaniques.
6.4. Les Relais de Mesure (à Seuil)
Le principe du relais de mesure est expliqué : il compare en permanence une grandeur électrique (tension, courant) à une valeur de consigne et actionne ses contacts lorsque le seuil est franchi. C’est la base de tous les relais de protection.
Chapitre 7: Les Relais de Protection
7.1. Le Relais de Protection Thermique
Le relais thermique, utilisé pour la protection des moteurs contre les surcharges, est étudié en détail. Son principe, basé sur la déformation de bilames chauffés par le courant du moteur, et son système de réarmement sont expliqués.
7.2. Le Relais de Protection Magnétique (Ampèremétrique)
Le relais ampèremétrique à maximum de courant protège contre les courts-circuits. Son principe (force d’attraction d’un électro-aimant) assure un déclenchement quasi instantané.
7.3. Les Relais de Protection de Tension (Voltmétrique)
Les relais à minimum ou à maximum de tension sont présentés. Ils protègent les équipements sensibles contre les creux de tension ou les surtensions du réseau, un problème fréquent qui nécessite une protection adéquate des équipements dans les hôpitaux de Bukavu.
7.4. Le Relais Différentiel
Le relais différentiel, qui assure la protection des personnes contre les contacts indirects, est étudié. Son principe, basé sur la mesure de la somme vectorielle des courants (qui doit être nulle en l’absence de défaut à la terre) à l’aide d’un transformateur torique, est expliqué.
Chapitre 8: Les Relais de Commande, de Verrouillage et de Temporisation
8.1. Le Relais comme Interface de Commande
L’utilisation du relais pour commander un circuit de forte puissance à partir d’un signal de faible puissance (isolation galvanique) est mise en avant comme l’une de ses fonctions principales.
8.2. Les Circuits de Verrouillage
Les montages de verrouillage électrique à l’aide de contacts de relais sont étudiés. Ils permettent d’interdire l’enclenchement simultané de deux commandes contradictoires, comme les deux sens de marche d’un moteur.
8.3. La Technologie des Relais Temporisés
Les différentes technologies pour créer une temporisation sont présentées : la temporisation pneumatique (par étranglement d’un flux d’air), et la temporisation électronique (par un circuit RC), qui est la plus courante aujourd’hui.
8.4. Fonctions de Temporisation
La distinction entre la temporisation « au travail » (le contact s’actionne après un délai suivant l’alimentation de la bobine) et la temporisation « au repos » (le contact s’actionne après un délai suivant la coupure de l’alimentation) est expliquée et illustrée par des chronogrammes.
PARTIE 4: SYSTÈMES DE PROTECTION ET D’AUTOMATISME MODERNES
Cette dernière partie ouvre une fenêtre sur les technologies actuelles et futures de la protection et de la commande, en introduisant les relais numériques et le concept fondamental de la sélectivité, tout en préparant la transition vers les automates programmables.
Chapitre 9: Introduction aux Relais Numériques
9.1. Principe du Relais Numérique (à Microprocesseur)
Le relais numérique est présenté : il mesure les grandeurs via des convertisseurs, les traite à l’aide d’un microprocesseur selon des algorithmes programmés, et commande des relais de sortie.
9.2. Avantages des Relais Numériques
Les avantages sont nombreux : multifonction (un seul relais peut assurer plusieurs protections), grande précision et flexibilité des réglages, capacité d’enregistrement des événements (historique des défauts) et de communication avec un système de supervision.
9.3. Paramétrage d’un Relais Numérique
L’élève est initié à la notion de paramétrage. Contrairement à un relais électromécanique, un relais numérique doit être configuré (via un ordinateur ou une interface locale) pour définir les seuils, les temporisations et les logiques de protection désirées.
9.4. Le Relais de Protection Intégré au Disjoncteur
La tendance moderne est d’intégrer la fonction de relais de protection directement dans le déclencheur électronique du disjoncteur de puissance, créant ainsi un « intelligent protective device ».
Chapitre 10: Principes de la Sélectivité des Protections
10.1. Le Problème de la Sélectivité
La sélectivité est définie comme l’aptitude d’un système de protection à n’isoler que la partie défectueuse de l’installation, en laissant le reste en service. Son absence peut entraîner des coupures généralisées pour un défaut local.
10.2. La Sélectivité Ampèremétrique
Ce type de sélectivité est basé sur l’étagement des seuils de déclenchement des protections en cascade. Elle n’est efficace que si les courants de court-circuit varient significativement le long du réseau.
10.3. La Sélectivité Chronométrique
La sélectivité chronométrique est la plus utilisée. Elle consiste à étager les temporisations des relais de protection : plus on se rapproche de la source, plus le délai de déclenchement est long, laissant le temps à la protection en aval d’éliminer le défaut.
10.4. La Sélectivité Logique
Pour les réseaux industriels critiques, la sélectivité logique est présentée. Les relais communiquent entre eux : un relais en amont attend un signal du relais en aval pour savoir s’il doit déclencher, permettant des temps de coupure très rapides tout en garantissant la sélectivité.
ANNEXES
Les annexes sont une compilation de ressources technologiques. Elles incluent des fiches de choix pour les câbles et les disjoncteurs, des guides de paramétrage simplifiés pour les relais de protection courants, des schémas de principe pour les circuits de commande à relais, et un glossaire des termes de la protection et de l’appareillage industriel.



