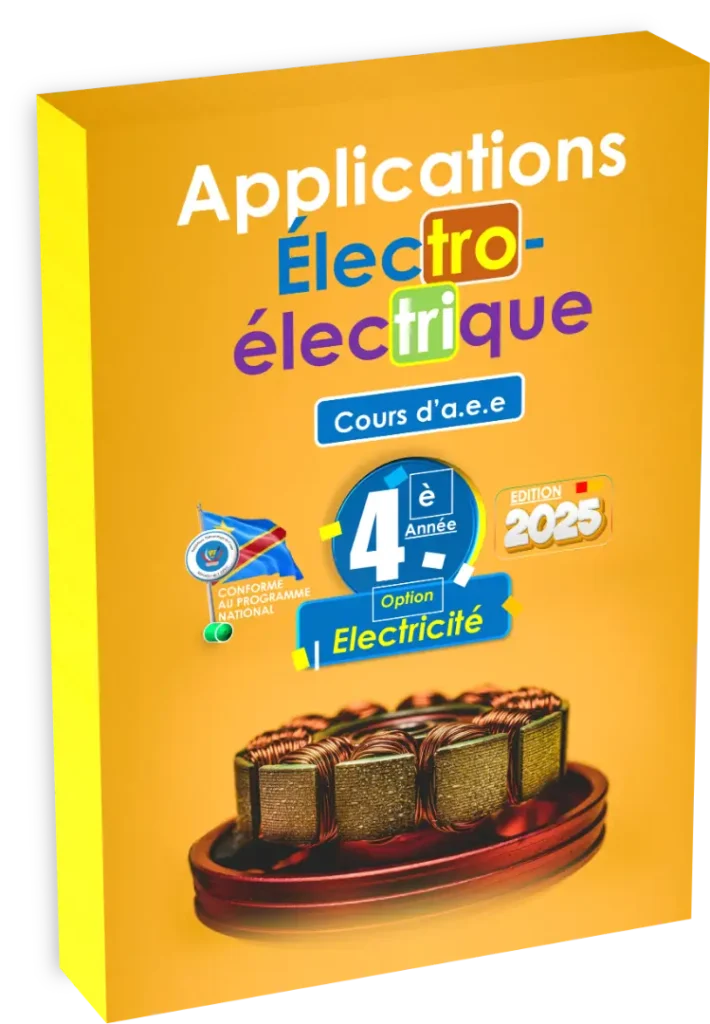
APPLICATIONS ÉLECTRIQUES, 4ÈME ANNÉE, OPTION ÉLECTRICITÉ
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
PRÉLIMINAIRES
1. Objectifs Généraux du Cours 🎯
Ce cours de quatrième année représente la synthèse et le couronnement de la formation en électrotechnique. Son objectif est de faire converger toutes les connaissances acquises vers l’étude des systèmes et applications qui constituent le cœur du monde de l’énergie électrique : les machines tournantes, les transformateurs, et les grands systèmes de production, de transport et d’utilisation de l’électricité. L’ambition est de former un technicien polyvalent, capable de comprendre le fonctionnement d’un alternateur, de diagnostiquer une panne sur un moteur industriel, de comprendre l’architecture d’un réseau électrique et de s’initier aux applications de l’électronique de puissance.
2. Approche Pédagogique Recommandée 🧑🏫
La pédagogie de ce cours final doit être fortement intégrative et axée sur l’étude de systèmes complets. Les séances de laboratoire « Essais de Machines » sont le complément indispensable de chaque chapitre théorique, permettant de confronter les modèles mathématiques à la réalité expérimentale. L’enseignant doit favoriser une approche systémique, en montrant comment les différentes machines (générateurs, transformateurs, moteurs) s’intègrent dans une chaîne énergétique globale. Des études de cas approfondies, basées sur des installations réelles, seront privilégiées : analyse du fonctionnement de la centrale hydroélectrique de Zongo, étude du plan de protection d’un poste de distribution de la SNEL à Goma, ou encore conception de la chaîne de puissance pour une application industrielle à Kinshasa.
3. Prérequis du Cours 📚
Une maîtrise totale et approfondie de l’ensemble des programmes des trois années précédentes est un prérequis absolu. L’élève doit exceller dans l’analyse des circuits en régime sinusoïdal triphasé, comprendre les phénomènes électromagnétiques, et posséder de solides bases en mécanique et en technologie. Ce cours exige une grande capacité d’abstraction, de synthèse et d’application des connaissances à des systèmes complexes.
PARTIE 1 : MACHINES DE PRODUCTION ET DE TRANSFORMATION D’ÉNERGIE
Cette partie est dédiée à l’étude des machines statiques et tournantes qui sont à l’origine de la quasi-totalité de l’énergie électrique. Elle dissèque la technologie des alternateurs qui la produisent et des transformateurs qui en adaptent le niveau de tension pour permettre son transport et sa distribution.
Chapitre 1: L’Alternateur Triphasé (Machine Synchrone Génératrice)
1.1. Constitution et Principe de Fonctionnement
La structure de l’alternateur est détaillée : l’inducteur (rotor) créant le champ magnétique et l’induit (stator) où sont générées les tensions triphasées. Le principe de la création d’une f.é.m. par la rotation du champ magnétique devant des enroulements fixes est expliqué.
1.2. Fonctionnement à Vide et en Charge
Le fonctionnement à vide permet de tracer la caractéristique à vide, qui lie la f.é.m. au courant d’excitation. Le fonctionnement en charge met en évidence le phénomène de la réaction magnétique d’induit et la chute de tension interne de la machine.
1.3. Modèle Équivalent et Diagramme de Behn-Eschenburg
Le modèle électrique d’une phase de l’alternateur (modèle de Behn-Eschenburg) est établi, incluant la f.é.m. et l’impédance synchrone. Le diagramme vectoriel correspondant est construit pour analyser le comportement de la machine.
1.4. Bilan des Puissances et Rendement
Le diagramme des flux de puissance dans un alternateur est analysé, en identifiant les différentes pertes (mécaniques, fer, Joule à l’induit et à l’inducteur). Le calcul du rendement est effectué, une donnée cruciale pour l’exploitation des centrales.
Chapitre 2: Le Transformateur Statique
2.1. Constitution et Principe du Transformateur Monophasé
La constitution du transformateur (circuit magnétique, enroulements primaire et secondaire) est décrite. Son principe, basé sur l’induction mutuelle entre deux circuits couplés magnétiquement, est expliqué.
2.2. Le Transformateur Parfait et le Transformateur Réel
Le modèle du transformateur parfait (sans pertes) est étudié pour établir les rapports de transformation des tensions, des courants et des impédances. Le modèle réel est ensuite introduit, en tenant compte des pertes cuivre (par effet Joule) et des pertes fer (par hystérésis et courants de Foucault).
2.3. Diagramme de Kapp et Chute de Tension
Le diagramme vectoriel de Kapp est construit pour visualiser et calculer la chute de tension au secondaire du transformateur en fonction du courant et du facteur de puissance de la charge.
2.4. Le Transformateur Triphasé : Couplages et Indice Horaire
La technologie des transformateurs triphasés est étudiée, ainsi que les différents couplages possibles des enroulements (Étoile Y, Triangle D, Zigzag Z). La notion d’indice horaire, qui caractérise le déphasage entre les tensions primaires et secondaires, est définie.
Chapitre 3: Couplage en Parallèle des Machines Statiques et Tournantes
3.1. Nécessité du Couplage en Parallèle
Les raisons qui imposent le couplage en parallèle de plusieurs machines (alternateurs ou transformateurs) sur un même réseau sont expliquées : augmentation de la puissance disponible, continuité de service lors de la maintenance, et optimisation du rendement.
3.2. Conditions de Couplage des Transformateurs
Les quatre conditions indispensables pour coupler deux transformateurs en parallèle sont énoncées et justifiées : mêmes tensions, même rapport de transformation, même indice horaire (pour le triphasé) et même tension de court-circuit.
3.3. Conditions de Couplage des Alternateurs
Les conditions de couplage d’un alternateur sur le réseau sont détaillées : égalité des tensions, égalité des fréquences, et concordance de l’ordre des phases. La procédure de synchronisation à l’aide de lampes ou d’un synchronoscope est décrite.
3.4. Répartition de la Charge entre Machines en Parallèle
L’analyse montre comment la puissance active et réactive se répartit entre deux alternateurs couplés au réseau. La puissance active est contrôlée par le régulateur de vitesse de la turbine, tandis que la puissance réactive est contrôlée par le courant d’excitation de l’alternateur.
PARTIE 2 : MACHINES DE CONVERSION ÉLECTROMÉCANIQUE (MOTEURS)
Cette partie se concentre sur les machines qui réalisent la fonction inverse : la conversion de l’énergie électrique en énergie mécanique. L’étude détaillée des moteurs asynchrones et synchrones, qui représentent l’immense majorité des actionneurs industriels, est au cœur de cette section.
Chapitre 4: Le Moteur Asynchrone Triphasé
4.1. Constitution et Principe du Champ Tournant
La constitution du moteur asynchrone (stator identique à celui d’un alternateur, rotor en cage d’écureuil ou bobiné) est décrite. Le principe fondamental de la création d’un champ magnétique tournant par les enroulements statoriques alimentés en triphasé est expliqué.
4.2. Le Phénomène de Glissement
Le concept de glissement (g) est défini comme la différence de vitesse relative entre le champ tournant statorique et le rotor. Il est expliqué que ce glissement est indispensable pour induire des courants dans le rotor et créer le couple moteur.
4.3. Bilan de Puissance et Caractéristique Mécanique
Le diagramme des flux de puissance est analysé, en distinguant la puissance transmise au rotor et les pertes rotoriques. La caractéristique mécanique, qui lie le couple à la vitesse (ou au glissement), est tracée, montrant le couple de démarrage, le couple maximal et le point de fonctionnement nominal.
4.4. Démarrage des Moteurs Asynchrones
Les différentes méthodes pour réduire l’appel de courant au démarrage sont étudiées : démarrage direct pour les petits moteurs, démarrage étoile-triangle, démarrage par autotransformateur et par résistances statoriques pour les machines de plus forte puissance, comme celles utilisées par la REGIDESO pour le pompage d’eau.
Chapitre 5: Le Moteur Synchrone
5.1. Constitution et Principe de Fonctionnement
Le moteur synchrone est présenté comme une machine dont le stator est identique à celui du moteur asynchrone, mais dont le rotor est un électro-aimant alimenté en courant continu. Le principe de l’accrochage magnétique entre le champ tournant du stator et le champ du rotor est expliqué, forçant le moteur à tourner à la vitesse de synchronisme.
5.2. Caractéristiques et Démarrage
La caractéristique principale du moteur synchrone est sa vitesse rigoureusement constante. Son incapacité à démarrer seul (couple de démarrage nul) est expliquée, et les méthodes de démarrage (asynchrone par cage d’amortisseur, moteur auxiliaire) sont présentées.
5.3. Le Compensateur Synchrone
Le comportement unique du moteur synchrone en ce qui concerne la puissance réactive est étudié. En faisant varier son courant d’excitation, le moteur peut se comporter comme une charge inductive, résistive ou capacitive. Utilisé à vide, il devient un compensateur synchrone capable de fournir de l’énergie réactive pour améliorer le facteur de puissance d’un réseau, une application cruciale pour la stabilité du réseau de transport d’électricité.
5.4. Applications du Moteur Synchrone
Les domaines d’application du moteur synchrone sont présentés : entraînements de très forte puissance à vitesse constante (broyeurs dans l’industrie cimentière, compresseurs), où son excellent rendement et sa capacité de compensation sont des atouts majeurs.
Chapitre 6: Les Moteurs Monophasés et Spéciaux
6.1. Le Problème du Démarrage des Moteurs Monophasés
Il est expliqué qu’un simple enroulement monophasé crée un champ alternatif pulsant, et non tournant, ce qui ne génère aucun couple de démarrage. La nécessité d’un système auxiliaire de démarrage est établie.
6.2. Le Moteur Monophasé à Phase Auxiliaire
La solution la plus courante est présentée : l’ajout d’un enroulement de démarrage en quadrature, alimenté via un condensateur pour créer un déphasage et produire un champ tournant elliptique suffisant pour lancer le moteur.
6.3. Le Moteur Universel
Le moteur universel (à collecteur) est étudié. Sa capacité à fonctionner indifféremment en courant continu ou alternatif en fait le moteur de choix pour l’électroménager portatif (perceuses, aspirateurs) et de nombreux appareils domestiques.
6.4. Maintenance des Machines Électriques
Ce sous-chapitre synthétise les opérations de maintenance de base communes à toutes les machines tournantes : contrôle de l’état des roulements et graissage, mesure de la résistance d’isolement des enroulements, et surveillance des échauffements et vibrations anormaux.
PARTIE 3 : ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE ET APPLICATIONS
Cette section constitue une modernisation essentielle du programme, en remplaçant l’étude des convertisseurs obsolètes par une introduction à l’électronique de puissance, la technologie qui permet de contrôler et de convertir l’énergie électrique à l’aide de composants à semi-conducteurs.
Chapitre 7: Les Convertisseurs Statiques de Puissance
7.1. Les Composants de l’Électronique de Puissance
Les interrupteurs électroniques commandés sont introduits : le thyristor (SCR), le triac, et le transistor de puissance (MOSFET, IGBT). Leurs caractéristiques de commutation et leurs domaines d’application sont décrits.
7.2. Les Redresseurs Commandés
Le principe du redressement commandé à base de thyristors est expliqué. Contrairement aux redresseurs à diodes, ils permettent de faire varier la tension de sortie continue en contrôlant l’angle d’amorçage des thyristors.
7.3. Les Gradateurs
Le gradateur, utilisant généralement un triac, est présenté comme un convertisseur AC/AC qui permet de faire varier la valeur efficace de la tension aux bornes d’une charge, utilisé pour la variation d’intensité lumineuse ou le chauffage.
7.4. Les Onduleurs (Inverteurs)
Le principe de l’onduleur, qui convertit une tension continue en une tension alternative, est expliqué. C’est le composant clé des alimentations sans interruption (onduleurs pour ordinateurs) et des systèmes solaires photovoltaïques autonomes, qui se développent rapidement pour l’électrification rurale, par exemple dans la province de l’Équateur.
Chapitre 8: Applications en Variation de Vitesse
8.1. Nécessité de la Variation de Vitesse
Les avantages de la variation de vitesse pour les entraînements industriels sont soulignés : adaptation du procédé, économies d’énergie considérables (pour les pompes et ventilateurs), et amélioration de la commande des machines.
8.2. Les Variateurs de Vitesse pour Moteurs Asynchrones
Le variateur de fréquence est présenté comme la solution moderne pour la commande des moteurs asynchrones. Son principe (redresseur – bus continu – onduleur MLI) et sa capacité à faire varier la vitesse tout en maintenant le couple constant sont expliqués.
8.3. Les Démarreurs Électroniques (Soft Starters)
Le démarreur progressif est introduit comme une alternative au variateur, dédiée uniquement à la fonction de démarrage. Il assure une montée en tension progressive pour un démarrage en douceur, sans à-coups mécaniques.
8.4. Applications Industrielles
Des exemples d’applications des variateurs sont discutés : régulation du débit d’une pompe dans une station de traitement d’eau de la REGIDESO à Bukavu, commande d’un convoyeur à vitesse variable dans une usine d’embouteillage, ou encore la commande d’ascenseurs modernes.
PARTIE 4 : SYSTÈMES DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D’ÉNERGIE
Cette dernière partie élargit la perspective à l’échelle des grands systèmes électriques, en étudiant la manière dont l’énergie est produite dans les différentes centrales, transportée sur de longues distances, et finalement distribuée aux consommateurs, ainsi que les moyens mis en œuvre pour protéger ces vastes réseaux.
Chapitre 9: Les Centrales de Production d’Énergie
9.1. Les Centrales Hydroélectriques
Le principe de la conversion de l’énergie potentielle de l’eau en énergie mécanique (par une turbine) puis en énergie électrique (par un alternateur) est détaillé, en prenant comme exemple les barrages du site d’Inga, poumon énergétique de la RDC.
9.2. Les Centrales Thermiques à Flamme
Le fonctionnement des centrales thermiques (à charbon, gaz ou fuel) est expliqué : combustion pour produire de la vapeur, détente de la vapeur dans une turbine qui entraîne un alternateur. Les enjeux environnementaux sont également abordés.
9.3. Les Groupes Électrogènes (Centrales Diesel)
Le groupe électrogène, qui couple un moteur diesel à un alternateur, est étudié. Il est essentiel comme source de secours dans les industries et les hôpitaux, ou comme source principale dans les sites isolés non raccordés au réseau.
9.4. Les Centrales à Énergies Renouvelables
Une introduction aux technologies de production renouvelable est faite. Le principe des centrales solaires photovoltaïques (conversion directe de la lumière en électricité) et des parcs éoliens (conversion de l’énergie cinétique du vent) est présenté.
Chapitre 10: Transport et Distribution de l’Énergie Électrique
10.1. Structure Générale d’un Réseau Électrique
La structure hiérarchique du réseau est décrite : production centralisée, transport en Très Haute Tension (THT), répartition en Haute Tension (HT), et distribution en Moyenne et Basse Tension (MT/BT).
10.2. Les Lignes de Transport Très Haute Tension
La technologie des lignes THT est présentée : pylônes, chaînes d’isolateurs, conducteurs en alliage d’aluminium-acier, et câbles de garde pour la protection contre la foudre.
10.3. Les Postes d’Interconnexion et de Transformation
Le rôle et la structure d’un poste électrique sont expliqués : jeux de barres, sectionneurs, disjoncteurs, transformateurs de puissance, qui permettent de diriger les flux d’énergie et d’abaisser les niveaux de tension.
10.4. Les Réseaux de Distribution MT et BT
Les différentes architectures des réseaux de distribution (radiale, en boucle) sont comparées. La structure typique d’un réseau de distribution urbain, depuis le poste source jusqu’au transformateur sur poteau qui alimente un quartier, est détaillée.
Chapitre 11: Protection des Réseaux Électriques
11.1. Protection contre les Surtensions
Les deux origines des surtensions sont analysées : les surtensions de manœuvre et les surtensions atmosphériques (foudre). La technologie des parafoudres à oxyde de zinc pour la protection des équipements est étudiée.
11.2. Protection contre les Surintensités (Courts-circuits)
La protection des réseaux contre les courts-circuits à l’aide de relais de protection ampérométriques et de disjoncteurs est approfondie. Le principe de la sélectivité des protections est rappelé comme étant crucial pour la fiabilité du réseau.
11.3. La Protection Différentielle
Le principe de la protection différentielle, qui compare les courants entrant et sortant d’un équipement (transformateur, alternateur), est présenté comme une méthode très rapide et sensible pour détecter les défauts internes.
11.4. Applications Industrielles Spécifiques : Fours et Soudage
Les principes technologiques de la soudure à l’arc et des fours électriques (à résistance, à arc, à induction) sont rappelés comme des applications industrielles qui requièrent des alimentations électriques spécifiques et robustes, très répandues dans le secteur minier du Grand Katanga.
ANNEXES
Les annexes fournissent des ressources de synthèse pour le futur technicien supérieur. Elles contiennent des fiches caractéristiques des principales machines électriques, des schémas unifilaires types de postes de transformation et de centrales, des guides de choix pour les protections de réseau, et un glossaire complet des termes de l’électrotechnique de puissance.



