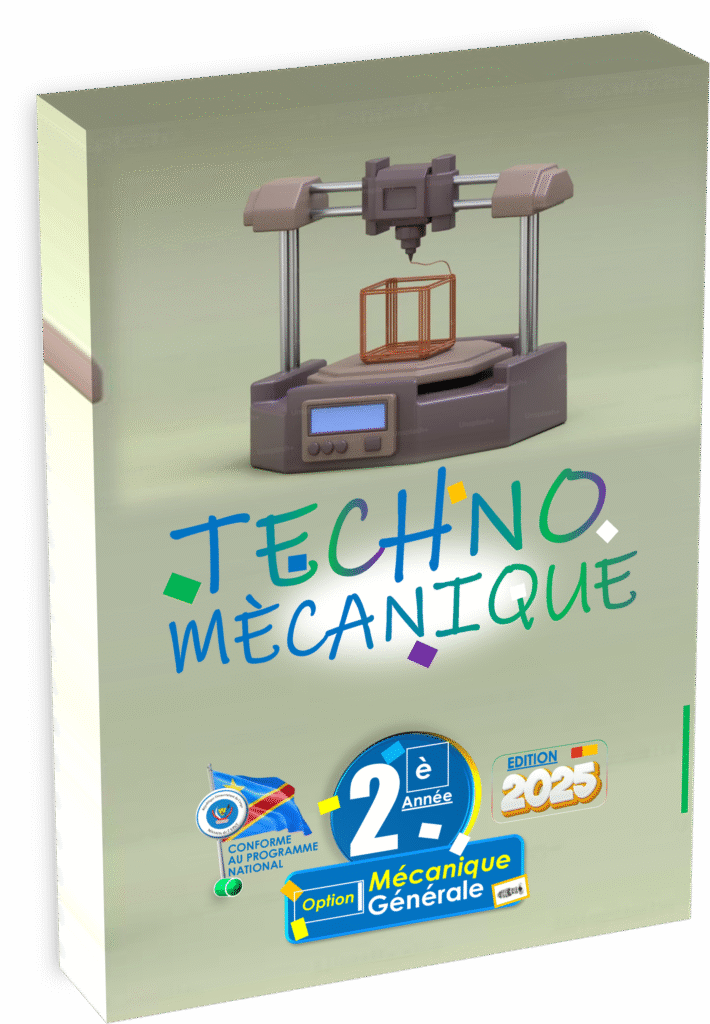
TECHNOLOGIE MÉCANIQUE, 2 ÈME ANNEE, OPTION MECANIQUE GENERALE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
Préliminaires
Objectifs Pédagogiques du Cours 🎯
Ce cours a pour objectif la maîtrise conceptuelle et pratique des procédés d’usinage fondamentaux par enlèvement de copeaux. Au terme de cette année, l’élève doit comprendre la cinématique, les capacités et les limites des machines-outils de base que sont l’étau-limeur, le tour et la fraiseuse. Il doit être capable de choisir un mode opératoire, de justifier la géométrie d’un outil de coupe, de déterminer les paramètres de coupe initiaux et de décrire les méthodes de fixation de pièce pour réaliser des opérations d’usinage simples. Cette compétence constitue le fondement du savoir-faire du technicien mécanicien, lui permettant de dialoguer efficacement avec l’atelier de fabrication.
Approche Didactique et Méthodologique ⚙️
L’enseignement de la technologie est indissociable de la pratique en atelier. Chaque leçon théorique sera systématiquement conduite en présence de la machine-outil concernée. L’approche privilégie l’observation directe et la manipulation pour illustrer les principes de fonctionnement. Les descriptions cinématiques sont volontairement simplifiées pour se concentrer sur l’aspect technologique : la relation entre la machine, l’outil, la pièce et le copeau. Le raisonnement de l’élève est constamment sollicité pour analyser une opération d’usinage en termes de mouvements, d’efforts et de qualité géométrique attendue.
Sécurité et Environnement Professionnel ⚠️
Une attention absolue est portée aux règles de sécurité spécifiques à l’utilisation des machines-outils. Le port des équipements de protection individuelle (lunettes, chaussures de sécurité) est obligatoire et non négociable. Les risques liés aux pièces en rotation, à la projection de copeaux, et à la manipulation d’outils coupants sont identifiés et les parades associées sont enseignées avant toute manipulation. Cette culture de la sécurité est une compétence professionnelle à part entière, indispensable pour tout technicien intervenant dans les ateliers de maintenance de la GECAMINES au Lualaba ou dans les PME de fabrication métallique de Kinshasa.
Partie I : Technologie du Rabotage et de la Génération de Surfaces Planes
Cette partie introductive assure la transition avec les acquis de l’année précédente en systématisant l’étude de la génération de surfaces planes par un mouvement de coupe rectiligne. Le rabotage, bien que moins courant aujourd’hui, reste un excellent cas d’école pour introduire les concepts de base de l’usinage.
Chapitre 1 : Principes et Machines du Rabotage
Ce chapitre analyse la famille des machines utilisant un outil à tranchant unique et un mouvement de coupe rectiligne pour produire des surfaces planes, des rainures ou des profils.
1.1. Les Machines de Rabotage : Étau-limeur, Raboteuse et Mortaiseuse
Les trois machines principales sont distinguées par leur cinématique : l’étau-limeur où l’outil est mobile, la raboteuse où la pièce est mobile, et la mortaiseuse qui travaille avec un mouvement vertical. Leurs domaines d’application respectifs sont présentés, du surfaçage de petites pièces sur étau-limeur à l’usinage de grands bâtis sur raboteuse.
1.2. L’Outil de Rabotage : Géométrie et Mouvement
La géométrie de l’outil de rabotage est analysée en détail (angles de dépouille, de coupe, d’inclinaison). Le mouvement de coupe rectiligne alternatif et le mécanisme qui génère un retour rapide pour optimiser le temps de production sont expliqués.
1.3. La Pièce en Rabotage : Fixation et Mouvements d’Avance
Les méthodes de fixation de la pièce (en étau ou par bridage sur table) sont décrites. Le mouvement d’avance intermittent de la pièce (ou de l’outil) est expliqué comme le mécanisme qui assure la couverture de toute la surface à usiner.
1.4. Opérations Typiques et Génération de Surfaces
Les opérations réalisables sont passées en revue : surfaçage horizontal, dressage vertical, usinage de surfaces obliques par inclinaison de la tête porte-outil, et réalisation de rainures, illustrant la polyvalence du procédé.
Partie II : Technologie du Tournage
Cette partie est consacrée à l’étude approfondie du tour parallèle, la machine-outil fondamentale pour la production de pièces de révolution, qui constituent une part majoritaire des composants mécaniques.
Chapitre 2 : Introduction à la Machine-Outil : Le Tour Parallèle
Ce chapitre dissèque le tour parallèle pour en comprendre la structure, les fonctions et la cinématique, afin de maîtriser la machine dans son ensemble.
2.1. Fonction Globale et Génération des Surfaces de Révolution
Le principe du tournage est défini : la pièce est animée d’un mouvement de rotation (mouvement de coupe), tandis que l’outil se déplace, générant ainsi des surfaces cylindriques, coniques ou planes.
2.2. Structure et Composants Principaux du Tour
Les différents éléments constitutifs du tour (banc, poupée fixe, poupée mobile, trainard, chariots) sont identifiés. Leur rôle respectif et leurs interactions sont expliqués pour donner une vision globale de l’architecture de la machine.
2.3. La Chaîne Cinématique de la Broche : Mouvement de Coupe
La transmission du mouvement depuis le moteur jusqu’à la broche qui entraîne la pièce est analysée. L’étude de la boîte de vitesses permet de comprendre comment obtenir les différentes vitesses de rotation nécessaires.
2.4. La Chaîne Cinématique des Chariots : Mouvements d’Avance
La transmission du mouvement vers les chariots porte-outil via la boîte des avances, la barre de chariotage et la vis-mère est décrite. La distinction entre le mouvement d’avance (pour le chariotage) et le mouvement de filetage est établie.
Chapitre 3 : La Pièce en Tournage : Prise et Maintien
La qualité et la sécurité du tournage dépendent directement de la méthode de fixation de la pièce. Ce chapitre explore les différents organes porte-pièce et leurs conditions d’utilisation.
3.1. Le Montage entre Pointes : Principe et Conditions
Le montage entre pointes est présenté comme la méthode la plus précise pour l’usinage de pièces longues, garantissant une concentricité parfaite. Le rôle des centres et l’entraînement par toc ou par mandrin à toc sont expliqués.
3.2. Le Montage en Mandrin : Mandrins 3 Mors et 4 Mors
Le mandrin est l’organe de serrage le plus courant. La différence fondamentale entre le mandrin à 3 mors (serrage concentrique, pour pièces cylindriques) et le mandrin à 4 mors indépendants (pour pièces de forme quelconque) est étudiée.
3.3. Les Accessoires de Maintien : Lunettes et Plateaux
L’utilisation des lunettes (fixes et à suivre) est expliquée comme étant indispensable pour soutenir les pièces longues et flexibles et éviter les vibrations. Le plateau de tour est présenté pour la fixation de pièces de grande dimension ou de forme complexe.
3.4. La Poupée Mobile : Fonctions et Réglages
La poupée mobile est analysée dans sa double fonction : support de la contre-pointe pour le montage mixte ou entre-pointes, et outil pour les opérations de perçage, d’alésage ou de taraudage dans l’axe de la broche.
Chapitre 4 : L’Outil de Tournage et Paramètres de Coupe
Ce chapitre se concentre sur l’acteur principal de l’usinage : l’outil, ainsi que sur les paramètres qui gouvernent la formation du copeau.
4.1. Géométrie de l’Outil de Chariotage : Angles Caractéristiques
Les angles de coupe, de dépouille, et d’inclinaison d’arête sont définis et leur influence sur la coupe, l’évacuation du copeau et la durée de vie de l’outil est expliquée. L’importance de l’angle de bec et du rayon de bec sur l’état de surface est soulignée.
4.2. Matériaux des Outils de Coupe
Une brève introduction aux grandes familles de matériaux d’outils est faite (Aciers Rapides, Carbures Métalliques), en liant leurs propriétés (dureté à chaud, résistance à l’usure) à leur domaine d’application et aux vitesses de coupe admissibles.
4.3. La Vitesse de Coupe : Définition et Importance
La vitesse de coupe est définie comme la vitesse relative de l’outil par rapport à la pièce. Son rôle prépondérant sur la température de coupe et la productivité est mis en avant. La formule de calcul de la fréquence de rotation est établie.
4.4. Avance et Profondeur de Passe
L’avance (vitesse de déplacement de l’outil) et la profondeur de passe (épaisseur de matière enlevée) sont définies. Leur influence combinée sur la section du copeau, les efforts de coupe et l’état de surface est analysée.
Chapitre 5 : Opérations Fondamentales de Chariotage et Dressage
Ce chapitre décrit les opérations de base qui permettent de générer les surfaces extérieures et planes les plus courantes en tournage.
5.1. Le Chariotage Longitudinal : Cylindrage
L’opération de cylindrage, qui consiste à usiner un diamètre extérieur, est décrite en distinguant l’ébauche (enlèvement de matière important) de la finition (obtention de la cote précise et du bon état de surface).
5.2. Le Dressage de Face : Surfaçage
L’opération de dressage, qui consiste à usiner une surface plane perpendiculaire à l’axe de rotation, est expliquée. Elle est souvent la première opération réalisée pour créer une surface de référence.
5.3. Opérations Combinées : Gorges et Chanfreins
L’usinage de gorges (pour dégagements, circlips) et de chanfreins (pour faciliter l’assemblage ou supprimer les arêtes vives) est présenté avec les outils de forme spécifiques requis.
5.4. Le Tronçonnage : Techniques et Outils
Le tronçonnage, ou coupe de la pièce, est décrit comme une opération délicate nécessitant un outil spécifique (l’outil à saigner) et des conditions de rigidité optimales pour éviter la rupture de l’outil.
Chapitre 6 : Techniques d’Usinage Intérieur et Conique
Ce chapitre étend le champ des opérations de tournage à la réalisation d’alésages et de surfaces coniques, élargissant considérablement les types de pièces réalisables.
6.1. Le Perçage au Tour
L’utilisation de forets montés dans la poupée mobile pour réaliser un trou axial dans la pièce est expliquée. Cette opération est souvent le préalable à un alésage de finition.
6.2. L’Alésage à l’Outil
L’alésage, qui consiste à agrandir et à calibrer un trou existant à l’aide d’un outil à aléser monté sur le chariot, est présenté comme la méthode de finition précise des diamètres intérieurs.
6.3. Le Tournage Conique par Inclinaison du Chariot Supérieur
Cette méthode est décrite pour l’usinage de cônes courts. Le principe consiste à orienter le petit chariot porte-outil selon l’angle du cône et à réaliser l’avance manuellement.
6.4. Le Tournage Conique par Désaxement de la Poupée Mobile
Pour l’usinage de cônes longs de faible conicité, la méthode du désaxement de la poupée mobile est expliquée. Le calcul de la valeur du désaxement est détaillé.
Chapitre 7 : Le Filetage au Tour
La réalisation de filetages précis est une des capacités les plus importantes du tour parallèle, indispensable pour la fabrication de vis, d’arbres filetés et d’écrous spéciaux.
7.1. Principe de Génération du Filet par la Vis-Mère
Le principe du filetage est expliqué par la synchronisation rigoureuse entre la rotation de la pièce et l’avance de l’outil, assurée par la vis-mère. L’engagement du demi-écrou du trainard sur la vis-mère est le geste clé de l’opération.
7.2. Calcul du Train d’Engrenages de la Lyre
La méthode de calcul des roues dentées à monter dans la lyre du tour pour obtenir le rapport de transmission nécessaire à la réalisation d’un pas de vis donné est enseignée.
7.3. L’Outil à Fileter et son Réglage
La géométrie spécifique de l’outil à fileter (profil triangulaire, carré, trapézoïdal) est décrite, ainsi que la méthode de réglage de sa position à l’aide d’un calibre de filetage pour garantir la perpendicularité par rapport à l’axe de la pièce.
7.4. Procédure de Réalisation d’un Filetage Extérieur
La procédure complète est détaillée, incluant le réglage de la machine, la prise de passes successives à l’aide du chariot supérieur orienté, l’utilisation de l’indicateur de filetage et le contrôle final du filet à l’aide de calibre.
Partie III : Technologie du Fraisage
Cette partie aborde la seconde machine-outil fondamentale, la fraiseuse. Elle est caractérisée par un outil rotatif à plusieurs dents, ce qui la rend extrêmement polyvalente pour la production de surfaces planes, de rainures et de formes complexes.
Chapitre 8 : Introduction à la Machine-Outil : La Fraiseuse
Ce chapitre présente la fraiseuse universelle, sa structure et sa cinématique, pour en comprendre le potentiel et les modes de fonctionnement.
8.1. Principe du Fraisage et Polyvalence de la Machine
Le principe du fraisage est défini : la matière est enlevée par un outil rotatif à arêtes multiples (la fraise), tandis que la pièce, fixée sur une table mobile, est animée d’un mouvement d’avance. La grande diversité des opérations possibles est mise en avant.
8.2. Structure et Axes de la Fraiseuse Universelle
La structure de la fraiseuse (bâti, console, chariot transversal, table) est décrite, ainsi que ses trois axes de déplacement orthogonaux (longitudinal, transversal, vertical). La capacité d’orientation de la table et de la tête de fraisage est expliquée comme la source de sa polyvalence.
8.3. Le Mouvement de Coupe : Broche et Vitesse de Rotation
Le mouvement de coupe, assuré par la rotation de la broche porte-fraise, est analysé. La boîte de vitesses de la broche permet d’adapter la fréquence de rotation au diamètre de la fraise et à la matière usinée pour respecter la vitesse de coupe.
8.4. Les Mouvements d’Avance de la Table
Les mouvements d’avance, qui déplacent la pièce contre l’outil, sont décrits. La boîte des avances, souvent indépendante de celle de la broche, permet de régler la vitesse d’avance en fonction de l’opération.
Chapitre 9 : L’Outil de Fraisage : La Fraise
Contrairement au tournage, le fraisage utilise une très grande variété d’outils. Ce chapitre classifie les fraises et analyse leur géométrie.
9.1. Classification des Fraises selon leur Forme et Utilisation
Les grandes familles de fraises sont présentées : fraises cylindriques 2 tailles, fraises 3 tailles, fraises à surfacer, fraises 2 dents (en bout), fraises de forme, scies circulaires, etc. Chaque type est associé à une ou plusieurs opérations spécifiques.
9.2. Géométrie d’une Dent de Fraise
La géométrie d’une arête de coupe de fraise est analysée, en définissant les angles de coupe et de dépouille. La notion d’hélice de la denture et son influence sur la progressivité de la coupe sont expliquées.
9.3. Montage des Fraises : Arbres Porte-Fraise et Pinces
Les deux principaux modes de montage des fraises sont décrits : le montage des fraises à trou sur un arbre porte-fraise (long ou court) pour le fraisage horizontal, et le montage des fraises à queue dans des pinces ou des mandrins pour le fraisage vertical.
9.4. Modes de Fraisage : en Roulant et en Opposition
La distinction fondamentale entre le fraisage en opposition (l’effort de coupe tend à soulever la pièce) et le fraisage en avalant ou en concordance (l’effort de coupe plaque la pièce) est établie. Les avantages et les prérequis de chaque méthode sont discutés, notamment la nécessité d’un système de rattrapage de jeu pour travailler en avalant.
Chapitre 10 : La Pièce en Fraisage : Fixation et Positionnement
Comme en tournage, la fixation rigide et précise de la pièce est une condition essentielle pour la qualité et la sécurité du fraisage.
10.1. Le Bridage Direct sur la Table
La méthode du bridage sur la table à rainures en T est expliquée pour les pièces de grande dimension. L’utilisation correcte des brides, des cales et des vis est détaillée pour assurer un serrage efficace sans déformer la pièce.
10.2. L’Utilisation de l’Étau de Fraisage
L’étau est l’accessoire de bridage le plus utilisé pour les pièces prismatiques de petite et moyenne taille. Les différents types d’étaux (fixe, orientable) et les techniques de positionnement de la pièce à l’aide de cales sont présentés.
10.3. Le Plateau Circulaire Diviseur
Le plateau diviseur est décrit comme un accessoire permettant de positionner la pièce selon des angles précis ou de lui imprimer un mouvement de rotation continu pour l’usinage de contours circulaires, comme ceux que l’on retrouve sur les brides de tuyauterie fabriquées à Boma.
10.4. L’Appareil Diviseur : Principe et Utilisation
L’appareil diviseur (ou diviseur universel) est présenté comme l’accessoire permettant de diviser la circonférence d’une pièce en un nombre entier de parties égales, indispensable pour le taillage d’engrenages, de cannelures ou l’usinage de têtes de vis.
Chapitre 11 : Opérations Fondamentales de Fraisage
Ce chapitre final met en application les connaissances acquises en décrivant la réalisation des opérations de fraisage les plus courantes.
11.1. Le Surfaçage avec Fraise 2 Tailles ou Fraise à Surfacer
Le surfaçage, qui consiste à générer une surface plane, est décrit en utilisant soit une fraise cylindrique 2 tailles en fraisage horizontal, soit une fraise à surfacer en fraisage vertical.
11.2. Le Rainurage avec Fraise 3 Tailles ou Fraise 2 Dents
L’usinage de rainures est présenté avec les deux outils typiques : la fraise 3 tailles (pour les rainures débouchantes) et la fraise 2 dents en bout (pour les rainures de clavette ou les mortaises).
11.3. Le Fraisage de Formes avec Fraises de Profil
Le principe du fraisage de profilés (concaves, convexes, en V) à l’aide de fraises de forme, dont le profil est le conjugué de celui à obtenir sur la pièce, est expliqué.
11.4. La Division Simple à l’Appareil Diviseur
La méthode de la division simple (ou indirecte) est détaillée. Le calcul du nombre de tours de manivelle et du nombre de trous à prendre sur un disque perforé pour obtenir un nombre de divisions donné est enseigné à travers des exercices pratiques.
Annexes
Les annexes fournissent des documents synthétiques et des données de référence pour une consultation rapide lors des exercices et des travaux pratiques.
Tableaux des Vitesses de Coupe 📈
Cette section fournit des tableaux de valeurs indicatives pour les vitesses de coupe recommandées en tournage et en fraisage pour les couples outil-matière les plus courants (Acier Rapide sur acier doux, carbure sur fonte, etc.).
Aide-Mémoire de Géométrie des Outils 🔪
Des schémas clairs rappellent la définition des angles caractéristiques des outils de tournage et des fraises, ainsi que les valeurs usuelles recommandées.
Schémas de Montage et de Bridage 🔩
Une série de schémas illustre les principes de bridage corrects et les erreurs à éviter pour garantir un maintien stable et sans déformation de la pièce sur le tour et la fraiseuse.