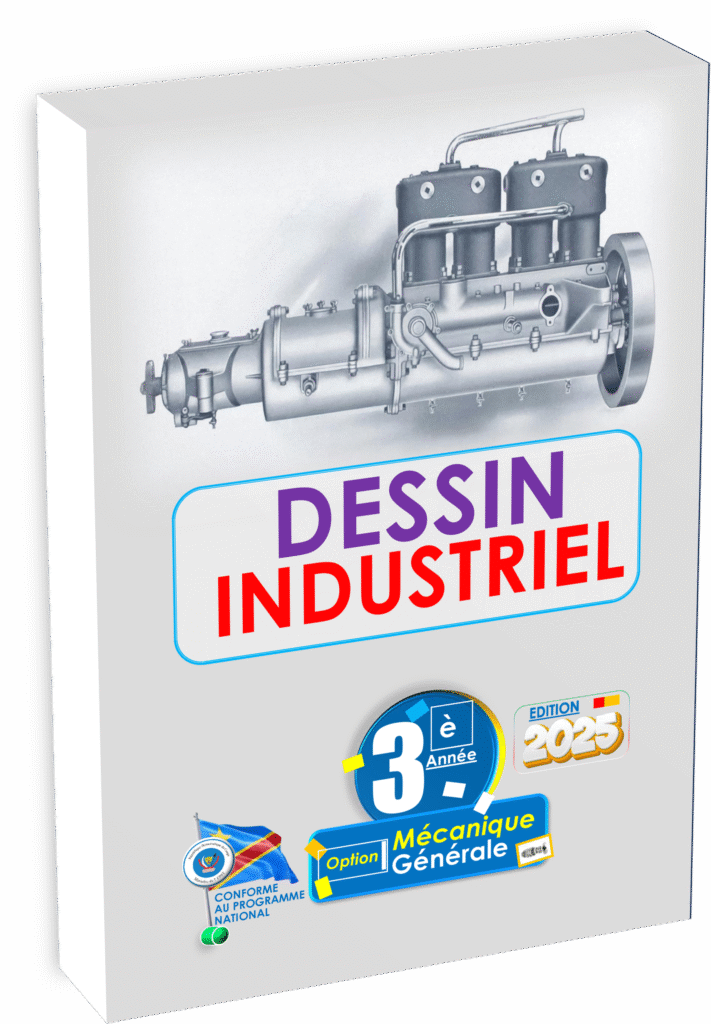
DESSIN INDUSTRIEL, 3 ÈME ANNEE, OPTION MECANIQUE GENERALE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
Préliminaires
Objectifs Pédagogiques du Cours 🎯
Ce cours a pour objectif de faire évoluer la compétence de l’élève du simple dessin de pièces isolées vers l’analyse et la conception de mécanismes fonctionnels. Au terme de cette année, l’apprenant doit maîtriser l’interprétation de dessins d’ensemble complexes, la justification des solutions constructives et la production de dessins de définition intégrant toutes les spécifications nécessaires à la fabrication (cotation fonctionnelle, tolérancement, états de surface). Il s’agit de développer un raisonnement de concepteur, capable de faire la synthèse entre les exigences fonctionnelles d’un mécanisme et les contraintes de sa réalisation en atelier.
Approche Didactique et Méthodologique ✍️
L’enseignement s’organise autour de l’étude de cas concrets et de micro-projets. La démarche part systématiquement de l’analyse d’un mécanisme existant (par exemple, un réducteur de vitesse pour un convoyeur minier, un système de vérin pour une presse). Les élèves procèdent à une analyse fonctionnelle pour comprendre le rôle de chaque composant avant d’en réaliser le dessin de définition. La méthode du projet guidera la seconde partie de l’année, où les élèves, à partir d’un cahier des charges simple, devront proposer et dessiner des solutions constructives, favorisant ainsi l’autonomie, la créativité et la rigueur.
Compétences Transversales et Contexte Industriel 🏭
Ce cours intègre des compétences transversales essentielles pour le technicien. La lecture de catalogues de fournisseurs, la recherche de solutions dans les manuels techniques et la consultation des normes sont des activités récurrentes. L’importance de la normalisation pour l’interchangeabilité des pièces et la réduction des coûts est constamment mise en avant, en illustrant son impact sur l’économie de la maintenance industrielle, que ce soit pour le parc de la SNCC à Lubumbashi ou pour les équipements des cimenteries du Kongo Central.
Partie I : Du Dessin d’Ensemble à l’Analyse Fonctionnelle
Cette première partie outille l’élève pour déchiffrer des plans d’ensemble complexes. L’objectif est de dépasser la simple reconnaissance des formes pour atteindre une compréhension profonde du fonctionnement du mécanisme, des interactions entre les pièces et de la logique de conception qui a présidé à sa création.
Chapitre 1 : Lecture et Interprétation Avancée des Dessins d’Ensemble
Ce chapitre vise à développer une lecture experte des plans d’assemblage, en se concentrant sur les informations fonctionnelles et les chaînes de cotes qui garantissent la performance du système.
1.1. Analyse Structurelle et Fonctionnelle d’un Mécanisme
L’élève apprend à décomposer un dessin d’ensemble en sous-ensembles fonctionnels (groupes de pièces assurant une fonction technique précise). Cette approche systémique facilite la compréhension de mécanismes complexes comme une boîte de vitesses.
1.2. Identification des Chaînes de Cotes Fonctionnelles
Cette section enseigne à repérer sur un dessin d’ensemble les séries de cotes qui, mises bout à bout, assurent une condition fonctionnelle essentielle (un jeu, un serrage, un alignement). Cette compétence est cruciale pour comprendre comment la précision de chaque pièce contribue à la performance globale.
1.3. Compréhension de la Nomenclature et des Spécifications
La lecture critique de la nomenclature est exercée. Au-delà du nom des pièces, l’élève apprend à interpréter les informations sur les matériaux, les traitements thermiques, et les références des composants standards (roulements, joints, etc.) qui y sont spécifiés.
1.4. Contextualisation : Étude d’un Réducteur pour l’Industrie Sucrière de Kwilu
Un cas pratique basé sur un réducteur de vitesse, tel qu’utilisé dans les usines de transformation de la canne à sucre, permet de mettre en application l’ensemble des techniques de lecture et d’analyse fonctionnelle sur un système industriel réel.
Chapitre 2 : L’Analyse Fonctionnelle et le Schéma Cinématique
Ce chapitre introduit les outils de modélisation qui permettent de représenter de manière simplifiée et universelle le fonctionnement d’un mécanisme, en faisant abstraction de la forme réelle des pièces.
2.1. Du Mécanisme Réel au Schéma de Principe
L’élève apprend à traduire un mécanisme complexe en un schéma simplifié qui ne conserve que les éléments essentiels à la compréhension de son fonctionnement. Cette abstraction est une compétence clé de l’ingénieur et du technicien.
2.2. Identification des Liaisons Mécaniques Normalisées
Les différentes liaisons normalisées entre les solides (pivot, glissière, appui plan, etc.) sont définies et leurs symboles graphiques sont étudiés. L’élève s’exerce à identifier ces liaisons dans des mécanismes réels.
2.3. Représentation Schématique des Mouvements
La construction de schémas cinématiques est enseignée. Ce type de schéma utilise les symboles de liaisons pour représenter la structure d’un mécanisme et permet une analyse rapide et efficace des transmissions et des transformations de mouvement.
2.4. Application : Schématisation d’un Cric de Maintenance Automobile
L’étude d’un cric de type « losange » ou « parallélogramme » sert d’exercice pratique pour passer de l’objet réel à son schéma cinématique, en identifiant les pivots et les glissières qui le composent.
Partie II : Le Dessin de Définition et ses Exigences de Précision
Cette partie approfondit les spécifications à apposer sur un dessin de définition pour qu’il constitue un contrat technique complet et sans ambiguïté pour la fabrication. Les notions de tolérancement dimensionnel et géométrique sont au cœur de cette section.
Chapitre 3 : Cotation Fonctionnelle et Tolérancement Dimensionnel
Ce chapitre a pour objectif de rendre l’élève capable de définir les tolérances dimensionnelles d’une pièce en fonction des exigences de son assemblage avec d’autres pièces.
3.1. Principe de la Cotation Fonctionnelle
La cotation fonctionnelle est présentée comme la démarche qui consiste à inscrire sur le dessin de définition les cotes directement issues des conditions d’assemblage et de fonctionnement, garantissant ainsi l’interchangeabilité des pièces.
3.2. Le Système de Tolérances ISO : Ajustements
Le système de tolérances normalisées ISO est étudié en détail. Les concepts d’alésage normal, d’arbre normal, et les différents types d’ajustements (avec jeu, incertain, avec serrage) sont expliqués à l’aide des tableaux de normes.
3.3. Inscription des Tolérances et Interprétation
L’élève apprend à inscrire les tolérances sur un dessin en utilisant la codification ISO (ex: Ø50 H7/g6) et à interpréter cette information pour calculer les jeux ou serrages maximum et minimum d’un assemblage.
3.4. Étude de cas : Ajustement Arbre-Moyeu d’une Pompe à Kananga
Un cas pratique d’ajustement glissant pour le montage d’une roue de pompe sur son arbre, tel qu’on pourrait le rencontrer dans les stations de pompage du Kasaï-Central, sert d’application concrète au choix et au calcul d’un ajustement.
Chapitre 4 : Tolérancement Géométrique : Formes et Positions
Ce chapitre introduit les spécifications géométriques qui contrôlent les imperfections de forme et de position des surfaces, un aspect crucial en mécanique de précision.
4.1. Spécifications de Forme : Planéité, Circularité, Cylindricité
Les tolérances de forme, qui limitent les défauts d’une surface par rapport à sa géométrie théorique parfaite, sont définies. Leurs symboles et leur inscription dans un cadre de tolérance sont étudiés.
4.2. Spécifications d’Orientation : Perpendicularité, Parallélisme, Inclinaison
Les tolérances d’orientation, qui contrôlent l’angle entre deux surfaces ou entre une surface et un axe, sont présentées. Leur importance pour le montage correct des pièces est mise en évidence.
4.3. Spécifications de Position : Localisation, Symétrie, Coaxialité
Les tolérances de position, qui définissent la localisation précise d’un élément par rapport à d’autres, sont abordées. La coaxialité, par exemple, est une exigence critique pour l’alignement de plusieurs paliers d’un même arbre.
4.4. Lecture des Cadres de Tolérance sur un Dessin
Des exercices de lecture de dessins industriels complexes sont proposés pour habituer l’élève à interpréter correctement les cadres de tolérancement géométrique et à comprendre les exigences de fabrication qu’ils impliquent.
Chapitre 5 : Les États de Surface et Leur Fonctionnalité
Ce chapitre approfondit la relation entre la microgéométrie d’une surface, son procédé d’obtention et sa fonction dans un mécanisme.
5.1. Relation entre Rugosité, Frottement et Usure
L’influence de l’état de surface sur les phénomènes de contact, de frottement et d’usure est analysée. Il est démontré qu’une faible rugosité est indispensable pour les surfaces de glissement ou les portées de joint d’étanchéité.
5.2. Symboles et Paramètres de Rugosité (Ra, Rz)
La symbolisation complète des états de surface est étudiée, incluant l’indication des paramètres de rugosité les plus courants comme le Ra (écart moyen arithmétique) et leur signification physique.
5.3. Choix de l’État de Surface en fonction du Procédé d’Usinage
Une corrélation est établie entre les différents procédés d’usinage (tournage, fraisage, rectification, polissage) et les gammes de rugosité qu’ils permettent d’atteindre. Ce lien aide le concepteur à spécifier des exigences réalisables.
5.4. Application : Spécification des Portées de Roulement et de Joint
L’élève s’exerce à spécifier les états de surface corrects sur le dessin d’un arbre et d’un alésage destinés à recevoir un roulement et un joint à lèvre, en justifiant ses choix par des arguments fonctionnels.
Partie III : Représentation et Conception des Liaisons Mécaniques
Cette partie se concentre sur le dessin des solutions technologiques qui réalisent les liaisons entre les pièces. La maîtrise du dessin de ces composants standards et des assemblages qu’ils constituent est une compétence fondamentale.
Chapitre 6 : Les Liaisons Démontables : Visserie et Boulonnerie
Ce chapitre traite en détail la représentation et la conception des assemblages par vis, qui sont les plus répandus en mécanique.
6.1. Représentation Détaillée et Schématique des Vis et Écrous
Les conventions de représentation des éléments filetés sont révisées et approfondies. La distinction entre une représentation détaillée, fidèle à la réalité, et une représentation schématique, plus rapide, est explicitée.
6.2. Cotation des Trous Taraudés et des Lamages
Les règles de cotation des trous destinés à recevoir des vis sont étudiées : trou borgne taraudé, trou débouchant, trou lisse pour passage de vis, et formes associées (lamage, fraisure).
6.3. Systèmes de Freinage d’Écrous
Différentes solutions pour empêcher le desserrage accidentel des vis et écrous (rondelles Grower, écrous Nylstop, contre-écrous) sont présentées et leur représentation sur un dessin d’ensemble est montrée.
6.4. Représentation d’un Assemblage Vissé Complet
Des exercices de dessin d’assemblages complets, comme la fixation d’un couvercle sur un carter, permettent de synthétiser toutes les conventions relatives à la visserie.
Chapitre 7 : Les Liaisons Démontables : Goupilles et Clavettes
Ce chapitre aborde les éléments assurant la mise en position et la transmission de couple entre un arbre et un moyeu.
7.1. Types et Représentation des Goupilles
Les différents types de goupilles (cylindriques, coniques, élastiques, cannelées) et leurs fonctions (positionnement, sécurité) sont décrits, ainsi que leur représentation en dessin technique.
7.2. Types et Représentation des Clavettes Parallèles
La clavette parallèle, élément standard de transmission de couple, est étudiée. Sa représentation en coupe et les différentes formes (bouts ronds, bouts droits) sont présentées.
7.3. Cotation Fonctionnelle d’un Assemblage Claveté
La méthode de cotation d’une rainure de clavette sur un arbre et dans un alésage est détaillée, en insistant sur les cotes tolérancées qui garantissent l’ajustement correct.
7.4. Représentation des Arbres Cannelés
Les cannelures sont présentées comme une solution plus robuste que les clavettes pour la transmission de couples importants. Leur représentation conventionnelle simplifiée est enseignée.
Chapitre 8 : Les Organes de Guidage en Rotation : Paliers et Roulements
Ce chapitre est consacré à la conception et au dessin des solutions qui permettent de guider un arbre en rotation, une fonction centrale dans la quasi-totalité des machines.
8.1. Représentation des Paliers Lisses (Coussinets)
Le principe du palier lisse, où l’arbre tourne dans un coussinet lubrifié, est expliqué. La représentation de ses composants (corps de palier, coussinet, système de lubrification) est étudiée.
8.2. Représentation Normalisée et Simplifiée des Roulements
Les roulements à billes ou à rouleaux étant des composants normalisés complexes, leur représentation est toujours simplifiée sur les dessins. Les conventions graphiques pour les différents types de roulements sont enseignées.
8.3. Montage des Roulements : Ajustements et Obstacles
Les règles de montage des roulements sont abordées : choix des ajustements pour la bague intérieure et la bague extérieure, et conception des épaulements et des autres obstacles (écrous à encoches, circlips) pour assurer leur positionnement axial.
8.4. Étude de cas : Dessin d’un Palier Complet pour Ventilateur Industriel
La conception complète d’un support de palier, depuis le choix du roulement dans un catalogue jusqu’au dessin de définition de l’arbre et du logement, constitue un exercice de synthèse majeur.
Partie IV : Études de Cas et Projets de Conception
Cette dernière partie est entièrement dédiée à la mise en application des compétences acquises à travers des études de conception supervisées. L’élève est mis en situation de technicien de bureau d’études pour résoudre des problèmes concrets.
Chapitre 9 : Méthodologie de l’Étude de Conception Mécanique
Ce chapitre formalise la démarche de projet qui sera appliquée dans les chapitres suivants, en structurant le processus de conception.
9.1. Du Cahier des Charges à la Solution de Principe
La première étape de la conception est présentée : traduire le besoin fonctionnel décrit dans un cahier des charges en une ou plusieurs solutions techniques schématisées.
9.2. Prise en Compte des Contraintes de Fabrication
L’élève apprend à orienter ses choix de conception en fonction des capacités de l’atelier de fabrication. Il s’agit de concevoir des pièces « usinables » à un coût raisonnable.
9.3. Prise en Compte des Contraintes de Montage et de Maintenance
La conception doit intégrer les aspects liés à la vie ultérieure du produit : facilité de montage, accessibilité pour le réglage, possibilité de démontage pour la maintenance, des aspects cruciaux pour les techniciens sur le terrain.
9.4. Élaboration du Dossier Technique : Nomenclature et Plans
La constitution du dossier de plans final est décrite : il doit comporter un plan d’ensemble, les dessins de définition de toutes les pièces non standards, et une nomenclature complète.
Chapitre 10 : Projet Guidé 1 – Étude d’un Système de Bridage
Un premier projet simple et guidé permet d’appliquer la méthodologie sur un cas concret et maîtrisé.
10.1. Analyse du Besoin et Définition des Fonctions
Le cahier des charges d’un dispositif de bridage pour une pièce sur une machine-outil est analysé. Les fonctions (positionner, serrer, desserrer) sont identifiées.
10.2. Conception et Dessin d’Ensemble de la Bride
Les élèves, guidés par l’enseignant, dessinent une solution pour le système de bridage, en choisissant les composants standards et en esquissant les pièces spécifiques.
10.3. Dessin de Définition de la Vis de Serrage
Le dessin de définition complet de la vis de manœuvre est réalisé, en spécifiant la matière, les filetages, les tolérances et les états de surface.
10.4. Dessin de Définition du Corps de la Bride
Le dessin de définition du corps principal du dispositif est élaboré, en portant une attention particulière à la cotation fonctionnelle et aux spécifications géométriques.
Chapitre 11 : Projet Guidé 2 – Étude d’un Guidage en Translation
Un second projet, légèrement plus complexe, aborde la conception d’un mécanisme de guidage, très courant en machine-outil.
11.1. Analyse du Besoin : Guidage d’un Chariot sur un Banc
Le cahier des charges pour un guidage en translation précis est présenté, avec des contraintes de course, de charge et de précision.
11.2. Conception et Dessin d’Ensemble du Guidage par Glissière
Une solution classique de guidage par glissière en queue d’aronde ou prismatique est choisie et dessinée en plan d’ensemble.
11.3. Dessin de Définition du Chariot avec Spécifications Géométriques
Le dessin du chariot est réalisé en portant une attention particulière aux tolérances de parallélisme et de planéité des surfaces de guidage, qui garantissent la précision du mouvement.
11.4. Dessin de Définition du Système de Réglage de Jeu (Lardon)
Le dessin du lardon, pièce essentielle qui permet de rattraper l’usure et de garantir l’absence de jeu dans le guidage, est étudié et dessiné en détail.
Annexes
Les annexes sont des outils de référence essentiels pour la réalisation des études et des projets de conception.
Catalogue de Composants Standards 🔩
Cette section fournit des extraits de catalogues de fabricants pour des composants courants (roulements, vis, circlips, etc.), permettant à l’élève de choisir des éléments normalisés et de trouver leurs dimensions d’encombrement.
Aide-Mémoire des Liaisons Mécaniques 🔗
Un tableau synthétique présente les principaux types de liaisons, leurs degrés de liberté, leurs symboles schématiques et les solutions technologiques courantes pour les réaliser.
Guide de Conception pour la Fabrication 🛠️
Cette annexe propose une série de recommandations de conception (« Design for Manufacturing »), sous forme de fiches pratiques, pour aider l’élève à concevoir des pièces faciles et économiques à usiner.