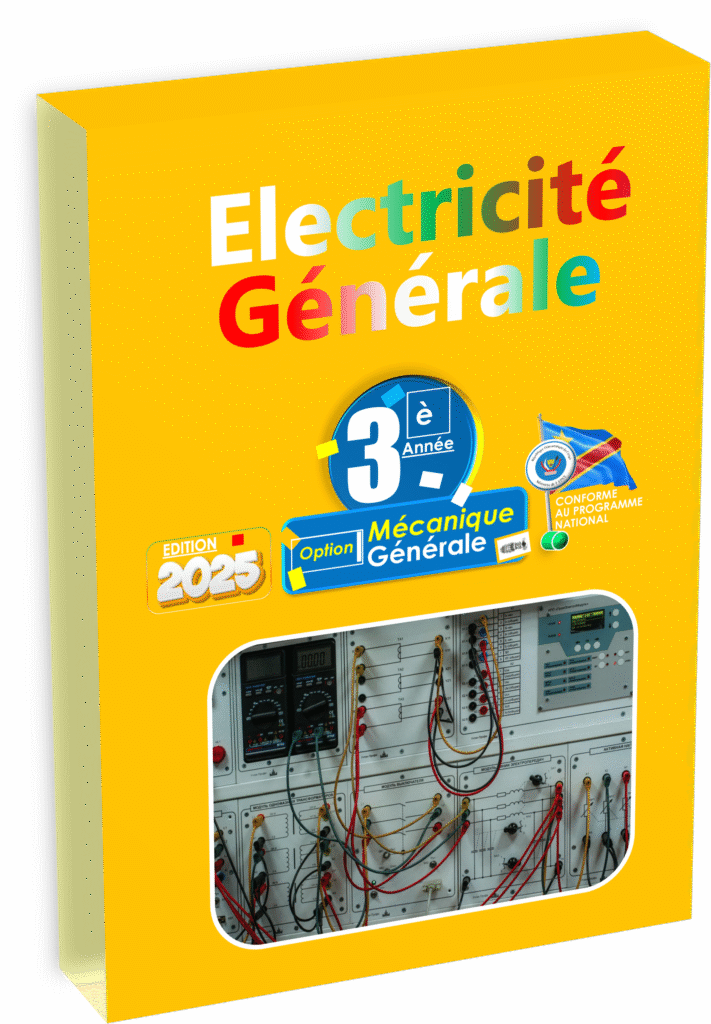
ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE ET AUTOMATISMES, 4 ÈME ANNEE, OPTION MECANIQUE GENERALE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
Préliminaires
Objectifs Pédagogiques du Cours 🎯
Ce cours, qui couronne le cycle de formation en électricité, a pour objectif de rendre le technicien mécanicien apte à comprendre, installer et maintenir les équipements électriques qui animent les systèmes de production. Au terme de cette année, l’élève doit maîtriser le fonctionnement et la commande des moteurs asynchrones triphasés, comprendre le rôle des transformateurs dans la distribution d’énergie, et être capable d’analyser et de concevoir des circuits d’automatisme électromécanique simples. Cette compétence est le pont indispensable entre la mécanique et l’électricité, formant des techniciens polyvalents aptes à intervenir sur des systèmes complets.
Approche Didactique et Méthodologique 🔌
L’enseignement est résolument tourné vers les applications industrielles. Chaque machine ou composant est étudié sous l’angle de sa fonction, de sa mise en œuvre et de sa maintenance. La lecture et la création de schémas électriques (puissance et commande) constituent l’activité centrale du cours. Une part importante est consacrée à la logique câblée, qui est la base de l’automatisme industriel. Des études de cas concrets et des travaux pratiques sur des bancs didactiques ou des équipements réels permettent de passer de l’analyse théorique à la réalisation pratique et au dépannage.
Contexte Industriel et Sécurité ⚡
Le cours s’ancre dans les réalités du tissu industriel congolais, en prenant pour exemples les démarreurs de moteurs des broyeurs de l’industrie minière, les circuits de commande des machines de l’industrie agroalimentaire à Kinshasa, ou les systèmes de pompage automatisés de la REGIDESO. La sécurité électrique en milieu industriel est un thème transversal et prioritaire. Les règles de consignation, le travail hors tension, le choix des dispositifs de protection (disjoncteurs, fusibles, relais thermiques) et les risques liés aux interventions sur les armoires électriques sont étudiés avec la plus grande rigueur.
Partie I : Les Machines Tournantes à Courant Alternatif
Cette partie est consacrée à l’étude du moteur asynchrone triphasé, qui représente plus de 80% des moteurs utilisés dans l’industrie. Sa robustesse, son faible coût et son entretien réduit en font le « cheval de bataille » de l’industrie mécanique.
Chapitre 1 : Le Champ Tournant et le Moteur Asynchrone Triphasé
Ce chapitre expose le principe physique génial à la base du fonctionnement de tous les moteurs à courant alternatif et décrit la constitution de la machine la plus répandue.
1.1. Création du Champ Magnétique Tournant
Le principe de la création d’un champ magnétique tournant à partir de trois enroulements décalés dans l’espace et alimentés par des courants triphasés est expliqué. Ce concept, attribué à Nikola Tesla, est la clé de la simplicité et de l’efficacité des moteurs à induction.
1.2. Le Moteur Synchrone : Principe et Propriétés
Le moteur synchrone est brièvement présenté comme une machine dont le rotor tourne à la même vitesse que le champ tournant. Ses propriétés spécifiques (vitesse constante, possibilité de régulation du facteur de puissance) et ses applications (entraînements de très forte puissance) sont mentionnées.
1.3. Constitution du Moteur Asynchrone à Cage d’Écureuil
La constitution du moteur asynchrone est détaillée : le stator, qui contient les enroulements créant le champ tournant, et le rotor en court-circuit, dit « à cage d’écureuil », dont la simplicité et l’absence de contacts électriques sont la source de sa robustesse.
1.4. Constitution du Moteur Asynchrone à Rotor Bobiné
Le moteur à rotor bobiné est présenté comme une variante technologique. Son rotor contient des enroulements accessibles via des bagues et des balais, ce qui permet d’insérer des résistances dans le circuit rotorique, principalement pour la phase de démarrage.
Chapitre 2 : Caractéristiques et Fonctionnement du Moteur Asynchrone
Ce chapitre analyse le comportement du moteur asynchrone en fonctionnement, en introduisant la notion fondamentale de glissement.
2.1. Le Phénomène de Glissement
Le glissement est défini comme la différence de vitesse relative entre le champ tournant statorique et le rotor. Il est expliqué que ce glissement est indispensable pour qu’il y ait induction de courants dans le rotor, et donc création d’un couple moteur.
2.2. Le Couple Moteur et sa Caractéristique
L’allure de la courbe du couple en fonction de la vitesse (ou du glissement) est analysée. Les points caractéristiques sont identifiés : le couple de démarrage, le couple maximal et le couple nominal. L’adaptation de cette courbe à la charge entraînée est discutée.
2.3. Fonctionnement à Vide et en Charge
Le comportement du moteur est comparé à vide (glissement très faible) et en charge (le glissement augmente pour fournir le couple requis). La plaque signalétique du moteur est déchiffrée pour en extraire les informations nominales (puissance, tension, courant, vitesse).
2.4. Avantages Comparés des Moteurs à Cage et à Rotor Bobiné
Une comparaison est établie : le moteur à cage est simple et sans entretien, tandis que le moteur à rotor bobiné, plus complexe, offre un couple de démarrage très élevé et réglable, ce qui le destine à l’entraînement de charges à forte inertie comme les grands ventilateurs de mine au Katanga.
Chapitre 3 : Les Procédés de Démarrage des Moteurs Asynchrones
Ce chapitre, d’une grande importance pratique, étudie les différentes solutions pour démarrer un moteur asynchrone en limitant l’appel de courant, qui peut être très élevé en démarrage direct.
3.1. Le Démarrage Direct (DOL)
Le démarrage direct est présenté comme la solution la plus simple, mais réservée aux moteurs de faible puissance, car l’appel de courant peut atteindre 5 à 8 fois le courant nominal, provoquant des chutes de tension sur le réseau.
3.2. Le Démarrage Étoile-Triangle
C’est le procédé le plus répandu pour les moteurs de moyenne puissance. Le principe, qui consiste à sous-alimenter le moteur en le couplant en étoile pendant la première phase du démarrage, permet de diviser l’appel de courant par trois. Le schéma de puissance et de commande est détaillé.
3.3. Le Démarrage par Résistances Statoriques ou par Autotransformateur
Ces deux méthodes, qui consistent également à démarrer sous tension réduite, sont présentées. Le démarrage par autotransformateur, bien que plus coûteux, offre une meilleure performance en termes de couple.
3.4. Le Démarrage des Moteurs à Rotor Bobiné
Le démarrage par élimination progressive de résistances rotoriques est expliqué. Cette méthode permet d’obtenir un couple de démarrage très élevé tout en maîtrisant parfaitement le courant, ce qui est idéal pour les charges les plus difficiles.
Chapitre 4 : Variation de Vitesse et Moteurs Spéciaux
Ce chapitre aborde les solutions pour faire varier la vitesse des moteurs asynchrones et présente quelques technologies alternatives.
4.1. Variation de Vitesse par Changement du Nombre de Pôles
Le principe du moteur à plusieurs polarités (moteur Dahlander ou à enroulements séparés) est expliqué. Cette solution permet d’obtenir plusieurs vitesses fixes (généralement 2 ou 3), une technique utilisée sur certaines machines-outils anciennes.
4.2. Introduction aux Variateurs de Vitesse Électroniques
Le variateur de fréquence est présenté comme la solution moderne et la plus performante pour faire varier la vitesse d’un moteur asynchrone de manière continue, en agissant simultanément sur la fréquence et la tension d’alimentation.
4.3. Le Moteur Asynchrone Monophasé
Le moteur asynchrone monophasé, très répandu dans le domaine domestique et les petits ateliers, est étudié. Le rôle du condensateur (de démarrage ou permanent) pour créer un champ tournant dephasé est expliqué.
4.4. Le Moteur Universel
Le moteur universel, qui a la particularité de pouvoir fonctionner aussi bien en courant continu qu’en courant alternatif (d’où son nom), est présenté. Sa grande vitesse de rotation le destine aux applications d’électroportatif (perceuses, meuleuses).
Partie II : Les Transformateurs et le Transport de l’Énergie
Cette partie est consacrée à l’étude du transformateur, une machine électrique statique qui joue un rôle absolument crucial dans les réseaux électriques en permettant de modifier les niveaux de tension.
Chapitre 5 : Le Transformateur Monophasé
Ce chapitre se concentre sur les principes de base du transformateur en étudiant le cas du modèle monophasé.
5.1. Constitution et Principe de Fonctionnement
La constitution du transformateur (un circuit magnétique feuilleté et deux enroulements, primaire et secondaire) est décrite. Son principe, basé sur l’induction électromagnétique, est expliqué : la variation de flux créée par le primaire induit une F.É.M. au secondaire.
5.2. Étude Théorique et Rapport de Transformation
Le transformateur parfait (sans pertes) est modélisé. Le rapport de transformation () est établi, montrant que les tensions sont proportionnelles aux nombres de spires.
5.3. Fonctionnement en Charge et Bilan des Puissances
Le comportement du transformateur en charge est analysé. Le bilan des puissances est effectué en identifiant les deux sources de pertes : les pertes par effet Joule dans les enroulements (« pertes cuivre ») et les pertes magnétiques dans le circuit ferromagnétique (« pertes fer »).
5.4. L’Autotransformateur : Principe et Risques
L’autotransformateur, qui ne possède qu’un seul enroulement avec une prise intermédiaire, est présenté. Son rendement plus élevé et son coût plus faible sont mis en balance avec le risque principal : l’absence d’isolation galvanique entre le primaire et le secondaire.
Chapitre 6 : Le Transformateur Triphasé et ses Applications
Ce chapitre étend l’étude aux transformateurs triphasés, qui sont les composants clés de tous les réseaux de transport et de distribution d’énergie.
6.1. Constitution et Couplage des Enroulements
La constitution d’un transformateur triphasé (soit par trois transformateurs monophasés, soit sur un noyau à trois colonnes) est montrée. Les différents couplages possibles des enroulements (Étoile, Triangle, Zigzag) sont étudiés.
6.2. Indice Horaire et Groupe de Couplage
La notion d’indice horaire, qui caractérise le déphasage entre les tensions primaires et secondaires, est introduite. La plaque signalétique d’un transformateur (ex: Dyn11) est déchiffrée. Le respect de ce groupe de couplage est essentiel pour la mise en parallèle de transformateurs.
6.3. Technologie et Refroidissement
Les aspects technologiques sont abordés : la cuve, les traversées isolantes, et surtout les différents modes de refroidissement (naturel dans l’air, dans l’huile, avec ventilation ou circulation forcée) qui conditionnent la puissance admissible du transformateur.
6.4. Rôle dans le Transport et la Distribution de l’Énergie
Le rôle stratégique du transformateur est synthétisé : des transformateurs élévateurs à la sortie des centrales comme celle d’Inga pour transporter l’énergie sous très haute tension et minimiser les pertes, et des transformateurs abaisseurs dans les postes de distribution pour ramener la tension à un niveau utilisable par les industries et les particuliers.
Partie III : Applications Industrielles de l’Électricité
Cette partie explore des applications technologiques directes de l’électricité, où l’énergie électrique est utilisée pour produire de la chaleur ou pour équiper et commander des machines.
Chapitre 7 : L’Électrothermie : Chauffage et Soudage
Ce chapitre étudie les procédés qui convertissent l’énergie électrique en énergie thermique à des fins industrielles.
7.1. Le Chauffage par Résistance (Effet Joule)
Le principe du chauffage par effet Joule dans des résistances électriques est rappelé. Des applications industrielles comme les fours de traitement thermique, les étuves ou les presses de vulcanisation pour l’industrie du caoutchouc sont présentées.
7.2. Le Chauffage par Induction
Le principe du chauffage par induction, où des courants de Foucault sont induits dans une pièce métallique conductrice placée dans un champ magnétique variable, est expliqué. Ce procédé permet un chauffage très rapide et localisé.
7.3. Le Soudage à l’Arc Électrique
Le principe du soudage à l’arc est décrit : l’arc électrique qui jaillit entre une électrode et la pièce à souder génère une chaleur intense qui provoque la fusion localisée du métal. Les postes de soudage statiques (transformateurs) sont étudiés.
7.4. Le Soudage par Résistance
Le principe du soudage par résistance est expliqué : un courant très intense traverse les pièces à assembler, et la chaleur dégagée par effet Joule au point de contact provoque une soudure. Les applications du soudage par points (carrosserie) et bout à bout sont montrées.
Chapitre 8 : Équipement Électrique des Machines-Outils
Ce chapitre fait la synthèse entre la connaissance des moteurs et celle des machines-outils, en analysant leur équipement électrique.
8.1. Distinction entre Circuit de Puissance et Circuit de Commande
La structure de toute armoire électrique est analysée en séparant le circuit de puissance, qui alimente les moteurs à la tension du réseau, et le circuit de commande, qui gère la logique de fonctionnement et fonctionne généralement en basse tension de sécurité.
8.2. Lecture de Schémas Électriques de Machines
La lecture de schémas électriques développés pour des machines simples (tour, perceuse) est exercée. L’élève apprend à suivre le cheminement de l’énergie et des ordres de commande et à identifier chaque composant.
8.3. Les Dispositifs de Protection des Moteurs
Les dispositifs indispensables à la protection d’un moteur sont décrits : la protection contre les courts-circuits (assurée par des fusibles ou un disjoncteur magnétique) et la protection contre les surcharges (assurée par le relais thermique).
8.4. Interfaçage avec les Systèmes Pneumatiques et Hydrauliques
La synergie entre les technologies est montrée. Des exemples de systèmes où un automate électrique commande des électro-distributeurs pour piloter des vérins pneumatiques ou hydrauliques sont étudiés, illustrant la base de la mécatronique.
Partie IV : Introduction à l’Automatisme Électromécanique
Cette dernière partie est une initiation à la logique de commande câblée, qui est le fondement de l’automatisation des machines et des processus industriels.
Chapitre 9 : Les Composants de Commande : Contacteurs et Relais
Ce chapitre présente les « muscles » et les « nerfs » du circuit de commande : les contacteurs, qui commutent la puissance, et les relais, qui traitent les signaux logiques.
9.1. Le Contacteur Électromagnétique
Le contacteur est décrit comme un interrupteur de puissance commandé à distance par un électroaimant. Sa constitution (bobine, circuit magnétique, contacts de puissance, contacts auxiliaires) est détaillée.
9.2. Le Relais Thermique de Surcharge
Le relais thermique est présenté comme le protecteur du moteur contre les surcharges prolongées. Son principe, basé sur des bilames qui se déforment sous l’effet de la chaleur, et son intégration avec le contacteur sont expliqués.
9.3. Les Relais Auxiliaires
Les relais auxiliaires sont décrits comme des contacteurs de faible puissance, utilisés uniquement dans le circuit de commande pour mémoriser des états, réaliser des fonctions logiques ou multiplier le nombre de contacts disponibles.
9.4. Les Blocs de Temporisation
Les relais temporisés (au travail ou au repos) sont introduits comme des composants permettant de créer des retards dans une séquence d’automatisme, une fonction essentielle dans de nombreux processus.
Chapitre 10 : Les Capteurs et Détecteurs Industriels
Ce chapitre aborde les « organes des sens » de la machine automatisée, qui lui permettent d’acquérir des informations sur son état et sur son environnement.
10.1. Les Boutons-Poussoirs et Sélecteurs
Les organes de dialogue homme-machine les plus simples sont présentés : les boutons-poussoirs (marche, arrêt, coup de poing), les sélecteurs à plusieurs positions, et les voyants lumineux.
10.2. Les Détecteurs de Position Mécaniques (Fins de Course)
Les interrupteurs de position, ou fins de course, sont décrits comme des capteurs actionnés par un contact physique avec un mobile, permettant de détecter la position d’un chariot ou l’ouverture d’une porte.
10.3. Les Détecteurs de Proximité Statiques
Une introduction aux capteurs sans contact est faite : les détecteurs inductifs (qui détectent les métaux), les détecteurs capacitifs (qui détectent tous les matériaux) et les détecteurs photoélectriques (barrières lumineuses).
10.4. Les Capteurs de Processus : Pression, Température, Niveau
Les capteurs qui mesurent des grandeurs physiques continues sont présentés : le pressostat (qui commute un contact à un seuil de pression), le thermostat (seuil de température) et les détecteurs de niveau (à flotteur, etc.).
Chapitre 11 : Logique Câblée et Schémas de Commande
Ce chapitre est le cœur de l’automatisme. Il enseigne comment agencer les composants de commande pour réaliser des fonctions logiques et des séquences automatiques.
11.1. Les Fonctions Logiques de Base (ET, OU, NON)
La réalisation des fonctions logiques de base par câblage de contacts est expliquée : la fonction ET par la mise en série de contacts, la fonction OU par la mise en parallèle de contacts.
11.2. Le Schéma d’Auto-Maintien (Mémoire)
Le circuit d’auto-alimentation (ou de mémorisation) d’un contacteur à l’aide d’un de ses propres contacts auxiliaires est présenté comme le montage fondamental pour qu’un ordre « marche » donné par une impulsion soit maintenu.
11.3. Les Verrouillages Électriques
Le principe du verrouillage électrique, qui consiste à utiliser un contact normalement fermé d’un contacteur pour interdire l’enclenchement d’un autre contacteur, est expliqué. C’est le montage de sécurité indispensable pour un inverseur de sens de marche.
11.4. Lecture et Conception de Schémas Développés
La méthode de lecture et de conception de schémas de commande développés est systématisée. L’élève apprend à suivre la logique du circuit, du départ de la ligne jusqu’aux bobines des contacteurs, pour en comprendre le fonctionnement séquentiel.
Chapitre 12 : Études de Cas d’Automatisation de Systèmes
Ce chapitre de synthèse applique l’ensemble des connaissances acquises à l’analyse et à la conception de circuits d’automatisme pour des systèmes industriels complets et concrets.
12.1. Étude : Commande d’un Démarrage Étoile-Triangle Automatique
Le schéma de commande complet pour un démarrage étoile-triangle entièrement automatique (avec temporisation) est analysé en détail, en identifiant les contacteurs de ligne, étoile et triangle, ainsi que leurs verrouillages mutuels.
12.2. Étude : Automatisation d’une Perceuse Sensitive
Un cycle simple de perçage (descente rapide, descente lente en travail, retour rapide) commandé par des fins de course est étudié, illustrant un automatisme séquentiel de base.
12.3. Étude : Automatisation d’une Station de Pompage
La commande automatique d’une pompe pour le remplissage d’un réservoir est analysée. Le circuit utilise des détecteurs de niveau bas et haut pour commander le démarrage et l’arrêt de la pompe, une application typique à la REGIDESO.
12.4. Étude : Commande d’une Porte de Garage Automatique
Un dernier cas concret, la commande d’une porte de garage avec inversion du sens de marche, fins de course, et sécurités, permet de réaliser une synthèse complète des logiques d’automatisme étudiées.
Annexes
Les annexes fournissent des documents de référence rapide qui sont des outils de travail quotidiens pour le technicien en électromécanique.
Bibliothèque de Schémas de Démarrage Moteur 📖
Cette section regroupe les schémas de puissance et de commande pour les principaux types de démarrage de moteurs asynchrones (direct, étoile-triangle, par résistances statoriques).
Symboles Normalisés pour Schémas de Commande 🗺️
Une planche récapitulative présente les symboles graphiques normalisés pour tous les composants d’automatisme étudiés (contacteurs, relais, boutons, capteurs, etc.).
Guide de Dépannage pour la Commande Moteur 🔍
Un tableau synthétique aide au diagnostic des pannes les plus fréquentes sur un départ-moteur (ex: « le moteur ne démarre pas », « le relais thermique déclenche »), en listant les causes probables et les vérifications à effectuer sur les circuits de puissance et de commande.