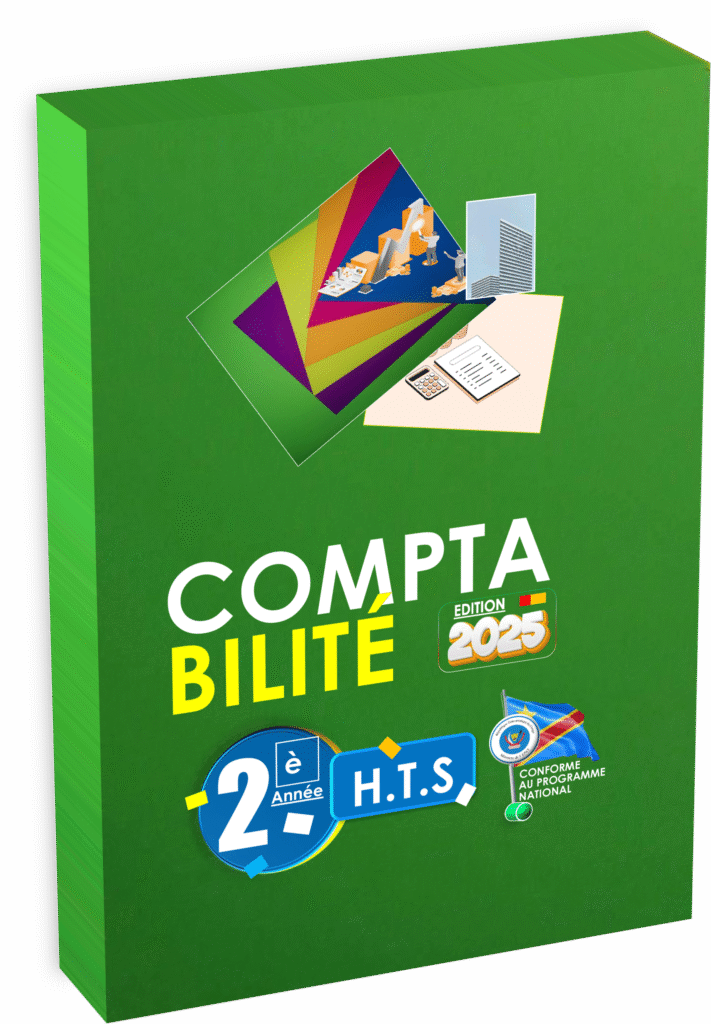
Cliquez pour lire
PRÉLIMINAIRES
Présentation du Programme National 📜
Ce cours de comptabilité est rigoureusement aligné sur le curriculum national de la République Démocratique du Congo pour l’option Techniques Sociales. Il vise à équiper les futurs techniciens des compétences comptables fondamentales, spécifiquement adaptées à la gestion des entités à vocation sociale, telles que les organisations non gouvernementales, les coopératives ou les mutuelles de santé. L’articulation du programme garantit une conformité totale avec les finalités de formation édictées par l’État, assurant ainsi la reconnaissance nationale du diplôme.
Objectifs Pédagogiques Généraux 🎯
À l’issue de cette formation, l’élève maîtrisera les compétences suivantes :
- Comprendre l’environnement comptable congolais régi par le système OHADA et ses principes fondamentaux.
- Enregistrer de manière chronologique et systématique les opérations courantes d’une organisation (achats, ventes, règlements).
- Traiter les opérations relatives à la paie du personnel en appliquant la législation sociale et fiscale de la RDC.
- Participer à l’élaboration des travaux de fin d’exercice et à la production des états financiers annuels.
- Gérer les documents comptables et pièces justificatives avec méthode et rigueur.
Méthodologie d’Enseignement 🧑🏫
L’approche pédagogique privilégie la méthode active et l’ancrage dans les réalités socio-économiques congolaises. Chaque concept théorique sera systématiquement illustré par des études de cas concrètes : la gestion d’un centre de santé à Mbuji-Mayi, le suivi des stocks d’une coopérative agricole dans la province du Kwilu, ou l’établissement de la paie pour une association de développement communautaire à Bukavu. Des simulations de gestion, des travaux pratiques sur pièces comptables et des projets de groupe favoriseront le développement de l’autonomie et des compétences professionnelles.
Modalités d’Évaluation 📝
L’évaluation des acquis combine deux approches complémentaires :
- L’évaluation formative : Réalisée en continu tout au long de l’année, elle prend la forme d’interrogations orales, d’exercices d’application, de tests rapides et de devoirs à domicile. Son but est de mesurer la progression de l’élève et de remédier immédiatement aux difficultés d’apprentissage.
- L’évaluation sommative : Organisée à la fin de chaque semestre, elle se matérialise par un examen écrit portant sur des problématiques de synthèse. Elle certifie le degré d’acquisition des compétences définies par les objectifs du programme.
PREMIÈRE PARTIE : FONDEMENTS DE LA COMPTABILITÉ SELON OHADA
CHAPITRE 1 : INTRODUCTION À LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 📘
1.1 Notion d’entreprise et de patrimoine
Cette section définit l’entité économique comme un agent distinct de ses propriétaires, possédant un patrimoine propre composé de biens (actifs) et de dettes (passifs). L’étude s’appuie sur l’exemple d’une micro-entreprise de transformation de manioc à Kananga pour illustrer concrètement la composition d’un patrimoine initial.
1.2 Généralités sur la comptabilité
La comptabilité est présentée comme un système d’information normalisé servant à collecter, traiter et communiquer des données financières pertinentes pour la prise de décision. Son rôle est essentiel pour la gestion interne, la reddition des comptes aux partenaires et le respect des obligations légales.
1.3 Présentation générale du système comptable OHADA
Ici est introduit le cadre juridique de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), qui standardise les pratiques comptables en RDC et dans 16 autres États africains. L’accent est mis sur l’objectif de fiabilité et de comparabilité de l’information financière.
1.4 Principes comptables fondamentaux
L’analyse porte sur les postulats qui gouvernent la tenue de la comptabilité selon l’Acte Uniforme OHADA : coût historique, prudence, continuité de l’exploitation, indépendance des exercices. Chaque principe est expliqué à l’aide d’un cas pratique simple pour en assurer la parfaite compréhension.
1.5 Organisation comptable et plan comptable
Ce point détaille les obligations en matière d’organisation comptable (tenue de livres obligatoires) et présente la structure du plan comptable général OHADA. Les élèves apprennent la classification des comptes en grandes masses (classes) et leur codification décimale.
CHAPITRE 2 : DOCUMENTS COMMERCIAUX ET COMPTABLES 📂
2.1 Factures et documents de vente
La facture est étudiée comme la pièce justificative fondamentale qui matérialise une opération commerciale. Les élèves apprennent à identifier ses mentions obligatoires et à la distinguer d’autres documents comme le devis ou le bon de commande.
2.2 Bons de commande et de livraison
Le bon de commande est présenté comme la formalisation d’un accord commercial, tandis que le bon de livraison prouve la réception physique des biens. Leur articulation avec le processus de facturation est clairement explicitée.
2.3 Quittances et reçus
La distinction est faite entre la quittance, qui atteste du paiement d’une dette, et le reçu, qui confirme la remise d’une somme ou d’un bien. Leur importance comme preuve de règlement est soulignée.
2.4 Organisation des pièces justificatives
Cette section aborde les méthodes de classement (numérique, chronologique, alphabétique) des pièces comptables. L’objectif est de garantir un accès rapide à l’information et de faciliter les contrôles ultérieurs.
2.5 Contrôle et archivage des documents
Sont exposées les procédures de contrôle interne visant à vérifier la validité et la régularité des pièces justificatives avant leur enregistrement. Les obligations légales en matière de durée et de modalités d’archivage sont également précisées.
CHAPITRE 3 : LE SYSTÈME COMPTABLE ET LA PARTIE DOUBLE ⚖️
3.1 Notion de bilan et comptes
Le bilan est introduit comme une photographie du patrimoine de l’entité à un instant T, présentant d’un côté l’actif (ce que l’entreprise possède) et de l’autre le passif (ce qu’elle doit). La notion de compte est ensuite définie comme l’outil de suivi des variations de chaque élément du patrimoine.
3.2 La partie double et l’équilibre comptable
Ce point constitue le cœur du mécanisme comptable. Le principe de la partie double est expliqué : toute opération est enregistrée dans au moins deux comptes, l’un étant débité et l’autre crédité pour un montant identique, maintenant ainsi l’équilibre fondamental Emplois = Ressources.
3.3 Notion de flux comptables
Les opérations de l’entreprise sont analysées en termes de flux : flux réels (mouvements de biens et services) et flux monétaires (mouvements d’argent). La comptabilité se charge de traduire ces flux en écritures.
3.4 Journal et grand livre
La fonction des deux livres comptables principaux est détaillée. Le journal enregistre les opérations de manière chronologique, tandis que le grand livre les regroupe par nature de compte, permettant de connaître le solde de chacun.
3.5 Correction des erreurs comptables
Les élèves apprennent les techniques admises pour rectifier les erreurs d’enregistrement (contre-passation, complément à zéro) en proscrivant formellement l’usage de ratures ou de suppressions, afin de garantir l’intangibilité des écritures.
DEUXIÈME PARTIE : OPÉRATIONS COURANTES DE L’ENTREPRISE
CHAPITRE 4 : ACHATS ET VENTES DE MARCHANDISES 🛒
4.1 Facturation et réductions commerciales
Cette section détaille le calcul et l’enregistrement des réductions commerciales (rabais, remises, ristournes) qui viennent en déduction du montant brut des ventes ou des achats.
4.2 Transport et frais accessoires
Le traitement comptable des frais liés aux achats (transport, assurance, commissions) est expliqué. Les élèves apprennent à incorporer ces frais au coût d’acquisition des marchandises.
4.3 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Le mécanisme de la TVA est décortiqué : TVA collectée sur les ventes, TVA déductible sur les achats, et détermination de la TVA à décaisser à l’État. L’application pratique se base sur les taux en vigueur en RDC.
4.4 Avances et acomptes
La distinction comptable et juridique entre les avances (versées avant tout commencement d’exécution) et les acomptes (versés au cours de l’exécution) est établie, tant du point de vue du client que du fournisseur.
4.5 Factures d’avoir et retours
L’établissement et l’enregistrement des factures d’avoir, qui annulent ou rectifient une facture initiale (suite à un retour de marchandises ou à l’octroi d’une réduction hors facture), sont traités en détail.
CHAPITRE 5 : GESTION DES STOCKS ET EMBALLAGES 📦
5.1 Inventaire permanent et intermittent
Les deux méthodes de suivi des stocks sont présentées. L’inventaire intermittent consiste en un comptage physique en fin de période, tandis que l’inventaire permanent enregistre les entrées et sorties en temps réel.
5.2 Valorisation des stocks (CMUP)
La méthode du Coût Moyen Unitaire Pondéré (CMUP) après chaque entrée est expliquée comme méthode de référence pour valoriser les sorties de stock et le stock final. Des exercices pratiques en assurent la maîtrise.
5.3 Emballages perdus et récupérables
La distinction est faite entre les emballages non restituables (cartons, sachets), dont le coût est inclus dans le prix de vente, et les emballages récupérables (bouteilles, caisses) qui peuvent être consignés.
5.4 Consignation et déconsignation
Le traitement comptable spécifique de la consignation est abordé : la dette du client envers le fournisseur pour les emballages, et l’annulation de cette dette lors de leur restitution (déconsignation).
5.5 Fiche de stock et contrôles
L’utilisation de la fiche de stock comme outil de suivi quantitatif et valorisé des mouvements d’un article est enseignée. Elle est un instrument essentiel du contrôle interne des existants.
CHAPITRE 6 : MOYENS DE RÈGLEMENT ET TRÉSORERIE 💰
6.1 Chèques et virements bancaires
L’enregistrement des règlements effectués ou reçus par voie bancaire est détaillé, en insistant sur les dates de valeur et l’impact sur le compte « Banque ».
6.2 Espèces et caisse
La gestion de la caisse est abordée, incluant l’enregistrement des encaissements et décaissements en espèces, la tenue d’un brouillard de caisse et les contrôles physiques.
6.3 Cartes bancaires
Le traitement comptable des paiements par carte bancaire est présenté, en tenant compte des commissions prélevées par les institutions financières.
6.4 État de rapprochement bancaire
Cette technique indispensable est enseignée pour justifier les différences entre le solde du compte « Banque » en comptabilité et le solde du relevé bancaire, par l’identification des opérations non encore enregistrées par l’une ou l’autre partie.
6.5 Recouvrement des créances
Les procédures comptables et administratives de suivi des comptes clients sont explorées, de la simple relance à la préparation d’un dossier pour le contentieux, illustré par un cas dans une mutuelle de santé à Lubumbashi.
TROISIÈME PARTIE : PAIE ET CHARGES SOCIALES
CHAPITRE 7 : RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL 👥
7.1 Structure de la rémunération
La composition du salaire brut est analysée : salaire de base, heures supplémentaires, primes et gratifications. Chaque élément est défini selon les dispositions du Code du travail congolais.
7.2 Indemnités et avantages
Le calcul et la comptabilisation des indemnités (transport, logement) et des avantages en nature (nourriture, véhicule) sont traités, en précisant leur soumission ou non aux cotisations sociales.
7.3 Calcul du salaire net
L’élève apprend à déduire du salaire brut les retenues légales pour obtenir le salaire net à payer : cotisations sociales salariales (INSS), impôt professionnel (IPR) et autres retenues.
7.4 Personnel intérimaire
Les spécificités de la comptabilisation des factures émises par les entreprises de travail temporaire sont abordées, en distinguant le coût de la prestation de la rémunération elle-même.
7.5 Avances et prêts au personnel
Le traitement comptable des avances et prêts consentis aux salariés est détaillé, incluant la gestion des échéances de remboursement par retenue sur salaire.
CHAPITRE 8 : FISCALITÉ SOCIALE ET COTISATIONS 🏛️
8.1 Impôt professionnel sur les salaires
Cette section est consacrée au calcul de l’IPR selon le barème légal en vigueur, en tenant compte de la situation familiale du salarié. La comptabilisation de la retenue à la source et de son reversement à l’État est expliquée.
8.2 Cotisations INSS (QPO et QPP)
Le calcul des cotisations à l’Institut National de Sécurité Sociale est détaillé, en séparant la part salariale de la part patronale pour le régime général (maladie, pension) et le régime des risques professionnels.
8.3 Cotisations ONEM
Le calcul de la contribution due à l’Office National de l’Emploi par l’employeur est présenté, ainsi que son enregistrement en tant que charge de personnel.
8.4 Déclarations fiscales et sociales
Les élèves apprennent à synthétiser les informations de la paie pour remplir les formulaires de déclaration mensuelle de l’IPR et des cotisations sociales et à comptabiliser leur paiement.
8.5 Saisie-arrêt et oppositions
Le traitement des saisies sur salaire ordonnées par la justice est abordé. La procédure de calcul de la quotité saisissable et l’enregistrement des paiements aux créanciers du salarié sont expliqués.
QUATRIÈME PARTIE : COMPTES DE BILAN ET DE GESTION
CHAPITRE 9 : IMMOBILISATIONS ET INVESTISSEMENTS 🏢
9.1 Classification des immobilisations
La distinction entre les immobilisations incorporelles (logiciels, fonds de commerce), corporelles (terrains, bâtiments, matériel) et financières (titres de participation) est établie conformément au plan OHADA.
9.2 Acquisitions et mises en service
L’enregistrement des immobilisations à leur coût d’acquisition est détaillé. Ce coût inclut le prix d’achat et tous les frais annexes nécessaires à leur mise en état de fonctionner.
9.3 Subventions d’investissement
Le traitement comptable spécifique des aides publiques reçues pour financer des actifs est présenté, notamment la méthode de leur échelonnement au compte de résultat au même rythme que l’amortissement du bien financé.
9.4 Autres immobilisations financières
Cette section couvre l’enregistrement des prêts accordés par l’entité et des dépôts et cautionnements versés (par exemple, une garantie locative pour un bureau à Gbadolite).
9.5 Cessions d’immobilisations
La comptabilisation de la vente d’une immobilisation est décomposée en trois étapes : l’enregistrement du produit de la vente, la sortie de l’actif du patrimoine et la constatation de la plus ou moins-value de cession.
CHAPITRE 10 : CRÉANCES ET DETTES 🤝
10.1 Fournisseurs et comptes rattachés
Ce point traite de l’enregistrement des dettes envers les fournisseurs de biens et services et de la gestion des comptes qui y sont associés (fournisseurs – effets à payer).
10.2 Clients et comptes rattachés
Symétriquement, l’enregistrement des créances sur les clients est abordé, ainsi que le suivi des effets de commerce à recevoir.
10.3 Créances douteuses et litigieuses
Les élèves apprennent à identifier les clients dont le recouvrement de la créance est incertain et à transférer ces créances dans un compte distinct pour un suivi attentif, prélude à une éventuelle dépréciation.
10.4 Opérations en devises étrangères
Les règles d’enregistrement initial des créances et dettes libellées en monnaie étrangère au cours du jour sont présentées, ainsi que le principe de leur réévaluation à la clôture de l’exercice.
10.5 Balance âgée des créances
L’élaboration et l’utilité de la balance âgée sont expliquées. Cet outil de gestion ventile les créances clients par ancienneté, permettant de cibler les efforts de recouvrement.
CINQUIÈME PARTIE : TRAVAUX DE FIN D’EXERCICE
CHAPITRE 11 : PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS 📉
11.1 Dépréciation des immobilisations
La dépréciation est présentée comme la constatation d’une perte de valeur ponctuelle d’un actif, lorsque sa valeur actuelle devient inférieure à sa valeur comptable nette.
11.2 Dépréciation des stocks
Ce point traite de la constatation d’une perte de valeur sur les stocks (produits démodés, abîmés) pour respecter le principe de prudence, en ramenant leur valeur au bilan à leur cours du jour.
11.3 Dépréciation des créances
La technique de la dépréciation des créances douteuses est enseignée. Elle consiste à estimer le montant de la perte probable et à le constater en charge, sans pour autant annuler la créance.
11.4 Provisions pour risques et charges
Les provisions sont définies comme des passifs dont l’échéance ou le montant n’est pas fixé de façon précise. Les élèves apprennent à comptabiliser une provision pour un litige en cours avec un salarié, par exemple.
11.5 Écritures de régularisation
Cette section synthétise les ajustements de fin de période (charges à payer, produits à recevoir) qui permettent de rattacher chaque charge et chaque produit à l’exercice comptable auquel il se rapporte.
CHAPITRE 12 : AMORTISSEMENTS ⏳
12.1 Méthodes d’amortissement
L’amortissement est défini comme la constatation comptable de la consommation des avantages économiques futurs d’un actif immobilisé. Les différentes méthodes (linéaire, dégressif, unités d’œuvre) sont introduites.
12.2 Amortissement linéaire
La méthode linéaire, qui répartit le coût d’un actif de manière égale sur sa durée d’utilité, est étudiée en détail comme étant la méthode de droit commun.
12.3 Amortissement dégressif
La méthode dégressive, qui constate des annuités d’amortissement plus importantes au début de la vie du bien, est présentée comme une option fiscale permettant d’accélérer la déduction des charges.
12.4 Dotations et reprises
Les écritures comptables relatives à l’amortissement sont expliquées : la dotation aux amortissements, qui est une charge calculée, et les reprises, qui correspondent à des annulations exceptionnelles.
12.5 Plan d’amortissement
Les élèves apprennent à construire un tableau prévisionnel qui détaille, pour chaque immobilisation et sur toute sa durée d’utilisation, la base amortissable, les annuités d’amortissement et la valeur nette comptable.
CHAPITRE 13 : ÉTATS FINANCIERS ANNUELS 📊
13.1 Compte de résultat par nature
La construction du compte de résultat est détaillée. Ce document synthétise toutes les charges et tous les produits de l’exercice pour faire apparaître le résultat net (bénéfice ou perte).
13.2 Bilan comptable
L’élaboration du bilan de clôture est expliquée comme l’aboutissement du cycle comptable. Il présente la situation patrimoniale de l’entité après inventaire et répartition du résultat.
13.3 Tableau des flux de trésorerie
Ce tableau, obligatoire dans le système normal OHADA, est présenté. Il explique les variations de la trésorerie au cours de l’exercice en classant les flux par activités (opérationnelles, d’investissement, de financement).
13.4 Notes annexes
Le rôle crucial des notes annexes est souligné. Elles fournissent des informations complémentaires et explicatives indispensables à la bonne compréhension du bilan et du compte de résultat.
13.5 Analyse des performances
Une initiation à l’analyse financière est proposée, à travers le calcul et l’interprétation de quelques ratios simples (fonds de roulement, besoin en fonds de roulement) pour porter un premier diagnostic sur la santé financière de l’entité.
ANNEXES
Annexe A : Plan comptable OHADA (extraits) 📖
Cette annexe fournit la liste des comptes les plus couramment utilisés dans le cadre du cours. Elle sert de référence permanente aux élèves pour leurs exercices pratiques, leur permettant de se familiariser avec la codification et l’intitulé exact des comptes.
Annexe B : Modèles de documents comptables 📄
Des spécimens de factures, de bons de commande, de chèques et de fiches de paie sont proposés. Ces modèles servent de support concret pour les simulations et les études de cas, plaçant l’élève en situation quasi-professionnelle.
Annexe C : Barèmes fiscaux et sociaux 📈
Cette section regroupe les barèmes à jour de l’IPR et les taux de cotisations sociales (INSS, ONEM). Elle constitue un outil indispensable pour les exercices relatifs à la comptabilité de la paie et doit être mise à jour annuellement.
Annexe D : Formulaires administratifs ✍️
Sont présentés des exemples de formulaires officiels de déclaration (TVA, IPR). L’objectif est de familiariser les élèves avec les documents qu’ils auront à manipuler dans leur future vie professionnelle.
Annexe E : Lexique comptable français-lingala 🗣️
Ce lexique bilingue a pour but de faciliter l’ancrage des concepts techniques dans l’environnement linguistique des élèves, notamment pour ceux dont le lingala est la langue véhiculaire principale. Il traduit des termes clés comme « actif » (biloko), « passif » (banyongo), « facture » (faktire) ou « bilan » (lipanda).