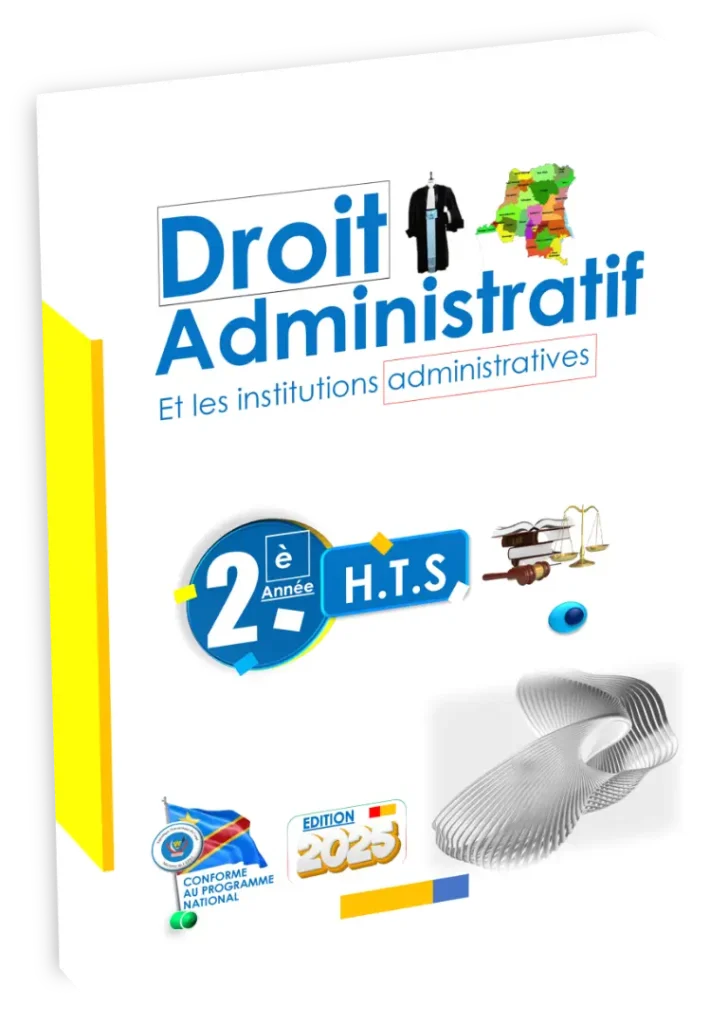
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF, 3ème année, option TECHNIQUES SOCIALES
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
Préliminaires
1. Objectifs du cours
L’objectif fondamental de ce cours est de fournir aux élèves une compréhension claire des règles spéciales qui régissent l’organisation, l’action et le contrôle de l’Administration publique en République Démocratique du Congo. 
2. Directives méthodologiques
Une approche pédagogique combinant l’exposé théorique et l’illustration par des exemples concrets et des visites de terrain structurera ce cours. Le professeur s’appuiera sur des situations réelles, comme l’analyse du fonctionnement d’une maison communale à Kinshasa ou l’étude d’un contrat de marché public de la province du Lualaba, pour rendre le droit administratif tangible. 
3. Compétences visées
À l’issue de cette formation, l’élève sera en mesure de :
- Définir le droit administratif et identifier ses sources.
- Décrire l’organisation administrative de la RDC (centralisation, décentralisation).
- Expliquer la notion de service public et ses grands principes.
- Comprendre les droits, obligations et le déroulement de carrière d’un agent public.
- Distinguer un acte administratif unilatéral d’un contrat administratif.
- Identifier les mécanismes de contrôle et de responsabilité de l’administration.
4. Outils et supports didactiques
La transmission des savoirs mobilisera une documentation juridique et administrative actualisée. 
Partie I : Les Fondements de l’Action Administrative
Cette première partie établit le cadre conceptuel et structurel du droit administratif. Elle définit la notion d’administration, explore les principes de son organisation sur le territoire congolais, et se concentre sur sa mission essentielle : la gestion du service public.
Chapitre 1 : Introduction au Droit Administratif
1.1. L’Administration publique : Définition, buts et moyens
L’Administration publique est définie comme l’ensemble des organes et des agents chargés, sous l’autorité du pouvoir politique, d’assurer l’exécution des lois et de répondre aux besoins d’intérêt général de la population, en utilisant des moyens de puissance publique.
1.2. Le Droit administratif : Un droit spécial pour l’action publique
Le droit administratif est présenté comme l’ensemble des règles juridiques dérogatoires au droit commun, spécifiquement applicables à l’administration. Ce droit spécial se justifie par la nécessité de concilier les prérogatives de la puissance publique et la protection des droits des citoyens.
1.3. Les sources du Droit administratif
Les origines des règles administratives sont explorées. La Constitution et les lois organiques constituent la source suprême, complétées par les règlements édictés par le pouvoir exécutif, la jurisprudence des juridictions administratives et les principes généraux du droit.
1.4. La distinction entre la gestion publique et la gestion privée
Cette section clarifie la différence fondamentale entre l’administration, qui poursuit l’intérêt général et peut utiliser la contrainte, et les acteurs privés, qui sont régis par la recherche du profit et le principe de l’autonomie de la volonté contractuelle.
Chapitre 2 : La Notion de Personne Morale de Droit Public
2.1. Définition et caractéristiques de la personne morale publique
La personne morale de droit public est une entité juridique distincte des individus qui la composent, créée par la puissance publique pour exercer une mission d’intérêt général. Elle est dotée de prérogatives et soumise à des sujétions spécifiques.
2.2. L’État comme personne morale centrale
L’État est présenté comme la personne morale de droit public par excellence. Il incarne la souveraineté sur le plan national et international et constitue le niveau supérieur de l’organisation administrative du pays.
2.3. Les collectivités territoriales
Conformément à la Constitution, la RDC est organisée en entités décentralisées dotées de la personnalité juridique. 
2.4. Les établissements publics
Un établissement public est une personne morale de droit public spécialisée, créée pour gérer un service public spécifique (ex: un hôpital public, une université publique). Il jouit d’une autonomie administrative et financière sous la tutelle de l’État ou d’une collectivité.
Chapitre 3 : L’Organisation Administrative de la RDC
3.1. Le principe de la centralisation administrative
La centralisation est un système où toutes les décisions administratives sont prises au niveau du pouvoir central, à Kinshasa. Les autorités locales ne sont alors que de simples exécutants sans pouvoir de décision propre.
3.2. Le principe de la décentralisation territoriale
La décentralisation, principe constitutionnel en RDC, consiste à transférer des compétences du pouvoir central à des collectivités locales (Provinces, ETD) qui disposent d’organes élus et d’une autonomie de gestion pour les affaires d’intérêt local.
3.3. La déconcentration comme modalité d’organisation
La déconcentration est une technique d’aménagement de la centralisation. Le pouvoir central délègue un pouvoir de décision à ses représentants locaux (gouverneur, administrateur de territoire) qui agissent en son nom et sous son contrôle hiérarchique.
3.4. Le pouvoir hiérarchique et le contrôle de tutelle
L’élève apprend à distinguer le pouvoir hiérarchique, qui est un contrôle complet du supérieur sur l’inférieur au sein d’une même administration, du contrôle de tutelle, qui est un contrôle de simple légalité exercé par l’État sur les entités décentralisées autonomes.
Chapitre 4 : Le Service Public
4.1. Définition et identification du service public
Le service public est une activité d’intérêt général assurée ou contrôlée par l’administration. Ses critères d’identification sont analysés, permettant de le distinguer des activités purement privées, même lorsqu’elles sont d’utilité sociale.
4.2. Les lois du service public
Les grands principes qui régissent le fonctionnement de tout service public sont étudiés. Il s’agit du principe de continuité (le service ne doit pas être interrompu), d’égalité (tous les usagers doivent être traités de la même manière) et de mutabilité (le service doit s’adapter à l’évolution des besoins).
4.3. Les modes de gestion : La régie directe
La régie est le mode de gestion où l’administration assure elle-même, avec ses propres moyens et son propre personnel, le fonctionnement du service public. C’est la forme de gestion la plus directe.
4.4. Les modes de gestion déléguée
L’administration peut confier la gestion d’un service public à un tiers. La concession de service public, par laquelle le concessionnaire se rémunère sur les usagers, est le principal exemple de cette gestion déléguée, souvent utilisée pour des services comme la distribution d’eau ou d’électricité.
Partie II : Les Moyens de l’Action Administrative
Cette deuxième partie examine les ressources humaines, matérielles et financières que l’administration met en œuvre pour accomplir ses missions. Elle se penche en détail sur le statut des agents de l’État, le régime des biens publics et les bases des finances publiques.
Chapitre 5 : La Fonction Publique
5.1. Le statut général des agents de l’État
La fonction publique est régie par un statut légal et réglementaire, et non par un contrat de travail de droit privé. Le cours se base sur la loi de 2016 portant statut général des agents de carrière des services publics de l’État pour en expliquer les grands principes.
5.2. Le recrutement et l’accès aux emplois publics
Le principe de l’égal accès aux emplois publics est affirmé. Les modalités de recrutement, fondées sur le concours et la vérification des aptitudes, sont étudiées comme une garantie de neutralité et de compétence au service de l’intérêt général.
5.3. Le déroulement de la carrière
La carrière de l’agent public est analysée à travers ses différentes étapes. Sont abordées les notions de grade, d’échelon, de notation, d’avancement et les différentes positions statutaires (activité, détachement, disponibilité).
5.4. La fin de carrière
Les différents modes de cessation définitive des fonctions sont examinés. La mise à la retraite est le mode normal, mais d’autres cas comme la démission, la révocation pour faute disciplinaire ou le décès sont également prévus par le statut.
Chapitre 6 : Droits et Obligations des Agents Publics
6.1. Les obligations
L’agent public est soumis à des obligations strictes. 
6.2. Les droits
En contrepartie de ses obligations, l’agent public bénéficie de droits garantis par son statut. Il s’agit notamment du droit à une rémunération après service fait, du droit à la protection par l’État dans l’exercice de ses fonctions, et des droits sociaux (congés, pension).
6.3. Le régime disciplinaire
Le manquement d’un agent à ses obligations peut entraîner une sanction disciplinaire. La procédure disciplinaire, qui doit respecter les droits de la défense, et l’échelle des sanctions, de l’avertissement à la révocation, sont expliquées.
6.4. Le statut particulier du travailleur social
Cette section se concentre sur la place et les spécificités du métier de travailleur social au sein de l’administration publique. Ses missions, son cadre d’emploi et les défis particuliers de sa fonction sont analysés.
Chapitre 7 : Les Biens de l’Administration (Le Domaine Public)
7.1. Définition et composition du domaine public
Le domaine public est l’ensemble des biens appartenant à une personne publique et qui sont soit affectés à l’usage direct du public (une route, une place), soit à un service public (un bâtiment ministériel, un hôpital).
7.2. Le régime juridique
Les biens du domaine public sont soumis à un régime de protection exorbitant du droit commun. 
7.3. L’affectation et la désaffectation
L’affectation est l’acte par lequel un bien est intégré au domaine public. La désaffectation est la procédure inverse, par laquelle un bien qui n’est plus utile à l’intérêt général est retiré du domaine public pour pouvoir être intégré au domaine privé de l’administration et éventuellement vendu.
7.4. L’utilisation du domaine public par les particuliers
L’utilisation collective du domaine public est libre et gratuite pour tous. Son utilisation privative (ex: terrasse de café sur un trottoir) est possible mais précaire, soumise à autorisation (permission de voirie) et au paiement d’une redevance.
Chapitre 8 : Les Finances de l’Administration
8.1. Introduction aux finances publiques
Les finances publiques sont l’étude des ressources et des dépenses des personnes publiques. Elles sont encadrées par des règles spécifiques qui visent à garantir la bonne gestion des deniers publics.
8.2. Les ressources de l’administration
Les principales ressources de l’État sont les prélèvements obligatoires. 
8.3. Le budget de l’État et des entités décentralisées
Le budget est l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour une année. Son adoption par l’organe délibérant (Parlement, Assemblée provinciale) est un acte démocratique majeur de contrôle de l’exécutif.
8.4. Les principes du contrôle des finances publiques
La gestion des finances publiques est soumise à de multiples contrôles. Sont étudiés le contrôle administratif (interne à l’administration), le contrôle juridictionnel (exercé par la Cour des comptes) et le contrôle politique (exercé par le Parlement).
Partie III : Les Actes de l’Administration et le Contentieux
Cette dernière partie s’intéresse aux outils juridiques que l’administration utilise pour agir et aux mécanismes qui permettent aux citoyens de contester ses décisions. Elle explore les actes unilatéraux, les contrats, avant d’aborder la question de la responsabilité de l’administration et les voies de recours devant le juge administratif.
Chapitre 9 : L’Acte Administratif Unilatéral
9.1. Définition et différentes catégories
L’acte administratif unilatéral est la manifestation de volonté de l’administration destinée à produire des effets de droit sans le consentement des destinataires. On distingue les actes réglementaires (à portée générale) des actes individuels (qui visent une personne nommément).
9.2. Les conditions de validité
Pour être légal, un acte administratif doit respecter plusieurs conditions : être pris par une autorité compétente, suivre la procédure requise, ne pas violer la loi et être fondé sur des motifs de droit et de fait exacts.
9.3. Les effets de l’acte administratif
L’acte administratif bénéficie du « privilège du préalable » : il est présumé légal et s’impose à ses destinataires dès sa publication ou sa notification, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un juge. L’administration peut même, dans certains cas, en assurer l’exécution forcée.
9.4. La sortie de vigueur
Un acte administratif peut cesser de produire ses effets. L’abrogation met fin à l’acte pour l’avenir, tandis que le retrait a un effet rétroactif et fait comme si l’acte n’avait jamais existé. Leurs conditions de mise en œuvre sont strictement encadrées.
Chapitre 10 : Le Contrat Administratif
10.1. Définition et critères d’identification
Un contrat est administratif soit parce que la loi le qualifie comme tel, soit parce qu’il remplit des critères jurisprudentiels : il lie une personne publique et contient des clauses exorbitantes du droit commun ou associe le cocontractant à l’exécution d’un service public.
10.2. Les règles de procédure et de forme
La passation des contrats administratifs, notamment des marchés publics, est soumise à des règles strictes de publicité et de mise en concurrence pour garantir l’égalité d’accès des candidats et le bon usage des deniers publics.
10.3. Les prérogatives de l’administration
Dans un contrat administratif, l’administration n’est pas un partenaire ordinaire. Elle dispose de pouvoirs spécifiques comme le pouvoir de direction et de contrôle, le pouvoir de sanction et même le pouvoir de modifier unilatéralement le contrat pour des motifs d’intérêt général.
10.4. L’exemple du contrat de marché public
Le marché public est le contrat par lequel l’administration achète des travaux, des fournitures ou des services à un opérateur économique. C’est le type de contrat administratif le plus courant et le plus réglementé.
Chapitre 11 : La Responsabilité de l’Administration
11.1. Le principe de la responsabilité de la puissance publique
Le principe selon lequel « toute décision de l’autorité doit être fondée sur la loi » implique que si l’administration cause un dommage par son action, elle doit le réparer. Ce principe fondamental met fin à l’irresponsabilité de l’État.
11.2. La responsabilité pour faute
Le plus souvent, la responsabilité de l’administration est engagée s’il est prouvé qu’elle a commis une faute. 
11.3. La responsabilité sans faute
Dans certaines situations (activités dangereuses, rupture d’égalité devant les charges publiques), la responsabilité de l’administration peut être engagée même en l’absence de toute faute de sa part, afin de garantir l’indemnisation de la victime.
11.4. L’action en réparation
La victime d’un dommage causé par l’administration doit saisir le juge administratif pour obtenir réparation. Le préjudice doit être direct, certain et personnel, et l’indemnisation vise à couvrir l’intégralité du dommage subi.
Chapitre 12 : Le Contentieux Administratif
12.1. L’organisation des juridictions administratives
Le contentieux administratif relève de juridictions spécialisées. En RDC, l’ordre administratif comprend le Conseil d’État, les Cours administratives d’appel et les Tribunaux administratifs, qui sont compétents pour juger les litiges impliquant l’administration.
12.2. Le recours pour excès de pouvoir
Ce recours permet à tout citoyen de demander au juge l’annulation d’un acte administratif qu’il estime illégal. C’est un outil essentiel de contrôle de la légalité et de protection contre l’arbitraire administratif.
12.3. Le contentieux de pleine juridiction
Dans ce type de contentieux, les pouvoirs du juge sont plus étendus. Il peut non seulement annuler un acte, mais aussi condamner l’administration à verser des dommages et intérêts ou réformer sa décision.
12.4. Les procédures d’urgence : Le référé
Le référé administratif est une procédure rapide qui permet d’obtenir du juge des mesures provisoires pour sauvegarder un droit en urgence, sans attendre le jugement au fond de l’affaire, qui peut prendre plusieurs mois.
Annexes
1. Glossaire des termes du droit administratif
Un lexique définit de manière simple les concepts techniques de la matière (acte unilatéral, contrat de concession, tutelle, domaine public, etc.), afin de garantir la maîtrise d’un vocabulaire précis et indispensable.
2. Organigramme de l’administration centrale et locale en RDC
Un schéma visuel représente la structure de l’administration congolaise, depuis les ministères au niveau central jusqu’aux entités territoriales décentralisées (Provinces, Villes, Communes, etc.), permettant de visualiser les différents niveaux de pouvoir.
3. Modèle d’un acte administratif unilatéral simple
Un exemple commenté d’un arrêté municipal ou provincial est fourni. Il permet à l’élève d’identifier les composantes formelles d’un tel acte (visas, motifs, dispositif) et de comprendre sa structure logique.
4. Canevas d’une requête devant le juge administratif
Un modèle simple de requête en annulation pour excès de pouvoir est proposé. 




