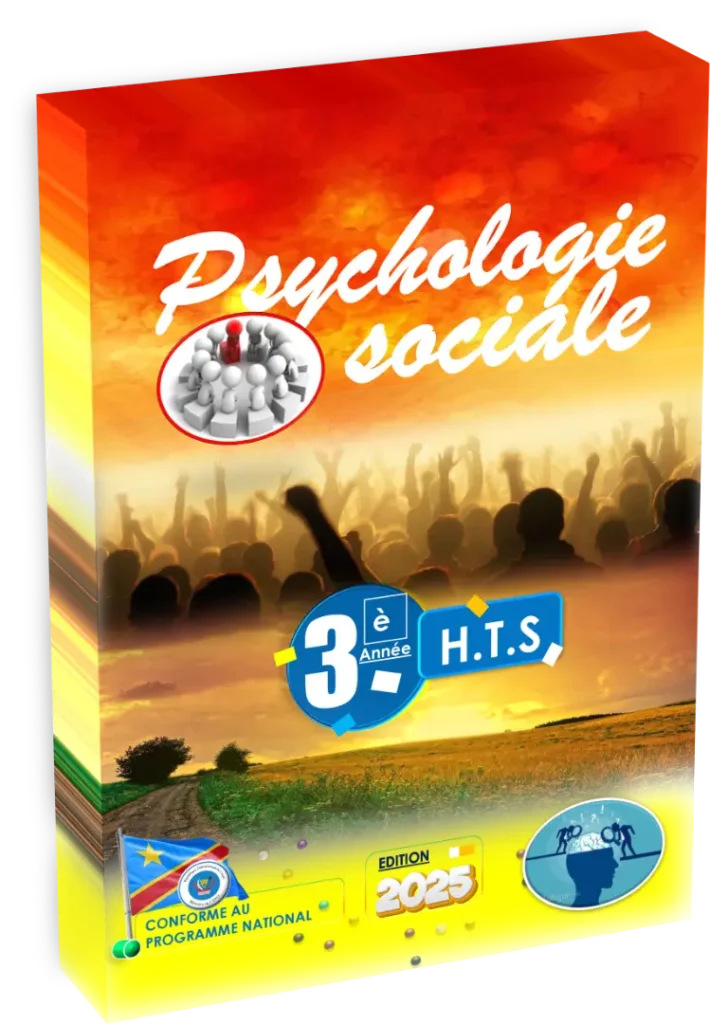
COURS DE PSYCHOLOGIE SOCIALE, 3ème année, option TECHNIQUES SOCIALES
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
Préliminaires
1. Objectifs du cours
L’objectif fondamental de ce cours est de doter les élèves d’une compréhension approfondie de la manière dont les pensées, les sentiments et les comportements des individus sont influencés par la présence réelle, imaginaire ou implicite des autres. 
2. Directives méthodologiques
Une approche pédagogique active et participative est au cœur de ce programme. Le professeur s’appuiera sur des exemples concrets et des mises en situation tirées de la vie quotidienne, comme l’analyse de la formation d’un préjugé dans un quartier de Bunia ou la simulation d’une prise de décision dans une association de jeunes à Boma. 
3. Compétences visées
À l’issue de cette formation, l’élève sera en mesure de :
- Définir la psychologie sociale et la situer par rapport aux disciplines voisines.
- Expliquer comment le contexte social influence le comportement d’un individu.
- Analyser la structure et la dynamique d’un petit groupe.
- Identifier les différents styles de leadership et leurs effets sur un groupe.
- Comprendre les mécanismes de formation des préjugés et des rumeurs.
- Appliquer des techniques de base pour l’analyse et l’animation de groupe.
4. Outils et supports didactiques
La transmission des savoirs mobilisera des supports variés pour illustrer les interactions humaines. 
Partie I : L’Individu dans le Contexte Social
Cette première partie établit les fondations de la discipline en se concentrant sur l’individu en tant qu’être social. Elle explore comment la présence des autres façonne notre perception, nos attitudes et nos comportements, et comment notre sens social se développe tout au long de la vie.
Chapitre 1 : Introduction à la Psychologie Sociale
1.1. Définition et objet de la psychologie sociale
La psychologie sociale est présentée comme l’étude scientifique de l’interaction entre l’individu et la société. Son objet spécifique est d’analyser comment le contexte social influence les processus psychologiques individuels et, en retour, comment ces derniers façonnent les phénomènes sociaux.
1.2. Distinction avec la psychologie générale
La psychologie sociale se distingue de la psychologie générale par son focus sur l’influence du social. Tandis que la psychologie générale étudie les processus mentaux (mémoire, perception) de manière plus isolée, la psychologie sociale examine comment ces processus sont modifiés par l’interaction avec autrui.
1.3. Distinction avec la sociologie
La distinction avec la sociologie réside dans le niveau d’analyse. La sociologie s’intéresse prioritairement aux structures sociales, aux institutions et aux grands groupes, alors que la psychologie sociale se concentre sur l’individu au sein de ces structures et sur les interactions en petits groupes.
1.4. L’importance de la psychologie sociale pour le travailleur social
Cette section démontre l’utilité cruciale de la discipline pour la pratique sociale. Comprendre les dynamiques de groupe, les phénomènes de leadership ou les mécanismes des préjugés est indispensable pour tout professionnel qui vise à animer une communauté ou à faciliter le changement social.
Chapitre 2 : Le Comportement Social
2.1. L’homme comme être social
Le cours affirme le postulat fondamental que l’être humain est un « animal social ». Sa survie, son développement et son identité même dépendent intrinsèquement de ses relations avec ses semblables et de son appartenance à des groupes.
2.2. L’influence du groupe sur le comportement individuel
L’influence sociale est présentée comme un processus majeur. La simple présence d’autrui, qu’elle soit réelle ou imaginée, modifie nos performances, nos décisions et nos comportements de manière significative, un phénomène que le travailleur social doit constamment prendre en compte.
2.3. La perception sociale
La perception sociale est le processus par lequel nous nous formons une impression des autres. 
2.4. Les attributions causales
Cette section explore la manière dont nous cherchons à expliquer les comportements des autres et les nôtres. L’élève apprend à distinguer les attributions internes (liées à la personne) des attributions externes (liées à la situation) et à repérer les biais fréquents, comme l’erreur fondamentale d’attribution.
Chapitre 3 : Le Développement du Sens Social
3.1. Les premières interactions
Le développement du sens social commence dès la naissance. La théorie de l’attachement est introduite pour montrer comment la qualité des premiers liens avec les figures parentales constitue la base de la sécurité affective et des futures relations sociales.
3.2. L’évolution du sens social durant l’enfance
Le cours retrace les grandes étapes de la socialisation de l’enfant. De l’égocentrisme initial, l’enfant apprend progressivement à se décentrer, à comprendre le point de vue des autres et à intégrer les règles du jeu social et de la coopération.
3.3. Les défis de la socialisation à l’adolescence
L’adolescence est une période de remaniement identitaire où le groupe de pairs devient une instance de socialisation cruciale. Les défis liés à la recherche d’autonomie et à la conformité au groupe sont analysés.
3.4. La construction de l’identité sociale
L’identité sociale est définie comme la partie de notre concept de soi qui provient de notre appartenance à des groupes sociaux. L’élève comprend comment l’identification à un groupe (familial, ethnique, national) contribue à définir qui nous sommes.
Chapitre 4 : Les Attitudes et leur Changement
4.1. Définition et composantes d’une attitude
Une attitude est une évaluation, positive ou négative, d’un objet social (personne, groupe, idée). Elle est composée de trois dimensions : cognitive (les croyances), affective (les émotions et sentiments) et comportementale (la tendance à agir).
4.2. La formation des attitudes
Les attitudes ne sont pas innées, elles s’apprennent. Le cours examine les différentes sources de nos attitudes : l’expérience personnelle, l’influence de la famille et des pairs, l’éducation scolaire et l’exposition aux médias de masse.
4.3. Les stratégies de persuasion
Cette section analyse les techniques utilisées pour changer les attitudes. L’élève découvre les principes de la communication persuasive, en s’intéressant aux caractéristiques de la source (crédibilité), du message (logique vs émotion) et de la cible.
4.4. Le lien entre attitudes et comportements
La relation entre ce que les gens pensent et ce qu’ils font est complexe. Le cours explique que les attitudes ne prédisent pas toujours le comportement, et explore les conditions dans lesquelles ce lien est le plus fort.
Partie II : La Dynamique des Groupes
Cette deuxième partie est une immersion au cœur du fonctionnement des petits groupes. Elle décortique leur structure, les relations qui s’y nouent, les phénomènes d’influence qui s’y déploient, et se conclut par l’étude de la fonction essentielle de direction, ou leadership.
Chapitre 5 : La Nature et la Structure des Groupes
5.1. Définition et caractéristiques générales d’un groupe
Un groupe est défini par l’interdépendance de ses membres et la conscience d’une identité commune. Ses caractéristiques, comme sa taille, ses buts et sa durée de vie, influencent profondément son fonctionnement.
5.2. La structure du groupe
Tout groupe, même informel, développe une structure. Sont étudiés les statuts (les positions), les rôles (les attentes comportementales liées aux statuts) et les normes (les règles de conduite partagées par les membres).
5.3. Les réseaux de communication
La manière dont l’information circule dans un groupe est un élément clé de sa structure. L’élève apprend à distinguer les réseaux centralisés, efficaces pour les tâches simples, des réseaux décentralisés, plus propices à la créativité et à la satisfaction des membres.
5.4. Les groupes de référence et d’appartenance
Le groupe d’appartenance est celui dont on fait objectivement partie, tandis que le groupe de référence est celui auquel on s’identifie et dont on emprunte les valeurs. Ces deux types de groupes façonnent notre identité et nos attitudes.
Chapitre 6 : Les Relations Interpersonnelles dans le Groupe
6.1. L’attraction interpersonnelle
Les phénomènes de sympathie et d’antipathie qui se développent entre les membres sont analysés. Le cours explore les facteurs qui favorisent l’attraction, comme la proximité, la similarité des attitudes et la complémentarité des besoins.
6.2. L’identification et la cohésion de groupe
La cohésion est la force qui maintient les membres unis au sein du groupe. 끈 Elle résulte de l’attraction du groupe pour ses membres et de leur identification à ses buts et à ses valeurs, et elle est un facteur clé de la performance collective.
6.3. Le niveau d’aspiration du groupe
Le niveau d’aspiration désigne les objectifs que le groupe se fixe. Le cours examine comment le groupe évalue ses performances passées pour ajuster ses ambitions futures, un processus crucial pour sa motivation et sa persévérance.
6.4. Le rôle de la suggestion et de l’influence
La suggestion est un processus d’influence par lequel les idées et les émotions se propagent rapidement au sein d’un groupe. L’élève étudie comment ce phénomène peut être utilisé de manière constructive par l’animateur ou conduire à des décisions irrationnelles.
Chapitre 7 : L’Influence du Groupe sur l’Individu
7.1. La normalisation
Placés en situation d’incertitude, les membres d’un groupe tendent à faire converger leurs jugements pour créer une norme collective. Ce processus de normalisation, illustré par les expériences de Sherif, montre la puissance du groupe pour créer une réalité partagée.
7.2. Le conformisme
Le conformisme est le changement de comportement ou de croyance d’un individu sous l’effet de la pression, réelle ou imaginaire, d’une majorité. Les célèbres expériences de Asch sont utilisées pour démontrer ce phénomène et analyser ses causes.
7.3. L’obéissance à l’autorité
L’obéissance est une forme d’influence où un individu modifie son comportement pour se soumettre à un ordre direct émanant d’une autorité légitime. Les expériences de Milgram sur la soumission à l’autorité sont analysées pour leurs implications éthiques.
7.4. La performance en groupe
Le cours explore les effets de la présence d’autrui sur la performance. La facilitation sociale (amélioration des performances pour les tâches simples) est distinguée de la paresse sociale (diminution de l’effort individuel dans une tâche collective).
Chapitre 8 : La Direction des Groupes (Leadership)
8.1. La nature de la direction
Le leadership est défini comme le processus d’influence par lequel un membre du groupe (le leader) amène les autres à coopérer pour atteindre les objectifs communs. Il est analysé comme une fonction et non comme une simple position hiérarchique.
8.2. Les caractéristiques et les compétences du leader
Plutôt qu’une liste de traits de personnalité, le cours met l’accent sur les compétences d’un leader efficace. Celles-ci incluent la capacité à structurer la tâche, à maintenir de bonnes relations et à communiquer une vision.
8.3. Les techniques de commandement
Les différents styles de leadership sont comparés : le style autoritaire (centré sur la tâche), le style démocratique (favorisant la participation) et le style « laisser-faire ». Leurs effets respectifs sur la productivité et le moral du groupe sont discutés.
8.4. La gestion des relations entre le dirigeant et les membres
Une bonne relation entre le leader et les membres est essentielle. Le cours aborde l’importance de la confiance, du respect mutuel et de la capacité du leader à motiver, à reconnaître et à gérer les conflits au sein du groupe.
Partie III : Relations Intergroupes et Phénomènes Collectifs
La dernière partie du cours élargit le champ d’analyse aux relations entre les groupes et aux phénomènes qui se déploient à une plus grande échelle. Elle traite de la coopération et du conflit, des préjugés, et des puissants mécanismes de communication qui façonnent l’opinion publique.
Chapitre 9 : Les Relations entre les Groupes
9.1. La coopération et l’interdépendance
La coopération entre les groupes est étudiée comme une condition de la vie sociale. Elle est favorisée lorsque les groupes partagent des buts communs qu’ils ne peuvent atteindre seuls, créant une situation d’interdépendance positive.
9.2. La compétition et le conflit intergroupe
La compétition pour des ressources rares ou des enjeux symboliques peut mener au conflit. Le cours analyse comment la simple catégorisation en « nous » (endogroupe) et « eux » (exogroupe) peut suffire à déclencher des tensions et des discriminations.
9.3. La distance sociale
La distance sociale est un concept qui mesure le degré de proximité ou d’éloignement ressenti entre différents groupes sociaux (ethniques, religieux, etc.). Elle est un indicateur clé du niveau d’intégration ou de ségrégation d’une société.
9.4. Les stratégies de réduction des conflits
Diverses stratégies pour apaiser les tensions intergroupes sont présentées. La plus efficace est l’introduction d’objectifs supérieurs communs, qui obligent les groupes en conflit à coopérer pour réussir, favorisant ainsi des relations plus positives.
Chapitre 10 : Les Préjugés et la Discrimination
10.1. Définition des préjugés et de la discrimination
Une distinction claire est établie. Les préjugés sont des attitudes, généralement négatives, à l’égard des membres d’un groupe. La discrimination est le comportement négatif et injuste qui en découle.
10.2. Les stéréotypes comme base cognitive des préjugés
Les stéréotypes sont des croyances généralisées et simplifiées sur les caractéristiques des membres d’un groupe. 
10.3. Les origines des préjugés
Les causes des préjugés sont multiples. Le cours explore les origines sociales (apprentissage, normes de groupe), cognitives (biais de catégorisation) et affectives (besoin de trouver un bouc émissaire en temps de crise).
10.4. La lutte contre les préjugés
La lutte contre les préjugés passe par l’éducation, la promotion des contacts intergroupes dans des conditions d’égalité, et des politiques publiques volontaristes contre la discrimination, un champ d’action majeur pour le travailleur social.
Chapitre 11 : Les Phénomènes de Communication de Masse
11.1. Les rumeurs
Une rumeur est une information qui se propage de bouche à oreille, sans source officielle et dont la véracité est douteuse. 
11.2. La propagande
La propagande est une forme de communication systématique et unilatérale visant à influencer l’opinion et le comportement d’un large public dans un sens politique ou idéologique, souvent en utilisant des techniques de manipulation émotionnelle.
11.3. La publicité
La publicité est une forme de communication persuasive visant à promouvoir la consommation d’un produit ou d’un service. Ses techniques, qui s’appuient sur les principes de la psychologie sociale (association, preuve sociale), sont décortiquées.
11.4. L’opinion publique
L’opinion publique est l’ensemble des jugements et des croyances partagés par une part significative d’une population sur un enjeu d’intérêt commun. Le cours aborde sa formation, sa mesure par les sondages et son influence sur les décisions politiques.
Chapitre 12 : Applications et Pratiques
12.1. La technique du sociogramme
Le sociogramme est un outil visuel qui permet de cartographier les relations affectives (attractions et rejets) au sein d’un petit groupe. 
12.2. Les techniques de dynamique de groupe
Cette section est un rappel pratique des techniques (jeux de rôle, brainstorming, etc.) qui permettent d’intervenir sur un groupe pour améliorer sa communication, sa cohésion ou sa capacité à résoudre des problèmes.
12.3. L’analyse psychosociale des phénomènes de société
L’élève est invité à appliquer les concepts du cours pour analyser des phénomènes sociaux contemporains en RDC, comme les tensions intercommunautaires, l’impact des réseaux sociaux sur les jeunes ou les dynamiques de participation citoyenne.
12.4. Synthèse : L’homme comme être complexe
Le cours se conclut en réaffirmant que l’être humain est une entité complexe, à la fois produit de ses appartenances sociales qui le façonnent, et producteur actif de la société par ses interactions et ses actions quotidiennes.
Annexes
1. Glossaire des termes de psychologie sociale
Un lexique définit de manière simple les concepts techniques de la discipline (attitude, conformisme, stéréotype, leadership, etc.), constituant un outil de référence indispensable pour maîtriser le vocabulaire spécifique.
2. Biographies succinctes des auteurs clés
De courtes notices biographiques présentent des figures majeures de la psychologie sociale (Kurt Lewin, Solomon Asch, Stanley Milgram), en résumant leur apport principal à la discipline.
3. Guide pour la réalisation d’un sociogramme
Une fiche méthodologique simple est proposée pour guider les élèves dans la construction d’un sociogramme. Elle détaille les étapes : formulation de la question, passation du questionnaire, construction de la sociomatrice et représentation graphique.
4. Canevas pour une analyse de dynamique de groupe
Un modèle de grille d’analyse est fourni. 




