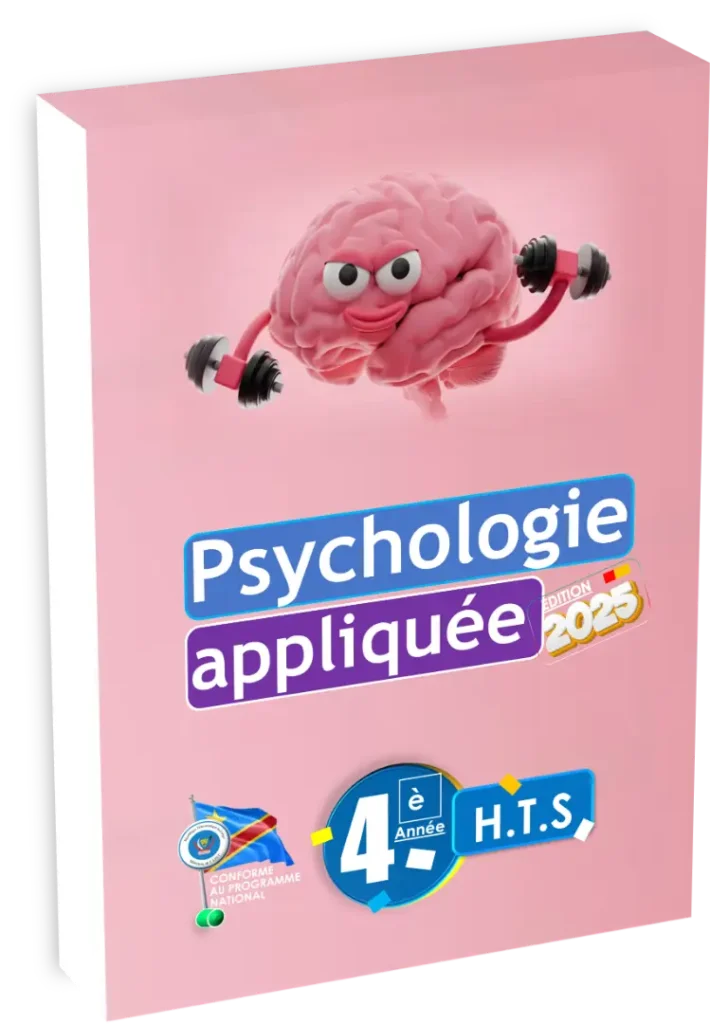
COURS DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE, 4ème année, option TECHNIQUES SOCIALES
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
Préliminaires
1. Objectifs du cours
L’objectif fondamental de ce cours est de familiariser les élèves avec l’application pratique des principes psychologiques dans les domaines de l’éducation et du travail, afin de les préparer à assister efficacement les orienteurs et les psychologues. 
2. Directives méthodologiques
Une approche pédagogique active et interrogative caractérise ce cours, visant à rendre les concepts directement opérationnels. Le professeur mettra l’élève en contact direct avec les outils de la psychologie appliquée, notamment par la manipulation et la passation de tests psychotechniques en classe. 
3. Compétences visées
À l’issue de cette formation, l’élève sera en mesure de :
- Définir la psychologie appliquée et identifier ses principaux champs d’intervention.
- Comprendre les principes et les exigences d’un test psychotechnique (fidélité, validité).
- Décrire les processus d’orientation scolaire et de sélection professionnelle.
- Participer à l’analyse d’un poste de travail pour en déduire les compétences requises.
- Expliquer l’influence des conditions de travail sur le bien-être et la performance des individus.
- Assister de manière pertinente un professionnel de l’orientation ou de la sélection.
4. Outils et supports didactiques
La transmission des savoirs mobilisera des outils concrets et des études de cas pour une immersion pratique. 
Partie I : Fondements et Outils de la Psychologie Appliquée
Cette première partie établit le cadre de la discipline. Elle définit ce qu’est la psychologie appliquée, explore ses différents domaines d’intervention, et se concentre sur son outil le plus emblématique : le test psychotechnique, en détaillant ses principes, ses exigences de qualité et ses différentes catégories.
Chapitre 1 : Introduction à la Psychologie Appliquée
1.1. Définition et objet de la psychologie appliquée
La psychologie appliquée est présentée comme la branche de la psychologie qui vise à utiliser les connaissances et les méthodes de la psychologie scientifique pour résoudre des problèmes concrets dans divers champs de l’activité humaine.
1.2. Les principaux domaines d’application
Le cours dresse un panorama des grands secteurs où la psychologie appliquée intervient. Sont explorés en priorité la psychologie du travail et des organisations, la psychologie de l’éducation et de l’orientation, ainsi que la psychologie de la santé.
1.3. L’objectif individuel
Sur le plan individuel, l’élève apprendra à utiliser les concepts psychologiques pour comprendre et analyser les difficultés d’adaptation, d’apprentissage ou de motivation que peuvent rencontrer les personnes en milieu scolaire ou professionnel.
1.4. L’objectif collectif
Sur le plan collectif, le cours vise à montrer comment la psychologie appliquée contribue à l’amélioration du fonctionnement des organisations, que ce soit en optimisant les processus de sélection, en améliorant le climat social ou en prévenant les risques psychosociaux.
Chapitre 2 : Les Tests Psychotechniques : Principes Généraux
2.1. Définition et fonction d’un test
Un test psychologique est défini comme une épreuve standardisée qui permet de mesurer de manière objective certains aspects du comportement ou de la personnalité d’un individu (aptitudes, connaissances, traits de caractère) en le comparant à un groupe de référence.
2.2. Les qualités métrologiques : La fidélité
La fidélité est la première exigence de qualité d’un test. 
2.3. Les qualités métrologiques : La validité
La validité est la qualité la plus importante. Elle indique si le test mesure bien ce qu’il est censé mesurer. Un test de raisonnement logique est valide s’il mesure effectivement la capacité de raisonnement et non, par exemple, le niveau de vocabulaire.
2.4. Les conditions d’application
Pour que les résultats soient comparables, un test doit être appliqué dans des conditions standardisées (mêmes consignes, même temps imparti). Il doit aussi être étalonné, c’est-à-dire que les résultats bruts sont transformés en notes standards basées sur les performances d’un groupe de référence.
Chapitre 3 : Les Différents Types de Tests
3.1. Les tests d’aptitudes et de connaissances
Les tests d’aptitudes mesurent le potentiel d’un individu à acquérir une nouvelle compétence (aptitude verbale, spatiale, numérique). Les tests de connaissances évaluent les savoirs et savoir-faire déjà acquis dans un domaine précis.
3.2. Les tests d’intelligence
Ces tests, souvent appelés tests de facteur « g », visent à mesurer l’efficience intellectuelle générale d’une personne, c’est-à-dire sa capacité à raisonner, à résoudre des problèmes nouveaux et à s’adapter à son environnement.
3.3. Les tests de personnalité
Les tests de personnalité, souvent sous forme de questionnaires, cherchent à décrire la structure du caractère d’un individu. Ils mesurent des dimensions comme l’extraversion, la stabilité émotionnelle ou la conscience professionnelle.
3.4. Les tests projectifs
À titre d’introduction, les tests projectifs (comme le Rorschach ou le TAT) sont présentés. Face à un matériel ambigu, le sujet est invité à « projeter » ses propres pensées et émotions, donnant ainsi accès à des aspects plus profonds de sa personnalité.
Partie II : L’Orientation Scolaire et Professionnelle (OSP)
Cette deuxième partie est consacrée à un champ d’application majeur de la psychologie : l’aide à la construction du projet de vie. Elle explore les fondements, les processus et les acteurs de l’orientation, en soulignant le rôle crucial que le technicien social peut y jouer.
Chapitre 4 : Les Fondements de l’Orientation
4.1. Définition et but de l’OSP
L’orientation scolaire et professionnelle est définie comme un processus d’aide à la décision qui permet à une personne de choisir en connaissance de cause une formation ou une profession correspondant à ses aspirations, ses aptitudes et aux réalités du marché du travail.
4.2. Les problèmes de l’orientation
L’orientation est un processus complexe qui se heurte à un double défi. 
4.3. L’importance de l’âge et de la maturité
Le processus d’orientation doit être adapté à l’âge et au niveau de maturité vocationnelle du candidat. Les interventions ne seront pas les mêmes pour un élève de fin de cycle primaire à Kananga et pour un finaliste du secondaire à Kinshasa.
4.4. Le rôle du technicien social
Le technicien social n’est pas un orienteur professionnel, mais il est un assistant précieux. Son rôle est de collaborer avec l’orienteur, de recueillir des informations sur le contexte de vie du jeune et de l’aider à lever les obstacles sociaux ou familiaux à son projet.
Chapitre 5 : Le Processus d’Orientation
5.1. L’organisation d’une séance d’orientation
Le déroulement type d’un bilan d’orientation est présenté. Il combine généralement plusieurs méthodes : entretiens, passation de questionnaires d’intérêts et de tests d’aptitudes, et recherche documentaire sur les métiers.
5.2. L’entretien d’orientation
L’entretien est le cœur du processus. Il permet au conseiller d’aider le jeune à explorer ses expériences, à clarifier ses désirs, à identifier ses points forts et à réfléchir aux différentes options qui s’offrent à lui.
5.3. L’utilisation des tests en orientation
Les tests sont utilisés en orientation comme des outils d’aide à la réflexion, et non comme des instruments de décision. Leurs résultats permettent d’élargir le champ des possibles et de suggérer des pistes à explorer, jamais d’imposer une voie.
5.4. L’importance des données supplémentaires
Une bonne orientation s’appuie sur une information riche et croisée. Le conseiller recueille des informations auprès des parents, des enseignants et des éducateurs pour avoir une vision globale de la personnalité et du parcours du jeune.
Chapitre 6 : Les Acteurs de l’Orientation en RDC
6.1. Le Service de l’Orientation Scolaire et Professionnelle (SOSP)
Le SOSP est présenté comme le service public de référence rattaché au Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, chargé de mettre en œuvre la politique nationale d’orientation dans les écoles.
6.2. L’Institut National de Préparation Professionnelle (INPP)
L’INPP, bien que centré sur la formation, joue un rôle clé dans l’orientation vers les métiers techniques et professionnels, en lien direct avec les besoins des entreprises sur l’ensemble du territoire congolais.
6.3. Les initiatives privées
Le cours mentionne le rôle complémentaire des centres de formation et d’orientation privés ou confessionnels, comme le CADICEC, qui proposent des bilans de compétences et des formations adaptées au marché du travail.
6.4. La collaboration entre les acteurs
L’efficacité du système d’orientation repose sur la collaboration entre tous ces acteurs. L’école, les centres d’orientation, les centres de formation et les entreprises doivent travailler en réseau pour offrir un parcours fluide et cohérent aux jeunes.
Partie III : La Psychologie du Travail et des Organisations
Cette troisième partie explore l’application de la psychologie au monde de l’entreprise. Elle détaille le processus de sélection du personnel, l’analyse des postes de travail, l’évaluation, et se conclut sur l’amélioration des conditions de vie au travail.
Chapitre 7 : La Sélection Professionnelle
7.1. Définition et problèmes de la sélection
La sélection professionnelle est le processus par lequel une entreprise choisit, parmi plusieurs candidats, celui qui présente la meilleure adéquation avec les exigences d’un poste à pourvoir.
7.2. La relation et la distinction entre orientation et sélection
L’orientation est centrée sur l’individu et vise son épanouissement. La sélection est centrée sur l’organisation et vise son efficacité. 
7.3. L’utilisation des tests en sélection
En sélection, les tests sont utilisés dans une logique prédictive. L’objectif est de prédire, à partir des résultats aux tests, la performance future du candidat dans le poste de travail.
7.4. Les autres outils de sélection
Les tests ne sont qu’un outil parmi d’autres. L’entretien de recrutement, la vérification des références, et de plus en plus, les mises en situation professionnelles, sont des méthodes complémentaires indispensables pour évaluer un candidat.
Chapitre 8 : Le Processus de Sélection
8.1. La composition d’une batterie de tests
Une sélection rigoureuse ne repose jamais sur un seul test. Le psychologue compose une « batterie » de tests variés (intelligence, aptitudes, personnalité) en fonction du profil de poste, et pondère les résultats de chaque épreuve.
8.2. La fixation de la limite critique
La limite critique, ou seuil de réussite, est la note minimale en dessous de laquelle un candidat est rejeté. Sa fixation est une décision statistique qui vise à optimiser le nombre de « bons » candidats retenus tout en minimisant le nombre de « mauvais » candidats acceptés.
8.3. Le rôle du technicien social
Le technicien social peut assister le psychologue dans la logistique de la sélection (accueil des candidats, surveillance des tests) et participer à l’évaluation des compétences relationnelles lors des entretiens de groupe.
8.4. L’organisation de visites d’entreprises
Des visites auprès de services de sélection de grandes entreprises, comme dans le secteur minier ou brassicole, permettent aux élèves de voir concrètement comment se déroule un processus de recrutement à grande échelle.
Chapitre 9 : L’Analyse du Travail
9.1. Définition et but de l’analyse de travail
L’analyse de travail est la méthode qui permet de décrire de manière détaillée le contenu d’un poste et les exigences qu’il requiert. C’est le point de départ de toute la gestion des ressources humaines (recrutement, formation, évaluation).
9.2. Les notions de profession, fonction et tâche
Une clarification terminologique est opérée. La tâche est l’activité élémentaire. La fonction est un ensemble de tâches connexes. La profession est un ensemble de fonctions qui demandent une formation et des compétences spécifiques.
9.3. La méthodologie
Le cours présente les principales méthodes d’analyse : l’observation directe du travailleur, l’entretien avec le titulaire du poste et son supérieur, et le questionnaire d’analyse de poste.
9.4. La déduction des qualités requises
À partir de l’analyse des tâches, l’analyste déduit le profil de compétences, de connaissances et d’aptitudes (« profil de poste ») nécessaire pour réussir dans la fonction, qui servira de base pour le recrutement.
Chapitre 10 : L’Évaluation du Travail et la Rémunération
10.1. L’évaluation du travail : Définition et enjeux
L’évaluation du travail (ou pesée des postes) est la méthode qui permet de hiérarchiser les différents postes au sein d’une entreprise en fonction de leur importance relative, afin de construire une grille de salaires équitable.
10.2. Les critères d’évaluation
Plusieurs critères sont utilisés pour évaluer les postes, comme le niveau de compétence requis, l’effort mental et physique, le niveau de responsabilité et les conditions de travail.
10.3. Les méthodes de calcul des salaires
Le cours présente les différentes composantes qui entrent dans le calcul du salaire, en lien avec la classification issue de l’évaluation des postes, mais aussi avec la performance individuelle (primes) et les contraintes du marché du travail.
10.4. Le lien entre évaluation, classification et rémunération
Cette section de synthèse montre la chaîne logique : l’analyse de poste permet de le décrire, l’évaluation permet de le classer, et cette classification détermine sa position dans la grille de rémunération de l’entreprise.
Chapitre 11 : L’Amélioration des Conditions de Travail
11.1. L’embellissement rationnel du milieu de travail
L’ergonomie est présentée comme l’application des connaissances psychologiques et physiologiques à la conception des lieux de travail, afin d’améliorer le confort, la sécurité et l’efficacité des travailleurs.
11.2. La gestion des problèmes d’éclairage et d’aération
Un bon éclairage et une bonne ventilation sont des facteurs essentiels du bien-être et de la prévention de la fatigue. Le cours aborde les normes à respecter et les solutions techniques pour optimiser ces paramètres.
11.3. L’utilisation psychologique des couleurs
Les couleurs ont un impact sur l’humeur et la perception. 
11.4. L’impact de la musique sur le rendement
Le cours examine de manière nuancée l’effet de la musique d’ambiance au travail. Pour les tâches répétitives et monotones, elle peut améliorer le moral et le rendement, mais pour les tâches complexes, elle peut être une source de distraction.
Partie IV : Applications Spécifiques et Pratique Professionnelle
La dernière partie du cours élargit le champ d’application de la psychologie à d’autres domaines pertinents et se conclut par une mise en pratique des compétences acquises, visant à synthétiser et à consolider la formation de l’élève en tant que futur assistant en psychologie appliquée.
Chapitre 12 : La Psychologie de la Vente et de la Publicité
12.1. Les motivations psychologiques de l’acheteur
Cette section explore les facteurs psychologiques qui influencent la décision d’achat, comme les besoins, les désirs, l’image de soi et l’influence du groupe social.
12.2. Les techniques de persuasion
Les principes psychologiques de la persuasion (réciprocité, preuve sociale, sympathie) sont appliqués à l’acte de vente, pour une analyse critique des techniques commerciales.
12.3. Les mécanismes psychologiques de la publicité
La publicité est analysée comme une forme de communication persuasive qui utilise des mécanismes psychologiques comme le conditionnement, l’association d’idées et l’appel aux émotions pour influencer le consommateur.
12.4. L’analyse critique des messages
L’élève est entraîné à décoder les messages publicitaires pour identifier les techniques psychologiques utilisées, afin de développer son esprit critique de consommateur et de citoyen.
Chapitre 13 : La Psychologie Clinique et de la Santé
13.1. Introduction à la psychologie clinique
La psychologie clinique est brièvement définie comme la branche de la psychologie qui s’intéresse au diagnostic et au traitement des troubles psychiques et des problèmes d’adaptation.
13.2. Le rôle du psychologue dans les institutions de santé
La place du psychologue dans les hôpitaux ou les centres de santé est présentée. Son rôle est d’apporter un soutien aux patients et à leurs familles et de collaborer avec les équipes soignantes.
13.3. L’approche psychosociale de la maladie
Cette approche montre que la maladie n’est pas seulement un phénomène biologique, mais aussi une expérience vécue qui est influencée par des facteurs psychologiques (stress, croyances) et sociaux (soutien de l’entourage).
13.4. Le technicien social comme relais
Le travailleur social est souvent le premier interlocuteur des personnes en souffrance psychique. Son rôle est de pouvoir repérer ces situations, d’offrir une première écoute et d’orienter vers les professionnels compétents.
Chapitre 14 : La Pratique Appliquée
14.1. Application pratique : Passation de tests
Les élèves se soumettent à des tests d’aptitudes et de personnalité et s’exercent à les faire passer à leurs condisciples, sous la supervision de l’enseignant, pour se familiariser avec la pratique.
14.2. Étude de cas : Simulation d’un entretien
Un jeu de rôle est organisé, simulant un entretien d’orientation ou de sélection. 
14.3. Projet de groupe : Analyse d’un poste
En groupe, les élèves réalisent l’analyse complète d’un poste de travail existant dans leur environnement, par exemple le poste de surveillant ou de secrétaire de leur école, et rédigent la fiche de poste correspondante.
14.4. Visite et rapport
Le cours se conclut par une visite obligatoire d’un service RH, d’un centre de l’INPP ou du SOSP. Les élèves doivent rédiger un rapport de visite structuré, synthétisant leurs observations et leur compréhension du fonctionnement de la structure.
Annexes
1. Glossaire de la psychologie appliquée
Un lexique définit de manière simple les termes techniques de la discipline (test, validité, OSP, ergonomie, etc.), fournissant un outil de référence pour maîtriser le vocabulaire professionnel.
2. Modèle de fiche de description de poste
Un exemple complet de fiche de poste est fourni. Il est commenté pour expliquer chaque rubrique (intitulé, missions, activités, compétences requises) et sert de guide pratique pour les exercices d’analyse d’emploi.
3. Guide pour l’interprétation d’un profil de test simple
Une fiche méthodologique explique, avec des termes simples, comment lire et interpréter le profil de résultats à un questionnaire d’intérêts professionnels, en se concentrant sur la mise en évidence des dominantes et des pistes de réflexion.
4. Canevas d’un rapport de visite institutionnelle
Un modèle structuré de rapport de visite est proposé. 




