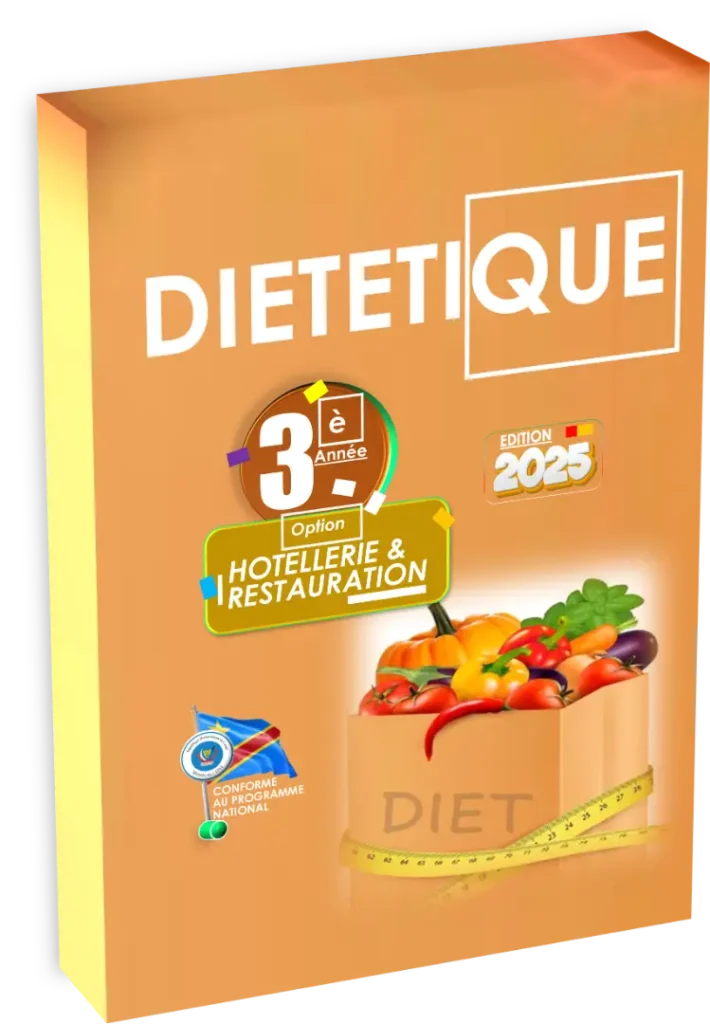
DIÉTÉTIQUE
3ÈME ANNÉE, OPTION HÔTELLERIE ET RESTAURATION
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
PRÉLIMINAIRES
1. Introduction à la Diététique Appliquée 🥗
Cette section d’ouverture définit la diététique comme la science de l’alimentation équilibrée, qui vise à maintenir la santé par une nutrition adaptée. L’étude la distingue de la nutrition (la science des nutriments) en la présentant comme son application pratique : l’art de composer des repas et des régimes qui répondent à des besoins spécifiques. Pour le futur professionnel de l’hôtellerie, la diététique est une compétence essentielle pour répondre à une clientèle de plus en plus soucieuse de son bien-être et de sa santé.
2. Objectifs Pédagogiques du Cours 🎯
Les compétences visées pour cette année sont orientées vers la conception et l’adaptation de l’offre alimentaire. Le programme a pour ambition de rendre l’élève capable de calculer les besoins énergétiques et nutritionnels, de composer des menus équilibrés pour une personne en bonne santé à différents âges de la vie, d’adapter les techniques culinaires pour préserver les qualités nutritionnelles des aliments, et de comprendre les principes des principaux régimes thérapeutiques. L’objectif est de former des professionnels capables de créer une offre de restauration saine et responsable.
3. Rappel des Acquis de Nutrition Générale 🥕
Ce point a pour fonction de consolider les connaissances acquises les années précédentes en nutrition : les rôles des macro et micro-nutriments, la composition des grandes familles d’aliments et les conséquences des carences ou des excès. Cette base de connaissances est le prérequis indispensable pour aborder la composition rationnelle des régimes alimentaires.
4. Le Rôle du Restaurateur comme Acteur de Santé Publique 🧑⚕️
L’étude met en lumière la responsabilité sociale du professionnel de la restauration. En proposant des plats équilibrés et en informant correctement ses clients, le restaurateur devient un acteur de l’éducation nutritionnelle et de la prévention de nombreuses maladies liées à l’alimentation, un rôle citoyen important à Kinshasa comme dans les villes de province.
PARTIE 1 : LES FONDEMENTS SCIENTIFIQUES DE LA DIÉTÉTIQUE
Aperçu : Cette première partie établit le socle de connaissances physiologiques et biochimiques sur lequel repose toute la science diététique. Elle explore la manière dont le corps humain utilise les aliments, définit les besoins quantitatifs et qualitatifs de l’organisme, et formalise les règles de l’équilibre alimentaire.
CHAPITRE 1 : LA DIGESTION ET L’UTILISATION DES NUTRIMENTS
1.1. Le Processus de la Digestion : de la Bouche à l’Intestin
Ce sous-chapitre propose une révision approfondie du parcours et de la transformation des aliments dans le tube digestif. L’action mécanique (mastication, brassage) et l’action chimique des enzymes digestives sur les glucides, les lipides et les protéines sont détaillées pour comprendre comment les aliments sont décomposés en nutriments assimilables.
1.2. L’Absorption et le Métabolisme des Nutriments
Une fois digérés, les nutriments traversent la paroi intestinale pour passer dans le sang. L’étude explique ce phénomène d’absorption et suit le devenir des nutriments dans l’organisme (le métabolisme) : leur utilisation pour produire de l’énergie, pour construire et réparer les tissus, ou leur mise en réserve.
1.3. La Digestibilité des Aliments
La notion de digestibilité est introduite. L’élève apprend que tous les aliments ne sont pas digérés avec la même facilité et que des facteurs comme la composition de l’aliment, son mode de cuisson et les associations alimentaires peuvent influencer la vitesse et le confort de la digestion.
1.4. Les Facteurs Influant sur la Digestion
Les facteurs nerveux, hormonaux et psychiques qui régulent la fonction digestive sont examinés. Le stress, par exemple, peut avoir un impact significatif sur la digestion, une information utile pour comprendre le comportement alimentaire de certains clients.
CHAPITRE 2 : LES BESOINS ÉNERGÉTIQUES DE L’ORGANISME
2.1. La Dépense Énergétique : Métabolisme de Base et Activité
La dépense énergétique totale d’un individu est décomposée en ses principales composantes. Sont définis le métabolisme de base (l’énergie nécessaire au repos pour faire fonctionner les organes vitaux), l’effet thermique des aliments et l’énergie dépensée lors de l’activité physique.
2.2. Le Calcul du Métabolisme de Base
Des formules simples (comme celle de Harris-Benedict) sont présentées pour permettre à l’élève d’estimer le métabolisme de base d’une personne en fonction de son sexe, de son âge, de son poids et de sa taille, une compétence fondamentale en diététique.
2.3. L’Évaluation des Besoins Liés à l’Activité Physique
L’élève apprend à quantifier la dépense énergétique liée à l’activité physique en utilisant des niveaux d’activité (sédentaire, actif, etc.). Le calcul du besoin énergétique total journalier est ainsi obtenu en multipliant le métabolisme de base par le facteur d’activité correspondant.
2.4. La Balance Énergétique : Poids et Énergie
Le concept de balance énergétique est expliqué : si les apports énergétiques (calories consommées) sont égaux aux dépenses énergétiques, le poids reste stable. Un déséquilibre de cette balance conduit à une prise ou à une perte de poids, un principe de base pour la gestion pondérale.
CHAPITRE 3 : LES BESOINS QUALITATIFS ET L’ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE
3.1. Les Besoins en Protéines, Lipides et Glucides (PLG)
Au-delà de l’énergie, l’organisme a des besoins qualitatifs. Ce cours détaille les recommandations pour la répartition des macronutriments dans l’apport énergétique total. L’importance de la qualité des protéines (acides aminés essentiels) et des lipides (acides gras essentiels) est soulignée.
3.2. Les Besoins en Vitamines et Minéraux
Les besoins en micronutriments, bien que nécessaires en petites quantités, sont vitaux. Le rôle des principales vitamines (A, C, D, groupe B) et des minéraux (calcium, fer, iode) est étudié, ainsi que les risques liés à leurs carences, qui peuvent être une problématique de santé publique dans certaines régions de la RDC.
3.3. L’Importance de l’Hydratation et des Fibres
Les besoins en eau sont rappelés comme étant essentiels à la vie. Le rôle des fibres alimentaires, qui ne sont pas digérées mais sont cruciales pour la santé intestinale et la régulation de la glycémie et du cholestérol, est également mis en avant.
3.4. Le Concept de Ration Alimentaire Équilibrée
La notion de ration alimentaire est définie comme la quantité d’aliments nécessaire pour couvrir les besoins d’un individu sur 24 heures. L’élève apprend qu’une ration équilibrée doit satisfaire à la fois les besoins quantitatifs (énergie) et qualitatifs (macro et micro-nutriments).
PARTIE 2 : LA DIÉTÉTIQUE APPLIQUÉE AUX ÉTAPES DE LA VIE
Aperçu : Cette deuxième partie applique les principes de la diététique aux besoins spécifiques des individus à différentes périodes de leur existence. De la femme enceinte à la personne âgée, l’élève apprend à adapter les recommandations nutritionnelles pour répondre aux exigences physiologiques particulières de chaque âge de la vie.
CHAPITRE 4 : L’ALIMENTATION DE LA FEMME ENCEINTE ET ALLAITANTE
4.1. Les Besoins Nutritionnels Spécifiques durant la Grossesse
Les besoins accrus de la femme enceinte en énergie, en protéines, en fer, en calcium et en acide folique (vitamine B9) sont expliqués. L’importance d’une alimentation de qualité pour la santé de la mère et le bon développement du fœtus est soulignée.
4.2. Les Recommandations et Interdits Alimentaires
Ce sous-chapitre détaille les conseils diététiques pour la grossesse : privilégier les aliments riches en nutriments essentiels et éviter les comportements à risque (alcool). Les précautions pour prévenir les toxi-infections alimentaires (toxoplasmose, listériose) sont également enseignées.
4.3. L’Alimentation durant l’Allaitement
Durant l’allaitement, les besoins nutritionnels de la mère restent élevés pour assurer une production de lait de qualité. Les recommandations pour une alimentation variée et une bonne hydratation sont fournies.
4.4. Exemple de Menu pour une Femme Enceinte
Pour concrétiser les apprentissages, un exemple de journée alimentaire type pour une femme enceinte est élaboré, en utilisant des produits locaux disponibles sur le marché de Mbandaka, comme le poisson frais, les légumes feuilles et les fruits tropicaux.
CHAPITRE 5 : LA DIÉTÉTIQUE DU NOURRISSON ET DE L’ENFANT
5.1. L’Allaitement Maternel : Avantages et Recommandations
L’allaitement maternel exclusif jusqu’à 6 mois est présenté comme l’alimentation idéale du nourrisson, parfaitement adaptée à ses besoins et à son immaturité digestive. Ses multiples bienfaits pour la santé de l’enfant et de la mère sont mis en avant.
5.2. Les Laits Infantiles et l’Allaitement Artificiel
En cas d’allaitement artificiel, les différents types de préparations pour nourrissons (laits 1er âge, 2ème âge) sont présentés. Les règles strictes d’hygiène pour la préparation des biberons sont enseignées pour éviter tout risque infectieux.
5.3. La Diversification Alimentaire
L’étape de la diversification, qui débute entre 4 et 6 mois, est détaillée. L’introduction progressive des différentes familles d’aliments (légumes, fruits, viandes, féculents) est expliquée, en respectant un calendrier précis pour favoriser l’éveil au goût et prévenir les allergies.
5.4. L’Équilibre Alimentaire de l’Enfant et de l’Adolescent
Les besoins liés à la croissance rapide de l’enfant et de l’adolescent sont étudiés. L’importance de repas structurés, d’une alimentation variée et de la limitation des produits sucrés et gras est soulignée pour prévenir l’obésité infantile, un problème croissant même dans les villes congolaises.
CHAPITRE 6 : L’ALIMENTATION DE L’ADULTE ET DU SPORTIF
6.1. L’Équilibre Alimentaire de l’Adulte Bien-Portant
Ce cours définit les grands principes de l’alimentation équilibrée pour un adulte ayant une activité modérée. Les recommandations de consommation pour chaque groupe d’aliments sont données pour maintenir un poids santé et prévenir les maladies chroniques.
6.2. Les Besoins Spécifiques du Sportif
L’alimentation du sportif est adaptée en fonction de l’intensité et de la durée de son activité. Les besoins accrus en glucides (le carburant de l’effort), en protéines (pour la réparation musculaire) et en eau (pour compenser les pertes sudorales) sont expliqués.
6.3. La Diététique de l’Effort : Avant, Pendant et Après
La chronologie de la nutrition sportive est détaillée. L’élève apprend à composer un repas optimal avant l’effort, à gérer l’hydratation et l’apport énergétique pendant l’effort, et à concevoir une collation de récupération pour reconstituer les stocks d’énergie et réparer les muscles après l’effort.
6.4. Les Risques des Régimes et Produits pour Sportifs
Une mise en garde est formulée contre les régimes extrêmes et l’utilisation non contrôlée de compléments alimentaires ou de produits dopants. L’accent est mis sur une approche naturelle et équilibrée de la nutrition sportive.
PARTIE 3 : L’APPLICATION DE LA DIÉTÉTIQUE EN RESTAURATION
Aperçu : Cette troisième partie fait le pont entre la théorie diététique et la pratique professionnelle en hôtellerie-restauration. Elle fournit les outils pour concevoir une offre de restauration équilibrée, adapter les techniques de cuisine et répondre aux grandes tendances alimentaires actuelles.
CHAPITRE 7 : LA CONCEPTION DE MENUS ÉQUILIBRÉS
7.1. Les Principes de l’Équilibre sur un Repas et une Journée
L’élève apprend à appliquer les règles de l’équilibre alimentaire non seulement sur une journée, mais aussi à l’échelle d’un seul repas. Un repas complet et équilibré doit idéalement comporter une source de protéines, de féculents, de légumes, un produit laitier et un fruit.
7.2. L’Analyse Nutritionnelle d’une Recette
Des méthodes simples pour évaluer la valeur nutritionnelle d’une recette sont enseignées. L’identification des groupes d’aliments présents et l’analyse critique de la recette (quantité de matières grasses, de sucre, mode de cuisson) permettent d’estimer son profil diététique.
7.3. La Création de Menus Équilibrés pour la Collectivité
La composition de menus pour la restauration collective (écoles, entreprises) est abordée. L’élève apprend à planifier des cycles de menus sur plusieurs semaines qui respectent l’équilibre alimentaire, la saisonnalité des produits et la variété, tout en maîtrisant les coûts, un défi pour un gestionnaire à Kananga.
7.4. La Valorisation de l’Offre « Santé » sur une Carte
Ce cours donne des pistes pour mettre en avant les plats les plus équilibrés sur la carte d’un restaurant. L’utilisation de logos, la rédaction d’intitulés attractifs et la formation du personnel de salle pour conseiller les clients sont des stratégies commerciales efficaces.
CHAPITRE 8 : LES RÉGIMES ET TENDANCES ALIMENTAIRES
8.1. Le Végétarisme et ses Variantes
Le régime végétarien, qui exclut la consommation de chair animale, est étudié. Ses différentes déclinaisons (lacto-ovo-végétarisme, végétalisme) sont expliquées. L’élève apprend à composer des menus végétariens équilibrés en veillant à la complémentarité des protéines végétales.
8.2. Le Régime « Sans Gluten » et « Sans Lactose »
La diététique des intolérances alimentaires les plus courantes est abordée. Le principe du régime sans gluten (pour la maladie cœliaque) et du régime sans lactose est expliqué, ainsi que les alternatives pour remplacer les aliments qui en contiennent.
8.3. Les Tendances du « Manger Sain »
Les nouvelles attentes des consommateurs sont analysées. La demande pour des produits locaux, de saison, biologiques ou issus du commerce équitable est une tendance de fond à laquelle la restauration doit s’adapter pour rester compétitive.
8.4. L’Analyse Critique des Régimes à la Mode
Un esprit critique est développé face à la prolifération des régimes amaigrissants « miracles ». L’élève apprend à analyser ces régimes à la lumière des connaissances scientifiques pour identifier ceux qui sont déséquilibrés, inefficaces à long terme, voire dangereux pour la santé.
PARTIE 4 : INTRODUCTION À LA DIÉTÉTIQUE THÉRAPEUTIQUE
Aperçu : Cette dernière partie offre une initiation à la diététique de la personne malade. Sans former des diététiciens cliniciens, elle vise à donner aux futurs professionnels les connaissances de base pour comprendre et appliquer les prescriptions de régimes pour les pathologies les plus courantes liées à l’alimentation.
CHAPITRE 9 : LES PRINCIPES DES RÉGIMES THÉRAPEUTIQUES
9.1. Définition et Objectifs d’un Régime Thérapeutique
Un régime thérapeutique est défini comme une alimentation prescrite par un médecin pour traiter une maladie ou en prévenir les complications. Ses objectifs peuvent être de soulager des symptômes, de mettre un organe au repos ou de corriger un trouble métabolique.
9.2. Les Régimes à Texture Modifiée
Les régimes où la texture des aliments est adaptée sont présentés. Le régime liquide, le régime mixé et le régime haché sont expliqués, notamment pour les personnes ayant des difficultés de mastication ou de déglutition.
9.3. Les Régimes d’Épargne Digestive
Le principe des régimes visant à faciliter le travail du système digestif est étudié. Le régime sans résidu, qui limite les fibres, et le régime pauvre en graisses sont décrits pour des situations de troubles digestifs aigus.
9.4. La Traduction d’une Prescription en Menu
La compétence la plus importante pour un cuisinier est de savoir traduire une prescription médicale (ex: « régime diabétique, sans sel ») en un menu concret, appétissant et respectueux des contraintes. Des exercices de mise en situation sont proposés.
CHAPITRE 10 : LA DIÉTÉTIQUE DES MALADIES MÉTABOLIQUES
10.1. Le Diabète : Principes Diététiques
La diététique du diabète est expliquée comme un contrôle des apports en glucides pour maintenir une glycémie stable. L’importance de la répartition des glucides au cours de la journée et le choix d’aliments à index glycémique bas sont soulignés.
10.2. La Goutte et le Régime Pauvre en Purines
La goutte est une maladie liée à un excès d’acide urique. Le régime vise à limiter les aliments très riches en purines (précurseurs de l’acide urique) comme les abats, certains poissons et la bière. Une bonne hydratation est également essentielle.
10.3. L’Hypertension Artérielle et le Régime Pauvre en Sodium
Pour lutter contre l’hypertension, la principale mesure diététique est la réduction des apports en sel (sodium). L’élève apprend à cuisiner avec moins de sel, à utiliser des herbes et des épices pour rehausser le goût, et à identifier le sel caché dans les produits industriels.
10.4. Les Dyslipidémies et le Contrôle des Matières Grasses
En cas d’excès de cholestérol ou de triglycérides, le régime vise à contrôler la quantité et surtout la qualité des matières grasses consommées : limiter les graisses saturées (viandes grasses, beurre) et privilégier les graisses insaturées (poissons gras, huiles végétales).
CHAPITRE 11 : LA GESTION DU POIDS ET LES TROUBLES NUTRITIONNELS
11.1. La Diététique de l’Obésité : le Régime Hypocalorique
Le principe du régime amaigrissant est la création d’un déficit calorique modéré. L’élève apprend à concevoir des menus hypocaloriques mais équilibrés, qui assurent la satiété et préservent la masse musculaire, en évitant les frustrations qui mènent à l’échec.
11.2. La Diététique de la Maigreur et de la Dénutrition
À l’inverse, le régime de la dénutrition vise à enrichir l’alimentation sans augmenter excessivement le volume des repas. Des techniques d’enrichissement (ajout de poudre de lait, de fromage, d’œufs) sont enseignées pour des personnes ayant peu d’appétit.
11.3. La Prise en Charge du Kwashiorkor
Le kwashiorkor, une forme de malnutrition protéino-énergétique sévère encore présente en RDC, est abordé. Bien que sa prise en charge soit médicale, le cours explique le principe de la réalimentation progressive avec des aliments thérapeutiques spécifiques.
11.4. L’Anorexie Mentale : une Approche Spécifique
Les troubles du comportement alimentaire comme l’anorexie mentale sont présentés comme des maladies psychiatriques complexes. Le rôle de l’équipe de restauration, en collaboration avec les soignants, est de proposer des repas de manière bienveillante et non conflictuelle, en suivant un plan de réalimentation progressif.
ANNEXES
1. Glossaire des Termes de Diététique 📖
Une liste alphabétique des termes techniques abordés (diététique, métabolisme, ration, régime, etc.) est fournie avec des définitions claires, afin de constituer un lexique de référence pour l’élève.
2. Table Simplifiée des Besoins Énergétiques 🏃
Un tableau synthétique présente une estimation des besoins énergétiques journaliers pour des hommes et des femmes types, en fonction de leur âge et de leur niveau d’activité physique.
3. Exemples de Menus Équilibrés sur une Journée 📅
Plusieurs exemples de journées alimentaires équilibrées sont proposés, adaptés à différents contextes (adulte sédentaire, enfant, femme enceinte) et composés à partir d’aliments courants en RDC.
4. Guide de Lecture des Étiquettes Nutritionnelles 🏷️
Une fiche pratique explique comment lire et interpréter le tableau de valeur nutritionnelle obligatoire sur les produits préemballés. Cet outil permet de faire des choix alimentaires éclairés en comparant les produits.



