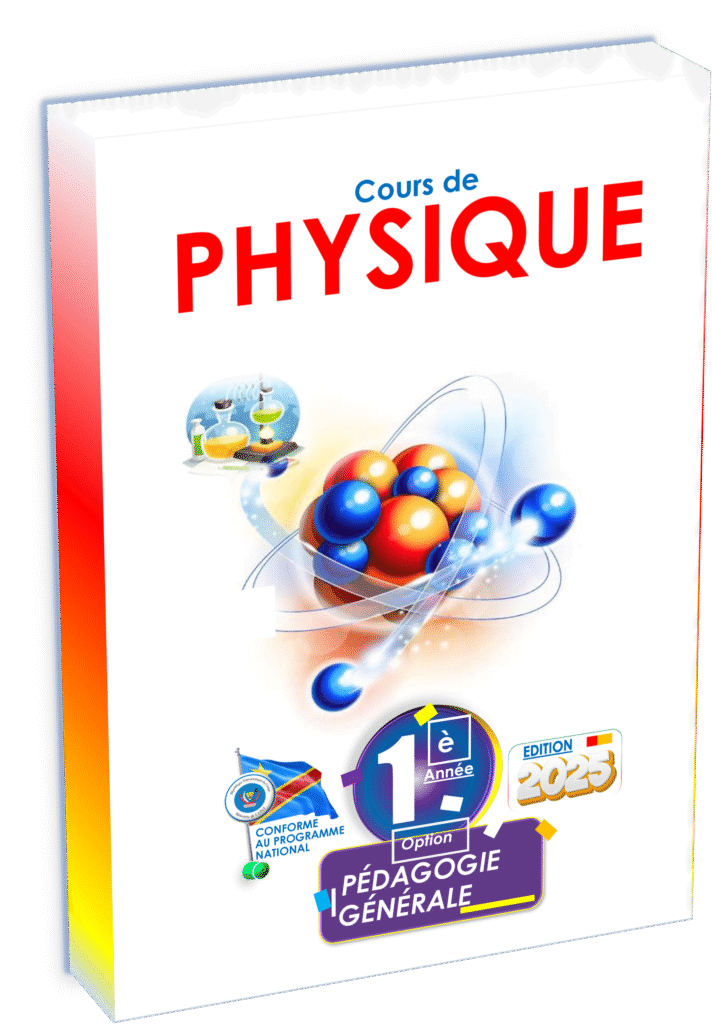
PRÉLIMINAIRES
1. Présentation du cours
Ce cours de Physique fournit aux futurs enseignants du primaire les connaissances fondamentales et les compétences didactiques nécessaires pour initier les élèves aux sciences physiques. L’approche est conçue pour démystifier la discipline en la reliant aux phénomènes observables du quotidien. La finalité est de former des maîtres capables de susciter la curiosité scientifique des enfants, de les guider dans une démarche d’investigation simple et de construire avec eux une première représentation rationnelle du monde matériel.
2. Objectifs généraux et spécifiques
Le cours vise à développer une culture scientifique de base et une maîtrise des outils pédagogiques adaptés à son enseignement. Au terme de cette formation, l’étudiant devra être en mesure de :
- Maîtriser les concepts fondamentaux de la mécanique, de la thermodynamique, de l’électricité et de l’optique.
- Utiliser correctement les unités du Système International et les instruments de mesure courants.
- Concevoir et réaliser des expériences simples avec du matériel accessible pour illustrer les principes physiques.
- Transposer les savoirs scientifiques en activités d’apprentissage engageantes et appropriées au niveau cognitif des élèves du primaire.
- Expliquer des phénomènes naturels et technologiques de l’environnement de l’élève en mobilisant les lois de la physique.
3. Orientations méthodologiques
La méthodologie adoptée privilégie l’approche expérimentale et la pédagogie active. Chaque concept théorique sera introduit à partir de situations-problèmes concrètes et d’observations. Les séances alterneront des exposés synthétiques, des démonstrations par l’enseignant, et des ateliers de manipulation en petits groupes. L’apprentissage par l’enquête sera systématiquement encouragé pour que les futurs maîtres développent eux-mêmes les réflexes de la démarche scientifique qu’ils devront transmettre.
4. Matériel didactique requis
L’enseignement de ce cours requiert un équipement de base permettant la réalisation d’expériences fondamentales. Le matériel inclut des instruments de mesure (mètres rubans, chronomètres, balances, thermomètres, multimètres), des sources d’alimentation électrique de basse tension (piles), des composants de circuits (ampoules, interrupteurs, fils), des aimants, des miroirs, des lentilles simples, ainsi que du matériel de verrerie et des supports divers. L’utilisation de matériaux de récupération pour construire des dispositifs didactiques sera encouragée.
PREMIÈRE PARTIE : FONDEMENTS DE LA PHYSIQUE
Chapitre I : Grandeurs et mesures
1.1 Système international d’unités
Cette section présente le Système International (SI) comme le langage universel de la science pour garantir l’uniformité et la comparabilité des mesures. L’étude se concentre sur les unités de base fondamentales pour le niveau primaire : le mètre (longueur), le kilogramme (masse) et la seconde (temps), en les illustrant par des exemples concrets tirés de l’environnement des élèves.
1.2 Mesure et incertitude
L’accent est mis sur la compréhension que toute mesure est une approximation et comporte une marge d’incertitude. Les étudiants apprennent à effectuer des mesures avec rigueur, à lire correctement les échelles graduées et à exprimer un résultat de manière adéquate, une compétence essentielle pour toute activité scientifique.
1.3 Instruments de mesure usuels
Ce point porte sur la manipulation correcte des instruments de mesure de base disponibles dans une école ou dans la vie courante. La pratique inclut l’utilisation de la latte, du ruban à mesurer, du chronomètre, de la balance de type Roberval et du thermomètre pour des applications pratiques et pédagogiques.
Chapitre II : Vecteurs et cinématique
2.1 Notion de vecteur
La notion de vecteur est introduite de manière intuitive comme un outil pour décrire des grandeurs qui possèdent une direction et un sens, en plus d’une valeur numérique. Des exemples comme le déplacement, la vitesse d’une pirogue sur le fleuve Congo ou une force sont utilisés pour visualiser le concept sans formalisme mathématique excessif.
2.2 Mouvement rectiligne uniforme et varié
L’étude se concentre sur la description du mouvement le plus simple. Le mouvement rectiligne uniforme est analysé à travers des exemples de la vie courante (marche à vitesse constante). Le mouvement uniformément varié est introduit par l’observation de la chute d’un objet, comme une mangue tombant d’un arbre.
2.3 Mouvements circulaires
Ce chapitre aborde la description du mouvement circulaire uniforme, observable dans de nombreuses situations (roue de vélo, manège). Les concepts de période, de fréquence et de vitesse angulaire sont introduits de façon qualitative pour expliquer ce type de mouvement.
Chapitre III : Dynamique
3.1 Lois de Newton
Les trois lois de Newton sont présentées comme les principes fondamentaux qui régissent le mouvement. Elles sont expliquées avec des termes simples et illustrées par des démonstrations qualitatives : le principe d’inertie, la relation entre force, masse et accélération (F=ma), et le principe des actions réciproques.
3.2 Forces et interactions
Cette section vise à identifier les différentes forces présentes dans des situations quotidiennes : le poids, la force de frottement, la tension d’une corde, la réaction d’un support. Les étudiants apprennent à représenter ces forces par des vecteurs sur un schéma simple.
3.3 Applications simples
Des situations concrètes sont analysées pour appliquer les principes de la dynamique. L’étude de l’équilibre d’un objet suspendu ou posé sur une surface permet de consolider la compréhension des interactions entre les forces.
DEUXIÈME PARTIE : ÉNERGIE ET TRAVAIL
Chapitre IV : Travail et puissance
4.1 Définition du travail
Le concept de travail est défini au sens physique du terme : une force produit un travail lorsque son point d’application se déplace. Des exemples clairs, comme pousser une brouette ou soulever une charge, permettent de distinguer le travail mécanique de la notion d’effort dans le langage courant.
4.2 Puissance mécanique
La puissance est présentée comme la mesure de la rapidité avec laquelle un travail est effectué. La comparaison entre monter une charge lentement et la monter rapidement illustre concrètement la différence entre travail et puissance.
4.3 Rendement
La notion de rendement est introduite pour expliquer qu’aucun système ne peut transformer intégralement l’énergie fournie en travail utile, en raison des pertes (frottements). Ce concept est essentiel pour une première approche de l’efficacité énergétique.
Chapitre V : Énergie cinétique et potentielle
5.1 Énergie cinétique
L’énergie cinétique est définie comme l’énergie que possède un corps du fait de son mouvement. Il est montré que cette énergie dépend de la masse du corps et de sa vitesse, expliquant pourquoi un camion en mouvement a plus d’énergie qu’une moto à la même vitesse.
5.2 Énergie potentielle gravitationnelle
L’énergie potentielle de pesanteur est présentée comme une énergie emmagasinée par un objet en raison de son altitude. L’exemple d’un barrage hydroélectrique comme celui d’Inga est utilisé pour illustrer comment l’eau en hauteur possède une énergie potentielle considérable.
5.3 Conservation de l’énergie
Le principe de conservation de l’énergie mécanique est introduit comme une loi fondamentale. Des exemples comme le mouvement d’un pendule ou d’une bille sur une montagne russe montrent comment l’énergie se transforme continuellement de potentielle en cinétique et vice-versa.
Chapitre VI : Sources et formes d’énergie
6.1 Énergies renouvelables et non renouvelables
Cette section classe les sources d’énergie en deux catégories. Les énergies renouvelables (solaire, hydraulique, biomasse) sont présentées comme des solutions d’avenir pour la RDC, en opposition aux énergies fossiles (pétrole, charbon) dont les stocks sont limités.
6.2 Transformation et transfert d’énergie
L’accent est mis sur le fait que l’énergie ne se crée ni ne se perd, mais se transforme. Une chaîne énergétique simple, comme celle d’une lampe de poche (chimique → électrique → lumineuse), permet de concrétiser ce principe.
6.3 Introduction à l’énergie électrique
L’énergie électrique est présentée comme un vecteur énergétique essentiel dans le monde moderne. Son mode de production (alternateur), de transport et ses multiples usages sont abordés de manière descriptive.
TROISIÈME PARTIE : THERMODYNAMIQUE
Chapitre VII : Température et chaleur
7.1 Mesure de la température
Ce point se focalise sur la maîtrise de l’utilisation du thermomètre. Les différentes échelles de température (Celsius, Kelvin) sont présentées, en insistant sur l’échelle Celsius pour les applications courantes.
7.2 Capacité thermique et chaleur massique
La distinction entre chaleur et température est approfondie. La notion de chaleur massique est introduite pour expliquer pourquoi certaines substances, comme l’eau, nécessitent plus d’énergie pour s’échauffer que d’autres, comme le sable.
7.3 Équilibre thermique
Le principe de l’équilibre thermique est expliqué : lorsque deux corps à des températures différentes sont mis en contact, la chaleur se transfère du corps chaud vers le corps froid jusqu’à ce qu’ils atteignent la même température.
Chapitre VIII : Changements d’état
8.1 Fusion et solidification
L’étude des processus de fusion (solide → liquide) et de solidification (liquide → solide) est menée à travers l’exemple de l’eau. La notion de température de fusion constante pendant le changement d’état est mise en évidence expérimentalement.
8.2 Vaporisation et condensation
Les phénomènes de vaporisation (liquide → gaz) et de condensation (gaz → liquide) sont analysés. La distinction entre l’ébullition et l’évaporation est clarifiée à l’aide d’exemples de la vie de tous les jours (linge qui sèche, eau qui bout).
8.3 Chaleur latente
Le concept de chaleur latente est introduit pour expliquer que l’énergie fournie pendant un changement d’état sert à modifier la structure de la matière et non à augmenter sa température.
Chapitre IX : Transfert thermique
9.1 Conduction
La conduction est présentée comme le mode de transfert de chaleur privilégié dans les solides, par contact direct. L’expérience d’une barre de métal chauffée à une extrémité illustre ce phénomène.
9.2 Convection
La convection est expliquée comme le transfert de chaleur par déplacement de matière dans les fluides (liquides et gaz). Le mouvement de l’eau dans une casserole qui chauffe ou la formation des brises en sont des exemples typiques.
9.3 Rayonnement
Le rayonnement est défini comme le transfert de chaleur par ondes électromagnétiques, qui peut se faire dans le vide. Le réchauffement de la Terre par le Soleil ou la chaleur ressentie à côté d’un feu de bois (« makala ») en sont les illustrations principales.
QUATRIÈME PARTIE : ÉLECTRICITÉ ET MAGNÉTISME
Chapitre X : Électricité statique
10.1 Charge électrique et conducteurs
L’existence de deux types de charges électriques (positive et négative) est introduite par des expériences simples d’électrisation par frottement. La distinction entre matériaux conducteurs (métaux) et isolants (plastique, bois) est établie.
10.2 Loi de Coulomb
La loi de Coulomb est présentée de manière qualitative pour décrire les interactions entre charges : les charges de même signe se repoussent, tandis que les charges de signes opposés s’attirent.
10.3 Applications élémentaires
Des phénomènes courants comme la foudre ou les petites décharges ressenties en touchant un objet sont expliqués à l’aide des concepts de l’électricité statique.
Chapitre XI : Courant électrique
11.1 Circuit électrique simple
Ce chapitre, très pratique, guide les futurs enseignants dans la réalisation d’un circuit électrique simple comprenant une source (pile), un récepteur (ampoule), un interrupteur et des fils de connexion. La notion de circuit ouvert et fermé est fondamentale.
11.2 Loi d’Ohm
La loi d’Ohm (U=RI) est présentée comme la relation fondamentale liant la tension (U), le courant (I) et la résistance (R) dans un circuit. Son application permet de comprendre le fonctionnement des composants de base.
11.3 Résistance, conductance et association de résistances
La résistance électrique est définie comme l’opposition au passage du courant. Les montages en série et en parallèle de résistances (ou d’ampoules) sont étudiés expérimentalement pour en déduire les lois d’association.
Chapitre XII : Magnétisme
12.1 Aimants et champ magnétique
Les propriétés des aimants permanents (pôles Nord et Sud, attraction et répulsion) sont étudiées. La notion de champ magnétique est visualisée à l’aide de limaille de fer pour cartographier les lignes de champ autour d’un aimant.
12.2 Force magnétique sur un courant
Le lien entre électricité et magnétisme est établi. Il est démontré qu’un fil parcouru par un courant et placé dans un champ magnétique subit une force. C’est le principe de fonctionnement du moteur électrique.
12.3 Applications simples
Des applications technologiques du magnétisme et de l’électromagnétisme sont présentées, comme la boussole, le haut-parleur ou l’électroaimant, utilisé par exemple dans les grues de levage de ferraille dans des zones industrielles comme à Lubumbashi.
CINQUIÈME PARTIE : ONDES ET OPTIQUE
Chapitre XIII : Ondes mécaniques
13.1 Définition et caractéristiques
Une onde est définie comme la propagation d’une perturbation transportant de l’énergie sans transport de matière. Les caractéristiques principales (amplitude, longueur d’onde, fréquence) sont définies à l’aide de l’exemple d’une onde sur une corde.
13.2 Vitesse de propagation
La notion de vitesse de propagation d’une onde (célérité) est introduite. Il est expliqué que cette vitesse dépend des propriétés du milieu dans lequel l’onde se propage.
13.3 Superposition d’ondes
Le principe de superposition est abordé de manière qualitative pour expliquer comment deux ondes peuvent se croiser sans se perturber ou comment elles peuvent s’additionner (interférences).
Chapitre XIV : Ondes sonores
14.1 Production et propagation du son
Le son est présenté comme une onde mécanique produite par la vibration d’un objet (corde vocale, peau de tam-tam). La nécessité d’un milieu matériel pour sa propagation est mise en évidence.
14.2 Fréquence et intensité
Les caractéristiques subjectives du son, la hauteur (grave/aigu) et l’intensité (fort/faible), sont mises en relation avec ses caractéristiques physiques, la fréquence et l’amplitude.
14.3 Applications pédagogiques
Des activités simples à réaliser en classe sont proposées, comme la fabrication d’un téléphone à ficelle ou d’instruments de musique simples pour étudier les propriétés du son.
Chapitre XV : Optique géométrique
15.1 Propagation rectiligne de la lumière
Le principe de la propagation rectiligne de la lumière est établi comme le fondement de l’optique géométrique. La formation des ombres et le fonctionnement de la chambre noire en sont des conséquences directes.
15.2 Réflexion et réfraction
Les lois de la réflexion (sur un miroir plan) et de la réfraction (changement de direction de la lumière en passant de l’air à l’eau) sont étudiées expérimentalement. Le phénomène du bâton « brisé » dans l’eau illustre la réfraction.
15.3 Lentilles et images
Le fonctionnement des lentilles convergentes et divergentes est exploré. La formation d’images réelles (projetables sur un écran) et virtuelles est expliquée, jetant les bases de la compréhension d’instruments comme la loupe.
ANNEXES
Annexe A : Tables de conversion et constantes
Cette annexe sert d’aide-mémoire pratique, regroupant les tables de conversion entre différentes unités de mesure et les valeurs des constantes physiques fondamentales utiles pour la résolution de problèmes simples.
Annexe B : Fiches d’activités de mesures
Il s’agit d’une collection de protocoles expérimentaux détaillés, étape par étape, pour guider les futurs enseignants dans la mise en place d’ateliers de mesure en classe (mesure de longueurs, de masses, de temps).
Annexe C : Schémas de circuits et montages simples
Cette section fournit une bibliothèque de schémas normalisés pour les circuits électriques de base et des illustrations de montages optiques ou mécaniques simples, servant de référence visuelle pour la préparation des expériences.
Annexe D : Grilles d’évaluation des compétences
Des modèles de grilles d’évaluation sont proposés pour permettre aux futurs enseignants d’évaluer de manière objective les compétences expérimentales et la compréhension conceptuelle de leurs élèves lors des activités pratiques.
Annexe E : Textes officiels du programme national
Cette dernière annexe compile les extraits pertinents du programme national de physique pour l’enseignement primaire. Elle constitue le référentiel officiel que l’enseignant est tenu de suivre et d’appliquer.