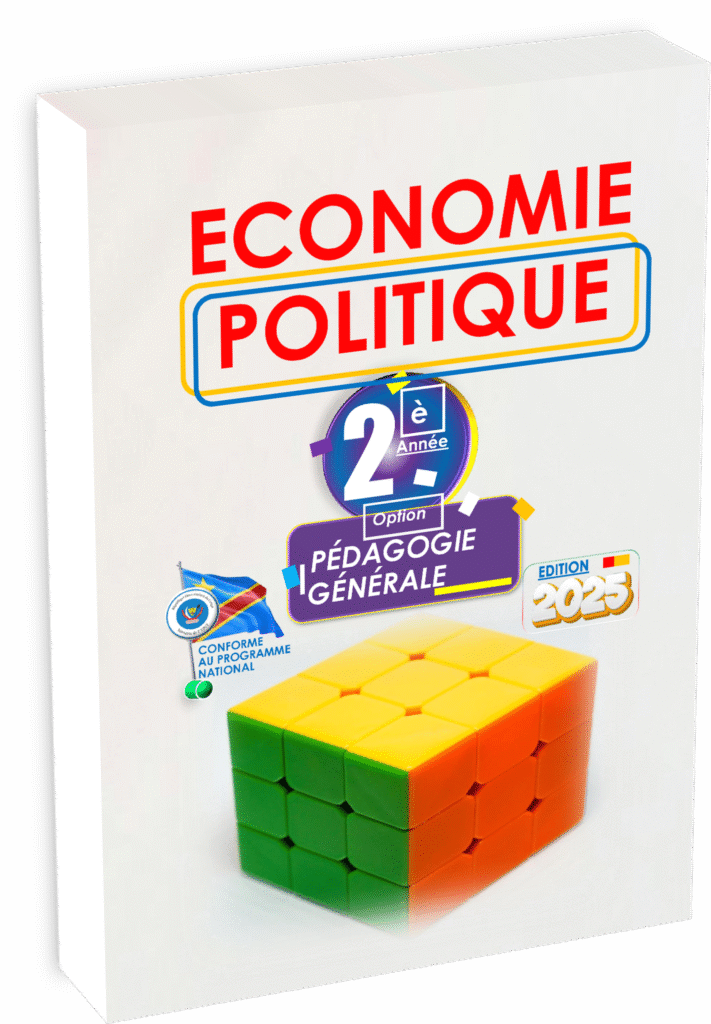
Économie Politique – 2ème Année des Humanités Pédagogiques
Edition 2025 / Enseignement, primaire, secondaire et technique en RDC.
PRÉLIMINAIRES
Présentation du programme
Ce cours initie les futurs enseignants aux concepts et mécanismes fondamentaux qui régissent la vie économique des sociétés. L’objectif est de leur fournir une grille d’analyse rigoureuse pour comprendre les grands enjeux économiques contemporains, notamment ceux qui caractérisent la République Démocratique du Congo. La maîtrise de ces savoirs doit leur permettre non seulement de former des citoyens éclairés, capables de décrypter leur environnement socio-économique, mais aussi de mieux appréhender le contexte dans lequel s’inscrit leur future profession.
📖 PREMIÈRE PARTIE : FONDEMENTS ET GÉNÉRALITÉS
Chapitre 1 : Introduction à l’économie politique
Ce chapitre établit les fondations de la discipline, en définissant son champ d’étude, ses outils d’analyse et son évolution historique, afin de situer l’économie comme une science sociale au cœur des problématiques de développement.
1.1. Définition et objet de l’économie politique
L’économie politique est définie comme la science sociale qui étudie la manière dont les individus et les sociétés allouent des ressources rares pour produire, échanger et consommer des biens et services afin de satisfaire leurs besoins. Son objet est l’analyse des choix économiques et des interactions entre les agents dans le cadre des institutions politiques et sociales.
1.2. Méthodes d’analyse économique
La démarche de l’économiste est présentée à travers deux approches complémentaires : la méthode déductive, qui part de théories et de modèles pour en déduire des implications logiques, et la méthode inductive, qui part de l’observation de faits et de données statistiques pour formuler des lois ou des tendances générales.
1.3. Histoire de la pensée économique
Un survol des grands courants de la pensée économique est proposé, depuis les mercantilistes et les physiocrates, en passant par les classiques (Adam Smith, David Ricardo), les critiques marxistes, la révolution néoclassique marginaliste, jusqu’aux apports de John Maynard Keynes et aux débats contemporains.
1.4. Économie politique et développement en RDC
Cette section contextualise l’étude en appliquant les concepts économiques aux réalités de la RDC. Sont abordés les défis structurels tels que la dépendance aux matières premières, le poids du secteur informel, les questions de gouvernance économique et la recherche de voies pour une croissance inclusive et durable.
Chapitre 2 : Agents économiques et besoins
Ce segment décompose le fonctionnement de l’économie en identifiant ses acteurs principaux et la logique fondamentale qui anime leur action : la satisfaction des besoins.
2.1. Classification des agents économiques
Les différents agents qui animent la vie économique sont identifiés et leurs fonctions principales sont décrites : les ménages (consommation), les entreprises (production), l’État (régulation, redistribution), les institutions financières (financement) et le reste du monde (échanges internationaux).
2.2. Nature et classification des besoins humains
La notion de besoin, moteur de toute activité économique, est analysée. Une distinction est opérée entre les besoins primaires (vitaux) et les besoins secondaires (sociaux, culturels), en s’appuyant sur des classifications comme la pyramide de Maslow pour illustrer leur hiérarchie.
2.3. Rareté des ressources et choix économiques
Le problème économique fondamental est exposé : la contradiction entre des besoins humains illimités et des ressources (naturelles, humaines, capital) disponibles en quantité limitée. Cette rareté impose de faire des choix, dont le coût d’opportunité (ce à quoi on renonce) est la mesure.
2.4. Circuits économiques fondamentaux
Un modèle simplifié du circuit économique est présenté pour visualiser les flux réels (biens, services, travail) et les flux monétaires (revenus, dépenses) qui circulent entre les principaux agents, notamment les ménages et les entreprises, illustrant l’interdépendance de leurs décisions.
🏭 DEUXIÈME PARTIE : PRODUCTION ET FACTEURS DE PRODUCTION
Chapitre 3 : Théorie de la production
Ce chapitre analyse l’acte de production, qui est le processus de création de richesses (biens et services) dans l’économie.
3.1. Définition et facteurs de production
La production est définie comme l’activité qui transforme des ressources (inputs) en produits (outputs) ayant une utilité. Les quatre grands facteurs de production sont détaillés : le travail (effort humain), la terre (ressources naturelles), le capital (biens de production durables) et la capacité entrepreneuriale.
3.2. Fonction de production et combinaisons productives
La fonction de production est introduite comme une relation mathématique qui exprime la quantité maximale de produit pouvant être obtenue à partir de différentes combinaisons des facteurs de production. Elle permet d’étudier l’efficacité productive.
3.3. Lois de rendement et productivité
La loi des rendements décroissants est expliquée : lorsque l’on augmente un seul facteur de production en maintenant les autres fixes, la production augmente mais à un rythme de plus en plus faible. La notion de productivité (efficacité des facteurs) est également centrale.
3.4. Coûts de production et structures productives
L’analyse des coûts de production est abordée, en distinguant les coûts fixes (indépendants du volume produit) et les coûts variables. La structure productive de la RDC, dominée par le secteur primaire (agriculture, mines), est examinée.
Chapitre 4 : Travail et capital
Ce volet approfondit l’étude des deux principaux facteurs de production mobilisés par l’homme.
4.1. Division et organisation du travail
Le principe de la division du travail, mis en évidence par Adam Smith, est analysé comme une source majeure de gains de productivité, en permettant la spécialisation des tâches et l’amélioration de l’habileté des travailleurs.
4.2. Productivité et qualification du travail
Les déterminants de la productivité du travail sont explorés : la formation (capital humain), l’expérience, la santé des travailleurs et la qualité des équipements utilisés. La question de l’adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail en RDC est posée.
4.3. Formation et accumulation du capital
Le capital est présenté sous ses différentes formes (physique, financier, humain). Son accumulation, via le processus d’investissement (l’acte de renoncer à une consommation présente pour accroître la capacité de production future), est identifiée comme un moteur essentiel de la croissance.
4.4. Rôle du capital dans la production
L’importance du capital technique (machines, infrastructures) est soulignée. Il permet d’augmenter considérablement la productivité du travail et d’accéder à des modes de production plus performants et à plus grande échelle.
🔄 TROISIÈME PARTIE : ÉCHANGE ET MARCHÉ
Chapitre 5 : Théorie de l’échange
Ce chapitre examine pourquoi et comment les agents économiques échangent entre eux les fruits de leur production.
5.1. Fondements et conditions de l’échange
L’échange est justifié par les gains liés à la spécialisation. Le concept d’avantage comparatif de David Ricardo montre que même si un agent est moins productif dans tous les domaines, il a quand même intérêt à se spécialiser et à échanger.
5.2. Formes et évolution de l’échange
L’évolution historique des formes d’échange est retracée, en partant du troc (échange de marchandise contre marchandise) et de ses limites (problème de la double coïncidence des besoins), jusqu’à l’émergence de l’économie monétaire.
5.3. Rôle et fonctions de la monnaie
La monnaie est présentée comme une innovation sociale fondamentale qui résout les problèmes du troc. Ses trois fonctions sont détaillées : intermédiaire des échanges, unité de compte (étalon de valeur) et réserve de valeur.
5.4. Systèmes monétaires et change
Les notions de base des systèmes monétaires modernes (monnaie fiduciaire, monnaie scripturale) sont expliquées, ainsi que le concept de taux de change, qui exprime la valeur d’une monnaie (le Franc Congolais) par rapport à une autre (le Dollar US).
Chapitre 6 : Formation des prix et mécanismes du marché
Ce segment analyse le marché comme le lieu de rencontre entre offreurs et demandeurs, où se déterminent les prix.
6.1. Lois de l’offre et de la demande
Les deux forces fondamentales du marché sont analysées. La loi de la demande établit une relation inverse entre le prix d’un bien et la quantité demandée. La loi de l’offre établit une relation directe entre le prix et la quantité offerte.
6.2. Équilibre du marché et formation des prix
Le concept d’équilibre de marché est présenté. Le prix d’équilibre est celui pour lequel la quantité que les acheteurs souhaitent acheter est exactement égale à la quantité que les vendeurs souhaitent vendre.
6.3. Structures de marché et concurrence
Une typologie des différentes structures de marché est établie en fonction du nombre d’offreurs et de demandeurs : concurrence parfaite (modèle théorique), concurrence monopolistique, oligopole et monopole.
6.4. Monopoles et régulation des marchés
Les situations de monopole sont analysées, en montrant leurs risques (prix plus élevés, quantités plus faibles). Les raisons et les modalités de l’intervention de l’État pour réguler ces marchés sont discutées, en prenant des exemples potentiels dans des secteurs comme les télécommunications au Kasaï.
🛒 QUATRIÈME PARTIE : CONSOMMATION ET DISTRIBUTION
Chapitre 7 : Théorie de la consommation
Cette partie se concentre sur les décisions du consommateur final, dont les choix orientent l’ensemble de l’activité économique.
7.1. Besoins et comportements de consommation
L’analyse porte sur les déterminants du choix du consommateur : ses préférences (utilité), son revenu (contrainte budgétaire) et les prix des biens. L’objectif du consommateur rationnel est de maximiser sa satisfaction compte tenu de ses ressources.
7.2. Revenus et propension à consommer
La relation entre le revenu et la consommation est étudiée. La propension marginale à consommer (part de chaque unité de revenu supplémentaire qui est dépensée) est un concept clé pour comprendre les effets des politiques économiques.
7.3. Élasticités de la demande
L’élasticité-prix de la demande mesure la sensibilité de la quantité demandée à une variation du prix. Elle permet de distinguer les biens de première nécessité (faible élasticité) des biens de luxe (forte élasticité).
7.4. Consommation et niveau de vie
La structure de la consommation d’un ménage ou d’un pays est un indicateur important du niveau de vie. Les lois d’Engel montrent que la part du revenu consacrée à l’alimentation diminue à mesure que le revenu augmente.
Chapitre 8 : Distribution et répartition des revenus
Ce chapitre examine comment la richesse créée par la production est partagée entre les différents agents ayant contribué à sa création.
8.1. Théories de la répartition
Les différentes approches théoriques de la répartition sont brièvement présentées, notamment la question de savoir si la répartition est dictée par les lois du marché (productivité marginale) ou par les rapports de force sociaux.
8.2. Rémunération des facteurs de production
La répartition primaire des revenus est analysée : le travail est rémunéré par le salaire, le capital par l’intérêt ou le profit, et la terre par la rente. Les déterminants de chaque type de revenu sont étudiés.
8.3. Inégalités et redistribution des revenus
La question des inégalités de revenus est abordée. Des outils de mesure (comme la courbe de Lorenz) sont présentés. La redistribution opérée par l’État via les impôts et les transferts sociaux vise à corriger ces inégalités initiales.
8.4. Politiques sociales et justice distributive
Les politiques de redistribution sont discutées sous l’angle de la justice sociale. Le débat porte sur l’ampleur souhaitable de cette redistribution et sur les meilleurs instruments pour la mettre en œuvre (services publics, prestations sociales).
🏛️ CINQUIÈME PARTIE : RÔLE DE L’ÉTAT ET DÉVELOPPEMENT
Chapitre 9 : Intervention de l’État dans l’économie
Ce chapitre analyse pourquoi et comment l’État intervient dans la vie économique pour en corriger les défaillances et en orienter le cours.
9.1. Justifications de l’intervention publique
L’intervention de l’État se justifie par l’existence de « défaillances du marché » : la présence de biens publics, d’externalités (effets sur des tiers), de monopoles naturels et d’asymétries d’information.
9.2. Instruments de politique économique
L’État dispose de trois grands types d’instruments : la politique budgétaire (dépenses et impôts), la politique monétaire (menée par la Banque Centrale) et la réglementation (lois et normes qui encadrent l’activité économique).
9.3. Politiques budgétaires et fiscales
La politique budgétaire est un outil puissant pour influencer la conjoncture économique (politique de relance ou d’austérité) et pour financer les services publics. La politique fiscale (le choix des impôts) a des enjeux d’efficacité et d’équité.
9.4. Régulation économique et services publics
Le rôle de l’État en tant que régulateur est examiné, par exemple dans le secteur minier du Katanga pour garantir que l’exploitation des ressources profite à la nation. Sa fonction de producteur de services publics (éducation, santé, infrastructures) est également essentielle.
Chapitre 10 : Économie politique du développement
Cette section finale aborde la question cruciale du développement économique et social, particulièrement pertinente pour la RDC.
10.1. Théories et stratégies de développement
Les différentes théories qui ont cherché à expliquer le sous-développement et à proposer des voies pour en sortir sont étudiées (modèles de croissance, théories de la dépendance, stratégies d’industrialisation, etc.).
10.2. Croissance économique et développement humain
La distinction fondamentale entre la croissance économique (augmentation quantitative du PIB) et le développement humain (amélioration qualitative du bien-être, de l’éducation et de la santé, mesurée par l’IDH) est établie.
10.3. Défis du développement en RDC
Les principaux obstacles au développement de la RDC sont analysés de manière structurée : la diversification économique pour sortir de la dépendance minière, le renforcement du capital humain, l’amélioration des infrastructures et la consolidation de la bonne gouvernance.
10.4. Développement durable et enjeux futurs
Le concept de développement durable est introduit, insistant sur la nécessité de concilier les objectifs de progrès économique, d’équité sociale et de protection de l’environnement pour les générations futures, un enjeu majeur pour un pays au patrimoine naturel aussi riche que la RDC.
📎 ANNEXES
Les annexes fournissent des outils pratiques et des données pour concrétiser les apprentissages. Le lexique des termes économiques est un outil indispensable pour maîtriser le vocabulaire précis de la discipline. Les indicateurs économiques de la RDC offrent des données chiffrées (PIB, inflation, etc.) pour ancrer l’analyse dans la réalité du pays. Les textes et documents de référence peuvent inclure des extraits de lois ou de rapports économiques pertinents. Enfin, les ressources bibliographiques guident les futurs enseignants désireux d’approfondir leurs connaissances.