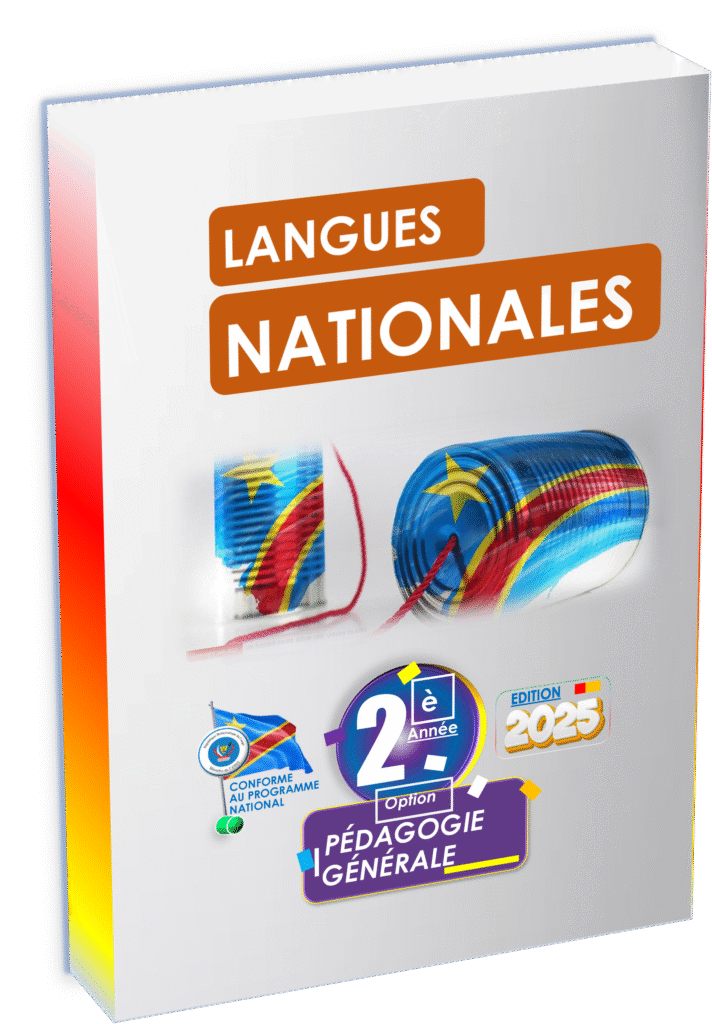
LANGUES NATIONALES – 2ÈME ANNÉE DES HUMANITÉS PÉDAGOGIQUES
Edition 2025 / Enseignement, primaire, secondaire et technique en RDC.
PRÉLIMINAIRES
Présentation du programme
Ce programme de deuxième année se focalise sur la didactique des langues nationales, préparant les futurs enseignants à devenir des praticiens compétents et réfléchis. Dépassant l’analyse structurale abordée en première année, ce cours outille les maîtres pour la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de situations d’apprentissage vivantes et efficaces. L’objectif est de former des professionnels capables de développer chez leurs élèves une véritable compétence communicative dans une des quatre langues nationales, tout en renforçant leur attachement à leur patrimoine culturel et linguistique.
📖 PREMIÈRE PARTIE : FONDAMENTAUX LINGUISTIQUES ET CONTEXTE
Chapitre 1 : Introduction aux langues nationales
Ce chapitre réaffirme l’importance des langues congolaises dans le projet éducatif national et précise le cadre de leur enseignement.
1.1. Statut et enjeux
Le statut des quatre langues nationales (Kikongo, Lingala, Kiswahili, Tshiluba) comme langues d’enseignement et objets d’étude est rappelé. Les enjeux sont à la fois pédagogiques (faciliter les premiers apprentissages), culturels (transmettre un héritage) et identitaires (construire une citoyenneté ancrée dans ses racines).
1.2. Objectifs généraux
La formation vise à rendre les futurs enseignants capables de développer chez les élèves une compétence de communication équilibrée dans les quatre habiletés langagières (écouter, parler, lire, écrire), de stimuler leur appréciation pour la richesse de leur langue et de mettre en œuvre la politique linguistique nationale.
1.3. Place dans le curriculum national
La place des langues nationales est centrale dans le curriculum des premières années du primaire, où elles servent de médium principal d’instruction. Leur enseignement se poursuit ensuite comme discipline à part entière, en articulation avec le français.
1.4. Diversité linguistique en RDC
Une sensibilisation à l’immense diversité linguistique du pays (plus de 200 langues) est menée pour que les futurs maîtres comprennent que les quatre langues nationales, bien que véhiculaires, ne sont qu’une partie d’un trésor linguistique plus vaste à respecter et à valoriser.
Chapitre 2 : Approches méthodologiques en didactique des langues
Ce segment explore les cadres théoriques et méthodologiques qui guident un enseignement moderne et efficace des langues.
2.1. Approche communicative
L’approche communicative est présentée comme le paradigme dominant. Son principe fondamental est que l’objectif premier de l’apprentissage d’une langue est d’apprendre à communiquer. Les activités de classe doivent donc simuler des situations de communication réelles.
2.2. Approche actionnelle
Prolongement de l’approche communicative, l’approche actionnelle considère l’apprenant comme un acteur social qui apprend la langue en réalisant des tâches ou des projets concrets. Par exemple, des élèves dans une école de Matadi pourraient réaliser un petit guide en Kikongo pour présenter leur quartier.
2.3. Approche intégrée
Cette approche préconise de ne pas enseigner les composantes de la langue (grammaire, vocabulaire) et les compétences (lire, écrire) de manière isolée, mais de les intégrer dans des activités de communication complexes et signifiantes.
2.4. Adaptation au contexte scolaire
La discussion porte sur l’adaptation de ces approches aux conditions réelles des écoles congolaises. Face à des classes nombreuses, des stratégies comme le travail en binômes ou en petits groupes sont essentielles pour maximiser le temps de parole de chaque élève.
Chapitre 3 : Psychopédagogie de l’apprentissage linguistique
Ce chapitre examine les processus psychologiques de l’acquisition d’une langue pour permettre un enseignement plus respectueux du rythme de l’apprenant.
3.1. Stades de l’acquisition
Les grandes étapes de l’acquisition d’une langue (période de silence, production de mots isolés, phrases simples, etc.) sont décrites. Leur connaissance permet à l’enseignant de ne pas avoir d’attentes irréalistes et d’interpréter correctement les productions de ses élèves.
3.2. Motivation et affectivité
Le rôle central de la motivation et du climat affectif de la classe est souligné. Un élève se sentant en sécurité et valorisé osera prendre des risques linguistiques, condition indispensable à la progression. La création d’un environnement bienveillant est une priorité.
3.3. Stratégies d’apprentissage
Les futurs maîtres apprennent à identifier et à enseigner explicitement des stratégies d’apprentissage efficaces (mémorisation, inférence, auto-correction) pour rendre les élèves plus autonomes et plus performants dans leur parcours linguistique.
3.4. Interaction en classe
L’interaction est le moteur de l’acquisition. Ce point insiste sur la nécessité pour l’enseignant de passer d’un rôle de transmetteur à un rôle d’organisateur et de facilitateur d’activités qui provoquent des échanges communicatifs authentiques entre les élèves.
🔬 DEUXIÈME PARTIE : COMPOSANTES LINGUISTIQUES
Chapitre 4 : Phonologie et phonétique
Ce chapitre est consacré à la didactique de la dimension sonore de la langue.
4.1. Inventaire des sons
Des techniques sont proposées pour enseigner la perception et la production des sons spécifiques à chaque langue nationale, notamment ceux qui n’existent pas en français (par ex. les clics dans certaines langues, ou les tons).
4.2. Alphabet et graphèmes
L’accent est mis sur l’enseignement de la relation entre les sons (phonèmes) et leur écriture (graphèmes). Des activités ludiques de type « loto des sons » sont proposées pour renforcer cette correspondance.
4.3. Règles de prononciation
Des exercices ciblés, comme les paires minimales (comparaison de deux mots ne différant que par un seul son), sont utilisés pour travailler les points de prononciation qui posent des difficultés aux apprenants.
4.4. Exercices phonétiques
L’utilisation de comptines, de chants et de virelangues traditionnels dans la langue cible est préconisée comme un moyen efficace et motivant pour améliorer la fluidité, le rythme et l’intonation.
Chapitre 5 : Morphologie et lexique
Ce volet traite de la didactique de la structure des mots et de l’enrichissement du vocabulaire.
5.1. Morphèmes et structure
Des approches visuelles (découpage de mots, utilisation de couleurs) sont présentées pour enseigner la structure des mots, notamment le système complexe mais logique des classes nominales dans les langues bantoues.
5.2. Affixes et dérivation
L’enseignant apprend à créer des activités où les élèves découvrent par eux-mêmes comment lajout de préfixes ou de suffixes permet de former de nouveaux mots, développant ainsi leur conscience morphologique.
5.3. Champs lexicaux
L’enseignement du vocabulaire de manière thématique (la nourriture, les vêtements, les animaux) est privilégié. Des outils comme les cartes mentales (schémas heuristiques) sont utilisés pour organiser et mémoriser le lexique.
5.4. Enrichissement lexical
Une panoplie de techniques est proposée : jeux de devinettes, mots croisés, utilisation de l’image, création d’un « mur de mots » dans la classe, pour rendre l’acquisition du vocabulaire active et continue.
Chapitre 6 : Syntaxe et construction de la phrase
Ce segment se concentre sur les stratégies pour enseigner l’organisation des mots en phrases.
6.1. Ordre des mots
Des activités de manipulation sont favorisées : les élèves reçoivent des étiquettes-mots et doivent les assembler pour reconstituer des phrases correctes, ce qui leur permet d’internaliser la structure syntaxique de base.
6.2. Accord sujet-verbe
L’accord, particulièrement complexe en raison des préfixes de classe, est travaillé à travers des exercices de substitution et de transformation, en partant de phrases modèles.
6.3. Types de phrases
La didactique de la phrase interrogative, négative et impérative est abordée à partir de situations de communication concrètes (poser une question, donner un ordre, refuser poliment).
6.4. Subordination et coordination
L’enseignement des connecteurs logiques et des conjonctions est introduit progressivement pour permettre aux élèves de passer de phrases simples à des constructions plus élaborées, exprimant la cause, la conséquence, le but, etc.
Chapitre 7 : Sémantique et pragmatique
Ce chapitre traite de la didactique du sens et de l’usage de la langue en contexte.
7.1. Sens lexical et figuré
Des activités sont proposées pour faire la distinction entre le sens littéral et le sens figuré, notamment à travers l’étude de proverbes et d’expressions idiomatiques, qui sont une porte d’entrée vers la culture partagée par les locuteurs d’une langue.
7.2. Registres et niveaux de langue
À travers des jeux de rôle, les élèves apprennent à adapter leur manière de parler à la situation et à l’interlocuteur (parler à un ami vs parler à un adulte respecté).
7.3. Implicatures
L’enseignant apprend à développer chez ses élèves la capacité à comprendre l’implicite, c’est-à-dire ce qui est communiqué sans être dit explicitement, une compétence essentielle dans la communication quotidienne.
7.4. Actes de parole et usage
La langue est vue comme un outil pour agir. Les futurs maîtres s’entraînent à concevoir des scénarios pour faire pratiquer les différents actes de parole (s’excuser, inviter, promettre, etc.) de manière appropriée culturellement.
🗣️ TROISIÈME PARTIE : COMPÉTENCES COMMUNICATIVES
Chapitre 8 : Compréhension orale
Ce chapitre est dédié au développement de la compétence la plus fondamentale : l’écoute.
8.1. Techniques d’écoute
Les futurs enseignants apprennent à varier les objectifs d’écoute : écoute globale (comprendre l’idée générale), écoute sélective (repérer une information précise), écoute détaillée.
8.2. Types de discours
Il est essentiel d’exposer les élèves à des documents audio variés et authentiques : dialogues de la vie courante, contes enregistrés, extraits de chansons, annonces publiques simples.
8.3. Indicateurs de compréhension
La compréhension est vérifiée par des tâches actives et souvent non verbales pour les débutants : montrer une image, exécuter un ordre, mimer une action.
8.4. Exercices pratiques
Une banque d’activités est fournie, comme le jeu de « dessinez, c’est gagné » à partir d’une description orale, ou la reconstitution d’une histoire entendue.
Chapitre 9 : Expression orale
Ce volet vise à donner aux élèves les outils et la confiance pour prendre la parole.
9.1. Préparation de l’oral
L’importance de structurer et de ritualiser la prise de parole est soulignée, en fournissant aux élèves des amorces de phrases et du vocabulaire clé pour les aider à se lancer.
9.2. Jeux de rôle
Les jeux de rôle sont présentés comme la technique par excellence pour une pratique de l’oral en contexte, permettant de simuler des situations réelles (une conversation téléphonique, un achat au marché de Kisangani en Kiswahili) dans un cadre sécurisant.
9.3. Présentation et récitation
La pratique de la récitation de poèmes ou de la présentation de courts exposés sur des sujets familiers est encouragée pour développer la fluidité et la structuration du discours.
9.4. Techniques d’animation
L’enseignant est formé aux techniques d’animation qui favorisent la participation de tous : gestion des tours de parole, relances, reformulation, correction constructive des erreurs.
Chapitre 10 : Compréhension écrite
Ce chapitre aborde la didactique de la lecture et de la compréhension de textes.
10.1. Types de textes
Les élèves doivent être confrontés à une variété de textes écrits dans la langue nationale : contes traditionnels transcrits, lettres, affiches, recettes de cuisine, etc.
10.2. Stratégies de lecture
Les futurs maîtres apprennent à enseigner explicitement des stratégies de lecture comme l’anticipation (à partir du titre ou d’une image), le repérage de mots clés ou l’inférence.
10.3. Repérage et inférence
Les activités sont conçues pour amener les élèves à distinguer l’information qui est explicitement donnée dans le texte de celle qu’ils doivent déduire en s’appuyant sur les indices et leurs connaissances du monde.
10.4. Activités de compréhension
Des alternatives aux questionnaires traditionnels sont proposées : Vrai/Faux, appariement texte/image, remise en ordre de paragraphes, résumé en une phrase.
Chapitre 11 : Expression écrite
Ce segment est consacré au développement progressif de la compétence d’écriture.
11.1. Construction de phrases
L’apprentissage commence par des activités très guidées : compléter des phrases, répondre par écrit à des questions, légender des images.
11.2. Rédaction de paragraphes
La rédaction est ensuite abordée au niveau du paragraphe, en travaillant sur la cohérence (une idée principale par paragraphe) et la cohésion (utilisation de connecteurs).
11.3. Textes fonctionnels
La production de textes courts et utiles est privilégiée : écrire une carte postale, une liste de courses, un court message, pour que l’écriture ait un sens immédiat pour l’élève.
11.4. Techniques de révision
L’enseignement du processus d’écriture est clé. Les élèves apprennent à relire et à améliorer leurs propres textes (auto-correction) ou ceux de leurs camarades (co-correction) à l’aide de grilles simples.
🤝 QUATRIÈME PARTIE : INTÉGRATION ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Chapitre 12 : Intégration interdisciplinaire
Ce chapitre montre comment faire de la langue nationale un outil au service de tous les apprentissages.
12.1. Projets thématiques
La pédagogie de projet est une voie royale pour l’intégration. Un projet sur les animaux de la savane pourrait intégrer la langue nationale (noms, descriptions), les sciences (mode de vie) et les arts (dessins, chants).
12.2. Activités culturelles
L’organisation d’une « journée culturelle » dans une école, avec des contes, des chants et des saynètes dans la langue nationale de la région, est une manière vivante et motivante de pratiquer la langue.
12.3. Collaborations disciplinaires
La collaboration entre l’enseignant de langue nationale et ses collègues d’histoire ou de géographie est encouragée pour que les élèves puissent utiliser la langue comme un outil de recherche et d’expression sur des sujets étudiés dans d’autres cours.
12.4. Valorisation du patrimoine
La classe de langue nationale est le lieu privilégié pour la collecte et la valorisation du patrimoine oral local (proverbes, devinettes, récits des anciens), transformant les élèves en petits chercheurs de leur propre culture.
Chapitre 13 : Évaluation des compétences linguistiques
Ce volet est consacré à la conception d’outils d’évaluation pertinents et justes.
13.1. Grilles et barèmes
Les futurs maîtres apprennent à élaborer des grilles d’évaluation critériées pour les productions orales et écrites, afin de rendre l’évaluation plus objective, transparente et formative.
13.2. Évaluation formative
L’accent est mis sur l’évaluation en cours d’apprentissage, qui a pour but de fournir un feedback immédiat à l’élève pour l’aider à progresser, et à l’enseignant pour réguler son enseignement.
13.3. Évaluation sommative
La conception d’épreuves de fin de séquence est travaillée. Elles doivent évaluer la capacité à communiquer en situation, et non seulement la connaissance de points de grammaire isolés.
13.4. Auto- et co-évaluation
L’implication des élèves dans leur propre évaluation est encouragée. L’auto-évaluation et l’évaluation par les pairs les aident à développer leur autonomie et leur esprit critique.
Chapitre 14 : Didactique différenciée et inclusion
Ce chapitre traite de la gestion de l’hétérogénéité dans la classe de langue.
14.1. Adaptation des contenus
Des stratégies sont proposées pour adapter les supports (par exemple, proposer deux versions d’un même texte, une simplifiée et une originale) pour tenir compte des différents niveaux de compétence des élèves.
14.2. Paliers de progression
L’enseignant apprend à concevoir des activités à plusieurs niveaux de difficulté (paliers), permettant à chaque élève de travailler sur le même objectif mais avec un degré de soutien ou de défi adapté à ses capacités.
14.3. Soutien individualisé
La mise en place de moments de remédiation en petits groupes de besoin est une stratégie efficace pour aider les élèves qui rencontrent des difficultés spécifiques sur un point de langue particulier.
14.4. Inclusion et bilinguisme
Une réflexion est menée sur la gestion de la classe bilingue, en valorisant la langue nationale comme une ressource et non comme un obstacle à l’apprentissage du français, et en utilisant des stratégies de pédagogie convergente.
Chapitre 15 : Perfectionnement et formation continue
Ce chapitre final vise à inscrire le futur enseignant dans une démarche de développement professionnel tout au long de sa vie.
15.1. Veille pédagogique
La nécessité de se tenir informé des nouvelles recherches, des nouvelles ressources et des nouvelles approches en didactique des langues est soulignée comme une exigence professionnelle.
15.2. Autoformation et ateliers
L’enseignant est encouragé à continuer à se former, que ce soit par des lectures personnelles, la participation à des ateliers, ou l’apprentissage de nouvelles techniques.
15.3. Réseaux professionnels
La création et la participation à des réseaux d’enseignants de langues nationales sont présentées comme un moyen puissant de rompre l’isolement, de partager des ressources et de réfléchir collectivement à ses pratiques.
15.4. Recherche-action
La recherche-action est introduite comme une démarche permettant à l’enseignant d’analyser une difficulté concrète de sa classe, de mettre en place une solution innovante et d’en évaluer les effets, devenant ainsi un praticien-chercheur.
📎 ANNEXES
Les annexes sont des outils concrets destinés à faciliter le travail de l’enseignant. La progression annuelle fournit un cadre structuré. Les modèles de fiches de préparation servent de guide pratique. Les grilles d’évaluation sont des instruments pour une évaluation juste. La bibliographie ouvre des pistes d’approfondissement. Le répertoire d’extraits textuels et audio constitue une banque de ressources de base, essentielle pour démarrer l’enseignement dans des conditions matérielles parfois difficiles.