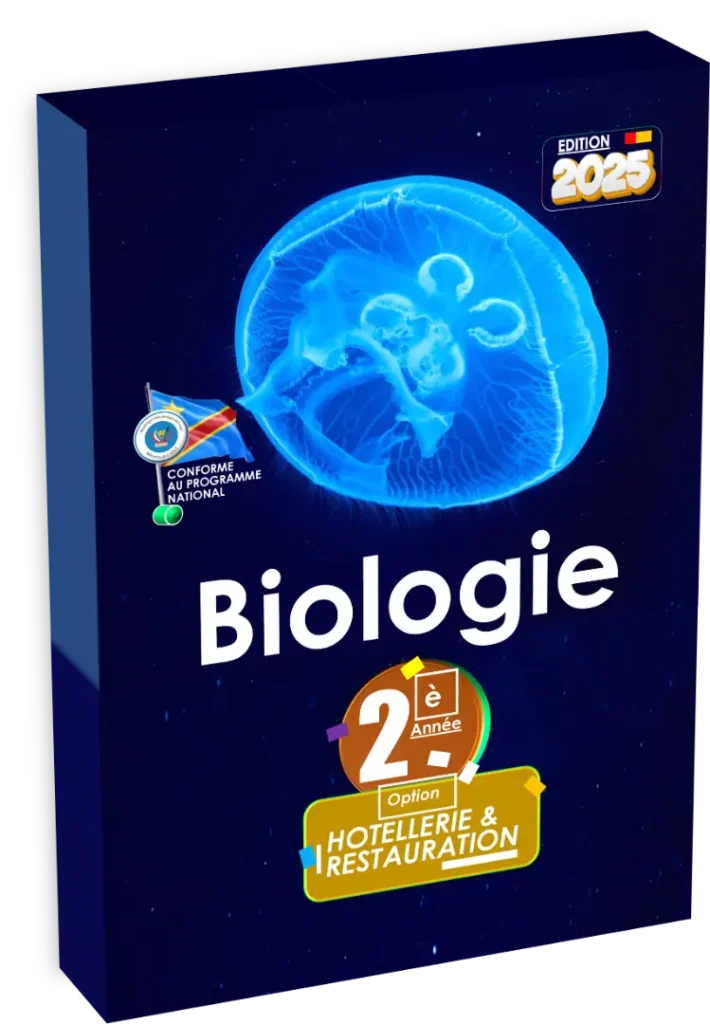
BIOLOGIE
2ÈME ANNÉE, OPTION HÔTELLERIE ET RESTAURATION
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
PRÉLIMINAIRES
1. Introduction à la Physiologie du Vivant 🌱
Cette section d’ouverture introduit la physiologie comme la science qui étudie le fonctionnement des organismes vivants, de leurs cellules et de leurs organes. Faisant suite à l’étude des structures en première année, ce cours se concentre sur les processus et les fonctions qui maintiennent la vie. Pour le futur professionnel de l’hôtellerie, comprendre la physiologie permet de maîtriser la maturation des fruits, la transformation de la viande ou encore les besoins nutritionnels des clients, un savoir essentiel de Kikwit à Kalemie.
2. Objectifs Pédagogiques du Cours 🎯
Les compétences que l’élève doit acquérir au terme de cette deuxième année sont ici clairement définies. Le programme vise à rendre l’apprenant capable d’expliquer les grandes fonctions vitales comme la nutrition, la respiration et la circulation chez les végétaux et les animaux, avec un focus particulier sur la physiologie humaine. L’objectif est de former des professionnels qui comprennent les mécanismes biologiques sous-jacents à la qualité de leurs produits et au bien-être de leur clientèle.
3. Rappel des Acquis de Première Année 🔬
Ce point a pour fonction de réactiver les connaissances fondamentales acquises en première année, notamment la structure de la cellule, la composition des tissus et la morphologie générale des plantes. Cette base est indispensable pour aborder l’étude du fonctionnement de ces structures, en assurant une transition logique et une consolidation des savoirs.
4. La Démarche Expérimentale en Physiologie 🧪
L’étude de la physiologie repose sur l’expérimentation. Cette partie expose les principes de la démarche expérimentale : observation d’un phénomène, formulation d’une hypothèse, conception d’une expérience avec un témoin, recueil des résultats et interprétation. Des exemples simples, comme la mise en évidence de la transpiration végétale, illustrent cette méthode rigoureuse.
PARTIE 1 : LES GRANDES FONCTIONS DE NUTRITION COMPARÉE
Aperçu : Cette première partie explore en profondeur la manière dont les êtres vivants s’approvisionnent en matière et en énergie. Elle détaille la nutrition autotrophe des végétaux par la photosynthèse et la nutrition hétérotrophe de l’homme à travers l’étude de l’appareil digestif et du métabolisme, créant un parallèle essentiel pour comprendre la chaîne alimentaire.
CHAPITRE 1 : LA NUTRITION MINÉRALE DES VÉGÉTAUX
1.1. L’Absorption de l’Eau et des Sels Minéraux
Ce sous-chapitre se concentre sur le rôle des racines dans la nutrition de la plante. Le mécanisme de l’absorption de l’eau par osmose au niveau des poils absorbants est expliqué. L’absorption sélective des sels minéraux dissous dans l’eau du sol, essentiels à la croissance de la plante, est également détaillée.
1.2. La Formation et la Circulation de la Sève Brute
Une fois absorbée, la solution d’eau et de minéraux forme la sève brute. L’étude retrace son parcours ascendant, des racines jusqu’aux feuilles, à travers les vaisseaux spécialisés du xylème. Les forces qui permettent cette montée, notamment la poussée racinaire et l’aspiration foliaire, sont analysées.
1.3. La Transpiration Foliaire : Moteur de l’Ascension
La transpiration est présentée comme le principal moteur de la circulation de la sève brute. Ce phénomène d’évaporation de l’eau au niveau des stomates des feuilles crée une tension dans les vaisseaux du xylème, aspirant ainsi la colonne d’eau depuis les racines, un processus vital pour un manguier à Mbanza-Ngungu.
1.4. Les Échanges d’Eau au Niveau Cellulaire
À l’échelle de la cellule végétale, les mouvements d’eau sont régis par les phénomènes de turgescence (cellule gorgée d’eau) et de plasmolyse (cellule rétractée par perte d’eau). La compréhension de ces états est cruciale pour expliquer la fermeté ou le flétrissement des légumes frais.
CHAPITRE 2 : LA PHOTOSYNTHÈSE ET LA NUTRITION CARBONÉE
2.1. Les Acteurs de la Photosynthèse : Chloroplastes et Chlorophylle
L’étude se focalise sur les organites et les pigments qui rendent la photosynthèse possible. Le chloroplaste est présenté comme l’usine cellulaire où se déroule le processus, et la chlorophylle comme le pigment vert capable de capter l’énergie lumineuse, indispensable à la réaction.
2.2. Le Mécanisme de la Photosynthèse
Le processus est expliqué comme une réaction biochimique qui, en présence de lumière, combine le dioxyde de carbone de l’air et l’eau puisée par les racines pour produire du glucose (sucre) et rejeter de l’oxygène. Cette synthèse de matière organique est la base de l’autotrophie des végétaux.
2.3. Les Facteurs Influant sur l’Intensité Photosynthétique
Les conditions externes qui modulent l’efficacité de la photosynthèse sont examinées. L’influence de l’intensité lumineuse, de la concentration en CO₂, de la température et de la disponibilité en eau est analysée, expliquant les variations de rendement des cultures agricoles à travers les différentes régions climatiques de la RDC.
2.4. La Sève Élaborée : Transport et Stockage des Sucres
Le glucose produit par la photosynthèse est transformé et transporté sous forme de sève élaborée dans toute la plante via les vaisseaux du phloème. Ce cours explique comment cette sève nourrit tous les organes et comment l’excédent de sucres est mis en réserve sous forme d’amidon dans les tubercules de manioc du Kasaï ou les fruits.
CHAPITRE 3 : L’APPAREIL DIGESTIF HUMAIN ET SON FONCTIONNEMENT
3.1. Anatomie Fonctionnelle de l’Appareil Digestif
Ce sous-chapitre propose une exploration détaillée de l’anatomie du tube digestif et des glandes annexes (foie, pancréas). Le rôle de chaque organe est expliqué dans la progression et la transformation des aliments, de la mastication dans la bouche jusqu’à l’évacuation des résidus.
3.2. La Digestion Mécanique et Chimique
Les deux aspects de la digestion sont approfondis. La digestion mécanique (broyage, brassage) et la digestion chimique, qui décompose les macromolécules en nutriments grâce à l’action d’enzymes spécifiques (amylases, protéases, lipases) contenues dans les sucs digestifs, sont décrites en détail.
3.3. Le Rôle du Foie et du Pancréas
L’importance capitale du foie, qui produit la bile pour émulsionner les graisses, et du pancréas, qui sécrète une multitude d’enzymes digestives, est mise en lumière. Leur contribution à la digestion des lipides, des protéines et des glucides est expliquée.
3.4. L’Absorption Intestinale des Nutriments
L’intestin grêle est présenté comme le siège principal de l’absorption des nutriments. Sa structure interne, avec ses nombreux replis et villosités qui augmentent considérablement la surface d’échange, est décrite pour expliquer l’efficacité du passage des nutriments vers la circulation sanguine.
PARTIE 2 : LES ÉCHANGES GAZEUX ET LA CIRCULATION
Aperçu : Cette deuxième partie se concentre sur les systèmes qui permettent de transporter l’oxygène, les nutriments et les déchets au sein des organismes. Elle établit un parallèle entre la respiration et la circulation chez les végétaux et les systèmes respiratoire et circulatoire beaucoup plus complexes de l’homme.
CHAPITRE 4 : LA RESPIRATION ET LES ÉCHANGES GAZEUX
4.1. La Respiration Cellulaire : Libérer l’Énergie
La respiration cellulaire est présentée comme le processus fondamental par lequel toutes les cellules vivantes (végétales et animales) dégradent le glucose en présence d’oxygène pour produire l’énergie (ATP) nécessaire à leur fonctionnement, avec production de CO₂ et d’eau comme déchets.
4.2. Les Échanges Gazeux chez les Végétaux
Les plantes respirent en permanence. Ce cours explique comment elles réalisent leurs échanges gazeux avec l’atmosphère (absorption d’O₂, rejet de CO₂) principalement à travers les stomates des feuilles, les mêmes orifices qui servent à la photosynthèse et à la transpiration.
4.3. Anatomie de l’Appareil Respiratoire Humain
Une description de l’appareil respiratoire humain est fournie, des fosses nasales aux poumons. Le trajet de l’air est suivi à travers le pharynx, le larynx, la trachée et les bronches jusqu’aux alvéoles pulmonaires, site des échanges gazeux.
4.4. La Mécanique Ventilatoire chez l’Homme
Les mouvements d’inspiration et d’expiration qui constituent la ventilation pulmonaire sont expliqués. Le rôle du diaphragme et des muscles intercostaux dans la variation du volume de la cage thoracique, qui provoque l’entrée et la sortie de l’air des poumons, est détaillé.
CHAPITRE 5 : LA CIRCULATION ET LE TRANSPORT CHEZ L’HOMME
5.1. Le Sang : Composition et Fonctions
Le sang est étudié comme le fluide de transport de l’organisme. Sa composition est détaillée : le plasma (partie liquide), les globules rouges (transport de l’oxygène), les globules blancs (défense immunitaire) et les plaquettes (coagulation).
5.2. Le Cœur : une Pompe Musculaire
L’anatomie et le fonctionnement du cœur sont décrits. Le cœur est présenté comme une double pompe qui assure la propulsion du sang dans tout le corps. Le cycle cardiaque (systole, diastole) et le rôle des valvules sont expliqués.
5.3. Les Vaisseaux Sanguins : Artères, Veines et Capillaires
Le réseau de distribution du sang est exploré. La structure et la fonction des artères (qui partent du cœur), des veines (qui retournent au cœur) et des capillaires (sites d’échanges avec les cellules) sont différenciées, formant un circuit fermé.
5.4. La Double Circulation Sanguine
Le concept de double circulation est clarifié. La circulation pulmonaire (ou petite circulation) qui assure l’oxygénation du sang au niveau des poumons, et la circulation systémique (ou grande circulation) qui distribue ce sang oxygéné à tous les organes du corps, sont décrites comme deux boucles interdépendantes.
PARTIE 3 : COORDINATION DES FONCTIONS ET PERCEPTION
Aperçu : Cette partie aborde les systèmes qui permettent aux organismes de percevoir leur environnement et de coordonner leurs actions. Elle se concentre sur le système nerveux et les organes des sens, des sujets d’une pertinence extrême pour les métiers de la restauration où le goût et l’odorat sont au premier plan.
CHAPITRE 6 : LE SYSTÈME NERVEUX HUMAIN
6.1. Organisation du Système Nerveux
L’étude présente la structure générale du système nerveux, divisé en système nerveux central (encéphale et moelle épinière), qui est le centre de commande, et système nerveux périphérique (nerfs), qui assure la liaison avec le reste du corps.
6.2. Le Neurone : Unité Fonctionnelle
Le neurone est décrit comme la cellule de base du système nerveux. Sa structure (corps cellulaire, dendrites, axone) et sa capacité à générer et à transmettre un signal électrique, l’influx nerveux, sont expliquées.
6.3. La Transmission de l’Information : Synapses
La communication entre les neurones est assurée par les synapses. Le mécanisme de la transmission synaptique, impliquant la libération de messagers chimiques (neurotransmetteurs) qui traversent l’espace synaptique, est détaillé de manière simplifiée.
6.4. L’Arc Réflexe : une Réponse Rapide
Le réflexe est présenté comme une réponse involontaire et rapide à un stimulus, impliquant un circuit nerveux simple appelé arc réflexe. L’exemple du retrait de la main au contact d’une plaque chaude dans une cuisine de Gbadolite illustre ce mécanisme de protection.
CHAPITRE 7 : LES ORGANES DES SENS : GOÛT ET ODORAT
7.1. La Langue et la Perception du Goût
La langue est étudiée comme l’organe du goût. Les papilles gustatives et les bourgeons du goût qu’elles contiennent sont décrits comme les récepteurs capables de détecter les cinq saveurs primaires : sucré, salé, acide, amer et umami.
7.2. Le Nez et la Perception des Odeurs
Le mécanisme de l’olfaction est exploré. Les molécules odorantes présentes dans l’air stimulent les récepteurs olfactifs situés dans la muqueuse nasale, envoyant une information au cerveau qui est interprétée comme une odeur. La grande sensibilité de ce système est soulignée.
7.3. L’Interaction du Goût et de l’Odorat : la Flaveur
Ce sous-chapitre explique que la perception complexe que nous appelons « goût » est en réalité une synergie entre le goût (perçu par la langue) et l’odorat (perçu par le nez via la voie rétronasale). Cette combinaison est appelée la flaveur et constitue l’essentiel de l’expérience de dégustation.
7.4. L’Éducation du Palais et l’Analyse Sensorielle
L’importance pour un professionnel de la restauration d’entraîner et d’affiner ses sens est mise en avant. Une introduction à l’analyse sensorielle est proposée comme une méthode structurée pour décrire et évaluer objectivement les qualités organoleptiques d’un produit alimentaire ou d’une boisson.
PARTIE 4 : LA CONTINUITÉ DE LA VIE
Aperçu : Cette dernière partie aborde les mécanismes fondamentaux qui assurent la croissance des organismes et la perpétuation des espèces. Elle se penche sur la division cellulaire comme base de la croissance et sur les principes de la reproduction et de l’hérédité.
CHAPITRE 8 : LA DIVISION CELLULAIRE ET LA CROISSANCE
8.1. Le Cycle Cellulaire
La vie d’une cellule est décrite comme un cycle alternant une phase de croissance (interphase) et une phase de division (mitose). L’interphase est présentée comme une période d’activité métabolique intense où la cellule duplique son matériel génétique en préparation de la division.
8.2. La Mitose : une Reproduction Conforme
La mitose est expliquée comme le processus de division cellulaire qui produit deux cellules filles génétiquement identiques à la cellule mère. Les différentes étapes (prophase, métaphase, anaphase, télophase) sont décrites, en soulignant son rôle dans la croissance des organismes et le renouvellement des tissus.
8.3. La Croissance chez les Végétaux
La croissance végétale est localisée au niveau de zones spécialisées appelées méristèmes, situées à l’extrémité des tiges et des racines. Ce cours explique comment la division cellulaire intense dans ces zones assure l’allongement de la plante.
8.4. La Croissance et la Régénération chez l’Homme
Chez l’homme, la mitose permet la croissance durant l’enfance et l’adolescence. À l’âge adulte, elle assure le renouvellement constant de certaines cellules (peau, sang, paroi intestinale) et la cicatrisation des tissus après une blessure.
CHAPITRE 9 : LA REPRODUCTION ET LES BASES DE L’HÉRÉDITÉ
9.1. Reproduction Asexuée et Végétative
La reproduction asexuée est définie comme un mode de reproduction qui ne fait pas intervenir de cellules sexuelles et produit des individus identiques au parent. Chez les végétaux, ce processus, appelé multiplication végétative (bouturage, marcottage), est largement utilisé en agriculture et en horticulture.
9.2. La Reproduction Sexuée : Méiose et Fécondation
La reproduction sexuée est caractérisée par la production de cellules spécialisées (gamètes) par un processus de division particulier, la méiose, et par leur union lors de la fécondation pour former un nouvel individu. Ce processus assure un brassage génétique et une diversité des descendants.
9.3. Introduction à la Génétique : Gènes et Chromosomes
Ce sous-chapitre introduit les concepts de base de l’hérédité. Les chromosomes sont présentés comme les supports de l’information génétique, et les gènes comme des segments d’ADN qui déterminent les caractères héréditaires.
9.4. L’Application en Amélioration des Plantes et des Animaux
Une ouverture sur les applications de la génétique est proposée. La sélection variétale en agriculture, qui vise à obtenir des plantes plus productives ou plus résistantes comme le maïs dans le Haut-Katanga, est présentée comme une application directe des lois de l’hérédité pour répondre aux besoins alimentaires.
ANNEXES
1. Glossaire des Termes de Physiologie 📖
Une liste alphabétique des termes techniques abordés (physiologie, mitose, photosynthèse, sève, ATP, etc.) est fournie avec des définitions claires, servant de référence pour l’élève.
2. Schémas des Systèmes Humains anatomie
Des planches anatomiques simplifiées des principaux systèmes étudiés (digestif, respiratoire, circulatoire, nerveux) sont incluses pour faciliter la mémorisation de leur structure.
3. Diagramme Récapitulatif de la Photosynthèse ☀️
Un schéma synthétique illustre les intrants (eau, CO₂, lumière) et les extrants (glucose, O₂) de la photosynthèse, ainsi que sa localisation dans le chloroplaste, offrant un support visuel pour la compréhension de ce processus complexe.
4. Fiches de Travaux Pratiques 📝
Des protocoles pour des expériences simples réalisables en classe sont proposés, comme la mise en évidence de la transpiration, l’observation de stomates au microscope ou des tests de sensibilité gustative, pour lier la théorie à la pratique.
TOUS LES MANUELS :
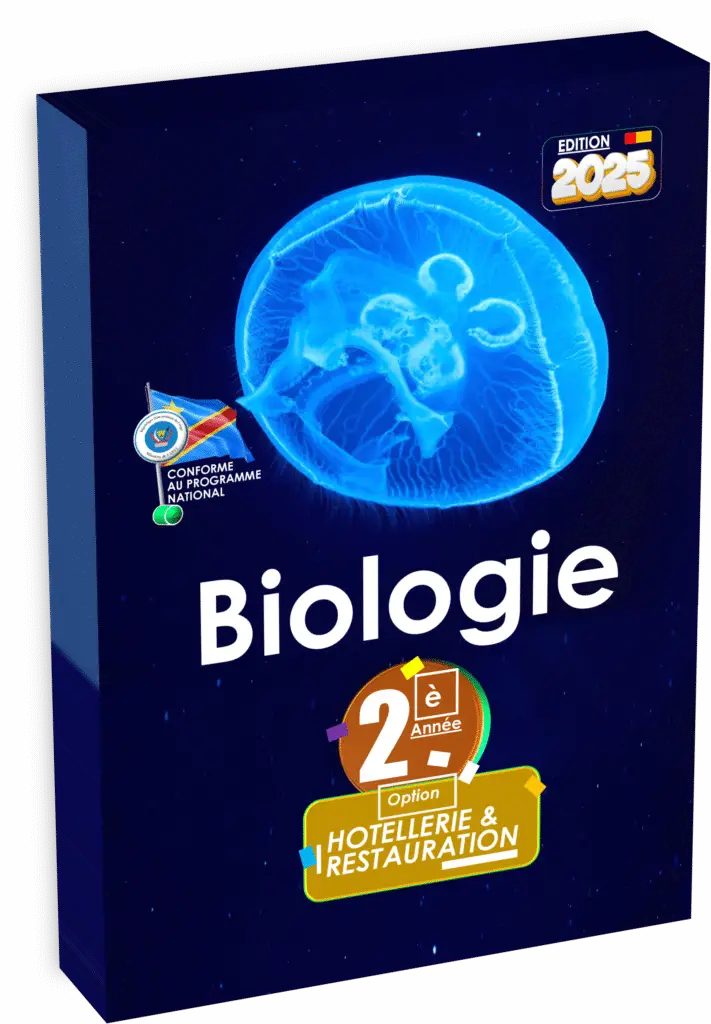
BIOLOGIE
2ÈME ANNÉE, OPTION HÔTELLERIE ET RESTAURATION
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
PRÉLIMINAIRES
1. Introduction à la Physiologie du Vivant 🌱
Cette section d’ouverture introduit la physiologie comme la science qui étudie le fonctionnement des organismes vivants, de leurs cellules et de leurs organes. Faisant suite à l’étude des structures en première année, ce cours se concentre sur les processus et les fonctions qui maintiennent la vie. Pour le futur professionnel de l’hôtellerie, comprendre la physiologie permet de maîtriser la maturation des fruits, la transformation de la viande ou encore les besoins nutritionnels des clients, un savoir essentiel de Kikwit à Kalemie.
2. Objectifs Pédagogiques du Cours 🎯
Les compétences que l’élève doit acquérir au terme de cette deuxième année sont ici clairement définies. Le programme vise à rendre l’apprenant capable d’expliquer les grandes fonctions vitales comme la nutrition, la respiration et la circulation chez les végétaux et les animaux, avec un focus particulier sur la physiologie humaine. L’objectif est de former des professionnels qui comprennent les mécanismes biologiques sous-jacents à la qualité de leurs produits et au bien-être de leur clientèle.
3. Rappel des Acquis de Première Année 🔬
Ce point a pour fonction de réactiver les connaissances fondamentales acquises en première année, notamment la structure de la cellule, la composition des tissus et la morphologie générale des plantes. Cette base est indispensable pour aborder l’étude du fonctionnement de ces structures, en assurant une transition logique et une consolidation des savoirs.
4. La Démarche Expérimentale en Physiologie 🧪
L’étude de la physiologie repose sur l’expérimentation. Cette partie expose les principes de la démarche expérimentale : observation d’un phénomène, formulation d’une hypothèse, conception d’une expérience avec un témoin, recueil des résultats et interprétation. Des exemples simples, comme la mise en évidence de la transpiration végétale, illustrent cette méthode rigoureuse.
PARTIE 1 : LES GRANDES FONCTIONS DE NUTRITION COMPARÉE
Aperçu : Cette première partie explore en profondeur la manière dont les êtres vivants s’approvisionnent en matière et en énergie. Elle détaille la nutrition autotrophe des végétaux par la photosynthèse et la nutrition hétérotrophe de l’homme à travers l’étude de l’appareil digestif et du métabolisme, créant un parallèle essentiel pour comprendre la chaîne alimentaire.
CHAPITRE 1 : LA NUTRITION MINÉRALE DES VÉGÉTAUX
1.1. L’Absorption de l’Eau et des Sels Minéraux
Ce sous-chapitre se concentre sur le rôle des racines dans la nutrition de la plante. Le mécanisme de l’absorption de l’eau par osmose au niveau des poils absorbants est expliqué. L’absorption sélective des sels minéraux dissous dans l’eau du sol, essentiels à la croissance de la plante, est également détaillée.
1.2. La Formation et la Circulation de la Sève Brute
Une fois absorbée, la solution d’eau et de minéraux forme la sève brute. L’étude retrace son parcours ascendant, des racines jusqu’aux feuilles, à travers les vaisseaux spécialisés du xylème. Les forces qui permettent cette montée, notamment la poussée racinaire et l’aspiration foliaire, sont analysées.
1.3. La Transpiration Foliaire : Moteur de l’Ascension
La transpiration est présentée comme le principal moteur de la circulation de la sève brute. Ce phénomène d’évaporation de l’eau au niveau des stomates des feuilles crée une tension dans les vaisseaux du xylème, aspirant ainsi la colonne d’eau depuis les racines, un processus vital pour un manguier à Mbanza-Ngungu.
1.4. Les Échanges d’Eau au Niveau Cellulaire
À l’échelle de la cellule végétale, les mouvements d’eau sont régis par les phénomènes de turgescence (cellule gorgée d’eau) et de plasmolyse (cellule rétractée par perte d’eau). La compréhension de ces états est cruciale pour expliquer la fermeté ou le flétrissement des légumes frais.
CHAPITRE 2 : LA PHOTOSYNTHÈSE ET LA NUTRITION CARBONÉE
2.1. Les Acteurs de la Photosynthèse : Chloroplastes et Chlorophylle
L’étude se focalise sur les organites et les pigments qui rendent la photosynthèse possible. Le chloroplaste est présenté comme l’usine cellulaire où se déroule le processus, et la chlorophylle comme le pigment vert capable de capter l’énergie lumineuse, indispensable à la réaction.
2.2. Le Mécanisme de la Photosynthèse
Le processus est expliqué comme une réaction biochimique qui, en présence de lumière, combine le dioxyde de carbone de l’air et l’eau puisée par les racines pour produire du glucose (sucre) et rejeter de l’oxygène. Cette synthèse de matière organique est la base de l’autotrophie des végétaux.
2.3. Les Facteurs Influant sur l’Intensité Photosynthétique
Les conditions externes qui modulent l’efficacité de la photosynthèse sont examinées. L’influence de l’intensité lumineuse, de la concentration en CO₂, de la température et de la disponibilité en eau est analysée, expliquant les variations de rendement des cultures agricoles à travers les différentes régions climatiques de la RDC.
2.4. La Sève Élaborée : Transport et Stockage des Sucres
Le glucose produit par la photosynthèse est transformé et transporté sous forme de sève élaborée dans toute la plante via les vaisseaux du phloème. Ce cours explique comment cette sève nourrit tous les organes et comment l’excédent de sucres est mis en réserve sous forme d’amidon dans les tubercules de manioc du Kasaï ou les fruits.
CHAPITRE 3 : L’APPAREIL DIGESTIF HUMAIN ET SON FONCTIONNEMENT
3.1. Anatomie Fonctionnelle de l’Appareil Digestif
Ce sous-chapitre propose une exploration détaillée de l’anatomie du tube digestif et des glandes annexes (foie, pancréas). Le rôle de chaque organe est expliqué dans la progression et la transformation des aliments, de la mastication dans la bouche jusqu’à l’évacuation des résidus.
3.2. La Digestion Mécanique et Chimique
Les deux aspects de la digestion sont approfondis. La digestion mécanique (broyage, brassage) et la digestion chimique, qui décompose les macromolécules en nutriments grâce à l’action d’enzymes spécifiques (amylases, protéases, lipases) contenues dans les sucs digestifs, sont décrites en détail.
3.3. Le Rôle du Foie et du Pancréas
L’importance capitale du foie, qui produit la bile pour émulsionner les graisses, et du pancréas, qui sécrète une multitude d’enzymes digestives, est mise en lumière. Leur contribution à la digestion des lipides, des protéines et des glucides est expliquée.
3.4. L’Absorption Intestinale des Nutriments
L’intestin grêle est présenté comme le siège principal de l’absorption des nutriments. Sa structure interne, avec ses nombreux replis et villosités qui augmentent considérablement la surface d’échange, est décrite pour expliquer l’efficacité du passage des nutriments vers la circulation sanguine.
PARTIE 2 : LES ÉCHANGES GAZEUX ET LA CIRCULATION
Aperçu : Cette deuxième partie se concentre sur les systèmes qui permettent de transporter l’oxygène, les nutriments et les déchets au sein des organismes. Elle établit un parallèle entre la respiration et la circulation chez les végétaux et les systèmes respiratoire et circulatoire beaucoup plus complexes de l’homme.
CHAPITRE 4 : LA RESPIRATION ET LES ÉCHANGES GAZEUX
4.1. La Respiration Cellulaire : Libérer l’Énergie
La respiration cellulaire est présentée comme le processus fondamental par lequel toutes les cellules vivantes (végétales et animales) dégradent le glucose en présence d’oxygène pour produire l’énergie (ATP) nécessaire à leur fonctionnement, avec production de CO₂ et d’eau comme déchets.
4.2. Les Échanges Gazeux chez les Végétaux
Les plantes respirent en permanence. Ce cours explique comment elles réalisent leurs échanges gazeux avec l’atmosphère (absorption d’O₂, rejet de CO₂) principalement à travers les stomates des feuilles, les mêmes orifices qui servent à la photosynthèse et à la transpiration.
4.3. Anatomie de l’Appareil Respiratoire Humain
Une description de l’appareil respiratoire humain est fournie, des fosses nasales aux poumons. Le trajet de l’air est suivi à travers le pharynx, le larynx, la trachée et les bronches jusqu’aux alvéoles pulmonaires, site des échanges gazeux.
4.4. La Mécanique Ventilatoire chez l’Homme
Les mouvements d’inspiration et d’expiration qui constituent la ventilation pulmonaire sont expliqués. Le rôle du diaphragme et des muscles intercostaux dans la variation du volume de la cage thoracique, qui provoque l’entrée et la sortie de l’air des poumons, est détaillé.
CHAPITRE 5 : LA CIRCULATION ET LE TRANSPORT CHEZ L’HOMME
5.1. Le Sang : Composition et Fonctions
Le sang est étudié comme le fluide de transport de l’organisme. Sa composition est détaillée : le plasma (partie liquide), les globules rouges (transport de l’oxygène), les globules blancs (défense immunitaire) et les plaquettes (coagulation).
5.2. Le Cœur : une Pompe Musculaire
L’anatomie et le fonctionnement du cœur sont décrits. Le cœur est présenté comme une double pompe qui assure la propulsion du sang dans tout le corps. Le cycle cardiaque (systole, diastole) et le rôle des valvules sont expliqués.
5.3. Les Vaisseaux Sanguins : Artères, Veines et Capillaires
Le réseau de distribution du sang est exploré. La structure et la fonction des artères (qui partent du cœur), des veines (qui retournent au cœur) et des capillaires (sites d’échanges avec les cellules) sont différenciées, formant un circuit fermé.
5.4. La Double Circulation Sanguine
Le concept de double circulation est clarifié. La circulation pulmonaire (ou petite circulation) qui assure l’oxygénation du sang au niveau des poumons, et la circulation systémique (ou grande circulation) qui distribue ce sang oxygéné à tous les organes du corps, sont décrites comme deux boucles interdépendantes.
PARTIE 3 : COORDINATION DES FONCTIONS ET PERCEPTION
Aperçu : Cette partie aborde les systèmes qui permettent aux organismes de percevoir leur environnement et de coordonner leurs actions. Elle se concentre sur le système nerveux et les organes des sens, des sujets d’une pertinence extrême pour les métiers de la restauration où le goût et l’odorat sont au premier plan.
CHAPITRE 6 : LE SYSTÈME NERVEUX HUMAIN
6.1. Organisation du Système Nerveux
L’étude présente la structure générale du système nerveux, divisé en système nerveux central (encéphale et moelle épinière), qui est le centre de commande, et système nerveux périphérique (nerfs), qui assure la liaison avec le reste du corps.
6.2. Le Neurone : Unité Fonctionnelle
Le neurone est décrit comme la cellule de base du système nerveux. Sa structure (corps cellulaire, dendrites, axone) et sa capacité à générer et à transmettre un signal électrique, l’influx nerveux, sont expliquées.
6.3. La Transmission de l’Information : Synapses
La communication entre les neurones est assurée par les synapses. Le mécanisme de la transmission synaptique, impliquant la libération de messagers chimiques (neurotransmetteurs) qui traversent l’espace synaptique, est détaillé de manière simplifiée.
6.4. L’Arc Réflexe : une Réponse Rapide
Le réflexe est présenté comme une réponse involontaire et rapide à un stimulus, impliquant un circuit nerveux simple appelé arc réflexe. L’exemple du retrait de la main au contact d’une plaque chaude dans une cuisine de Gbadolite illustre ce mécanisme de protection.
CHAPITRE 7 : LES ORGANES DES SENS : GOÛT ET ODORAT
7.1. La Langue et la Perception du Goût
La langue est étudiée comme l’organe du goût. Les papilles gustatives et les bourgeons du goût qu’elles contiennent sont décrits comme les récepteurs capables de détecter les cinq saveurs primaires : sucré, salé, acide, amer et umami.
7.2. Le Nez et la Perception des Odeurs
Le mécanisme de l’olfaction est exploré. Les molécules odorantes présentes dans l’air stimulent les récepteurs olfactifs situés dans la muqueuse nasale, envoyant une information au cerveau qui est interprétée comme une odeur. La grande sensibilité de ce système est soulignée.
7.3. L’Interaction du Goût et de l’Odorat : la Flaveur
Ce sous-chapitre explique que la perception complexe que nous appelons « goût » est en réalité une synergie entre le goût (perçu par la langue) et l’odorat (perçu par le nez via la voie rétronasale). Cette combinaison est appelée la flaveur et constitue l’essentiel de l’expérience de dégustation.
7.4. L’Éducation du Palais et l’Analyse Sensorielle
L’importance pour un professionnel de la restauration d’entraîner et d’affiner ses sens est mise en avant. Une introduction à l’analyse sensorielle est proposée comme une méthode structurée pour décrire et évaluer objectivement les qualités organoleptiques d’un produit alimentaire ou d’une boisson.
PARTIE 4 : LA CONTINUITÉ DE LA VIE
Aperçu : Cette dernière partie aborde les mécanismes fondamentaux qui assurent la croissance des organismes et la perpétuation des espèces. Elle se penche sur la division cellulaire comme base de la croissance et sur les principes de la reproduction et de l’hérédité.
CHAPITRE 8 : LA DIVISION CELLULAIRE ET LA CROISSANCE
8.1. Le Cycle Cellulaire
La vie d’une cellule est décrite comme un cycle alternant une phase de croissance (interphase) et une phase de division (mitose). L’interphase est présentée comme une période d’activité métabolique intense où la cellule duplique son matériel génétique en préparation de la division.
8.2. La Mitose : une Reproduction Conforme
La mitose est expliquée comme le processus de division cellulaire qui produit deux cellules filles génétiquement identiques à la cellule mère. Les différentes étapes (prophase, métaphase, anaphase, télophase) sont décrites, en soulignant son rôle dans la croissance des organismes et le renouvellement des tissus.
8.3. La Croissance chez les Végétaux
La croissance végétale est localisée au niveau de zones spécialisées appelées méristèmes, situées à l’extrémité des tiges et des racines. Ce cours explique comment la division cellulaire intense dans ces zones assure l’allongement de la plante.
8.4. La Croissance et la Régénération chez l’Homme
Chez l’homme, la mitose permet la croissance durant l’enfance et l’adolescence. À l’âge adulte, elle assure le renouvellement constant de certaines cellules (peau, sang, paroi intestinale) et la cicatrisation des tissus après une blessure.
CHAPITRE 9 : LA REPRODUCTION ET LES BASES DE L’HÉRÉDITÉ
9.1. Reproduction Asexuée et Végétative
La reproduction asexuée est définie comme un mode de reproduction qui ne fait pas intervenir de cellules sexuelles et produit des individus identiques au parent. Chez les végétaux, ce processus, appelé multiplication végétative (bouturage, marcottage), est largement utilisé en agriculture et en horticulture.
9.2. La Reproduction Sexuée : Méiose et Fécondation
La reproduction sexuée est caractérisée par la production de cellules spécialisées (gamètes) par un processus de division particulier, la méiose, et par leur union lors de la fécondation pour former un nouvel individu. Ce processus assure un brassage génétique et une diversité des descendants.
9.3. Introduction à la Génétique : Gènes et Chromosomes
Ce sous-chapitre introduit les concepts de base de l’hérédité. Les chromosomes sont présentés comme les supports de l’information génétique, et les gènes comme des segments d’ADN qui déterminent les caractères héréditaires.
9.4. L’Application en Amélioration des Plantes et des Animaux
Une ouverture sur les applications de la génétique est proposée. La sélection variétale en agriculture, qui vise à obtenir des plantes plus productives ou plus résistantes comme le maïs dans le Haut-Katanga, est présentée comme une application directe des lois de l’hérédité pour répondre aux besoins alimentaires.
ANNEXES
1. Glossaire des Termes de Physiologie 📖
Une liste alphabétique des termes techniques abordés (physiologie, mitose, photosynthèse, sève, ATP, etc.) est fournie avec des définitions claires, servant de référence pour l’élève.
2. Schémas des Systèmes Humains anatomie
Des planches anatomiques simplifiées des principaux systèmes étudiés (digestif, respiratoire, circulatoire, nerveux) sont incluses pour faciliter la mémorisation de leur structure.
3. Diagramme Récapitulatif de la Photosynthèse ☀️
Un schéma synthétique illustre les intrants (eau, CO₂, lumière) et les extrants (glucose, O₂) de la photosynthèse, ainsi que sa localisation dans le chloroplaste, offrant un support visuel pour la compréhension de ce processus complexe.
4. Fiches de Travaux Pratiques 📝
Des protocoles pour des expériences simples réalisables en classe sont proposés, comme la mise en évidence de la transpiration, l’observation de stomates au microscope ou des tests de sensibilité gustative, pour lier la théorie à la pratique.



