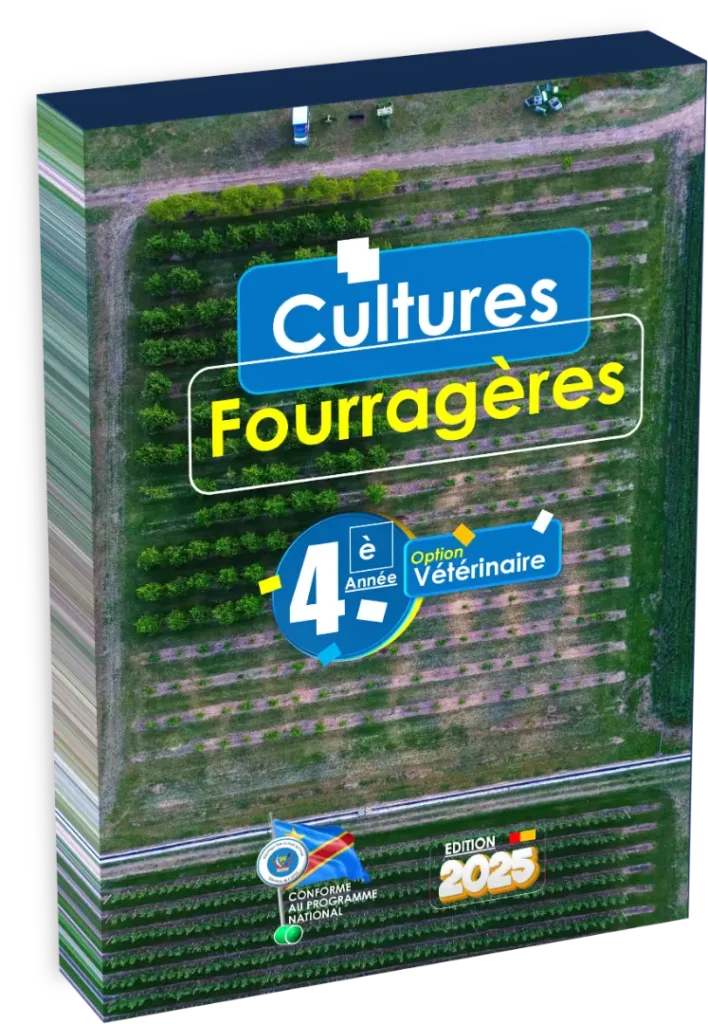
CULTURES FOURRAGERES, 4 EME ANNEE, OPTION VETERINAIRE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC
Préliminaires
0.1. Introduction Générale au Cours
Ce cours de Cultures Fourragères est la discipline qui connecte la science du sol et des plantes à la production animale. Il enseigne au futur technicien vétérinaire à devenir un « cultivateur de l’aliment du bétail », une compétence fondamentale pour l’intensification et la modernisation de l’élevage en République Démocratique du Congo. La maîtrise de la production fourragère est la clé pour s’affranchir des aléas des pâturages naturels, pour sécuriser l’alimentation du troupeau durant la saison sèche et pour améliorer drastiquement la productivité. De l’installation d’une prairie de Stylosanthes pour enrichir les sols et le bétail dans les savanes du Kasaï à la production de foin de qualité dans les hauts plateaux de l’Ituri, ce cours forme des techniciens capables de gérer la ressource alimentaire, qui est le premier pilier de la santé et de la performance animale.
0.2. Objectif Intermédiaire d’Intégration (O.I.I.)
Au terme de la quatrième année, l’élève sera en mesure de planifier l’installation d’une parcelle de culture fourragère, de la préparation du sol à la récolte. Il pourra identifier les principales espèces de graminées et de légumineuses fourragères adaptées à son milieu, calculer la capacité de charge d’un pâturage et mettre en œuvre des techniques d’exploitation rationnelle et d’amélioration des parcours. Cette compétence fait de lui un conseiller technique complet, capable d’agir à la fois sur l’animal et sur son alimentation.
0.3. Compétences Visées
- Identifier les exploitations et les types de pâturages 🏞️ : L’élève apprendra à analyser un système agropastoral, à reconnaître les différents types de prairies et à identifier les espèces végétales d’intérêt fourrager, mais aussi les plantes toxiques.
- Préparer le sol et installer une culture fourragère 🌱 : Le cours vise à le rendre apte à réaliser toutes les étapes de la mise en place d’une prairie artificielle, du labour au semis.
- Entretenir et exploiter durablement les pâturages 🔄 : L’élève maîtrisera les techniques de gestion (pâturage tournant), d’amélioration (fertilisation, sursemis) et de conservation des fourrages pour une utilisation optimale.
0.4. Approche Pédagogique
La pédagogie est concrète et expérimentale, se déroulant majoritairement sur le terrain. 🧑🌾 La parcelle de l’école, ou « jardin agrostologique », sert de laboratoire à ciel ouvert où les élèves sèment, entretiennent et récoltent différentes espèces fourragères. Ils apprennent par le geste : préparer un lit de semence, régler un semoir, reconnaître le stade optimal de récolte d’une graminée. L’enseignant guide les élèves dans une démarche de projet : « Améliorer la productivité d’une parcelle de pâturage naturel dégradé en utilisant la technique du sursemis de légumineuses ». Des visites dans des fermes et des centres de recherche agronomique permettent de confronter les apprentissages aux innovations et aux pratiques des professionnels.
Partie 1 : Les Fondements Agrostologiques et Pastoraux
Cette partie établit les bases de la connaissance des plantes fourragères et des écosystèmes pastoraux de la RDC. On ne peut améliorer que ce que l’on connaît bien.
Chapitre 1 : Introduction aux Cultures Fourragères et à l’Agropastoralisme 🤝
Ce chapitre définit les concepts de culture fourragère, de pâturage, de prairie et introduit les systèmes de production intégrés agriculture-élevage (agropastoralisme), qui sont un modèle de durabilité en optimisant les cycles de nutriments (fumure animale pour les cultures, résidus de culture pour les animaux).
Chapitre 2 : Les Grands Types de Pâturages Naturels en RDC 🌿
Les principaux écosystèmes pastoraux du pays sont étudiés :
- La savane, ressource principale pour l’élevage extensif.
- Le steppe, caractéristique de certaines zones d’altitude.
- Les herbages et prairies des zones plus humides. L’élève apprend à évaluer leur productivité et leurs contraintes.
Chapitre 3 : Identification des Espèces Fourragères et des Plantes Indésirables 🔍
3.1. Les Graminées Fourragères
L’élève apprend à identifier les espèces clés comme Panicum maximum, Pennisetum purpureum (herbe à éléphant), Trypsacum laxum, et le maïs ou le sorgho cultivés pour l’ensilage.
3.2. Les Légumineuses Fourragères
Le rôle capital des légumineuses (Stylosanthes, Mucuna, Pueraria, Leucaena) est souligné pour leur richesse en protéines et leur capacité à fixer l’azote de l’air, améliorant ainsi la fertilité du sol.
3.3. Les Plantes Toxiques
La reconnaissance des principales plantes toxiques pour le bétail est une compétence vitale pour prévenir les accidents lors de la mise en pâture dans des zones inconnues.
Partie 2 : La Création d’une Prairie Artificielle
Cette partie est un guide technique, étape par étape, pour transformer une parcelle de terre en une source productive et pérenne de fourrage de qualité.
Chapitre 4 : Le Choix du Site et la Préparation du Sol 🚜
Les critères de choix d’une parcelle sont étudiés (sol, pente, accès à l’eau). Les différentes opérations de préparation du lit de semence sont détaillées : labour, hersage, billonnage, et leur calendrier optimal par rapport à la saison des pluies.
Chapitre 5 : L’Installation de la Culture Fourragère 🌱
5.1. Le Choix du Matériel Végétal
L’élève apprend à choisir entre les semences, les éclats de souche ou les boutures, en fonction de l’espèce et des moyens disponibles.
5.2. Les Techniques de Semis et de Plantation
Les méthodes de semis (à la volée, en ligne) et de plantation manuelle ou mécanisée sont décrites, en insistant sur la densité et la profondeur optimales pour assurer une bonne levée.
Chapitre 6 : L’Entretien de la Prairie Installée
Les soins à apporter durant la phase d’installation sont cruciaux : désherbage, premier apport de fertilisation (si nécessaire) et gestion de la première exploitation pour ne pas affaiblir la jeune prairie.
Partie 3 : L’Exploitation et l’Amélioration Durable des Pâturages
Une fois la prairie installée, sa gestion à long terme détermine sa productivité et sa durabilité.
Chapitre 7 : Les Méthodes d’Exploitation Rationnelle 🐄
7.1. Le Calcul de la Capacité de Charge
L’élève apprend à calculer le nombre d’animaux qu’une parcelle peut nourrir sans se dégrader, une notion fondamentale de la gestion pastorale.
7.2. Le Pâturage Tournant
La technique du pâturage tournant (division du pâturage en parcelles ou « paddocks ») est expliquée. C’est la méthode la plus efficace pour optimiser l’utilisation de l’herbe et assurer sa repousse.
Chapitre 8 : L’Amélioration des Pâturages 📈
Ce chapitre explore les techniques pour augmenter la productivité des prairies, qu’elles soient naturelles ou artificielles :
- La fertilisation raisonnée.
- Le sursemis de légumineuses dans une prairie de graminées existante.
- L’utilisation du feu de brousse contrôlé comme outil de gestion de la végétation dans les parcours extensifs.
Partie 4 : La Conservation des Fourrages : Vaincre la Saison Sèche
Cette partie (enrichissement) est essentielle car elle apporte la solution à la contrainte majeure de la plupart des systèmes d’élevage en RDC : le déficit alimentaire en saison sèche.
Chapitre 10 : La Production de Foin ☀️
La technique de fabrication du foin est détaillée : fauchage au stade optimal, séchage (fanage), andainage et stockage à l’abri de la pluie. La difficulté de faire du foin de qualité dans les régions à forte humidité, comme près de Kisangani, est discutée.
Chapitre 11 : L’Ensilage : Conserver la Fraîcheur 🌽
L’ensilage est une technique de conservation par fermentation en l’absence d’air. Les principes de base sont expliqués : le choix des plantes (maïs, sorgho), le hachage fin, le tassement énergique et la fermeture hermétique du silo (silo-fosse, silo-bunker).
Chapitre 12 : Les Autres Formes de Stockage sur Pied 🌳
La technique de la « banque fourragère » est présentée. Elle consiste à planter des parcelles denses d’arbustes fourragers (comme le Leucaena ou le Gliricidia) qui seront coupés et distribués aux animaux durant la saison sèche, une stratégie très pertinente pour l’élevage de chèvres dans des régions comme le Kongo-Central.
Annexes
Annexe 1 : Glossaire des Termes Agrostologiques
Ce lexique définit les termes clés de la discipline, de « agrostologie » à « UGB » (Unité Gros Bétail), en passant par « ensilage », « légumineuse » et « capacité de charge ». 📖
Annexe 2 : Guide d’Identification des Principales Espèces Fourragères
Des fiches illustrées présentent les caractéristiques des graminées et légumineuses les plus importantes pour la RDC, avec leurs exigences écologiques et leur valeur nutritive. 🌿
Annexe 3 : Calendrier Fourrager pour un Système Agropastoral
Un calendrier type est proposé. 🗓️ Il planifie, mois par mois, les activités liées à la production fourragère (préparation du sol, semis, entretien, récoltes, conservation) et les met en parallèle avec les besoins du troupeau au fil des saisons.



