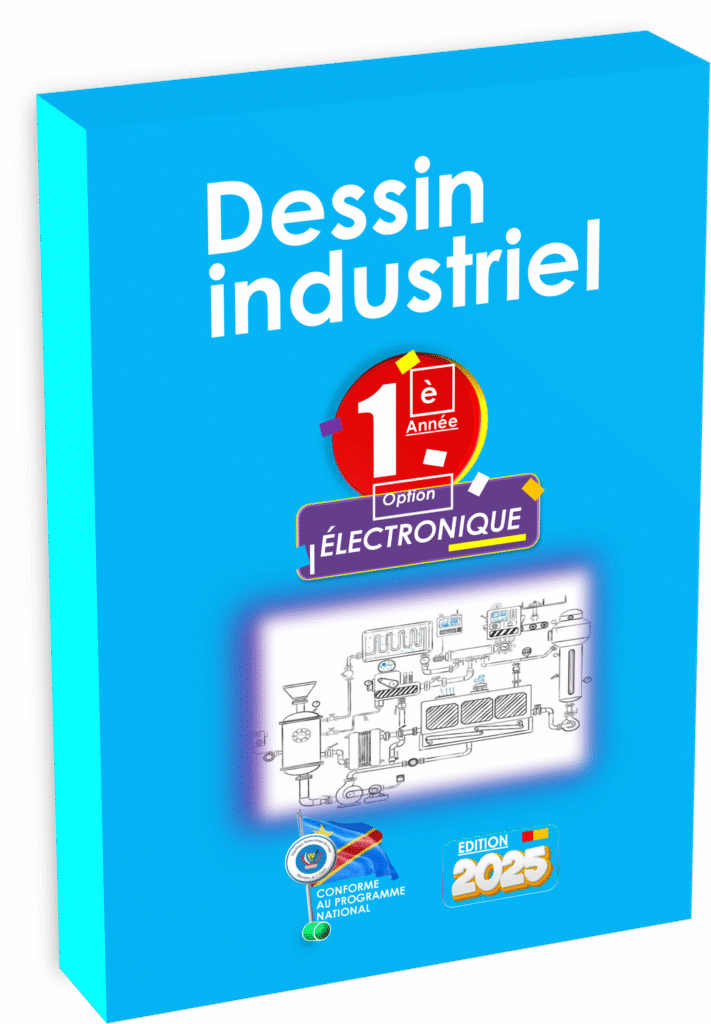
DESSIN INDUSTRIEL
1ÈRE ANNÉE – OPTION ÉLECTRONIQUE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC
Préliminaires
1. Objectifs Généraux du Cours
Ce manuel a pour vocation de structurer la pensée technique de l’élève en lui inculquant la maîtrise du dessin industriel, discipline fondamentale qui constitue le langage universel de la conception et de la fabrication mécanique. L’acquisition de cette compétence permet de transformer une idée conceptuelle en un plan détaillé et exploitable, assurant une communication précise et sans équivoque entre les différents acteurs d’un projet technique, du bureau d’études à l’atelier de production.
2. Compétences Visées
Au terme de cette formation, l’élève détiendra la capacité de :
- Appliquer rigoureusement les normes de la projection orthogonale pour représenter un objet sous ses vues multiples.
- Élaborer des dessins de définition complets, incluant une cotation fonctionnelle, des tolérances et des spécifications d’états de surface.
- Lire, interpréter et dessiner des pièces mécaniques simples ainsi que des organes de liaison standardisés.
- Réaliser des croquis clairs en perspective et des schémas d’assemblage, facilitant la compréhension volumétrique et la communication technique.
3. Approche Pédagogique
La méthodologie adoptée repose sur une synergie constante entre l’exposé théorique des concepts et leur mise en pratique systématique. Chaque nouvelle notion de normalisation ou de représentation est immédiatement suivie d’exercices graphiques de complexité graduelle, allant du traçage de formes élémentaires à la conception de petits ensembles mécaniques. Des études de cas contextualisées, telles que la conception d’un support pour une antenne de télécommunication à Mbandaka ou d’un boîtier pour un appareil de mesure destiné aux industries minières du Lualaba, ancrent l’apprentissage dans les réalités industrielles de la RDC.
PREMIÈRE PARTIE : LES FONDAMENTAUX DU LANGAGE GRAPHIQUE 📝
Cette partie initiale constitue le socle de la discipline, en établissant les règles et conventions qui régissent la communication technique. Elle vise à familiariser l’élève avec l’environnement normatif du dessin industriel, les outils de traçage et les principes fondamentaux de la projection. La maîtrise de ces bases est une condition indispensable pour produire des documents techniques d’une clarté et d’une précision irréprochables, compréhensibles par tout technicien à l’échelle mondiale.
CHAPITRE 1 : NORMES ET OUTILS DU DESSIN TECHNIQUE
1.1. L’environnement de travail du dessinateur
Ce sous-chapitre détaille l’organisation optimale d’un poste de dessin, en présentant les instruments traditionnels (té, équerres, compas, trace-cercles) et leur usage correct. L’accent est mis sur l’acquisition de gestes précis pour garantir la propreté et l’exactitude des tracés. Une brève ouverture vers les outils de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) est également proposée pour situer la discipline dans son contexte technologique actuel.
1.2. Les formats et le cartouche
La standardisation des supports est ici abordée à travers l’étude des différents formats de papier (A0, A1, A2, A3, A4) et des règles de pliage conformes aux normes ISO. L’élève apprend à construire et à renseigner méthodiquement un cartouche, qui contient toutes les métadonnées du dessin : échelle, titre, dessinateur, date, symbole de projection, et indice de modification.
1.3. La nomenclature
Indissociable du dessin d’ensemble, la nomenclature est une liste structurée de tous les éléments constituant un mécanisme. Ce sous-chapitre enseigne comment l’établir en y faisant figurer pour chaque pièce le repère, le nombre, la désignation, la matière et d’éventuelles observations, assurant ainsi une identification claire de chaque composant.
1.4. Les échelles de représentation
L’élève apprend à choisir l’échelle la plus appropriée pour représenter un objet en fonction de sa taille réelle et du format de papier choisi. Les concepts d’échelle d’agrandissement, de réduction et de vraie grandeur sont expliqués, ainsi que leur inscription normalisée dans le cartouche, garantissant la correcte interprétation des dimensions du dessin.
CHAPITRE 2 : CONVENTIONS DE LIGNES ET ÉCRITURE NORMALISÉE
2.1. Les types de traits et leurs applications
Ce point fondamental détaille la « grammaire » du dessin technique. L’élève apprendra à différencier et à tracer avec précision les divers types de traits normalisés : le trait continu fort pour les arêtes vues, le trait interrompu fin pour les contours cachés, le trait mixte fin pour les axes et les plans de symétrie, et d’autres traits spécifiques.
2.2. Groupes de traits et priorités
Lorsqu’en un même lieu plusieurs types de traits se superposent, un ordre de priorité doit être respecté pour maintenir la lisibilité du dessin. L’élève étudiera ces règles de priorité, qui stipulent par exemple qu’un trait continu fort prime toujours sur un trait interrompu ou un trait mixte fin.
2.3. L’écriture normalisée
La clarté des informations textuelles sur un plan est aussi cruciale que la qualité du dessin lui-même. Ce sous-chapitre forme l’élève au traçage de lettres et de chiffres selon les normes ISO, en respectant les proportions, l’inclinaison et l’espacement pour garantir une lisibilité parfaite, que ce soit à main levée ou à l’aide de gabarits.
2.4. Applications et exercices de traçage
Une série d’exercices progressifs est proposée pour permettre à l’élève de s’approprier la maîtrise gestuelle du traçage des différents types de lignes et de l’écriture. Ces exercices visent à développer la dextérité et la rigueur nécessaires à la production de dessins de qualité professionnelle.
CHAPITRE 3 : PROJECTIONS ORTHOGONALES ET DISPOSITION DES VUES
3.1. Le principe de la projection orthogonale
Le concept central de la représentation en vues multiples est ici expliqué. À l’aide de l’analogie du « cube de projection », l’élève comprend comment la forme tridimensionnelle d’un objet peut être décomposée en une série de vues bidimensionnelles, chacune correspondant à une observation perpendiculaire à l’une de ses faces.
3.2. Les six vues principales
L’élève apprend à identifier et à nommer les six vues possibles d’un objet : la vue de face, la vue de dessus, la vue de gauche, la vue de droite, la vue de dessous et la vue arrière. La compréhension de leur position relative est essentielle pour interpréter correctement un plan.
3.3. Disposition normalisée des vues (ISO-E)
La convention européenne de projection (ISO-E), utilisée en RDC, est étudiée en détail. Ce sous-chapitre enseigne la règle de disposition des vues autour de la vue de face, ainsi que le symbole normalisé qui doit figurer dans le cartouche pour indiquer sans ambiguïté la méthode de projection utilisée.
3.4. De l’objet 3D aux vues 2D
Des exercices pratiques guident l’élève dans le processus de création des vues d’un objet. En partant d’une représentation en perspective d’une pièce simple, il apprendra à dessiner méthodiquement la vue de face, puis à projeter les autres vues nécessaires en assurant une correspondance parfaite des dimensions.
DEUXIÈME PARTIE : LA REPRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES PIÈCES ⚙️
Fort des bases de la projection, l’élève aborde dans cette partie les techniques avancées qui permettent de décrire complètement et sans ambiguïté la géométrie d’une pièce, y compris ses formes internes. L’objectif est de savoir choisir les vues les plus pertinentes, de visualiser l’objet en trois dimensions à travers la perspective, et de représenter virtuellement une pièce « coupée » pour en révéler les détails cachés.
CHAPITRE 4 : CORRESPONDANCE DES VUES ET CHOIX DE LA VUE DE FACE
4.1. La correspondance entre les vues
Ce sous-chapitre renforce la compréhension des liens géométriques entre les différentes projections d’un même objet. L’élève apprendra à utiliser les lignes de rappel et les constructions géométriques (telle que la droite à 45°) pour garantir que les dimensions sont cohérentes et parfaitement alignées d’une vue à l’autre.
4.2. Le choix judicieux de la vue de face
La sélection de la vue de face est la décision la plus importante dans la mise en plan d’une pièce. L’élève étudiera les critères de choix : la vue doit représenter la pièce dans sa position de fonctionnement et montrer le maximum de formes caractéristiques tout en minimisant le recours aux contours cachés.
4.3. Le nombre de vues nécessaires
Le principe d’économie de vues est essentiel pour ne pas surcharger un dessin. L’élève apprendra à analyser la géométrie d’une pièce (pièces de révolution, pièces avec plans de symétrie) pour déterminer le nombre minimal de vues strictement nécessaires à sa définition complète.
4.4. Vues particulières et vues partielles
Pour des formes complexes ou obliques, les vues principales peuvent être insuffisantes. Ce sous-chapitre introduit les vues particulières (ou auxiliaires) pour représenter des faces inclinées en vraie grandeur, ainsi que les vues partielles (ou interrompues) pour se concentrer sur un détail spécifique d’une grande pièce.
CHAPITRE 5 : LA PERSPECTIVE CAVALIÈRE POUR LA VISUALISATION 3D
5.1. Principes et conventions de la perspective cavalière
Cette technique de dessin rapide permet une représentation tridimensionnelle simple. L’élève étudiera ses principes : une face avant dessinée en vraie grandeur et des « fuyantes » représentant la profondeur, typiquement inclinées à 45° et dessinées avec un rapport de réduction de 0,5.
5.2. Traçage des formes simples en perspective
L’élève s’exercera à dessiner en perspective cavalière des volumes de base comme le cube, le parallélépipède, le cylindre et le prisme. La maîtrise du tracé des cercles en perspective (ellipses) est une compétence clé abordée ici.
5.3. De la projection orthogonale à la perspective
L’exercice inverse, tout aussi formateur, est pratiqué. En partant d’un jeu de vues en projection orthogonale, l’élève apprendra à synthétiser les informations pour construire une représentation en perspective cavalière, démontrant ainsi sa capacité à visualiser mentalement l’objet en 3D.
5.4. Lecture et interprétation de croquis en perspective
La capacité à lire rapidement un croquis en perspective est cruciale en atelier ou lors de discussions techniques. L’élève analysera des croquis de pièces, comme un support moteur pour une génératrice à Bukavu, afin d’identifier toutes ses formes et de comprendre sa fonction.
CHAPITRE 6 : LES COUPES ET SECTIONS POUR RÉVÉLER LES DÉTAILS INTERNES
6.1. Le principe de la coupe
Lorsque l’intérieur d’une pièce creuse est complexe, les contours cachés rendent le dessin illisible. Ce sous-chapitre explique le principe de la coupe : on imagine scier la pièce pour en voir l’intérieur. La représentation du plan de coupe et du sens d’observation est normalisée.
6.2. Hachures : règles et conventions
Les surfaces coupées sont mises en évidence par des hachures. L’élève apprendra les règles de base : hachures fines, inclinées à 45°, et dont l’orientation change pour chaque pièce adjacente dans un dessin d’assemblage. Des conventions spécifiques de hachures existent pour désigner différentes matières.
6.3. Les différents types de coupes
Plusieurs types de coupes existent pour s’adapter à la géométrie de la pièce. L’élève étudiera la coupe simple, la demi-coupe (pour les pièces symétriques), la coupe brisée à plans parallèles ou obliques (pour suivre le contour des formes internes) et la coupe locale (pour un détail précis).
6.4. Les sections
Contrairement à une coupe, une section ne représente que la surface de la matière coupée, sans montrer ce qui se trouve derrière. L’élève apprendra à dessiner des sections sorties (dessinées à côté de la vue) et des sections rabattues (dessinées en surcharge sur la vue), des techniques utiles pour définir le profil d’une poutre ou d’un bras de levier.
TROISIÈME PARTIE : LA SPÉCIFICATION DIMENSIONNELLE ET GÉOMÉTRIQUE 📏
Cette partie est consacrée à l’art de la cotation, qui consiste à ajouter au dessin géométrique toutes les informations numériques et qualitatives nécessaires à la fabrication et au contrôle de la pièce. Un dessin peut être géométriquement juste, mais il est inutile sans une cotation claire, complète et fonctionnelle. L’élève apprendra à spécifier les dimensions, les tolérances et l’état des surfaces pour garantir que la pièce fabriquée remplira parfaitement son rôle.
CHAPITRE 7 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA COTATION FONCTIONNELLE
7.1. Terminologie et éléments de la cotation
Ce sous-chapitre définit le vocabulaire de base : ligne de cote, ligne de rappel, flèches, et la valeur numérique de la cote. Les règles de disposition (les cotes doivent être lisibles et placées en dehors de la pièce si possible) et les différents éléments graphiques sont présentés en détail.
7.2. Le concept de cotation fonctionnelle
La cotation ne doit pas être un simple relevé de toutes les dimensions. L’élève apprendra le concept de cotation fonctionnelle, qui consiste à identifier et à coter en priorité les dimensions qui sont critiques pour le bon fonctionnement de la pièce dans son mécanisme (conditions d’assemblage, de jeu, de mouvement).
7.3. Cotation en série, en parallèle et à cotes superposées
Différentes méthodes de disposition des cotes sont étudiées. La cotation en série (en chaîne), la cotation en parallèle (par rapport à une même référence) et la cotation à cotes superposées (pour un gain de place) sont présentées avec leurs avantages, leurs inconvénients et leurs domaines d’application respectifs.
7.4. Analyse et cotation de pièces simples
À travers des exercices pratiques, l’élève mettra en application les principes vus précédemment. Il devra analyser la fonction d’une pièce simple, comme un axe ou une bague d’espacement, pour en déduire les surfaces fonctionnelles et proposer une cotation complète et non surabondante.
CHAPITRE 8 : COTATION DES FORMES SPÉCIFIQUES ET CAS PARTICULIERS
8.1. Cotation des diamètres et des rayons
La cotation des formes cylindriques et des arrondis suit des règles précises. L’élève apprendra à utiliser les symboles Ø pour les diamètres et R pour les rayons, et à placer correctement ces cotes, que la forme soit entièrement visible ou qu’il s’agisse d’un arc de cercle.
8.2. Cotation des chanfreins et des trous
Ce sous-chapitre aborde la cotation des détails d’usinage courants. La méthode pour coter un chanfrein (par exemple, 2×45°) et les différentes façons de spécifier la position et la taille des trous (perçages), y compris les trous lamés ou fraisurés, sont enseignées.
8.3. Cotation des angles et des pentes
L’élève étudiera la manière de spécifier les surfaces inclinées. La cotation des angles en degrés et la spécification des pentes ou des conicités par des rapports (par exemple, 1:10) sont expliquées, avec les conventions graphiques associées.
8.4. Éléments répétitifs et symétrie
Pour simplifier le dessin, les éléments qui se répètent (comme une série de trous sur un cercle) ne sont cotés qu’une seule fois, avec une indication du nombre de répétitions. L’utilisation du symbole de symétrie pour éviter de coter une pièce deux fois est également présentée.
CHAPITRE 9 : TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES ET AJUSTEMENTS
9.1. L’inévitabilité des imperfections de fabrication
Ce sous-chapitre introduit la notion fondamentale qu’il est impossible de fabriquer une pièce avec une dimension rigoureusement exacte. L’élève comprendra la nécessité d’autoriser une marge d’erreur, appelée tolérance, pour que la fabrication soit réalisable et économiquement viable.
9.2. Inscription des tolérances sur le dessin
L’élève apprendra les différentes manières d’inscrire une tolérance sur une cote : par ses écarts (supérieur et inférieur), par une valeur de tolérance ISO (ex: 40 H7), ou par une indication de tolérance générale dans le cartouche pour les cotes non spécifiées.
9.3. Le système ISO d’ajustements
Lorsqu’un arbre doit s’assembler dans un alésage (un trou), la relation entre leurs dimensions est cruciale. L’élève découvrira le système ISO qui permet de définir des ajustements standardisés : avec jeu (pour une pièce tournante), avec serrage (pour un montage fixe) ou incertain.
9.4. Lecture des tableaux d’ajustements
Pour une tolérance donnée (ex: « h6 » pour un arbre), il faut en connaître les écarts en micromètres. L’élève s’initiera à la lecture des tableaux de tolérances normalisés pour trouver les valeurs numériques exactes correspondant aux codes ISO, une compétence essentielle pour le bureau des méthodes et le contrôle qualité.
CHAPITRE 10 : ÉTATS DE SURFACE ET SIGNES DE FAÇONNAGE
10.1. Importance de l’état de surface
La rugosité de la surface d’une pièce, c’est-à-dire l’ensemble des petites aspérités laissées par l’usinage, a un impact majeur sur son fonctionnement (frottement, usure, étanchéité). Ce sous-chapitre sensibilise l’élève à l’importance de spécifier cette caractéristique.
10.2. Le symbole de l’état de surface et ses indications
Un symbole graphique normalisé est utilisé pour spécifier la rugosité. L’élève apprendra à dessiner ce symbole et à y ajouter les indications nécessaires : la valeur de la rugosité maximale (Ra), le procédé d’usinage préconisé, et l’orientation des stries d’usinage.
10.3. Signes de façonnage et procédés d’obtention
Ce sous-chapitre fait le lien entre les spécifications du dessin et les opérations d’atelier. L’élève découvrira les différents procédés d’usinage (tournage, fraisage, rectification) et comment le choix de l’état de surface influence le processus de fabrication et donc le coût de la pièce.
10.4. Positionnement des symboles sur le dessin
Les indications d’état de surface sont placées directement sur la ligne représentant la surface concernée ou sur une ligne de rappel. L’élève s’exercera à positionner correctement ces symboles sur des dessins de pièces, par exemple en spécifiant une surface rectifiée pour un palier de moteur destiné à une usine textile de Lubumbashi.
QUATRIÈME PARTIE : LA REPRÉSENTATION DES ORGANES DE LIAISON ET D’ASSEMBLAGE 🔩
Cette dernière partie se concentre sur la représentation des éléments standards qui permettent de connecter les pièces entre elles pour former un mécanisme fonctionnel. La connaissance de la représentation normalisée de ces composants est indispensable, car ils sont omniprésents en construction mécanique. L’élève apprendra à dessiner les filetages, les vis, les écrous et autres dispositifs de liaison, ainsi que les assemblages permanents comme la soudure.
CHAPITRE 11 : LE FILETAGE : REPRÉSENTATION ET COTATION NORMALISÉES
11.1. Terminologie du filetage
Avant de le dessiner, il faut comprendre ce qu’est un filetage. L’élève étudiera son vocabulaire : pas, flanc, sommet, diamètre nominal, etc. La distinction entre le filetage (sur une tige) et le taraudage (dans un trou) est établie.
11.2. Représentation conventionnelle du filetage et du taraudage
Le dessin réel d’un filetage serait trop complexe et fastidieux. L’élève apprendra donc la représentation symbolique normalisée : le diamètre extérieur en trait fort et le fond de filet en trait fin, que ce soit pour une vis ou un écrou, en vue extérieure ou en coupe.
11.3. Cotation des filetages
La cotation d’un filetage doit être concise et complète. L’élève apprendra à la spécifier par une désignation normalisée, par exemple « M12x1.75 », qui indique un filetage métrique (M) de diamètre nominal 12 mm et de pas 1.75 mm. La cotation de la longueur filetée est également abordée.
11.4. Représentation des vis et écrous assemblés
Ce sous-chapitre montre comment dessiner correctement l’assemblage d’une vis dans un trou taraudé. Les règles de priorité des traits et la convention de non-coupe des éléments filetés pleins dans les vues en coupe longitudinale sont appliquées.
CHAPITRE 12 : ORGANES D’ASSEMBLAGE FILETÉS (VIS, ÉCROUS, GOUJONS)
12.1. Les différentes têtes de vis
Il existe une grande variété de vis, différenciées principalement par la forme de leur tête. L’élève apprendra à dessiner les types les plus courants : vis à tête hexagonale (H), cylindrique (CHc), ou fraisée (F). La représentation de l’empreinte pour l’outil de serrage (fente, Phillips, Allen) est également vue.
12.2. Les écrous et les rondelles
Compléments indispensables de la vis, les écrous et rondelles ont aussi leur représentation normalisée. L’élève dessinera des écrous hexagonaux (H), des écrous borgnes, et différentes sortes de rondelles (plates, Grower) en respectant leurs proportions simplifiées.
12.3. Les goujons et les vis de pression
L’élève étudiera la représentation d’autres éléments filetés. Le goujon, une tige filetée à ses deux extrémités, est utilisé pour des montages fréquents. La vis de pression, souvent sans tête, sert à immobiliser une pièce par rapport à une autre, par exemple une bague sur un arbre.
12.4. Le dessin d’un assemblage boulonné
En synthèse, l’élève réalisera le dessin complet d’un assemblage par boulon, qui comprend la vis, l’écrou et les rondelles, assemblant deux plaques. Cet exercice permet de mettre en pratique toutes les conventions de représentation, de coupe et de hachurage vues précédemment.
CHAPITRE 13 : AUTRES ORGANES DE LIAISON (GOUBILLES, RIVETS, CLAVETTES)
13.1. Les goupilles
Les goupilles sont des petits cylindres utilisés pour l’immobilisation ou le positionnement précis de pièces. L’élève apprendra à représenter les goupilles cylindriques, coniques et élastiques (Mecanindus), ainsi que leur cotation spécifique.
13.2. Les rivets
Utilisés pour les assemblages permanents, notamment en chaudronnerie, les rivets ont une représentation symbolique simple. L’élève découvrira comment dessiner les différents types de têtes de rivets (ronde, fraisée) et comment représenter un assemblage riveté.
13.3. Les clavettes
La clavette est un organe qui assure la liaison en rotation entre un arbre et un moyeu (poulie, engrenage). L’élève étudiera la représentation de la rainure de clavette sur l’arbre et dans le moyeu, ainsi que le dessin de la clavette elle-même, qu’elle soit parallèle ou disque.
13.4. Les anneaux élastiques (circlips)
Ces éléments permettent de réaliser des arrêts axiaux simples et économiques sur un arbre ou dans un alésage. L’élève apprendra à dessiner les gorges pour anneaux élastiques et à représenter ces composants dans un assemblage, par exemple pour retenir un roulement sur l’arbre d’un petit moteur électrique fabriqué à Kinshasa.
CHAPITRE 14 : LES ASSEMBLAGES SOUDÉS ET LEUR REPRÉSENTATION SYMBOLIQUE
14.1. Principe du soudage et types de soudures
Ce sous-chapitre introduit le soudage comme méthode d’assemblage permanent par fusion de la matière. Les principaux types de joints (bout à bout, en angle, à recouvrement) sont présentés pour contextualiser leur représentation.
14.2. La symbolisation normalisée des soudures
Il existe un système de symboles complet pour décrire une soudure sur un plan sans avoir à la dessiner en détail. L’élève apprendra la structure de cette symbolisation, qui inclut une ligne de repère, une flèche, et des symboles élémentaires indiquant la forme de la soudure.
14.3. Indications complémentaires et cotation
La symbolisation peut être enrichie d’informations numériques. L’élève apprendra à ajouter les dimensions de la soudure (épaisseur, longueur) et d’autres indications comme le procédé de soudage à utiliser ou le type de finition à apporter au cordon de soudure.
14.4. Exemples d’application sur des dessins de définition
L’élève s’exercera à lire et à positionner des symboles de soudage sur des dessins de pièces mécano-soudées, comme le châssis d’une machine agricole conçue pour les plaines du Kongo-Central, garantissant que les instructions pour l’atelier de soudure sont complètes et précises.
Annexes
1. Mémento des organes de liaison
Cette section fournirait des tableaux illustrés des principaux organes de liaison normalisés (vis, écrous, rondelles, goupilles, etc.) avec leur désignation et leurs proportions de dessin simplifiées. Cet outil serait une référence visuelle rapide et pratique pour l’élève.
2. Extraits de catalogues de fournisseurs
Des pages de catalogues de fabricants de composants mécaniques (roulements, visserie, etc.) seraient présentées. L’objectif est d’habituer l’élève à rechercher des informations techniques dans la documentation professionnelle et à faire le lien entre le dessin et le composant commercial réel.
3. Guide des tolérances et ajustements
Des tableaux simplifiés du système ISO de tolérances et d’ajustements seraient inclus, permettant à l’élève de déterminer rapidement les écarts pour les qualités les plus courantes et de choisir le type d’ajustement (jeu, serrage) en fonction de l’application mécanique visée.
4. Dossier d’un projet de fin d’année
Un exemple complet de dossier de dessin pour un petit mécanisme (par exemple, un cric simple ou une petite étau) serait fourni. Ce dossier inclurait le dessin d’ensemble, les dessins de définition de chaque pièce avec leur cotation complète, la nomenclature et les perspectives, servant de modèle et de synthèse à l’ensemble du cours.