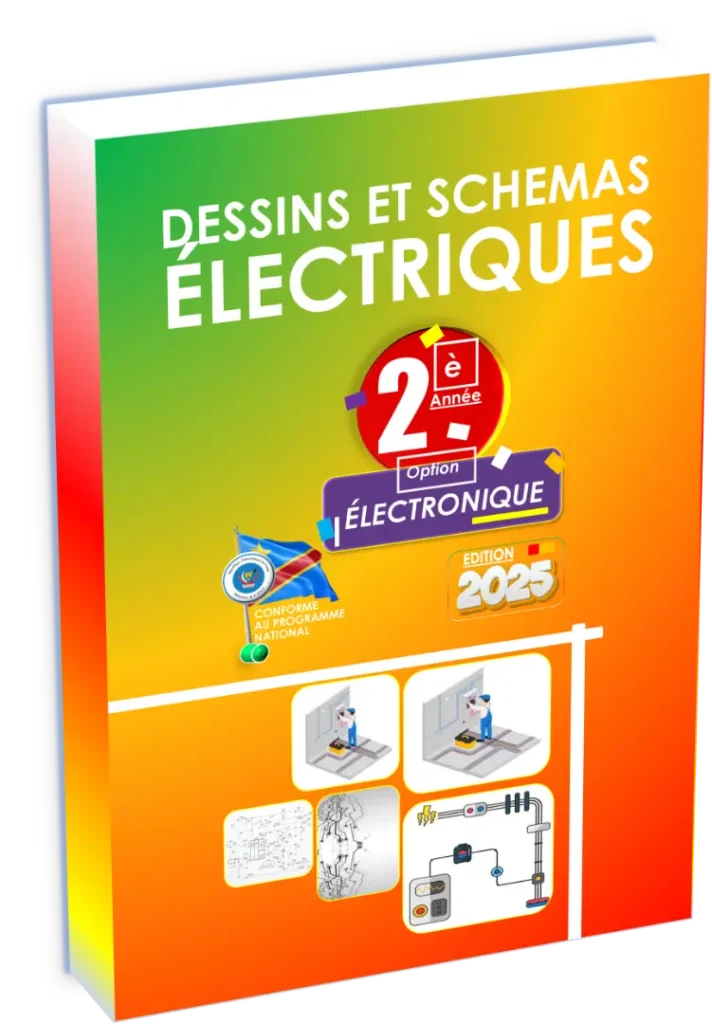
DESSINS ET SCHÉMAS ÉLECTRONIQUES
2ÈME ANNÉE – OPTION ÉLECTRONIQUE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC
Préliminaires
1. Objectifs Généraux du Cours
Ce manuel vise à faire évoluer l’élève de la simple reconnaissance des symboles à la maîtrise de la conception et de l’analyse de schémas électroniques fonctionnels. S’appuyant sur les acquis de première année, ce cours se concentre sur la représentation graphique des circuits fondamentaux de l’électronique analogique, notamment les alimentations et les étages d’amplification. L’objectif est de développer une rigueur méthodologique dans la création de documents techniques clairs, complets et conformes aux normes professionnelles.
2. Compétences Visées
Au terme de cette année d’apprentissage, l’élève détiendra la capacité de :
- Appliquer les normes de l’établissement des schémas pour produire des documents structurés et lisibles.
- Dessiner les schémas de principe et de câblage de circuits d’alimentation linéaire complets, incluant le redressement, le filtrage et la stabilisation.
- Représenter graphiquement les circuits de polarisation des transistors et tracer leurs droites de charge.
- Lire, interpréter et documenter des schémas de préamplificateurs de tension, en identifiant chaque composant et sa fonction.
- Initier la transition du schéma théorique vers le circuit imprimé en réalisant des schémas d’implantation.
3. Approche Pédagogique
La démarche pédagogique est résolument orientée vers l’application. Chaque concept théorique vu dans les cours d’électronique générale est ici traduit en sa représentation graphique normalisée. L’apprentissage se fait par la construction progressive de schémas de complexité croissante. Des projets de synthèse, comme la conception du dossier schématique complet d’une mini-alimentation de laboratoire ou d’un préamplificateur pour microphone, servent de fil rouge. Des exemples concrets, tels que l’analyse du schéma d’un chargeur solaire pour une station de pompage dans le Bandundu, ancrent les compétences dans des applications pertinentes pour le contexte congolais.
PREMIÈRE PARTIE : NORMES AVANCÉES ET MÉTHODOLOGIE DU SCHÉMA ÉLECTRONIQUE ✍️
Cette partie a pour but de consolider et de professionnaliser les compétences de l’élève en matière de dessin technique électronique. Elle va au-delà du simple dessin de symboles pour aborder les règles de composition, de clarté et de documentation qui transforment un simple croquis en un véritable document technique exploitable. La maîtrise de cette méthodologie est une condition indispensable pour communiquer efficacement dans un environnement professionnel, que ce soit pour la conception, la fabrication ou la maintenance.
CHAPITRE 1 : CLASSIFICATION ET RÔLE DES SCHÉMAS ÉLECTRONIQUES
1.1. Le schéma structurel (ou synoptique)
Ce sous-chapitre présente le schéma structurel comme une représentation de haut niveau, utilisant des blocs pour illustrer les principales fonctions d’un système et leurs interactions. L’élève apprendra à utiliser ce type de schéma pour décrire l’architecture globale d’un appareil, comme un récepteur radio, avant d’en détailler les circuits.
1.2. Le schéma de principe (ou théorique)
Le schéma de principe est le cœur de la conception électronique. Il représente tous les composants par leurs symboles normalisés et toutes les liaisons électriques, dans le but d’expliquer le fonctionnement du circuit. Les règles visant à optimiser sa lisibilité (signaux de gauche à droite, tensions positives en haut) sont établies.
1.3. Le schéma de câblage
Contrairement au schéma de principe, le schéma de câblage a une finalité pratique : guider le montage. L’élève apprendra à dessiner ce type de schéma qui représente les composants tels qu’ils sont physiquement disposés et montre le cheminement réel des fils et connexions, par exemple sur une platine d’essai.
1.4. Le schéma d’implantation
Le schéma d’implantation est le lien direct vers la fabrication d’un circuit imprimé (PCB). Il montre la disposition physique des composants sur la carte. Ce sous-chapitre initie l’élève à la création de ce document, qui est essentiel pour le placement des composants avant le routage des pistes.
CHAPITRE 2 : RÈGLES DE REPRÉSENTATION ET ORGANISATION D’UN SCHÉMA
2.1. Disposition des éléments sur le schéma
Des règles de composition claires sont présentées pour améliorer la lisibilité des schémas de principe. L’élève apprendra à organiser le flux du signal (entrées à gauche, sorties à droite), à placer les alimentations (tensions positives en haut, masses en bas) et à regrouper les composants par fonction logique.
2.2. Conventions de croisement et de connexion
Pour éviter toute ambiguïté, des conventions strictes s’appliquent au tracé des liaisons. La différence entre deux conducteurs qui se croisent sans se connecter et deux conducteurs qui sont connectés (jonction matérialisée par un point) est expliquée et mise en pratique.
2.3. Utilisation des renvois de liaison
Dans les schémas complexes, tracer toutes les liaisons peut conduire à un enchevêtrement illisible. L’élève découvrira l’utilisation des renvois de liaison (labels ou flèches) pour indiquer la continuité d’une connexion entre deux points éloignés du schéma, ou même entre plusieurs feuilles.
2.4. Représentation des masses et des alimentations
Une gestion claire des alimentations est cruciale. Ce sous-chapitre normalise la représentation des différentes masses (masse analogique, masse numérique, masse châssis) et l’utilisation de symboles simplifiés pour les lignes d’alimentation (, , etc.), évitant de surcharger le schéma.
CHAPITRE 3 : NOMENCLATURE, REPÉRAGE ET DOCUMENTATION TECHNIQUE
3.1. Le repérage des composants
Chaque composant sur un schéma doit posséder un identifiant unique, appelé repère (par exemple R1, C2, Q3). Ce sous-chapitre établit les règles de nommage (lettre-identifiant par famille de composant) et de numérotation séquentielle, indispensables pour la nomenclature et le montage.
3.2. L’établissement de la nomenclature (Bill of Materials – BOM)
La nomenclature est la liste exhaustive de tous les composants nécessaires à la fabrication du circuit. L’élève apprendra à la générer à partir d’un schéma, en y faisant figurer pour chaque item le repère, la valeur, la description technique et la quantité.
3.3. Annotations et commentaires
Un bon schéma contient souvent des informations textuelles qui précisent des points importants. L’élève s’exercera à ajouter des annotations claires pour indiquer des points de test, des tensions de référence, des instructions d’ajustement ou des contraintes de montage.
3.4. Gestion des versions et des indices de modification
Dans un contexte professionnel, les schémas évoluent. Ce sous-chapitre introduit la notion de gestion de versions, avec l’utilisation d’indices de modification (A, B, C…) et d’un tableau de révisions dans le cartouche pour tracer l’historique des changements apportés au document.
DEUXIÈME PARTIE : SCHÉMATISATION DES CIRCUITS D’ALIMENTATION LINÉAIRE 🔋
Cette partie est entièrement consacrée à la représentation graphique de l’une des fonctions les plus fondamentales en électronique : la conversion du courant alternatif du secteur en un courant continu stable pour alimenter les circuits. L’élève appliquera les normes de schématisation à chaque étape de la chaîne d’alimentation, depuis la transformation de la tension jusqu’à sa stabilisation, en passant par le redressement et le filtrage.
CHAPITRE 4 : SCHÉMAS DES CIRCUITS DE REDRESSEMENT
4.1. Le redressement simple alternance
L’élève dessinera le schéma de principe du montage redresseur le plus simple, utilisant un transformateur et une seule diode. L’analyse portera sur la représentation des formes d’ondes (sinusoïdale en entrée, demi-sinusoïdes en sortie) aux points clés du circuit.
4.2. Le redressement double alternance avec transformateur à point milieu
Ce montage, utilisant un transformateur spécifique et deux diodes, est schématisé. L’élève apprendra à représenter correctement le transformateur à prise médiane et à illustrer comment chaque diode conduit pendant une alternance, produisant une tension redressée plus facile à filtrer.
4.3. Le redressement double alternance en pont de Graetz
Le montage en pont de quatre diodes, le plus courant, est étudié en détail. L’élève s’entraînera à dessiner le pont de Graetz, à identifier le parcours du courant pour chaque alternance et à représenter les formes d’ondes correspondantes.
4.4. Identification et choix des composants
Pour chaque type de montage redresseur, l’élève apprendra à identifier les caractéristiques cruciales des diodes à choisir, notamment la tension inverse maximale qu’elles doivent supporter et le courant direct moyen qu’elles doivent laisser passer, informations clés à reporter dans la nomenclature.
CHAPITRE 5 : SCHÉMAS DES CIRCUITS DE FILTRAGE
5.1. Le filtrage par condensateur (filtrage capacitif)
Le filtrage le plus simple consiste à placer un condensateur de forte valeur en parallèle avec la charge. L’élève dessinera ce montage et représentera graphiquement l’effet du condensateur, qui se charge lors des pics de tension et se décharge lentement, lissant ainsi la tension redressée.
5.2. Représentation de l’ondulation résiduelle
Malgré le filtrage, il subsiste une petite variation de tension appelée ondulation. L’élève apprendra à représenter cette ondulation sur les chronogrammes et à comprendre qualitativement son lien avec la valeur du condensateur et le courant consommé par la charge.
5.3. Le filtrage LC (inductif et capacitif)
Pour un meilleur lissage, des filtres plus complexes sont utilisés. Le schéma d’un filtre en « L », composé d’une bobine en série et d’un condensateur en parallèle, est dessiné. Le rôle de l’inductance, qui s’oppose aux variations du courant, est mis en évidence.
5.4. Le filtrage en « Pi » (CLC)
Le filtre en « Pi » (deux condensateurs encadrant une inductance) offre des performances de filtrage encore supérieures. L’élève dessinera ce type de structure et comprendra son utilité dans les alimentations de haute qualité, par exemple pour des équipements audio dans un studio à Kinshasa.
CHAPITRE 6 : SCHÉMAS DES CIRCUITS DE STABILISATION À DIODE ZENER
6.1. Principe du régulateur Zener « Shunt »
Ce sous-chapitre détaille la schématisation du circuit de régulation de base. L’élève dessinera le montage comprenant une résistance chutrice en série et une diode Zener en parallèle avec la charge, qui dérive le courant excédentaire pour maintenir la tension constante.
6.2. Calcul et annotation des éléments du schéma
Un bon schéma doit permettre la réalisation du circuit. L’élève s’exercera à calculer les valeurs de la résistance de limitation et la puissance qu’elle doit dissiper, ainsi que la puissance dissipée par la diode Zener, et à reporter ces informations cruciales sur le schéma et dans la nomenclature.
6.3. Représentation des limites de fonctionnement
L’élève apprendra à analyser les conditions de fonctionnement du régulateur. Il déterminera les plages de variation de la tension d’entrée et du courant de charge pour lesquelles la régulation reste efficace, des informations qui peuvent être ajoutées en commentaire sur le schéma.
6.4. Schéma complet d’une alimentation régulée par diode Zener
En guise de synthèse, l’élève réalisera le dossier schématique complet d’une petite alimentation stabilisée. Le document final intégrera le schéma de principe (transformateur, pont de diodes, filtre, régulateur Zener) et la nomenclature détaillée.
CHAPITRE 7 : SCHÉMAS DES CIRCUITS MULTIPLICATEURS DE TENSION
7.1. Le doubleur de tension de Latour
Ce montage, qui permet d’obtenir une tension continue d’environ le double de la valeur crête de la tension alternative, est schématisé. L’élève dessinera le circuit (deux diodes, deux condensateurs) et en analysera le fonctionnement en deux temps (charge d’un condensateur pendant une alternance, puis mise en série avec la source pendant l’autre).
7.2. Le doubleur de tension de Schenkel
Une autre configuration de doubleur, souvent utilisée comme brique de base pour des multiplicateurs d’ordre supérieur, est présentée. Son schéma en « échelle » est dessiné et son principe de fonctionnement par transfert de charge de condensateur en condensateur est expliqué.
7.3. Les tripleurs et quadrupleurs de tension
En cascadeant le montage de Schenkel, on peut obtenir des tensions encore plus élevées. L’élève apprendra à dessiner les schémas des tripleurs et quadrupleurs de tension, en comprenant la logique d’extension du montage.
7.4. Applications et limitations
Ce sous-chapitre illustre l’utilité des multiplicateurs pour générer les hautes tensions nécessaires dans certains appareils (photomultiplicateurs, anciens téléviseurs), tout en soulignant leurs limitations : ils ne peuvent fournir que de faibles courants et leur régulation est médiocre.
TROISIÈME PARTIE : REPRÉSENTATION DES CIRCUITS D’AMPLIFICATION À TRANSISTORS 📈
Cette partie aborde la schématisation du cœur de l’électronique analogique : l’amplification. L’élève apprendra à représenter graphiquement les circuits qui permettent à un transistor de fonctionner en amplificateur de signal. L’accent est mis sur la traduction schématique des circuits de polarisation, qui sont essentiels pour établir le bon point de fonctionnement, et sur l’analyse graphique du comportement du transistor à l’aide des droites de charge.
CHAPITRE 8 : SCHÉMAS DE POLARISATION DES TRANSISTORS BIPOLAIRES
8.1. Nécessité de la polarisation
Ce sous-chapitre explique pourquoi un transistor doit être correctement polarisé pour fonctionner en amplificateur. L’objectif est de fixer un « point de repos » (un courant collecteur et une tension collecteur-émetteur) au milieu de sa zone de fonctionnement linéaire.
8.2. Le montage à polarisation de base
Le schéma de la méthode de polarisation la plus simple, utilisant une seule résistance de base, est dessiné. L’élève analysera ce circuit et comprendra pourquoi sa grande simplicité se paie par une très forte dépendance à la température et au gain (β) du transistor, le rendant instable.
8.3. Le montage à polarisation par pont diviseur
Le circuit de polarisation le plus répandu et le plus stable, utilisant un pont de deux résistances pour fixer la tension de base, est étudié en détail. L’élève apprendra à dessiner ce schéma et à identifier tous ses composants, y compris la résistance d’émetteur qui assure la stabilisation.
8.4. Calcul des éléments de polarisation
L’élève s’exercera à calculer les valeurs de toutes les résistances d’un montage de polarisation par pont diviseur pour obtenir un point de repos défini (par exemple, , ). Ces valeurs calculées seront ensuite reportées sur le schéma.
CHAPITRE 9 : DROITES DE CHARGE STATIQUE ET DYNAMIQUE
9.1. Le réseau de sortie et la droite de charge statique
La droite de charge statique représente l’ensemble des points de fonctionnement possibles pour le transistor dans un circuit donné. L’élève apprendra à la tracer sur le réseau de caractéristiques de sortie du transistor en utilisant ses deux points extrêmes : le blocage et la saturation.
9.2. Détermination graphique du point de repos
Le point de repos du transistor est l’intersection entre la droite de charge statique et la caractéristique de sortie correspondant au courant de base de repos. L’élève s’exercera à déterminer graphiquement ce point, confirmant ainsi les calculs du circuit de polarisation.
9.3. La droite de charge dynamique (AC)
Lorsqu’un signal alternatif est appliqué, la charge vue par le collecteur du transistor change à cause des condensateurs de liaison. L’élève apprendra que la droite de charge dynamique, plus pentue que la statique, décrit les excursions du point de fonctionnement en présence d’un signal.
9.4. Excursion maximale et distorsion
L’analyse graphique à l’aide de la droite de charge dynamique permet de visualiser l’amplitude maximale du signal de sortie avant l’apparition de la distorsion par écrêtage (lorsque le signal atteint le blocage ou la saturation). L’élève apprendra à dessiner cette excursion pour un signal d’entrée donné.
CHAPITRE 10 : SCHÉMATISATION D’UN ÉTAGE PRÉAMPLIFICATEUR DE TENSION
10.1. Structure complète d’un amplificateur à émetteur commun
Le schéma complet d’un étage amplificateur est dessiné et analysé. Il intègre le circuit de polarisation (par pont diviseur), les condensateurs de liaison d’entrée et de sortie (qui bloquent le continu), et le condensateur de découplage de la résistance d’émetteur.
10.2. Rôle des condensateurs de liaison
Ce sous-chapitre se focalise sur le rôle des condensateurs de liaison. L’élève comprendra qu’ils sont indispensables pour coupler le signal alternatif d’un étage à l’autre (ou depuis la source et vers la charge) sans perturber les polarisations en courant continu de chaque étage.
10.3. Rôle du condensateur de découplage
Le condensateur de découplage de la résistance d’émetteur est expliqué. Son rôle est de court-circuiter cette résistance pour les signaux alternatifs, afin d’augmenter le gain de l’amplificateur. Le compromis entre un gain élevé (avec condensateur) et une meilleure stabilité (sans condensateur) est discuté.
10.4. Identification des entrées et sorties
L’élève s’exercera à identifier clairement sur un schéma les différents « ports » du circuit : l’entrée du signal (haute impédance), la sortie du signal (impédance de sortie) et les bornes d’alimentation, des informations cruciales pour l’interconnexion des circuits.
CHAPITRE 11 : ANALYSE ET LECTURE DE SCHÉMAS D’AMPLIFICATEURS SIMPLES
11.1. Méthodologie de lecture d’un schéma
Une méthode systématique pour analyser un schéma inconnu est proposée. Elle consiste à d’abord identifier les blocs fonctionnels (alimentation, amplification, etc.), puis à analyser le chemin du courant continu (polarisation) et enfin à suivre le chemin du signal alternatif.
11.2. Lecture d’un préamplificateur à un étage
L’élève appliquera la méthodologie pour lire et comprendre le schéma d’un préamplificateur simple, comme celui que l’on pourrait trouver dans une petite radio assemblée à Mbandaka. Il devra identifier chaque composant, déterminer son rôle et expliquer le fonctionnement global.
11.3. Lecture d’un préamplificateur à deux étages
Un schéma d’amplificateur à deux étages en cascade est présenté. L’élève analysera le type de liaison entre les étages (liaison capacitive) et comprendra comment le gain total est le produit des gains de chaque étage.
11.4. Établissement de la nomenclature d’un préamplificateur
En exercice de synthèse, à partir du schéma d’un préamplificateur, l’élève devra dresser la liste complète des composants (nomenclatures), en indiquant pour chacun son repère, sa valeur (ex: 10 kΩ, 100 nF), sa tolérance et toute autre spécification pertinente.
Annexes
1. Mémento des Configurations d’Amplificateurs à Transistor
Cette section fournirait les schémas de base des trois configurations d’amplificateurs (Émetteur Commun, Collecteur Commun, Base Commune), en résumant sous forme de tableau leurs caractéristiques principales (gain en tension, gain en courant, impédances d’entrée et de sortie).
2. Réseaux de Caractéristiques de Transistors Courants
Des exemples de réseaux de caractéristiques de sortie () pour des transistors bipolaires courants (ex: BC547, 2N2222) seraient fournis. Ces graphiques serviraient de support pour les exercices de traçage de droites de charge et de détermination du point de repos.
3. Guide de Câblage sur Platine d’Essai (Breadboard)
Un guide visuel expliquerait comment transposer un schéma de principe simple en un montage fonctionnel sur une platine d’essai sans soudure. Les connexions internes de la platine seraient détaillées pour éviter les erreurs de câblage courantes.
4. Dépannage Basé sur le Schéma
Une introduction à la logique de dépannage serait proposée. L’élève apprendrait comment utiliser le schéma théorique comme une « carte » pour guider la recherche de pannes, en effectuant des mesures de tension de polarisation aux points clés (base, collecteur, émetteur) et en les comparant aux valeurs théoriques.



