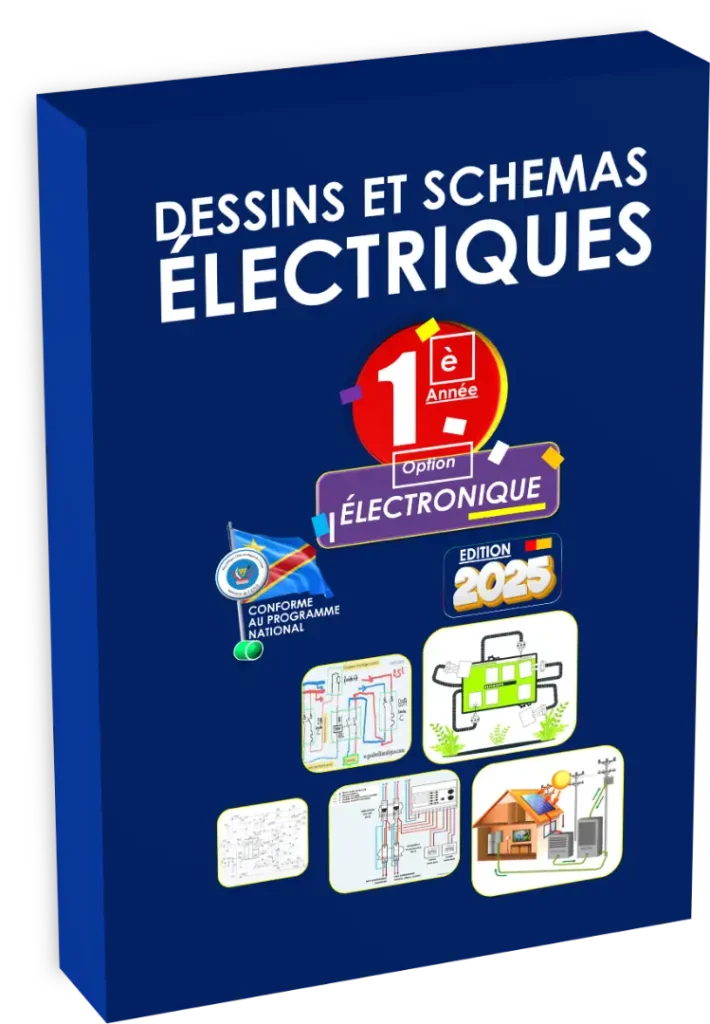
DESSIN ET SCHEMAS ELECTRONIQUES
1ÈRE ANNÉE – OPTION ÉLECTRONIQUE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC
Préliminaires
1. Objectifs Généraux du Cours
Ce manuel vise à doter l’élève des compétences fondamentales pour la lecture, l’interprétation et la création de schémas techniques dans les domaines de l’électricité et de l’électronique. L’objectif est de maîtriser le langage graphique universel qui permet de représenter, sans ambiguïté, des circuits et des installations, depuis les montages domestiques simples jusqu’aux systèmes industriels et électroniques plus complexes. La rigueur dans la représentation et le respect des normes internationales constituent le socle de cette formation.
2. Compétences Visées
Au terme de cette année d’apprentissage, l’élève sera capable de :
- Identifier et dessiner correctement les symboles normalisés des composants électriques et électroniques.
- Élaborer des schémas de principe, de câblage et d’implantation pour des installations électriques résidentielles.
- Concevoir des circuits de commande industrielle simples basés sur la logique à contacteurs.
- Tracer les schémas de circuits électroniques fondamentaux, tels que les alimentations stabilisées.
- Appliquer les règles de cotation et de repérage pour assurer la clarté et la fonctionnalité des documents techniques.
3. Approche Pédagogique
L’approche pédagogique privilégie une méthode active et progressive. Chaque concept théorique est immédiatement mis en application à travers des exercices de dessin et de conception de complexité croissante. L’apprentissage partira de l’analyse de schémas existants pour évoluer vers la création autonome de solutions graphiques répondant à des cahiers des charges précis. Des exemples contextualisés, comme la schématisation d’une installation pour un centre de santé à Mbuji-Mayi ou d’un système de pompage pour une coopérative agricole à Bandundu, ancrent les savoirs dans la réalité congolaise.
PREMIÈRE PARTIE : FONDEMENTS DU DESSIN TECHNIQUE ET NORMALISATION 💡
Cette partie introductive établit les bases indispensables à toute communication technique graphique. Elle équipe l’élève des outils intellectuels et matériels nécessaires pour produire des documents clairs, précis et universellement compréhensibles. L’accent est mis sur l’acquisition d’un langage symbolique rigoureux, en conformité avec les normes internationales, qui constitue le fondement de la conception et de la maintenance des systèmes électriques et électroniques.
CHAPITRE 1 : INTRODUCTION AUX NORMES ET OUTILS DU DESSIN TECHNIQUE
1.1. L’environnement de travail et le matériel
Ce sous-chapitre présente l’ensemble des instruments classiques du dessinateur technicien, de la planche à dessin aux différents types de crayons et trace-lettres. Il détaille les bonnes pratiques pour l’organisation de l’espace de travail afin d’assurer précision et efficacité. Une introduction aux logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) est également proposée, mettant en lumière la transition numérique du métier.
1.2. Formats, cartouches et nomenclatures
La standardisation des documents est abordée ici à travers l’étude des formats de papier normalisés (A4, A3, etc.) et de leur pliage. L’élève apprend à structurer un cartouche d’inscription, véritable carte d’identité du plan, en y intégrant les informations essentielles : titre, échelle, auteur, date, indice de révision. La méthode pour établir une nomenclature claire listant tous les composants du schéma est également enseignée.
1.3. Types de traits et leur signification
L’élève découvrira la grammaire du dessin technique : la signification conventionnelle des différents types de traits. Le trait continu fort pour les contours vus, le trait interrompu fin pour les arêtes cachées, ou encore le trait mixte fin pour les axes de symétrie sont étudiés en détail. La maîtrise de ce code visuel est essentielle pour une lecture rapide et sans équivoque des plans.
1.4. Échelles et perspectives
Cette section traite de la représentation proportionnelle des objets. L’élève apprendra à choisir et à utiliser les échelles de réduction, d’agrandissement et de vraie grandeur pour adapter la représentation à la taille du support. Les principes de base de la perspective cavalière sont également introduits pour permettre la représentation en volume de pièces simples, facilitant la visualisation tridimensionnelle à partir d’un support en deux dimensions.
CHAPITRE 2 : SYMBOLES NORMALISÉS EN ÉLECTRICITÉ
2.1. Sources, protections et transformateurs
Ce sous-chapitre se concentre sur la représentation des éléments en amont d’un circuit. L’élève mémorisera et dessinera les symboles des différentes sources d’énergie (générateurs, piles), des dispositifs de protection contre les surintensités (fusibles, disjoncteurs) et les surtensions, ainsi que les symboles des transformateurs monophasés.
2.2. Appareillages de commande et récepteurs
L’étude porte ici sur les composants permettant l’interaction avec le circuit et la conversion de l’énergie. Sont abordés les symboles des interrupteurs, boutons-poussoirs, commutateurs, et autres organes de commande manuelle. L’élève apprendra aussi à représenter les récepteurs courants : lampes, moteurs, résistances de chauffage, et sonneries.
2.3. Canalisations, connexions et repérage
La représentation des liaisons physiques entre les composants est détaillée. L’élève apprendra à différencier les types de conducteurs (Phase, Neutre, Terre) par des conventions graphiques et à dessiner les boîtes de dérivation, les borniers et les modes de connexion. Les règles de numérotation et de repérage des conducteurs et des bornes sont établies pour faciliter le câblage et la maintenance.
2.4. Types de schémas électriques
L’élève apprendra à distinguer et à utiliser les quatre types principaux de schémas. Le schéma de principe (ou développé) pour la compréhension du fonctionnement, le schéma de câblage (ou de réalisation) pour le montage, le schéma unifilaire pour une vue d’ensemble, et le schéma architectural pour l’intégration dans un bâtiment sont expliqués et illustrés par des exemples concrets.
CHAPITRE 3 : SYMBOLES NORMALISÉS EN ÉLECTRONIQUE
3.1. Composants passifs : résistances, condensateurs, bobines
Ce sous-chapitre initie l’élève à la symbolisation des briques de base de tout circuit électronique. Il apprendra à dessiner les symboles des résistances (fixes, variables, potentiomètres), des condensateurs (non polarisés, polarisés, ajustables) et des inductances (bobines, transformateurs HF), en incluant les conventions de marquage de leurs valeurs.
3.2. Composants actifs : diodes et transistors
La représentation des semi-conducteurs est au cœur de cette section. L’élève maîtrisera les symboles des différents types de diodes (redressement, Zener, LED) et de transistors (bipolaires NPN/PNP, à effet de champ), en apprenant à identifier clairement leurs électrodes (anode, cathode, base, collecteur, émetteur).
3.3. Sources de tension et masses
Une attention particulière est portée à la représentation des alimentations spécifiques à l’électronique. L’élève apprendra à symboliser les sources de tension continue, les points de masse (châssis, analogique, numérique) et les différentes lignes d’alimentation (, ), éléments cruciaux pour la compréhension de la polarisation des circuits.
3.4. Connecteurs et circuits intégrés
Cette section aborde la représentation des interfaces et des composants complexes. L’élève étudiera les symboles des connecteurs (borniers, jacks, SUB-D) et la méthode de représentation des circuits intégrés, soit sous forme de rectangle avec entrées et sorties numérotées, soit en utilisant des symboles logiques spécifiques pour les fonctions de base.
DEUXIÈME PARTIE : SCHÉMAS D’INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DOMESTIQUES 🔌
Cette deuxième partie plonge l’élève au cœur des applications pratiques du dessin électrique dans le contexte résidentiel. En s’appuyant sur les normes et symboles acquis, il développera la compétence de traduire des besoins concrets en schémas fonctionnels et réalisables. L’objectif est de maîtriser la conception des circuits qui animent nos habitations, en garantissant sécurité, fonctionnalité et conformité.
CHAPITRE 4 : CIRCUITS D’ÉCLAIRAGE FONDAMENTAUX
4.1. Le simple allumage
Le montage le plus élémentaire est ici disséqué. L’élève dessinera les schémas de principe, de câblage et unifilaire d’un point lumineux commandé par un seul interrupteur. L’exercice inclura la représentation d’une prise de courant commandée ou non par le même interrupteur, une configuration fréquente dans les logements à Kinshasa.
4.2. Le double allumage
Cette section traite de la commande indépendante de deux groupes de lampes depuis un même point. L’élève concevra les différents schémas pour un montage à double allumage, en apprenant à gérer la distribution des conducteurs et à choisir l’appareillage adéquat.
4.3. Le va-et-vient
L’élève apprendra à concevoir le circuit permettant de commander un point lumineux depuis deux endroits distincts. Le schéma de principe du va-et-vient, avec ses deux commutateurs, sera étudié en détail, ainsi que ses variantes de câblage (méthode « navettes » ou « court-circuit »).
4.4. Le télérupteur
Pour la commande d’un circuit d’éclairage depuis plus de deux points, le télérupteur est la solution. L’élève dessinera le schéma de ce montage, en distinguant clairement le circuit de commande (boutons-poussoirs) du circuit de puissance (bobine et contact du télérupteur), une solution typique pour les longs couloirs d’un immeuble à Goma.
CHAPITRE 5 : CIRCUITS DE PRISES DE COURANT ET SPÉCIALISÉS
5.1. Représentation des circuits de prises
Ce sous-chapitre se concentre sur la conception de circuits dédiés à l’alimentation des appareils. L’élève apprendra à dessiner des lignes de prises de courant en série (repiquage), à respecter le nombre maximal de points par circuit, et à représenter correctement la liaison à la terre, un élément de sécurité essentiel.
5.2. Circuits spécialisés pour gros électroménager
Certains appareils nécessitent des circuits dédiés. L’élève dessinera les schémas pour l’alimentation d’une cuisinière électrique, d’un chauffe-eau ou d’un climatiseur, en incluant les protections spécifiques (disjoncteurs de calibre adapté) et les sections de conducteurs requises.
5.3. Le tableau de répartition
Le cœur de l’installation électrique est étudié ici. L’élève apprendra à concevoir le schéma unifilaire d’un tableau de répartition domestique, en positionnant l’appareil général de coupure, les interrupteurs différentiels et les disjoncteurs divisionnaires protégeant chaque circuit. Le repérage de chaque départ sera également abordé.
5.4. Schémas d’une installation complète
En guise de synthèse, l’élève réalisera le dossier technique complet pour une petite habitation. Ce projet intégrera le plan architectural avec l’implantation du matériel, les schémas unifilaires de chaque circuit, le schéma du tableau de répartition, et la nomenclature du matériel nécessaire.
CHAPITRE 6 : CIRCUITS DE COMMUNICATION ET DE SIGNALISATION
6.1. Montages de sonneries
Ce sous-chapitre couvre les circuits d’appel. L’élève dessinera des schémas de sonneries simples, de carillons, et de montages plus complexes permettant d’identifier l’origine d’un appel via plusieurs boutons-poussoirs, comme à l’entrée d’un petit bureau à Kisangani.
6.2. Commande par minuterie
La gestion de l’éclairage dans les parties communes est abordée ici. L’élève concevra le schéma d’un circuit d’escalier commandé par une minuterie, permettant un allumage temporisé depuis plusieurs boutons-poussoirs, optimisant ainsi la consommation d’énergie.
6.3. Schémas d’interphonie et de portier
L’initiation aux systèmes de communication résidentiels est l’objet de cette section. L’élève étudiera et reproduira les schémas de principe d’un système d’interphone simple (audio) et d’un portier vidéo, en identifiant les liaisons entre le poste de rue et le combiné intérieur.
6.4. Introduction à la détection
Ce sous-chapitre explore les bases de la sécurité. L’élève apprendra à représenter schématiquement des circuits simples incluant des détecteurs de mouvement pour la commande automatique de l’éclairage ou des contacts d’ouverture pour un système d’alarme de base.
TROISIÈME PARTIE : SCHÉMAS D’INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES 🏭
Cette partie marque une transition vers des systèmes plus robustes et automatisés, typiques du monde industriel. L’élève y découvre la logique câblée, qui est à la base de la commande des machines et des processus. La maîtrise de la représentation de ces circuits est cruciale pour tout technicien en électronique industrielle, car elle permet de décrire des séquences de fonctionnement complexes de manière structurée.
CHAPITRE 7 : INTRODUCTION AUX CONTACTEURS ET À LA LOGIQUE CÂBLÉE
7.1. Le contacteur : constitution et symbole
L’organe central de la commande industrielle est présenté. L’élève étudiera la structure d’un contacteur (bobine, circuit magnétique, contacts de puissance, contacts auxiliaires) et apprendra à le représenter sur les schémas, en distinguant bien les différents éléments qui le composent.
7.2. Contacts et logique de base (ET, OU)
L’élève découvrira comment réaliser des fonctions logiques simples avec des contacts. L’association en série de contacts pour réaliser une fonction « ET » et leur mise en parallèle pour une fonction « OU » seront schématisées. Le concept de contact « normalement ouvert » (NO) et « normalement fermé » (NF) est fondamental ici.
7.3. Relais thermiques et protection moteur
La protection des récepteurs industriels, notamment les moteurs, est primordiale. L’élève apprendra à symboliser le relais de protection thermique, à le dessiner en association avec un contacteur, et à représenter son contact de déclenchement dans le circuit de commande.
7.4. Distinction entre circuit de commande et circuit de puissance
Une règle fondamentale du schéma industriel est enseignée : la séparation claire des circuits. L’élève s’exercera à dessiner systématiquement le circuit de puissance (souvent en triphasé) qui alimente le récepteur, et séparément, le circuit de commande (en basse tension) qui pilote les contacteurs.
CHAPITRE 8 : CIRCUITS DE COMMANDE DE BASE
8.1. Démarrage direct d’un moteur asynchrone
Le schéma de base pour la commande d’un moteur est étudié. L’élève dessinera les circuits de puissance et de commande pour un démarrage direct, en intégrant les protections (sectionneur, fusibles, relais thermique) et la commande par boutons-poussoirs « marche » et « arrêt » avec auto-maintien.
8.2. Commande depuis plusieurs postes
L’élève apprendra à modifier le schéma de démarrage direct pour permettre le contrôle depuis différents endroits. Il schématisera la mise en parallèle des boutons « marche » et la mise en série des boutons « arrêt », une configuration typique pour la commande d’un convoyeur dans une usine de cimenterie près de Lukala.
8.3. Inversion du sens de rotation
Cette section aborde la commande d’un moteur dans les deux sens. L’élève concevra un schéma avec deux contacteurs, en intégrant les verrouillages indispensables (électrique par contacts croisés et mécanique) pour empêcher la commande simultanée des deux sens, ce qui provoquerait un court-circuit.
8.4. Circuits de signalisation
Un bon schéma de commande inclut des informations visuelles pour l’opérateur. L’élève ajoutera des voyants lumineux pour signaler l’état du système : « sous tension », « moteur en marche », « défaut thermique ». Il apprendra à câbler ces voyants sur les contacts auxiliaires appropriés.
CHAPITRE 9 : AUTOMATISATION ET SÉQUENÇAGE PAR CONTACTEURS
9.1. Démarrage étoile-triangle
Pour limiter le courant au démarrage des moteurs de forte puissance, la méthode étoile-triangle est courante. L’élève dessinera le schéma de commande complexe utilisant trois contacteurs et un temporisateur pour assurer la séquence automatique : couplage étoile, temporisation, puis passage en couplage triangle.
9.2. Commande par fins de course
L’automatisation d’un mouvement est introduite ici. L’élève concevra le schéma de commande d’un chariot ou d’une porte automatique, en utilisant des capteurs de position (fins de course) pour arrêter le mouvement en fin de parcours.
9.3. Séquences automatiques simples
Ce sous-chapitre initie à la logique séquentielle. L’élève dessinera un schéma assurant une séquence de type « A+, B+, B-, A-« , où le démarrage de chaque mouvement est conditionné par la fin du précédent. L’utilisation de relais et de contacts auxiliaires est la clé de ces montages.
9.4. Schémas avec temporisation
La gestion du temps est essentielle en automatisme. L’élève schématisera des circuits utilisant des relais temporisés (au travail ou au repos) pour réaliser des actions différées, comme le démarrage décalé de plusieurs moteurs ou le fonctionnement intermittent d’un ventilateur dans un entrepôt à Matadi.
QUATRIÈME PARTIE : INTRODUCTION AUX SCHÉMAS ÉLECTRONIQUES ANALOGIQUES 📈
La dernière partie du cours ouvre les portes du monde de l’électronique. Alors que les parties précédentes se concentraient sur la gestion de la puissance et la commande électromécanique, celle-ci s’intéresse à la manipulation de signaux de faible niveau. L’élève apprendra à représenter les circuits qui sont au cœur des appareils de communication, de mesure et de l’informatique, en développant une rigueur spécifique à la schématisation électronique.
CHAPITRE 10 : REPRÉSENTATION DES CIRCUITS D’ALIMENTATION
10.1. Schémas de redressement
Ce sous-chapitre traite de la conversion du courant alternatif en courant continu. L’élève dessinera les schémas des montages redresseurs fondamentaux : simple alternance, double alternance avec transformateur à point milieu, et le pont de Graetz (pont de diodes), en illustrant le parcours du courant pour chaque alternance.
10.2. Schémas de filtrage
Un courant redressé est pulsé et doit être lissé. L’élève apprendra à ajouter des filtres aux schémas de redressement. Le filtrage capacitif simple (condensateur en parallèle) et les filtres plus efficaces en « Pi » (CLC) ou « L » (LC) seront schématisés.
10.3. Schémas de stabilisation à diode Zener
Pour obtenir une tension de sortie constante, une régulation est nécessaire. L’élève dessinera le schéma d’un régulateur de tension de base utilisant une diode Zener et une résistance de limitation de courant, un montage simple mais très instructif pour comprendre le principe de la stabilisation.
10.4. Schéma complet d’une alimentation simple
En guise de synthèse, l’élève réalisera le schéma de principe complet d’une petite alimentation régulée, en partant du secteur 220V. Le schéma intégrera le transformateur, le pont de diodes, le condensateur de filtrage, et le régulateur à diode Zener, avec les repères et valeurs des composants.
CHAPITRE 11 : SCHÉMATISATION DES CIRCUITS À TRANSISTORS
11.1. Circuits de polarisation du transistor bipolaire
Le bon fonctionnement d’un transistor en amplificateur nécessite de fixer son point de repos. L’élève dessinera les différents types de circuits de polarisation : polarisation par la base, par pont diviseur de tension. L’importance de ce dernier pour la stabilité thermique sera soulignée.
11.2. Schéma d’un amplificateur à émetteur commun
Le montage amplificateur le plus courant est étudié. L’élève dessinera le schéma complet d’un étage amplificateur à émetteur commun, en identifiant les condensateurs de liaison (entrée et sortie) et le condensateur de découplage de la résistance d’émetteur, et en expliquant le rôle de chaque composant.
11.3. Lecture de schémas de préamplificateurs
L’élève s’exercera à analyser des schémas existants de préamplificateurs audio simples. L’objectif est d’identifier les différents étages (si plusieurs), les circuits de polarisation, et les éventuelles boucles de contre-réaction, pour comprendre le cheminement du signal audio.
11.4. Notions de schémas d’amplificateurs de puissance
Une introduction aux étages de sortie est proposée. L’élève découvrira la structure schématique des amplificateurs de classe A et des montages push-pull (classe B ou AB) utilisés pour fournir de la puissance à une charge, comme un haut-parleur.
CHAPITRE 12 : CONCEPTION DE CIRCUITS IMPRIMÉS (PCB) – INITIATION
12.1. Du schéma de principe au schéma d’implantation
Ce sous-chapitre explique la transition entre la représentation logique et la disposition physique des composants. L’élève apprendra à dessiner un schéma d’implantation, qui montre l’arrangement des composants sur une platine d’essai ou un futur circuit imprimé.
12.2. Règles de base du routage
Le dessin des pistes en cuivre qui relient les composants sur un PCB suit des règles précises. L’élève découvrira les principes de base : largeur des pistes en fonction du courant, espacement, évitement des angles à 90°, et optimisation du trajet des connexions.
12.3. Dessin du typon (côté cuivre)
Le typon est le dessin, à l’échelle 1, des pistes de cuivre. L’élève s’entraînera à réaliser manuellement le typon d’un circuit simple (comme une petite alimentation) sur un calque, en représentant les pistes et les pastilles de soudure.
12.4. Dessin du masque de sérigraphie (côté composants)
Pour faciliter le montage et le dépannage, un dessin indiquant l’emplacement et la référence de chaque composant est imprimé sur le PCB. L’élève apprendra à créer ce masque de sérigraphie, qui complète le dossier de fabrication du circuit imprimé.
Annexes
1. Mémento des symboles normalisés
Cette section contiendrait des tableaux récapitulatifs exhaustifs des symboles graphiques étudiés durant l’année, conformes aux normes CEI (Commission Électrotechnique Internationale). Elle servirait de référence rapide pour les élèves lors de leurs travaux de conception et d’analyse.
2. Guide de lecture de schémas complexes
Des exemples de schémas industriels et électroniques authentiques (extraits de documentations techniques) seraient présentés et commentés. L’objectif est d’entraîner l’élève à décomposer un schéma complexe en blocs fonctionnels pour en faciliter la compréhension.
3. Introduction à un logiciel de CAO
Un tutoriel d’initiation à un logiciel de dessin assisté par ordinateur gratuit (comme KiCad ou Fritzing) serait proposé. Il guiderait l’élève pas à pas dans la création d’un schéma simple et la conception du circuit imprimé associé, le préparant ainsi aux outils modernes du métier.
4. Glossaire technique
Un glossaire définirait de manière claire et concise tous les termes techniques et les acronymes utilisés dans le manuel. De « contacteur » à « pont de Graetz » en passant par « schéma unifilaire », cet outil linguistique assurerait une compréhension parfaite du vocabulaire professionnel.



