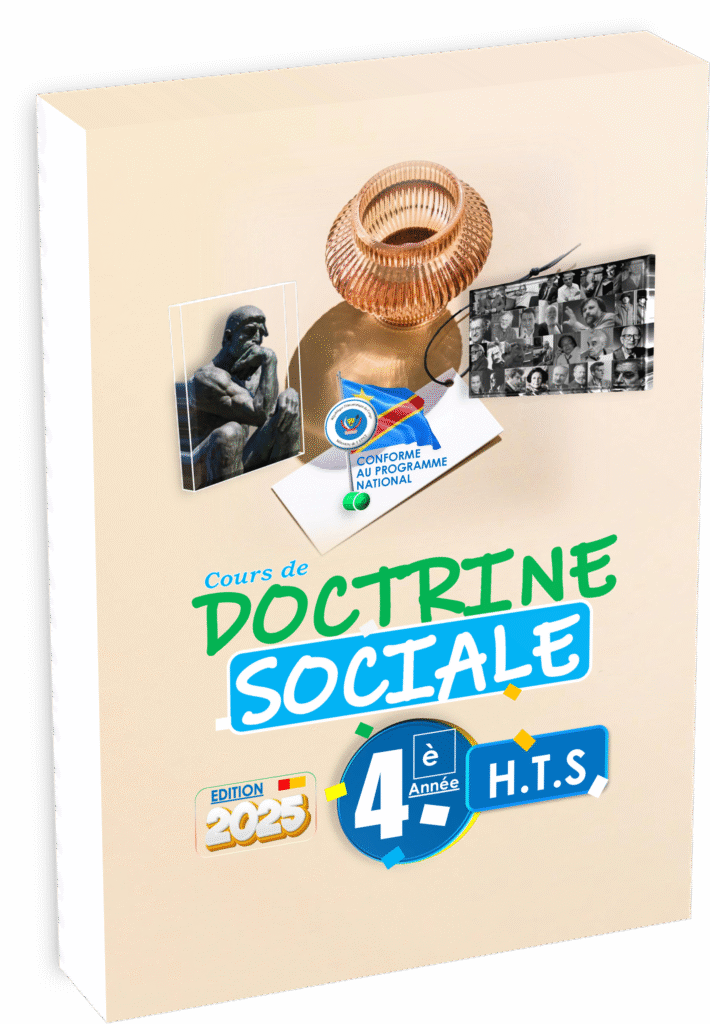
Cliquez pour lire
PRÉLIMINAIRES
1. Page de titre 📑
La page de titre formalise l’identité du document pédagogique. Elle spécifie l’intitulé exact du cours, « Doctrines Sociales », le niveau d’enseignement auquel il est destiné, l’option « Techniques Sociales », ainsi que l’institution de tutelle et l’année académique, constituant ainsi sa carte d’identité officielle.
2. Avant-propos ✍️
L’avant-propos expose la vision et la justification du cours. Il articule la pertinence de l’étude des doctrines sociales pour le futur technicien social en RDC, en soulignant comment la compréhension des grands courants idéologiques éclaire les enjeux sociaux contemporains. Cette section peut également formuler des remerciements aux contributeurs et préciser la démarche intellectuelle de l’auteur.
3. Table des matières 🗺️
La table des matières offre une vue synoptique et structurée de l’ensemble du cours. Elle fonctionne comme une feuille de route logique, présentant la hiérarchie des parties, chapitres et sections, ce qui permet à l’enseignant et à l’élève de naviguer de manière efficiente à travers le contenu et d’en saisir l’architecture globale.
4. Introduction Générale 🎯
L’introduction générale pose les fondations du parcours d’apprentissage. Elle définit la problématique centrale – pourquoi l’analyse des doctrines est indispensable à l’action sociale –, énonce les objectifs de connaissance et de compétence à atteindre, présente brièvement l’articulation des cinq grandes parties du programme et clarifie l’approche méthodologique qui sera suivie.
PREMIÈRE PARTIE : FONDEMENTS ET HISTOIRE DES IDÉES SOCIALES
Cette partie initiale construit le socle conceptuel et historique du cours. Elle vise à armer les élèves d’un vocabulaire précis pour différencier les systèmes de pensée et d’une perspective chronologique pour comprendre l’émergence et la filiation des idées qui ont façonné les sociétés.
CHAPITRE 1 : INTRODUCTION À LA NOTION DE DOCTRINE SOCIALE 📖
1.1. Définitions et concepts clés
1.1.1. Le concept de Doctrine
Une doctrine est définie comme un ensemble cohérent et systématique de principes, de thèses et de croyances qui structurent une pensée et visent à orienter l’action. Sa portée est normative ; elle ne se contente pas de décrire le monde, elle propose une manière de le comprendre et de le transformer.
1.1.2. Spécificité de la Doctrine Sociale
La doctrine sociale se distingue par son objet : l’organisation de la vie en société. Elle se concentre sur la nature des relations entre les individus et les groupes, la répartition des ressources et du pouvoir, ainsi que la finalité de la communauté politique, en proposant un modèle pour la structure sociale.
1.2. Objet et Finalité des doctrines sociales
1.2.1. L’analyse des faits sociaux
Toute doctrine sociale comporte une dimension analytique. Elle fournit une grille de lecture pour interpréter les phénomènes sociaux tels que la pauvreté dans les périphéries de Kananga, les conflits fonciers au Kivu ou les dynamiques du secteur informel à Kinshasa, en identifiant leurs causes et leurs mécanismes.
1.2.2. La proposition d’un idéal social
Au-delà de l’analyse, chaque doctrine possède une dimension prescriptive. Elle formule une vision de la société idéale, un projet de « vivre-ensemble » fondé sur des valeurs spécifiques (la liberté, l’égalité, la solidarité) et propose des moyens concrets pour atteindre cet idéal.
1.3. Typologie des doctrines sociales
Ce point établit une cartographie des grands courants de pensée qui seront étudiés. La classification s’articule principalement autour des doctrines libérales, qui placent l’individu au centre ; des doctrines socialistes, qui privilégient le collectif et la justice sociale ; et de la doctrine sociale de l’Église, qui propose une troisième voie fondée sur des principes éthiques et moraux.
CHAPITRE 2 : APERÇU HISTORIQUE DE LA PENSÉE SOCIALE 🏛️
2.1. La pensée sociale dans l’Antiquité gréco-romaine
2.1.1. Platon et la Cité idéale
L’étude de « La République » de Platon présente sa conception d’une Cité juste, organisée de manière hiérarchique en trois classes (gardiens, guerriers, artisans) selon les aptitudes de chacun, et gouvernée par la raison incarnée par les « philosophes-rois ».
2.1.2. Aristote : Politique et organisation sociale
L’analyse de la pensée d’Aristote met en lumière son approche plus empirique. Il y examine les différentes constitutions politiques, affirme que l’homme est un « animal politique » qui ne s’accomplit qu’au sein de la Cité (polis), et théorise les conditions d’une vie sociale vertueuse.
2.2. La pensée sociale au Moyen Âge
2.2.1. Saint Augustin et la Cité de Dieu
La pensée de Saint Augustin est abordée à travers sa distinction fondamentale entre la « Cité terrestre », marquée par l’imperfection humaine, et la « Cité de Dieu », idéal spirituel. Cette vision a profondément influencé la conception médiévale des rapports entre le pouvoir temporel des rois et l’autorité spirituelle de l’Église.
2.2.2. Thomas d’Aquin et la recherche du bien commun
La synthèse thomiste, qui concilie la foi chrétienne et la philosophie aristotélicienne, est étudiée. L’accent est mis sur sa définition du « bien commun » comme finalité de toute organisation politique et sur la notion de loi naturelle comme fondement d’une société juste.
2.3. La pensée sociale à l’époque moderne et aux Lumières
2.3.1. Nicolas Machiavel et la raison d’État
Machiavel marque une rupture en séparant la politique de la morale traditionnelle. Son analyse se concentre sur les mécanismes réels de l’acquisition et de la conservation du pouvoir, introduisant la notion de « raison d’État » qui justifie des actions au nom de l’intérêt supérieur de la collectivité.
2.3.2. Les théoriciens du contrat social : John Locke et Jean-Jacques Rousseau
Sont présentées les théories contractualistes qui fondent la légitimité du pouvoir politique sur un accord volontaire des individus. L’étude oppose la vision de Locke, qui justifie un gouvernement limité pour protéger les droits naturels (propriété, liberté), à celle de Rousseau, qui théorise la souveraineté populaire absolue incarnée par la « volonté générale ».
DEUXIÈME PARTIE : LE LIBÉRALISME ET SES ÉVOLUTIONS
Cette section se consacre à l’étude exhaustive du libéralisme, doctrine centrale de la modernité. Elle en explore les fondements philosophiques et économiques, suit son développement à travers ses grandes écoles de pensée, et analyse ses transformations face aux crises et aux critiques, jusqu’à ses manifestations contemporaines.
CHAPITRE 3 : LE LIBÉRALISME CLASSIQUE 💡
3.1. Notions générales et principes fondateurs
3.1.1. La liberté individuelle comme valeur suprême
Le libéralisme est défini avant tout par la primauté qu’il accorde à l’individu et à ses libertés fondamentales : liberté de conscience, d’expression, d’association et, de manière centrale, liberté d’entreprendre et d’échanger.
3.1.2. Le droit de propriété et la limitation du rôle de l’État
Le droit de propriété est conçu comme un droit naturel, extension de la liberté individuelle et condition de son exercice. Il en découle une vision de l’État dont le rôle doit être strictement limité à ses fonctions régaliennes (justice, police, défense), qualifié d’ « État-gendarme ».
3.2. Les précurseurs : L’école des physiocrates
L’école physiocratique française (Quesnay, Turgot) est présentée comme pionnière du libéralisme économique. Son apport majeur réside dans la notion d’un ordre économique naturel et dans le mot d’ordre « Laissez faire, laissez passer », qui prône la non-intervention de l’État dans l’économie.
3.3. L’école classique anglaise
3.3.1. Adam Smith : La « main invisible » et la division du travail
La pensée d’Adam Smith est analysée à travers ses deux concepts majeurs : la « main invisible », métaphore du marché qui ajuste harmonieusement les intérêts individuels pour concourir à l’intérêt général, et la division du travail, source fondamentale de l’augmentation de la productivité et de la richesse des nations.
3.3.2. Thomas Malthus : Le pessimisme démographique
L’étude de Malthus introduit une note pessimiste au sein du libéralisme. Sa théorie postule que la population croît de manière exponentielle tandis que les ressources alimentaires augmentent de façon arithmétique, rendant les famines et la misère inévitables si la croissance démographique n’est pas freinée.
3.3.3. David Ricardo : La théorie de la valeur-travail et des avantages comparatifs
Ricardo approfondit l’analyse économique classique. Sa théorie de la valeur-travail stipule que la valeur d’un bien est déterminée par la quantité de travail nécessaire à sa production. Sa théorie des avantages comparatifs fournit la justification la plus puissante du libre-échange international.
3.4. L’école classique française
3.4.1. Jean-Baptiste Say et la « loi des débouchés »
La contribution de Jean-Baptiste Say est centrée sur sa « loi des débouchés », selon laquelle « l’offre crée sa propre demande ». Cette loi fonde l’optimisme des libéraux classiques en affirmant l’impossibilité de crises de surproduction générales et durables.
3.4.2. Frédéric Bastiat et l’optimisme libéral
Bastiat est présenté comme le défenseur le plus ardent et le plus accessible du libéralisme. Son œuvre vise à démontrer « l’harmonie naturelle » des intérêts économiques au sein d’un marché libre et à dénoncer les « sophismes » des protectionnistes et des étatistes.
CHAPITRE 4 : CRITIQUES, ADAPTATIONS ET NÉO-LIBÉRALISME 🔄
4.1. Les critiques internes du libéralisme
4.1.1. John Stuart Mill et l’amendement social du libéralisme
John Stuart Mill incarne une évolution du libéralisme. Tout en défendant les libertés individuelles, il reconnaît les défaillances du marché et la nécessité d’une intervention de l’État dans l’éducation et l’aide aux plus démunis, proposant ainsi une version plus sociale du libéralisme.
4.2. La réponse keynésienne à la crise de 1929
4.2.1. John Maynard Keynes et l’interventionnisme étatique
La théorie de Keynes constitue une révolution intellectuelle en réfutant la loi de Say. Face à la crise, il démontre que l’économie peut être durablement en équilibre de sous-emploi et préconise une intervention active de l’État via la politique budgétaire et monétaire pour relancer la demande globale.
4.2.2. William Beveridge et la naissance de l’État-providence
Le rapport Beveridge est présenté comme la traduction politique des idées keynésiennes. Il fournit le plan de construction de l’État-providence, un système de sécurité sociale généralisé visant à protéger les citoyens contre les grands risques de la vie (maladie, chômage, vieillesse).
4.3. Le Néo-libéralisme et le capitalisme contemporain
4.3.1. Les théoriciens du capitalisme moderne (Schumpeter, Perroux)
Sont étudiées les analyses qui enrichissent la compréhension du capitalisme. Joseph Schumpeter introduit le rôle central de l’entrepreneur-innovateur et le concept de « destruction créatrice » comme moteur du dynamisme capitaliste. François Perroux analyse les effets de domination et les déséquilibres structurels de l’économie.
4.3.2. Les courants contemporains (École de Chicago)
Le néo-libéralisme, incarné par l’École de Chicago (Milton Friedman, Friedrich Hayek), est analysé comme une critique radicale de l’interventionnisme keynésien. Il prône un retour aux principes du marché, la déréglementation, la privatisation et une politique monétaire stricte pour lutter contre l’inflation.
TROISIÈME PARTIE : LES SOCIALISMES : DE L’IDÉALISME AU COMMUNISME
Cette partie se penche sur la famille des doctrines socialistes, apparues comme une réponse critique aux conséquences sociales de la révolution industrielle. L’exploration va des premiers projets de société idéale à la construction théorique rigoureuse du marxisme, pour finir sur ses applications politiques qui ont marqué le XXe siècle.
CHAPITRE 5 : LE SOCIALISME PRÉ-MARXISTE (OU UTOPISQUE) 🌈
5.1. Origines et caractéristiques du premier socialisme
Ce courant est caractérisé par sa critique morale des inégalités et de l’exploitation générées par le capitalisme naissant. Il se distingue par sa volonté de proposer des modèles de société alternative fondés sur la coopération, l’association et la planification rationnelle, souvent sans une analyse profonde des mécanismes du pouvoir.
5.2. Les figures de l’idéalisme social
5.2.1. Henri de Saint-Simon et l’industrialisme
Saint-Simon propose une société réorganisée non par des nobles ou des juristes, mais par une élite de « producteurs » (savants, industriels, ingénieurs) qui planifieraient l’économie au service de l’amélioration du sort de la classe la plus pauvre.
5.2.2. Charles Fourier et le Phalanstère
Fourier imagine une société idéale composée de « phalanstères », des communautés de vie et de travail où les individus s’associeraient librement en fonction de leurs passions, transformant le travail en une activité plaisante et harmonieuse.
5.2.3. Robert Owen et le socialisme associationniste
Industriel philanthrope, Robert Owen met en pratique ses idées en améliorant les conditions de vie et de travail dans ses usines et en tentant de créer des communautés coopératives autonomes, fondées sur l’éducation et l’absence de propriété privée.
5.2.4. Louis Blanc et l’organisation du travail
Journaliste et homme politique, Louis Blanc promeut le « droit au travail » et propose la création d’ « ateliers sociaux », des coopératives de production financées par l’État pour concurrencer puis remplacer l’entreprise capitaliste.
CHAPITRE 6 : LE SOCIALISME SCIENTIFIQUE : LE MARXISME 🔬
6.1. Les fondements intellectuels du marxisme
6.1.1. L’influence de la philosophie allemande (Hegel, Feuerbach)
L’étude montre comment Marx a « remis sur ses pieds » la dialectique de Hegel (passant de l’Idée à la Matière) et a repris le matérialisme de Feuerbach tout en lui reprochant son manque de dimension historique et pratique, pour forger sa propre philosophie.
6.2. Karl Marx et Friedrich Engels : les concepts centraux
6.2.1. Le matérialisme dialectique et historique
Le matérialisme historique est présenté comme la clé de voûte de la pensée marxiste : ce sont les conditions matérielles de production (l’infrastructure économique) qui déterminent en dernière instance les formes politiques, juridiques et idéologiques (la superstructure) d’une société. L’histoire évolue par la contradiction dialectique entre forces productives et rapports de production.
6.2.2. La théorie de la lutte des classes
Pour Marx, l’histoire de toute société est l’histoire de la lutte des classes. Dans le mode de production capitaliste, cette lutte oppose la bourgeoisie, qui détient les moyens de production, et le prolétariat, qui ne possède que sa force de travail. Cette lutte est le moteur qui doit conduire à la révolution.
6.2.3. L’analyse du capitalisme et la théorie de la plus-value
L’analyse de Marx vise à dévoiler le mécanisme d’exploitation au cœur du capitalisme. La théorie de la plus-value (ou plus-value) explique que le profit du capitaliste provient de la différence entre la valeur créée par le travail de l’ouvrier et le salaire qu’il reçoit, qui ne correspond qu’au coût de reproduction de sa force de travail.
CHAPITRE 7 : LE COMMUNISME COMME APPLICATION POLITIQUE DU MARXISME ✊
7.1. Le marxisme-léninisme
7.1.1. Lénine et la théorie de l’avant-garde révolutionnaire
Lénine adapte le marxisme aux conditions de la Russie du début du XXe siècle. Sa contribution majeure est la théorie du parti d’avant-garde : le prolétariat, seul, ne peut atteindre qu’une conscience syndicale ; il a besoin d’un parti de révolutionnaires professionnels pour le guider vers la prise du pouvoir.
7.2. Les variantes et dissidences du communisme au XXe siècle
7.2.1. Joseph Staline et le totalitarisme soviétique
Le stalinisme est analysé comme une déviation totalitaire du projet communiste, caractérisée par la concentration absolue du pouvoir, le culte de la personnalité, la planification économique ultra-centralisée et l’usage de la terreur de masse pour éliminer toute opposition.
7.2.2. Léon Trotski et la « révolution permanente »
La pensée de Trotski s’oppose à celle de Staline sur la question de la stratégie révolutionnaire. Il défend la « révolution permanente », l’idée que la révolution socialiste ne peut survivre dans un seul pays et doit s’étendre à l’échelle mondiale pour réussir.
7.2.3. Mao Tsé-Toung et l’adaptation du communisme au contexte chinois
Le maoïsme est présenté comme une adaptation du marxisme-léninisme à une société majoritairement paysanne. Mao Tsé-Toung place la paysannerie au centre de la stratégie révolutionnaire et développe des concepts propres comme la « guerre populaire prolongée ».
QUATRIÈME PARTIE : LA DOCTRINE SOCIALE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE
Cette partie est dédiée à l’analyse du corpus d’enseignement de l’Église catholique sur les questions sociales. Elle expose les principes éthiques qui structurent cette pensée et retrace son évolution historique à travers l’étude de ses textes magistériels les plus importants, montrant comment elle cherche à offrir une voie alternative aux idéologies libérales et socialistes.
CHAPITRE 8 : FONDEMENTS ET PRINCIPES ✝️
8.1. Sources et nature de l’enseignement social de l’Église
Les sources de cette doctrine sont la Révélation (Bible), la Tradition de l’Église et la loi naturelle accessible par la raison. Sa nature n’est pas celle d’une idéologie politique, mais d’une doctrine morale qui vise à éclairer les consciences et à proposer des orientations pour l’action des chrétiens dans la société.
8.2. Les principes cardinaux
8.2.1. La dignité inaliénable de la personne humaine
Ce principe est le fondement absolu de toute la doctrine. Chaque être humain, créé à l’image de Dieu, possède une dignité intrinsèque qui doit être respectée et promue, de sa conception à sa mort naturelle. Toute organisation sociale doit être jugée à l’aune de ce respect.
8.2.2. Le principe du bien commun
Le bien commun est défini comme l’ensemble des conditions sociales qui permettent aux personnes et aux groupes d’atteindre leur plein épanouissement. Il n’est pas la simple somme des biens individuels, mais un bien de tous et pour tous, qui exige l’engagement de chacun.
8.2.3. Le principe de subsidiarité
Ce principe stipule qu’une instance sociale d’un niveau supérieur ne doit pas se substituer à une instance de niveau inférieur (une commune, une association, une famille) dans les tâches que celle-ci est capable d’accomplir par elle-même. Il vise à protéger l’autonomie et l’initiative des corps intermédiaires.
8.2.4. Le principe de solidarité
La solidarité est la reconnaissance de l’interdépendance de tous les êtres humains. Elle se traduit par une détermination ferme et persévérante à travailler pour le bien commun, en particulier pour le bien des plus pauvres, non par pitié, mais par conviction de la responsabilité de tous envers tous.
CHAPITRE 9 : LES GRANDES ÉTAPES DE L’ENSEIGNEMENT SOCIAL PONTIFICAL 📜
9.1. La réponse à la « question ouvrière » : Rerum Novarum (Léon XIII, 1891)
Cette encyclique est considérée comme le texte fondateur de la doctrine sociale moderne. Elle condamne les excès du capitalisme libéral (la misère ouvrière) et le socialisme (le rejet de la propriété privée), et préconise des solutions comme le juste salaire, le droit d’association pour les travailleurs et l’intervention de l’État pour protéger les plus faibles.
9.2. La consolidation de la doctrine : Quadragesimo Anno (Pie XI, 1931)
Quarante ans après, cette encyclique réaffirme les principes de Rerum Novarum dans le contexte de la crise de 1929 et de la montée des totalitarismes. Elle développe le principe de subsidiarité et propose un modèle d’organisation sociale basé sur des corps professionnels intermédiaires (corporatisme).
9.3. L’ouverture aux questions du développement et de la mondialisation
9.3.1. De Mater et Magistra (Jean XXIII) à Populorum Progressio (Paul VI)
Ces encycliques marquent un élargissement de la perspective. La « question sociale » n’est plus seulement celle des ouvriers en Europe, mais celle des inégalités entre pays riches et pays pauvres. Populorum Progressio affirme avec force que « le développement est le nouveau nom de la paix ».
9.3.2. Les apports de Jean-Paul II (Laborem Exercens, Centesimus Annus)
Jean-Paul II propose une profonde réflexion sur la dignité du travail humain (Laborem Exercens). Dans Centesimus Annus, publiée après la chute du mur de Berlin, il analyse les causes de l’effondrement du communisme, met en garde contre les dérives d’un capitalisme sans âme et réaffirme la pertinence de la doctrine sociale de l’Église.
CINQUIÈME PARTIE : PENSÉES SOCIALES EN AFRIQUE ET EN R.D. CONGO
Cette partie finale ancre la réflexion dans le contexte spécifique du continent africain et de la République Démocratique du Congo. Elle explore les doctrines et idéologies qui ont émergé de l’expérience postcoloniale, cherchant à construire des projets de société originaux en réponse aux défis locaux et à l’héritage historique.
CHAPITRE 10 : LES SOCIALISMES AFRICAINS ET LA QUÊTE D’UNE VOIE PROPRE 🌍
10.1. Le socialisme de Léopold Sédar Senghor et la Négritude
Le socialisme senghorien est analysé comme une tentative de synthétiser les apports du socialisme démocratique européen, les valeurs de la Négritude (l’ensemble des valeurs culturelles du monde noir) et une dimension humaniste, visant une voie de développement spécifiquement africaine.
10.2. Le socialisme communautaire (Ujamaa) de Julius Nyerere en Tanzanie
L’ Ujamaa (terme swahili pour « esprit de famille ») est présenté comme une doctrine visant à construire le socialisme en s’appuyant sur les valeurs communautaires traditionnelles africaines. L’étude portera sur sa mise en œuvre à travers la politique de « villagisation » et ses résultats mitigés.
10.3. Le « Harambee » de Jomo Kenyatta au Kenya
Le Harambee (terme swahili pour « tirer tous ensemble ») est moins une doctrine socialiste qu’une idéologie développementiste. Elle exalte l’unité nationale, l’effort collectif et l’auto-assistance communautaire comme moteurs du développement, dans un cadre économique qui reste largement capitaliste.
10.4. Le Panafricanisme comme doctrine politique et sociale (Kwame Nkrumah)
Le panafricanisme, porté par des figures comme Kwame Nkrumah, est étudié comme une doctrine politique qui considère l’unification politique et économique du continent africain comme la condition indispensable pour achever la décolonisation, résister au néocolonialisme et assurer un développement social souverain.
CHAPITRE 11 : IDÉOLOGIES POLITIQUES ET SOCIALES EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 🇨🇩
11.1. Le nationalisme congolais à l’aube de l’indépendance
Ce point examine les différentes facettes du nationalisme qui ont mené à l’indépendance en 1960. Il met en lumière la diversité des projets de société, en contrastant notamment le nationalisme unitaire et panafricaniste de Patrice Lumumba avec des visions plus fédéralistes ou ethniquement ancrées d’autres leaders politiques.
11.2. Le Mobutisme comme doctrine d’État
11.2.1. Le Manifeste de la N’sele
Le Manifeste de la N’sele est analysé comme le texte fondateur de l’idéologie du Mouvement Populaire de la Révolution (MPR), instaurant le parti unique. Il expose un programme de nationalisme économique et de centralisation politique radicale, qui a structuré l’État zaïrois pendant des décennies.
11.2.2. Le Recours à l’Authenticité et ses implications sociales
L’Authenticité est étudiée comme une politique culturelle et une doctrine sociale visant à « décoloniser les mentalités » en rejetant les noms, les vêtements et les modes de pensée occidentaux au profit de valeurs « authentiquement » zaïroises. L’analyse portera sur ses effets sociaux, culturels et son utilisation comme instrument de légitimation et de contrôle du pouvoir.
ANNEXES 🗂️
Les annexes sont conçues comme des outils de référence pour renforcer et approfondir les connaissances acquises.
- Glossaire des termes et concepts clés : Ce lexique fournit des définitions claires et concises des termes techniques et des concepts fondamentaux abordés dans le cours, assurant une maîtrise précise du vocabulaire.
- Tableau chronologique des auteurs et des doctrines : Cet outil visuel permet de situer les penseurs et les mouvements étudiés dans leur contexte historique, facilitant la compréhension des filiations, des influences et des ruptures intellectuelles.
- Bibliographie indicative : Cette sélection d’ouvrages et de textes de référence offre des pistes pour les élèves et les enseignants désireux d’approfondir certains sujets, encourageant ainsi la curiosité intellectuelle et la recherche personnelle.