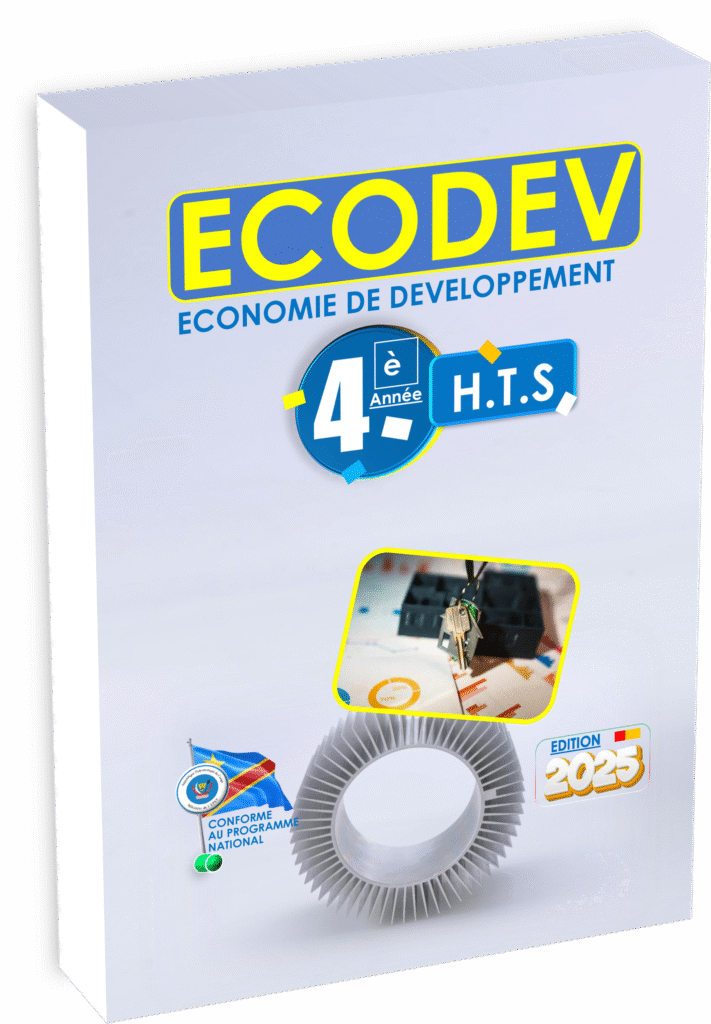
Cliquez pour lire
PRÉLIMINAIRES
1. Avant-propos ✍️
Ce manuel est conçu comme un outil didactique destiné aux futurs techniciens sociaux de la République Démocratique du Congo. Son ambition est de traduire les directives du programme national en un support pédagogique qui éclaire les mécanismes économiques fondamentaux et leurs implications directes sur le développement social. Loin de se limiter à une exposition théorique, il vise à équiper l’élève d’une grille d’analyse pertinente pour comprendre les défis socio-économiques congolais et pour envisager des solutions adaptées au terrain.
2. Objectifs généraux du cours 🎯
Au terme de cette formation, l’élève devra manifester une maîtrise des compétences suivantes :
- Identifier et définir les concepts de base de la science économique, en distinguant rigoureusement la croissance du développement.
- Analyser les facteurs matériels et immatériels qui conditionnent le développement d’une nation, tels que la démographie, le capital et la technologie.
- Évaluer de manière critique les différentes théories et stratégies de développement, en les rapportant aux contextes historiques et géographiques qui les ont vues naître.
- Appliquer l’ensemble de ces connaissances théoriques à l’étude de cas spécifique de l’économie de la République Démocratique du Congo, en identifiant ses blocages et ses potentialités.
3. Mode d’emploi du manuel 📖
La structure de cet ouvrage a été pensée pour faciliter un apprentissage progressif et cohérent. Chaque partie débute par une introduction qui en présente les enjeux et les objectifs spécifiques. Les chapitres sont organisés de manière logique, allant des notions générales aux cas particuliers. Des exemples concrets, puisés dans la réalité des différentes provinces de la RDC, de l’agro-industrie du Kongo Central aux défis miniers du Haut-Katanga, viennent systématiquement illustrer les concepts. Des exercices récapitulatifs à la fin de chaque chapitre permettront à l’élève de tester sa compréhension et de consolider ses acquis.
PREMIÈRE PARTIE : INTRODUCTION GÉNÉRALE À LA SCIENCE ÉCONOMIQUE ET AU DÉVELOPPEMENT
Chapitre 1 : Notions Générales sur la Science Économique
1.1. Définitions de l’économie
L’économie est la science sociale qui étudie la manière dont les individus et les sociétés allouent des ressources rares à la satisfaction de besoins illimités. Elle analyse les choix relatifs à la production, la distribution et la consommation des biens et services.
1.2. Objet de la science économique
Son objet fondamental est de résoudre le problème de la rareté. La science économique cherche à comprendre et à optimiser les mécanismes par lesquels une société parvient à concilier des désirs infinis avec des moyens de production finis pour atteindre le plus haut niveau de bien-être possible.
1.3. Les divisions de la science économique
1.3.1. L’économie politique et l’économie sociale
L’économie politique étudie les lois générales de la production et de la répartition des richesses au niveau de la nation. L’économie sociale, quant à elle, se concentre sur les problématiques liées au bien-être collectif, à la justice sociale et à la réduction des inégalités, intégrant des dimensions éthiques et politiques.
1.3.2. La microéconomie et la macroéconomie
La microéconomie analyse le comportement des agents économiques individuels (ménages, entreprises) et leurs interactions sur des marchés spécifiques. La macroéconomie étudie l’économie dans sa globalité, à travers des agrégats tels que le Produit Intérieur Brut (PIB), l’inflation ou le chômage.
1.3.3. L’économie pure, l’économie descriptive et l’économie appliquée
L’économie pure ou théorique développe des modèles abstraits pour expliquer les phénomènes économiques. L’économie descriptive collecte et présente des données factuelles sur une économie donnée. L’économie appliquée utilise les outils de la théorie et les données de la description pour résoudre des problèmes concrets.
1.4. Les méthodes de la science économique
1.4.1. La méthode déductive
Cette approche part de principes généraux ou d’hypothèses (axiomes) pour en déduire logiquement des conclusions spécifiques. Elle raisonne du général au particulier.
1.4.2. La méthode inductive
À l’inverse, cette méthode part de l’observation de faits particuliers et répétés pour en tirer des lois ou des principes généraux. Elle raisonne du particulier au général.
Chapitre 2 : Les Concepts Économiques Fondamentaux
2.1. Les besoins humains
2.1.1. Définition et caractères
Un besoin est un sentiment de manque qui pousse un individu à agir pour le combler. Les besoins économiques sont caractérisés par leur multiplicité, leur satiabilité (un besoin peut être satisfait à un moment donné) et leur interdépendance.
2.1.2. Classification des besoins (Pyramide de Maslow)
Abraham Maslow hiérarchise les besoins en cinq niveaux, des plus fondamentaux aux plus élevés : physiologiques (faim, soif), de sécurité (logement, emploi), d’appartenance (famille, amis), d’estime (reconnaissance) et d’accomplissement de soi.
2.2. Les biens économiques
2.2.1. Définition et caractères
Un bien est tout ce qui peut satisfaire un besoin. Un bien est dit économique lorsqu’il est utile, disponible et rare, ce qui implique un coût pour l’obtenir.
2.2.2. Classification des biens (matériels/immatériels, de consommation/de production)
Les biens matériels sont tangibles (un sac de maïs de Kasai), tandis que les biens immatériels (ou services) sont intangibles (une consultation médicale à Mbuji-Mayi). Les biens de consommation satisfont directement un besoin (un pain), tandis que les biens de production servent à produire d’autres biens (un four de boulanger).
2.3. La valeur et l’utilité
2.3.1. La notion d’utilité économique
L’utilité désigne la capacité d’un bien à satisfaire un besoin. C’est une notion subjective qui varie d’un individu à l’autre et dans le temps.
2.3.2. La théorie de la valeur (valeur d’usage et valeur d’échange)
La valeur d’usage correspond à l’utilité d’un bien pour un individu. La valeur d’échange représente la quantité d’autres biens qu’un bien permet d’obtenir sur un marché ; elle est généralement exprimée par son prix.
2.4. Le circuit économique
2.4.1. Les agents économiques (ménages, entreprises, État, reste du monde)
Le circuit économique schématise les interactions entre les principaux acteurs : les ménages (consomment et fournissent le travail), les entreprises (produisent), l’État (régule et redistribue) et le reste du monde (échanges internationaux).
2.4.2. Les flux économiques (réels et monétaires)
Entre ces agents circulent des flux réels (biens, services, travail) et des flux monétaires (salaires, paiements, impôts) qui sont la contrepartie des flux réels.
Chapitre 3 : Croissance, Développement et Sous-développement
3.1. La croissance économique
3.1.1. Définition et caractéristiques
La croissance est l’augmentation soutenue, sur une longue période, de la production de biens et de services dans un pays. C’est un phénomène quantitatif et réversible.
3.1.2. Les indicateurs de mesure (PIB, PNB, Taux de croissance)
Elle se mesure principalement par l’évolution du Produit Intérieur Brut (PIB), qui est la somme des valeurs ajoutées réalisées à l’intérieur d’un territoire, et du Produit National Brut (PNB), qui inclut les revenus des nationaux à l’étranger.
3.2. Le développement
3.2.1. Définition et dimensions (économique, sociale, culturelle, politique)
Le développement est un processus multidimensionnel de transformation des structures économiques, sociales, mentales et politiques. Il implique non seulement la croissance, mais aussi l’amélioration du bien-être de la population (santé, éducation, libertés).
3.2.2. Les indicateurs de mesure (IDH, IPH)
L’Indicateur de Développement Humain (IDH) est un indice composite qui mesure le niveau de développement en combinant l’espérance de vie, le niveau d’éducation et le revenu par habitant. L’IPH mesure les privations dans ces mêmes domaines.
3.3. La distinction entre croissance et développement
La croissance économique est une condition nécessaire mais non suffisante au développement. Il peut y avoir croissance sans développement si les fruits de cette croissance ne sont pas équitablement répartis et ne servent pas à améliorer la qualité de vie de la majorité.
3.4. Le sous-développement
3.4.1. Définitions et caractéristiques
Le sous-développement est un état structurel caractérisé par de faibles revenus, de fortes inégalités, une grande pauvreté, une dépendance économique et technologique, et une faible industrialisation.
3.4.2. Les indicateurs du sous-développement
Il est identifié par des indicateurs tels qu’un faible PIB par habitant, un IDH bas, un fort taux d’analphabétisme, une faible espérance de vie et une forte dépendance aux exportations de matières premières.
DEUXIÈME PARTIE : LES FACTEURS DE DÉVELOPPEMENT
Chapitre 4 : Le Facteur Démographique (La Population) 👨👩👧👦
4.1. Concepts de base de la démographie
4.1.1. Natalité, mortalité, fécondité, espérance de vie
Ces indicateurs décrivent la dynamique d’une population : la natalité (naissances), la mortalité (décès), la fécondité (nombre moyen d’enfants par femme) et l’espérance de vie (durée de vie moyenne).
4.1.2. Structure de la population (par âge et par sexe)
La pyramide des âges représente la répartition de la population par sexe et par âge. Une base large, typique de la RDC, indique une population jeune, source potentielle de dynamisme mais aussi un défi en matière d’éducation et d’emploi.
4.2. Population et développement
4.2.1. La population comme facteur de production (main-d’œuvre)
Une population active, nombreuse et bien formée constitue une ressource essentielle pour la production économique.
4.2.2. La population comme marché de consommation
Une population importante représente également un vaste marché intérieur potentiel, capable de stimuler la production locale.
4.3. Les théories démographiques (Malthus, transition démographique)
La théorie de Malthus postule que la population croît plus vite que les ressources, menant à la misère. La théorie de la transition démographique décrit le passage d’un régime de forte natalité et mortalité à un régime de faible natalité et mortalité, caractéristique du développement.
4.4. Les politiques démographiques
Elles regroupent les mesures prises par un État pour influencer la dynamique de sa population, comme les politiques de santé publique pour réduire la mortalité infantile ou les programmes d’éducation pour l’autonomisation des femmes.
Chapitre 5 : Le Facteur Capital 💰
5.1. Définition et formes du capital
5.1.1. Le capital technique (fixe et circulant)
Le capital technique regroupe les biens de production. Le capital fixe est durable (bâtiments, machines d’une usine textile à Kisangani), tandis que le capital circulant est transformé ou détruit durant le processus de production (coton, énergie).
5.1.2. Le capital financier
Il s’agit des ressources monétaires (liquidités, crédits) nécessaires pour acquérir le capital technique et financer l’activité économique.
5.1.3. Le capital humain (éducation, santé)
Le capital humain représente l’ensemble des compétences, des connaissances et de l’état de santé des individus, qui déterminent leur productivité. Investir dans l’éducation et la santé est donc un levier de développement crucial.
5.2. L’accumulation du capital : l’investissement
5.2.1. Définition et types d’investissement
L’investissement est l’acte d’acquérir de nouveaux biens de production pour augmenter ou maintenir le stock de capital. Il peut être matériel (achat de machines) ou immatériel (recherche et développement).
5.2.2. Le rôle de l’épargne dans l’investissement
L’épargne, qui est la part du revenu non consommée, constitue la principale source de financement de l’investissement. Sans épargne, il n’y a pas d’investissement durable.
5.3. Le financement du développement
5.3.1. Le financement interne (épargne nationale, recettes publiques)
Le développement peut être financé par des ressources nationales : l’épargne des ménages et des entreprises, ainsi que les recettes de l’État (impôts, taxes douanières).
5.3.2. Le financement externe (aide publique au développement, investissements directs étrangers, dette)
Il provient de l’extérieur sous forme d’aide publique (dons, prêts concessionnels), d’investissements directs étrangers (IDE), comme dans le secteur des télécommunications à Kinshasa, ou d’emprunts sur les marchés financiers (dette extérieure).
Chapitre 6 : Les Ressources Naturelles et la Technologie 🌍
6.1. Rôle des ressources naturelles dans le développement
6.1.1. Typologie des ressources naturelles
Elles peuvent être renouvelables (forêts du bassin du Congo, potentiel hydroélectrique d’Inga) ou non renouvelables (minerais du Kivu, pétrole de la côte atlantique).
6.1.2. La « malédiction » des ressources naturelles
Ce paradoxe décrit la situation où des pays riches en ressources naturelles connaissent une croissance plus faible et une gouvernance de moindre qualité que des pays moins dotés, souvent à cause de la corruption et des conflits.
6.1.3. La gestion durable des ressources naturelles
Elle implique une exploitation qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs, en intégrant les dimensions environnementales et sociales.
6.2. Le progrès technique et l’innovation
6.2.1. Définition et formes du progrès technique
Le progrès technique désigne l’ensemble des innovations qui améliorent l’efficacité du processus de production, permettant de produire plus ou mieux avec la même quantité de facteurs.
6.2.2. Le rôle du progrès technique dans la production
Il est un moteur essentiel de la croissance à long terme en générant des gains de productivité.
6.2.3. Le transfert de technologie
Pour les pays en développement, l’acquisition de technologies développées à l’étranger est une voie rapide pour moderniser l’appareil de production, bien qu’elle pose des défis d’adaptation et de coût.
TROISIÈME PARTIE : LES THÉORIES ET STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT
Chapitre 7 : Les Théories du Développement 🧠
7.1. Les théories classiques et néoclassiques (Smith, Ricardo)
Ces théories mettent l’accent sur le libre-échange, la spécialisation selon les avantages comparatifs et l’accumulation du capital comme moteurs de la croissance pour toutes les nations.
7.2. La théorie des étapes de la croissance de Rostow
W.W. Rostow propose un modèle linéaire selon lequel toute société passe par cinq étapes pour atteindre le développement : la société traditionnelle, les conditions préalables au décollage, le décollage (take-off), la marche vers la maturité et l’ère de la consommation de masse.
7.3. Les théories structuralistes (modèle centre-périphérie)
Ces théories, développées notamment par Raúl Prebisch, soutiennent que la structure de l’économie mondiale, divisée entre un « centre » industrialisé et une « périphérie » exportatrice de matières premières, est intrinsèquement inégale et freine le développement de la périphérie.
7.4. Les théories de la dépendance (Samir Amin)
Poussant plus loin l’analyse structuraliste, ces théories affirment que le sous-développement n’est pas un retard, mais le résultat d’un processus historique d’intégration inégale dans le système capitaliste mondial qui maintient activement la périphérie dans un état de dépendance.
7.5. Les approches alternatives : le développement humain et le développement durable
Le développement humain (Amartya Sen) recentre l’objectif sur l’expansion des « capacités » des individus (vivre longtemps et en bonne santé, être éduqué, etc.). Le développement durable y ajoute une dimension environnementale, prônant un modèle qui préserve la planète pour les générations futures.
Chapitre 8 : Les Stratégies de Développement 🗺️
8.1. Les stratégies basées sur l’industrialisation
8.1.1. L’industrialisation par substitution d’importations (ISI)
Cette stratégie vise à développer une industrie nationale en protégeant le marché intérieur de la concurrence étrangère par des barrières douanières, afin de produire localement ce qui était auparavant importé.
8.1.2. L’industrialisation par promotion des exportations (IPE)
Cette approche consiste à encourager les industries nationales à devenir compétitives sur les marchés mondiaux et à orienter leur production vers l’exportation.
8.2. Les stratégies basées sur l’agriculture (développement rural)
Elles donnent la priorité à la modernisation du secteur agricole pour atteindre l’autosuffisance alimentaire, augmenter les revenus des paysans et créer une base pour l’industrialisation. Le développement des parcs agro-industriels en RDC, comme celui de Bukanga-Lonzo, s’inscrit dans cette logique.
8.3. Les stratégies de développement axées sur les besoins essentiels
Cette approche pragmatique se concentre sur la satisfaction des besoins fondamentaux de la population : alimentation, logement, santé, éducation et accès à l’eau potable, comme objectif prioritaire de toute politique de développement.
8.4. Le rôle de l’État et du marché dans le développement
Ce point explore le débat continu entre les partisans d’une intervention forte de l’État pour planifier et orienter l’économie, et ceux qui favorisent la libéralisation et la confiance dans les mécanismes du marché pour allouer les ressources efficacement.
8.5. La planification du développement
La planification est un outil par lequel l’État fixe des objectifs de développement à moyen et long terme et coordonne les actions nécessaires pour les atteindre, en orientant les investissements publics et en incitant le secteur privé.
QUATRIÈME PARTIE : L’ÉCONOMIE DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Chapitre 9 : Structure de l’Économie Congolaise 🇨🇩
9.1. Aperçu historique de l’économie congolaise
L’analyse retrace les grandes phases de l’économie du pays, depuis l’économie de traite coloniale, en passant par la politique de « zaïrianisation » jusqu’aux ajustements structurels et à l’économie actuelle, marquée par le secteur minier.
9.2. Les principaux secteurs d’activité
9.2.1. Le secteur primaire (agriculture, mines)
Ce secteur domine l’économie et l’emploi, mais de manière duale : un secteur minier extraverti et à forte intensité capitalistique (cuivre, cobalt) coexiste avec une agriculture de subsistance largement majoritaire et peu productive.
9.2.2. Le secteur secondaire (industrie, construction)
Le secteur industriel reste embryonnaire et peu diversifié, principalement concentré sur la transformation de quelques produits locaux (brasseries, cimenteries) et souffrant d’un déficit énergétique et d’infrastructures.
9.2.3. Le secteur tertiaire (services, commerce, transport)
Ce secteur est en pleine expansion mais largement dominé par le commerce informel. Les services formels comme la banque et les télécommunications connaissent un essor notable mais restent concentrés dans les grands centres urbains.
9.3. Les atouts et les faiblesses structurelles de l’économie congolaise
Les atouts sont immenses : ressources naturelles abondantes, potentiel agricole et hydroélectrique exceptionnel, population jeune et vaste marché intérieur. Les faiblesses sont tout aussi importantes : faible diversification, extraversion, infrastructures défaillantes, et forte dépendance du secteur informel.
Chapitre 10 : Les Obstacles au Développement de la RDC
10.1. Les obstacles d’ordre économique (dépendance extérieure, faible diversification)
L’économie congolaise est extrêmement vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux des matières premières. Le manque de diversification la rend peu résiliente aux chocs externes.
10.2. Les obstacles d’ordre institutionnel et politique (gouvernance, corruption)
La faiblesse de l’État de droit, la corruption endémique et l’instabilité politique persistante découragent l’investissement productif et entravent une gestion efficace des ressources publiques.
10.3. Les obstacles d’ordre social et démographique
Malgré ses richesses, le pays fait face à une pauvreté de masse, de profondes inégalités, et des indicateurs de santé et d’éducation parmi les plus bas du monde. La forte croissance démographique constitue un défi majeur pour la fourniture de services sociaux de base.
10.4. La problématique de la dette extérieure
Bien qu’ayant bénéficié d’allègements, le poids de la dette extérieure continue de limiter la marge de manœuvre budgétaire de l’État pour financer les investissements de développement.
Chapitre 11 : Perspectives et Stratégies de Développement pour la RDC
11.1. La diversification de l’économie comme impératif
La réduction de la dépendance au secteur minier est la priorité stratégique. Cela passe par le développement de chaînes de valeur locales, notamment dans l’agriculture et l’industrie légère.
11.2. La promotion du secteur agricole
Valoriser l’immense potentiel agricole du pays est la clé pour assurer la sécurité alimentaire, créer des millions d’emplois et réduire la pauvreté en milieu rural, des plaines de la Ruzizi aux plateaux du Kwango.
11.3. La valorisation du capital humain (éducation et santé)
Aucun développement durable n’est possible sans un investissement massif dans l’éducation pour former une main-d’œuvre qualifiée et dans la santé pour garantir le bien-être et la productivité de la population.
11.4. L’amélioration du climat des affaires et la bonne gouvernance
Instaurer un cadre légal et réglementaire stable, lutter contre la corruption et garantir la sécurité des investissements sont des conditions indispensables pour attirer les capitaux privés nationaux et étrangers.
11.5. Les documents de planification stratégique en RDC (DSCRP, PNDS)
L’étude de ces documents, tels que le Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCRP) et le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS), permet de comprendre la vision et les axes prioritaires définis par l’État congolais pour son développement.
ANNEXES
1. Glossaire des termes économiques 🗂️
Cette section fournit des définitions claires et concises des concepts techniques utilisés tout au long du manuel. Son objectif est de garantir une compréhension précise du vocabulaire économique et d’éviter toute ambiguïté, constituant un référentiel essentiel pour l’élève.
2. Tableaux des principaux indicateurs économiques et sociaux de la RDC 📊
Ces tableaux rassemblent des données statistiques récentes et fiables (PIB, IDH, taux de pauvreté, etc.) spécifiques à la RDC. Ils servent de base factuelle pour l’analyse et permettent aux élèves d’appliquer les concepts théoriques à des données concrètes et actualisées, ancrant l’apprentissage dans la réalité du pays.
3. Bibliographie indicative 📚
Cette liste propose une sélection d’ouvrages, de rapports et d’articles pertinents pour ceux qui souhaitent approfondir les sujets abordés. Elle constitue une porte d’entrée vers une recherche plus autonome et une exploration plus poussée des sciences économiques et des enjeux du développement.