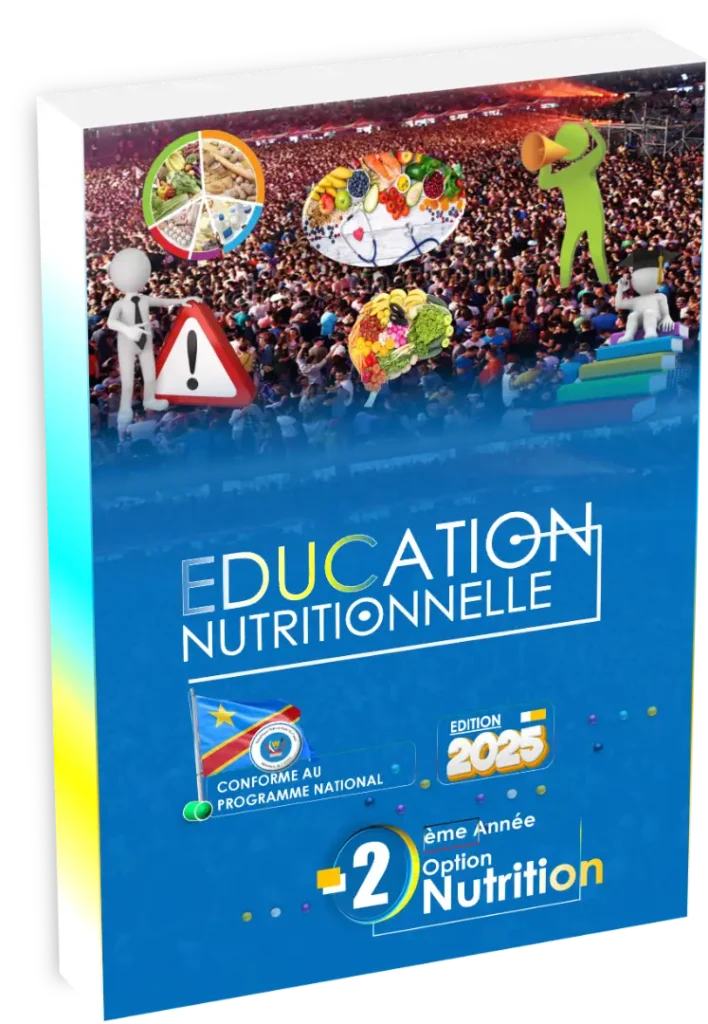
..
ÉDUCATION NUTRITIONNELLE, 2ÈME ANNÉE, OPTION NUTRITION
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
PRÉLIMINAIRES
1. Objectifs Généraux du Cours
Ce cours vise à former des techniciens en nutrition capables de traduire leur savoir scientifique en changements de comportements concrets et durables au sein des communautés. L’objectif principal est de maîtriser les principes et les techniques de la communication et de l’éducation pour la santé afin de promouvoir de bonnes pratiques alimentaires et d’hygiène. Il s’agit de passer du savoir-faire technique au savoir-faire pédagogique, en rendant l’élève apte à concevoir, animer et évaluer des interventions nutritionnelles efficaces et culturellement adaptées au contexte congolais. 🗣️
2. Compétences Visées
À l’issue de cette formation, l’élève devra être en mesure de :
- Analyser les déterminants socio-culturels et économiques des comportements alimentaires d’une communauté cible.
- Planifier une séance d’éducation nutritionnelle en définissant des objectifs clairs, en choisissant une méthodologie appropriée et en développant des messages pertinents.
- Animer une session éducative (causerie, démonstration culinaire) en utilisant des techniques participatives pour favoriser l’apprentissage et l’engagement de l’audience.
- Créer des supports didactiques simples et efficaces (boîte à images, affiches) adaptés au niveau de littératie du public.
- Évaluer l’efficacité d’une intervention éducative en mesurant les changements au niveau des connaissances, des attitudes et des pratiques.
3. Approche Pédagogique
La démarche pédagogique privilégie l’apprentissage par l’action et la simulation. Les exposés théoriques seront systématiquement complétés par des mises en situation, des jeux de rôle et des études de cas basées sur des problématiques réelles de la RDC (promotion de l’allaitement maternel exclusif à Kinshasa, lutte contre les anémies nutritionnelles dans le Haut-Katanga, revalorisation des légumes-feuilles locaux dans le Kasaï). Les élèves travailleront en groupe pour concevoir et présenter des mini-projets d’éducation nutritionnelle, favorisant ainsi le développement de leurs compétences en communication et en travail d’équipe. 🤝
4. Modalités d’Évaluation
L’évaluation sera conçue pour mesurer les compétences pratiques autant que les connaissances théoriques. Elle inclura :
- Des interrogations écrites portant sur les concepts fondamentaux de la communication et de la pédagogie.
- La conception d’un support didactique (par exemple, une série d’images pour une boîte à images sur l’alimentation de complément).
- La préparation et l’animation d’une causerie de 15 minutes devant la classe, qui sera évaluée sur la clarté du message, la qualité de l’animation et la pertinence des réponses aux questions.
- Un rapport d’analyse d’une problématique nutritionnelle locale proposant une stratégie d’éducation adaptée.
PARTIE I : FONDEMENTS DE LA COMMUNICATION ET DE L’ÉDUCATION POUR LA SANTÉ 💬
Cette partie initiale pose les bases théoriques indispensables pour comprendre ce qu’est l’éducation nutritionnelle. Elle va au-delà de la simple transmission d’informations pour explorer les mécanismes de la communication humaine, les théories de l’apprentissage et les facteurs qui influencent les changements de comportement. L’élève apprendra ici pourquoi « dire » ne suffit pas et comment « faire » pour que les messages soient compris, acceptés et appliqués.
Chapitre 1 : Introduction à l’Éducation Nutritionnelle
Ce chapitre définit le champ d’action et les concepts clés, en positionnant l’éducation nutritionnelle comme une composante essentielle de la santé publique.
1.1. Définitions et Concepts
Clarification de la terminologie fondamentale : éducation nutritionnelle, éducation pour la santé, communication, sensibilisation, promotion et vulgarisation. La distinction entre ces termes permet de mieux cerner les objectifs et les stratégies de chaque type d’intervention.
1.2. Le Processus de la Communication
Analyse du schéma de la communication (émetteur, récepteur, message, canal, feedback) et des obstacles potentiels (bruits sémantiques, culturels, psychologiques). L’importance de la communication non verbale et de l’écoute active dans le contexte d’une causerie communautaire est particulièrement soulignée.
Chapitre 2 : Comprendre les Comportements et leur Changement
Ce chapitre explore la psychologie derrière les habitudes alimentaires pour mieux cibler les interventions.
2.1. Les Déterminants du Comportement Alimentaire
Étude des facteurs qui façonnent nos choix alimentaires : facteurs individuels (connaissances, perceptions), socio-culturels (traditions, interdits alimentaires, influence familiale), économiques (revenu, prix des denrées) et environnementaux (disponibilité des aliments). Des exemples concrets, comme les tabous alimentaires liés à la grossesse dans la province du Kongo Central, seront analysés.
2.2. Les Modèles de Changement de Comportement
Introduction simplifiée à des modèles comme le « Health Belief Model » pour comprendre les étapes par lesquelles un individu passe avant d’adopter une nouvelle pratique. Cela aide à adapter le message au niveau de préparation de l’audience.
PARTIE II : DIAGNOSTIC ET PLANIFICATION D’UNE INTERVENTION ÉDUCATIVE 🎯
Avant toute action, un bon éducateur doit comprendre son public et planifier son intervention. Cette partie est consacrée à la démarche méthodique qui précède l’animation : l’enquête, l’identification des problèmes prioritaires, la formulation d’objectifs et l’élaboration d’une stratégie. C’est l’étape de la conception, où la rigueur garantit la pertinence de l’action.
Chapitre 3 : L’Analyse de la Situation Nutritionnelle Communautaire
Ce chapitre fournit les outils pour réaliser un diagnostic participatif, pierre angulaire de toute intervention pertinente.
3.1. Techniques de Collecte d’Informations
Présentation de méthodes simples pour comprendre les besoins d’une communauté : observation directe, entretiens avec des leaders d’opinion (chefs de quartier, leaders religieux), et organisation de groupes de discussion (focus groups) pour explorer les connaissances, attitudes et pratiques des mères sur l’alimentation de leurs enfants, par exemple.
3.2. Identification et Priorisation des Problèmes
Une fois les données collectées, cette section apprend à identifier les problèmes nutritionnels majeurs et les pratiques à risque. Elle enseigne comment prioriser les problèmes sur lesquels l’intervention aura le plus d’impact, en tenant compte de la gravité du problème et de la faisabilité du changement.
Chapitre 4 : La Planification de la Séance Éducative
Ce chapitre détaille la transformation du diagnostic en un plan d’action structuré et cohérent.
4.1. Formulation des Objectifs Pédagogiques
Apprentissage de la méthode SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini) pour formuler des objectifs clairs et précis. Distinction entre objectif général, objectifs spécifiques et objectifs pédagogiques.
4.2. Choix des Thèmes et Élaboration des Messages Clés
Sur base des problèmes priorisés, cette section traite du choix des thèmes à aborder (allaitement, hygiène des mains, diversification alimentaire). Elle se concentre sur la technique de rédaction de messages simples, clairs, positifs et limités en nombre pour maximiser leur mémorisation.
4.3. Élaboration du Calendrier et Choix du Lieu
La planification logistique est cruciale. Cette section aborde comment choisir le moment et le lieu les plus appropriés pour une causerie (par exemple, au marché local un jour d’affluence, ou au centre de santé lors des séances de pesée), en concertation avec la communauté.
PARTIE III : MÉTHODOLOGIES ET OUTILS DE L’ÉDUCATION NUTRITIONNELLE 🛠️
Cette partie plonge au cœur de l’action éducative. Elle présente un éventail de méthodes et de supports que le technicien en nutrition peut mobiliser pour rendre ses séances vivantes, interactives et efficaces. L’accent est mis sur les approches participatives qui font de l’audience un acteur de son propre apprentissage.
Chapitre 5 : Les Méthodes d’Animation Participatives
Ce chapitre se concentre sur le « comment faire » pour animer une session de manière engageante.
5.1. La Causerie Éducative
Étude de la structure d’une causerie : introduction, développement par questions-réponses, synthèse et conclusion. Des techniques pour stimuler la discussion, comme le brainstorming (remue-méninges), sont présentées.
5.2. La Démonstration Culinaire
Analyse de la démonstration comme méthode pratique pour enseigner la préparation de recettes nutritives (par exemple, une bouillie enrichie pour jeunes enfants à base de farine de maïs, de soja et d’arachide, produits disponibles dans la région des Grands Lacs).
5.3. Les Approches Ludiques
Exploration de techniques comme les jeux de rôle, les sketchs ou le théâtre communautaire pour aborder des sujets sensibles de manière dédramatisée et mémorable.
Chapitre 6 : Conception et Utilisation des Supports Didactiques
Un bon support visuel peut décupler l’impact d’un message, surtout auprès de publics peu ou pas lettrés.
6.1. Les Supports Visuels
Principes de conception et d’utilisation de la boîte à images, des affiches, et des flanellographes. L’importance de pré-tester les images auprès de la communauté cible pour s’assurer de leur bonne compréhension est mise en avant.
6.2. Les Supports Audio-visuels
Discussion sur l’utilisation de la radio communautaire, très écoutée dans des provinces comme le Maniema, pour diffuser des spots ou des émissions de sensibilisation, ainsi que des vidéos sur téléphone portable.
PARTIE IV : SUIVI ET ÉVALUATION DES INTERVENTIONS ÉDUCATIVES 📈
Une intervention n’est complète que lorsqu’on en a mesuré les effets. Cette dernière partie initie l’élève aux principes de base du suivi et de l’évaluation, des compétences essentielles pour justifier de l’efficacité de son travail, l’améliorer continuellement et rendre compte aux partenaires et à la communauté.
Chapitre 7 : Les Principes du Suivi et de l’Évaluation
Ce chapitre distingue deux processus complémentaires mais différents.
7.1. Le Suivi des Activités
Définition du suivi comme un processus continu qui vérifie si les activités planifiées sont bien mises en œuvre (par exemple, le nombre de causeries réalisées, le nombre de participants).
7.2. L’Évaluation des Résultats
L’évaluation cherche à mesurer les effets de l’intervention. Distinction entre l’évaluation de processus, d’impact (changements de comportement à long terme) et de résultats (changements de connaissances et d’attitudes à court terme).
Chapitre 8 : Techniques d’Évaluation d’une Séance
Ce chapitre propose des méthodes simples pour évaluer l’efficacité immédiate d’une session.
8.1. Évaluation des Connaissances
Techniques pour vérifier ce que les participants ont retenu, comme des jeux de questions-réponses ou des exercices de tri d’images (classer les aliments en groupes).
8.2. Évaluation de la Satisfaction
Méthodes simples pour recueillir le feedback des participants sur la clarté de la séance, la performance de l’animateur et la pertinence du sujet, afin d’améliorer les futures interventions.
ANNEXES
1. Glossaire des Termes en Éducation pour la Santé
Ce glossaire fournit des définitions claires pour le vocabulaire technique du cours, incluant des termes comme « approche participative », « message clé », « canal de communication », « focus group », et « pré-test ».
2. Exemple de Fiche de Préparation d’une Causerie
Un modèle de fiche pratique est proposé, détaillant toutes les étapes de la préparation d’une causerie : thème, public cible, objectifs pédagogiques, messages clés, déroulement étape par étape, matériel nécessaire et méthode d’évaluation.
3. Catalogue de Supports Visuels
Cette section présente des exemples de supports visuels (images pour boîtes à images, affiches) sur des thèmes nutritionnels variés, conçus pour être culturellement pertinents pour le contexte de la RDC, et pouvant servir d’inspiration pour les travaux pratiques des élèves.



