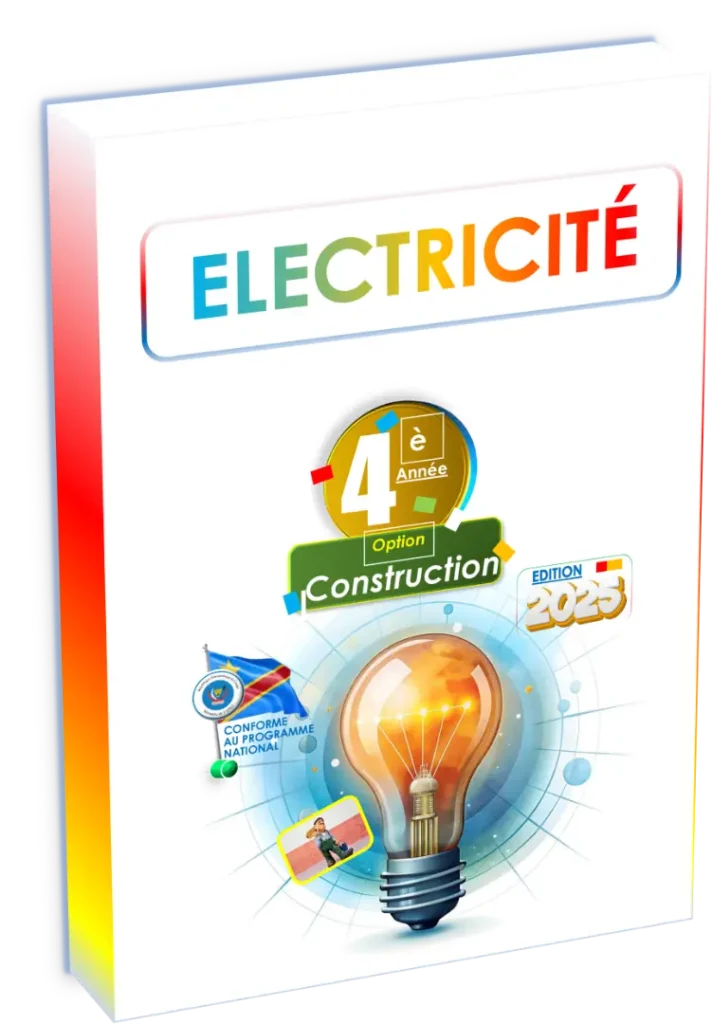
ÉLECTRICITÉ
OPTION CONSTRUCTION – 4ÈME ANNÉE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
Préliminaire
Objectifs du cours
Ce cours terminal d’électricité a pour objectif de conférer à l’élève une maîtrise opérationnelle des systèmes en courant alternatif, des installations électriques du bâtiment et des machines tournantes qui animent tout chantier de construction. L’ambition est de former un technicien capable de lire un schéma électrique, de comprendre la distribution de l’énergie dans un bâtiment, de dialoguer avec l’électricien et de superviser la mise en service et la maintenance des équipements motorisés. Il s’agit d’une compétence stratégique pour le futur chef de chantier, garant de la performance et de la sécurité électrique de ses opérations. 💡
Approche Pédagogique
Dépassant la simple théorie, l’enseignement s’ancrera dans une démarche résolument appliquée. Chaque concept de courant alternatif (déphasage, puissances) sera immédiatement illustré par ses implications pratiques sur le fonctionnement des machines. L’étude des installations du bâtiment se basera sur la lecture de plans réels et l’analyse de schémas de câblage. L’observation et la description technologique des moteurs et des génératrices primeront sur la complexité des calculs électromécaniques. Des études de cas, comme le choix d’un groupe électrogène pour un chantier à Kananga ou la conception du tableau électrique d’une villa à Gombe, rythmeront l’apprentissage.
Compétences Visées
Au terme de cette année, l’élève détiendra les compétences suivantes :
- Analyser : Comprendre et interpréter les grandeurs caractéristiques du courant alternatif monophasé et triphasé (valeur efficace, puissances, facteur de puissance).
- Concevoir : Lire, interpréter et dessiner les schémas des circuits électriques courants d’une installation domestique (éclairage, prises).
- Identifier : Reconnaître les différents types de moteurs et de génératrices, et expliquer leur principe de fonctionnement et leurs domaines d’emploi privilégiés.
- Appliquer : Mettre en œuvre les règles de sécurité, choisir les dispositifs de protection adéquats et comprendre les principes de la mise à la terre d’une installation de chantier.
Modalités d’Évaluation
L’évaluation sera axée sur la capacité à mobiliser les connaissances pour résoudre des problèmes technologiques concrets. Elle combinera des épreuves écrites (résolution d’exercices sur le courant alternatif, analyse de schémas), des épreuves pratiques d’identification de matériel et de câblage de circuits simples. Un projet de synthèse final demandera à l’élève d’établir le bilan de puissance d’un petit chantier et de proposer un schéma unifilaire de son installation électrique provisoire, incluant le choix du groupe électrogène. ⚡
Partie I : Les Fondamentaux des Courants Alternatifs
Cette partie établit les bases théoriques indispensables à la compréhension de l’énergie électrique telle qu’elle est distribuée et utilisée dans le monde. Elle couvre l’étude du courant alternatif monophasé et triphasé, ainsi que des composants clés qui permettent de le transformer et de le contrôler.
Chapitre 1 : Le Courant Alternatif Monophasé
Ce chapitre explore les caractéristiques du courant sinusoïdal, qui diffère fondamentalement du courant continu étudié l’année précédente, et introduit les nouvelles grandeurs physiques qui le décrivent.
1.1. La Production du Signal Sinusoïdal
Le principe de la génération d’une tension alternative par la rotation d’une spire dans un champ magnétique est expliqué, justifiant ainsi la forme sinusoïdale du courant distribué sur le réseau.
1.2. Les Grandeurs Caractéristiques
Les notions de fréquence (en Hertz), de période, d’amplitude et, surtout, de valeur efficace sont définies. La valeur efficace est la grandeur fondamentale utilisée dans tous les calculs de puissance en alternatif.
1.3. Le Déphasage et la Représentation Vectorielle
Dans les circuits alternatifs, la tension et le courant ne sont pas toujours en phase. Le concept de déphasage est introduit et visualisé à l’aide de la représentation de Fresnel (vecteurs tournants).
1.4. Le Triangle des Puissances
La puissance en alternatif se décompose en trois notions : la puissance active (P, en Watts), qui produit le travail ; la puissance réactive (Q, en VAR), liée aux champs magnétiques ; et la puissance apparente (S, en VA), qui est la somme vectorielle des deux. Le facteur de puissance (cos φ) qui les lie est un paramètre clé.
Chapitre 2 : Le Courant Alternatif Triphasé
Pour le transport de l’énergie et l’alimentation des moteurs de forte puissance, le système triphasé est la norme universelle. Ce chapitre en explique les principes et les avantages.
2.1. La Production et les Avantages du Triphasé
Un réseau triphasé est constitué de trois tensions sinusoïdales de même fréquence, déphasées de 120°. Ce système permet d’économiser du cuivre et de produire des champs magnétiques tournants, essentiels pour les moteurs.
2.2. Les Tensions Simples et Composées
Dans un réseau triphasé, on distingue les tensions simples (entre une phase et le neutre) et les tensions composées (entre deux phases). Leur relation mathématique (U = V√3) est établie.
2.3. Les Montages Étoile et Triangle
Les récepteurs triphasés peuvent être couplés selon deux montages : le montage étoile (avec ou sans neutre) et le montage triangle. Les caractéristiques de chaque couplage sont analysées.
2.4. Le Calcul de la Puissance en Triphasé
Les formules de calcul des puissances active, réactive et apparente pour un système triphasé équilibré sont établies. Elles sont indispensables pour le dimensionnement des installations industrielles et de chantier.
Chapitre 3 : Les Transformateurs
Le transformateur est une machine statique qui permet de modifier les niveaux de tension en courant alternatif. C’est un maillon essentiel du transport et de la distribution de l’électricité.
3.1. Le Transformateur Monophasé Parfait
Le principe de fonctionnement du transformateur, basé sur l’induction mutuelle entre deux enroulements (le primaire et le secondaire) placés sur un circuit magnétique commun, est expliqué.
3.2. Les Caractéristiques d’un Transformateur Réel
Un transformateur réel n’est pas parfait : il présente des pertes (pertes fer et pertes cuivre) qui affectent son rendement. Sa plaque signalétique, qui résume ses caractéristiques, est décodée.
3.3. Le Transformateur Triphasé : Couplages et Utilisation
Pour les réseaux triphasés, des transformateurs spécifiques sont utilisés. Les différents couplages possibles des enroulements (étoile, triangle, zig-zag) et leurs domaines d’application sont présentés.
3.4. L’Autotransformateur et les Transformateurs Spéciaux
Le cas particulier de l’autotransformateur, qui ne possède qu’un seul enroulement, est étudié. D’autres transformateurs spéciaux (d’isolement, de mesure) sont également introduits.
Chapitre 4 : Les Organes de Commande et de Protection
La maîtrise de l’énergie électrique passe par des appareils capables de l’établir, de l’interrompre et de la protéger contre les anomalies.
4.1. Le Discontacteur et le Relais : La Commande à Distance
Le discontacteur est un interrupteur de puissance commandé à distance par un électro-aimant. Il est au cœur de tous les automatismes et des circuits de commande de moteurs, comme ceux des grues à tour sur les chantiers de la REGIDESO.
4.2. La Protection contre les Surcharges
Une surcharge est une augmentation modérée mais prolongée du courant, qui provoque un échauffement dangereux des câbles. Le relais thermique est le dispositif qui assure cette protection.
4.3. La Protection contre les Courts-Circuits
Un court-circuit est une augmentation brutale et très intense du courant. La protection est assurée par des fusibles (à usage unique) ou par le déclencheur magnétique des disjoncteurs.
4.4. Les Disjoncteurs-Moteurs : une Protection Intégrée
Le disjoncteur-moteur est un appareil modulaire qui regroupe en un seul boîtier les fonctions de coupure, de commande, et de protection contre les surcharges et les courts-circuits pour un moteur.
Partie II : Les Installations Électriques du Bâtiment et du Chantier
Cette partie est la mise en application directe des connaissances pour le technicien en construction. Elle a pour but de le rendre capable de comprendre et de dialoguer sur la conception et la réalisation d’une installation électrique, que ce soit dans le bâtiment qu’il construit ou sur le chantier qu’il supervise.
Chapitre 5 : La Lecture des Plans et Schémas Électriques
Le plan électrique est le document de communication par excellence entre le bureau d’études, l’installateur et le contrôleur. Sa maîtrise est indispensable.
5.1. Les Normes et les Signes Conventionnels
Chaque composant d’une installation électrique (prise, interrupteur, luminaire, tableau) est représenté par un symbole normalisé. L’apprentissage de ce langage graphique est la première étape.
5.2. La Lecture d’un Plan d’Implantation Architectural
Le plan d’implantation montre la position des différents appareils sur le plan du bâtiment. L’élève apprend à lire ce document pour visualiser l’équipement électrique d’un local.
5.3. La Compréhension d’un Schéma Unifilaire de Distribution
Le schéma unifilaire est une représentation simplifiée qui montre l’architecture de l’installation, depuis le compteur jusqu’aux différents circuits, avec les caractéristiques des protections.
5.4. La Distinction entre Schéma de Principe et Schéma de Câblage
Le schéma de principe explique le fonctionnement d’un circuit, tandis que le schéma de câblage montre comment relier physiquement les différents appareils. La lecture de ces deux types de schémas est abordée.
Chapitre 6 : Les Circuits Électriques Usuels du Bâtiment
Ce chapitre analyse le fonctionnement et le câblage des montages électriques les plus courants que l’on trouve dans une habitation ou un bureau.
6.1. Le Circuit Simple Allumage
Le montage le plus simple, qui consiste à commander un point lumineux depuis un seul endroit, est détaillé, du schéma de principe au câblage réel dans les boîtes de dérivation.
6.2. Le Circuit Double Allumage
Ce montage permet de commander deux groupes de lampes différents depuis un même interrupteur double. Son câblage et ses applications (lustre à plusieurs ampoules) sont étudiés.
6.3. Le Circuit Va-et-Vient et le Télérupteur
Pour commander un même éclairage depuis plusieurs endroits (couloir, escalier), le montage va-et-vient (pour 2 points de commande) et le télérupteur (pour plus de 2 points de commande) sont les solutions.
6.4. Le Câblage des Circuits de Prises de Courant
La réalisation des circuits alimentant les prises de courant est étudiée, en insistant sur les règles de câblage (nombre de prises par circuit, section des conducteurs) et le raccordement du fil de terre.
Chapitre 7 : La Réalisation d’une Installation Électrique
Au-delà des schémas, la réalisation physique d’une installation fait appel à des technologies et des règles de l’art précises pour garantir la sécurité et la conformité.
7.1. La Technologie des Conduits et des Boîtes de Dérivation
Les câbles électriques sont protégés par des conduits (tubages) encastrés ou apparents. Les différents types de conduits et les règles de mise en œuvre des boîtes de jonction sont présentés.
7.2. Le Tableau de Distribution
Véritable « cœur » de l’installation, le tableau de distribution regroupe tous les organes de protection (disjoncteurs) et de répartition des circuits. Son organisation et son câblage sont analysés.
7.3. La Prise de Terre : Rôle Fondamental et Réalisation
La mise à la terre de toutes les masses métalliques est une exigence de sécurité absolue. Son rôle de protection des personnes et les différentes techniques pour la réaliser (piquet de terre, boucle en fond de fouille) sont étudiés.
7.4. Les Principales Dispositions Réglementaires pour le Constructeur
Le technicien en construction doit connaître les principaux articles du règlement technique qui le concernent, notamment en matière de passages de gaines, de réservations et de coordination avec l’électricien.
Chapitre 8 : Les Installations Spécifiques de Chantier
Un chantier est un environnement particulier qui exige des installations électriques provisoires, robustes et sécurisées.
8.1. L’Alimentation Provisoire d’un Chantier
Les différentes solutions pour alimenter un chantier en électricité sont présentées : raccordement provisoire au réseau public ou utilisation d’un groupe électrogène autonome, une solution fréquente pour les chantiers en zone rurale comme à Inongo.
8.2. Les Installations Aériennes et Souterraines sur Site
La distribution de l’énergie sur le chantier peut se faire par des lignes aériennes sur potelets ou par des câbles enterrés. Les avantages, inconvénients et règles de sécurité de chaque solution sont comparés.
8.3. La Protection des Machines et des Équipements de Chantier
Chaque machine fixe (grue, bétonnière) et chaque base-vie doit être équipée de son propre coffret de protection, incluant une coupure d’urgence et une protection différentielle.
8.4. La Gestion de l’Éclairage et de la Puissance sur un Chantier
La planification des besoins en éclairage (pour le travail de nuit ou dans les zones sombres) et en puissance pour les différents équipements est une étape clé de l’installation de chantier.
Partie III : Les Machines Électriques Tournantes
Cette dernière partie est consacrée à l’étude des convertisseurs électromécaniques que sont les moteurs (qui transforment l’énergie électrique en mouvement) et les génératrices (qui font l’inverse). Ces machines sont omniprésentes sur un chantier et dans les bâtiments.
Chapitre 9 : Les Machines à Courant Continu
Bien que moins répandues aujourd’hui en forte puissance, les machines à courant continu conservent des applications spécifiques et leur étude est une excellente introduction à l’électromécanique.
9.1. Le Principe de Fonctionnement Réversible
Une machine à courant continu est fondamentalement réversible : selon qu’on l’alimente en électricité ou qu’on l’entraîne mécaniquement, elle fonctionne en moteur ou en génératrice (dynamo).
9.2. Les Principaux Types de Génératrices CC (Dynamos)
Les différents types d’excitation (série, shunt, compound) des dynamos sont présentés, avec leurs caractéristiques de tension et leurs domaines d’application.
9.3. Les Principaux Types de Moteurs à Courant Continu
De même, les moteurs à courant continu sont classifiés selon leur type d’excitation. Le moteur série, avec son fort couple de démarrage, est particulièrement bien adapté aux applications de traction.
9.4. Les Domaines d’Emploi et la Maintenance
Les applications modernes des machines CC (servomoteurs, traction électrique) sont évoquées, ainsi que les opérations de maintenance spécifiques, notamment l’entretien du collecteur et des balais.
Chapitre 10 : Les Machines Synchrones (Alternateurs)
La machine synchrone, fonctionnant en génératrice, est appelée alternateur. C’est elle qui produit la quasi-totalité de l’énergie alternative dans les centrales et les groupes électrogènes.
10.1. Le Principe de l’Alternateur
Le fonctionnement de l’alternateur est basé sur l’induction d’une tension dans un enroulement fixe (le stator) par un champ magnétique tournant créé par un électro-aimant (le rotor).
10.2. L’Alternateur Monophasé et Triphasé
La structure des alternateurs monophasés et triphasés est décrite, en montrant comment l’agencement des enroulements du stator permet de générer un système de tensions équilibrées.
10.3. Le Couplage au Réseau et aux Groupes Électrogènes
Le couplage d’un alternateur au réseau ou à un autre alternateur exige des conditions strictes de synchronisation (même tension, même fréquence, même phase). Le principe de ces opérations est expliqué.
10.4. Application aux Groupes Électrogènes de Chantier
Le groupe électrogène, qui associe un moteur thermique et un alternateur, est un équipement vital pour de nombreux chantiers en RDC. Son principe, ses caractéristiques et son choix sont étudiés.
Chapitre 11 : Les Moteurs Asynchrones
Robuste, fiable et peu coûteux, le moteur asynchrone est le « cheval de trait » de l’industrie et du bâtiment. Il constitue la très grande majorité des moteurs utilisés sur les chantiers.
11.1. Le Principe du Champ Tournant et du Glissement
Le moteur asynchrone fonctionne grâce à la création d’un champ magnétique tournant au stator, qui entraîne par induction un rotor en cage d’écureuil. Le rotor tourne toujours à une vitesse légèrement inférieure (le glissement) à celle du champ.
11.2. Le Moteur Asynchrone Triphasé
Le moteur asynchrone triphasé est le moteur de puissance par excellence pour les machines fixes (pompes, compresseurs, grues). Sa simplicité et sa robustesse sont ses principaux atouts.
11.3. Le Moteur Asynchrone Monophasé
Pour les applications domestiques ou de faible puissance où le triphasé n’est pas disponible, le moteur asynchrone monophasé est utilisé. Ses dispositifs de démarrage spécifiques sont présentés.
11.4. Le Démarrage des Moteurs Asynchrones
Le courant de démarrage d’un moteur asynchrone est très élevé. Pour les fortes puissances, des procédés de démarrage spécifiques (étoile-triangle, démarreur progressif) sont nécessaires pour limiter cet appel de courant.
Annexes
Formulaire d’Électrotechnique Appliquée
Un recueil des formules essentielles pour le calcul en courant alternatif (puissances, tensions en triphasé) et pour les machines électriques (glissement) sera fourni. 🧮
Catalogue de Symboles et Schémas Types
Des fiches illustrées présenteront les symboles électriques normalisés, ainsi que les schémas de câblage commentés pour les circuits les plus courants (va-et-vient, télérupteur, démarrage étoile-triangle).
Guide de Choix d’un Groupe Électrogène
Une fiche méthodologique décrira la procédure pour réaliser un bilan de puissance simple et pour choisir un groupe électrogène adapté aux besoins d’un chantier.
Lexique Illustré des Machines Électriques
Un glossaire visuel définira les termes techniques spécifiques aux machines (stator, rotor, collecteur, balais, glissement, etc.), pour une parfaite maîtrise du vocabulaire professionnel. 🔩



