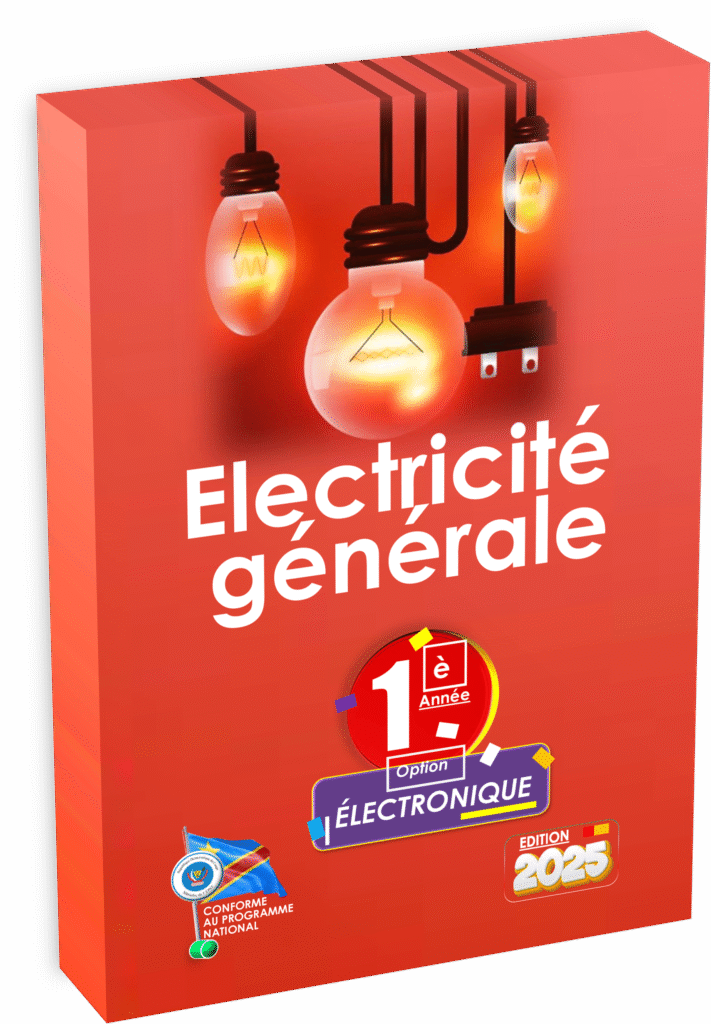
ELECTRICITE GENERALE
1ÈRE ANNÉE – OPTION ÉLECTRONIQUE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC
Préliminaires
1. Objectifs Généraux du Cours
Ce manuel a pour finalité d’établir chez l’élève une compréhension approfondie des principes fondamentaux de l’électricité, depuis les phénomènes électrostatiques jusqu’aux lois régissant les circuits en courant continu. L’objectif est de construire un socle de connaissances théoriques et pratiques robustes, indispensable à toute spécialisation ultérieure en électronique. La maîtrise de ces concepts permet d’analyser, de calculer et de concevoir des circuits électriques de base avec rigueur et précision.
2. Compétences Visées
Au terme de ce programme d’apprentissage, l’élève sera en mesure de :
- Expliquer la nature de la charge électrique et appliquer la loi de Coulomb pour quantifier les forces d’interaction.
- Analyser des circuits en courant continu simples en utilisant les lois d’Ohm et de Pouillet pour déterminer les tensions, courants et résistances.
- Calculer l’énergie consommée et la puissance dissipée dans un circuit, et établir des bilans de puissance pour des générateurs et des récepteurs.
- Différencier les types de générateurs électrochimiques et interpréter leurs caractéristiques essentielles, telles que la capacité et la résistance interne.
3. Approche Pédagogique
La démarche pédagogique adoptée articule de manière systématique l’exposé des lois physiques et leur application concrète à travers la résolution de problèmes. Une progression logique, partant de l’étude des charges immobiles pour aboutir à celle des circuits parcourus par un courant, structure le cours. Des exemples contextualisés, comme le calcul de la section d’un conducteur pour alimenter un dispensaire à Boende ou l’analyse de l’autonomie d’une batterie pour un système de communication à Kindu, visent à rendre les concepts tangibles et pertinents pour l’environnement de l’élève.
PREMIÈRE PARTIE : PHÉNOMÈNES FONDAMENTAUX ET GRANDEURS ÉLECTRIQUES ⚡
Cette section inaugurale explore l’univers de l’électricité à son niveau le plus fondamental : celui des charges électriques au repos. En partant de la structure de la matière, l’élève découvre les concepts de force, de champ et de potentiel qui gouvernent les interactions électrostatiques. L’étude se conclut par l’analyse du condensateur, premier composant essentiel qui illustre la capacité à emmagasiner de l’énergie au sein d’un champ électrique. La maîtrise de ces notions est cruciale pour comprendre ultérieurement le comportement des charges en mouvement.
CHAPITRE 1 : INTRODUCTION À L’ÉLECTROSTATIQUE ET AUX CHAMPS ÉLECTRIQUES
1.1. Structure de la matière et charge électrique
Ce sous-chapitre revient sur le modèle atomique pour expliquer l’origine de la charge électrique. Les notions d’électrons, de protons, de corps neutres et de corps ionisés sont établies. [cite_start]Les processus d’électrisation par frottement, contact et influence sont décrits pour illustrer comment un corps peut acquérir une charge électrique nette[cite: 147].
1.2. La loi de Coulomb
La quantification de l’interaction entre deux charges ponctuelles est au cœur de ce point. [cite_start]L’élève apprendra à énoncer et à appliquer la loi de Coulomb pour calculer la force électrostatique, en tenant compte de son caractère attractif ou répulsif et de sa dépendance à la distance et au milieu[cite: 148].
1.3. Le champ électrique
La notion de champ est introduite comme une propriété de l’espace modifiée par la présence d’une charge. [cite_start]L’élève apprendra à définir le vecteur champ électrique en un point, à le représenter par des lignes de champ et à l’utiliser pour déterminer la force subie par une charge placée dans ce champ[cite: 150].
1.4. Le théorème de Gauss
Pour des distributions de charges symétriques, le calcul du champ électrique est grandement simplifié par le théorème de Gauss. [cite_start]L’élève sera initié à la notion de flux de champ électrique et à l’application de ce théorème pour déterminer l’expression du champ créé par des distributions simples (sphère, fil infini)[cite: 185].
CHAPITRE 2 : POTENTIEL ÉLECTRIQUE ET PHÉNOMÈNES D’INFLUENCE
2.1. Travail de la force électrostatique et énergie potentielle
Ce sous-chapitre aborde l’aspect énergétique des interactions électriques. Le concept de travail d’une force est appliqué à la force de Coulomb, menant à la définition de l’énergie potentielle électrique d’un système de charges.
2.2. Potentiel et différence de potentiel
Le potentiel électrique (V) est défini comme l’énergie potentielle par unité de charge, offrant une description scalaire de l’état électrique d’un point de l’espace. [cite_start]La différence de potentiel (ou tension) entre deux points est alors introduite comme étant la circulation du champ électrique, une notion capitale pour l’étude des circuits[cite: 154].
2.3. Surfaces équipotentielles
L’élève apprendra que l’ensemble des points de l’espace ayant le même potentiel forme une surface équipotentielle. La relation d’orthogonalité entre les lignes de champ et ces surfaces sera démontrée et utilisée pour visualiser la topographie électrique d’une région de l’espace.
2.4. Rigidité diélectrique
Les matériaux isolants ne peuvent supporter qu’un champ électrique maximal avant de devenir conducteurs (phénomène de claquage). [cite_start]Cette limite, appelée rigidité diélectrique, est une caractéristique essentielle des isolants utilisés en électrotechnique, et sa compréhension est vitale pour la conception d’appareillages sécurisés[cite: 150].
CHAPITRE 3 : LE CONDENSATEUR ET LE STOCKAGE D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
3.1. Description et capacité d’un condensateur
Le condensateur est présenté comme un dispositif constitué de deux conducteurs en influence, capable de stocker des charges électriques. [cite_start]Sa caractéristique principale, la capacité (C), est définie comme le rapport de la charge stockée à la tension appliquée ()[cite: 180, 182]. [cite_start]La formule de la capacité d’un condensateur plan est également établie ()[cite: 181].
3.2. Principaux types de condensateurs
L’élève découvrira la diversité technologique des condensateurs, chacun étant adapté à des usages spécifiques. [cite_start]Les condensateurs céramiques, à film plastique, électrolytiques (polarisés) et variables sont décrits, en soulignant leurs ordres de grandeur de capacité et leurs domaines d’application[cite: 181].
3.3. Groupement de condensateurs
Afin d’obtenir une capacité non disponible en standard, il est possible d’associer des condensateurs. [cite_start]Les formules pour calculer la capacité équivalente d’un groupement en série et d’un groupement en parallèle sont établies et mises en pratique à travers des exercices[cite: 184].
3.4. Énergie emmagasinée dans un condensateur
Ce sous-chapitre démontre qu’un condensateur chargé emmagasine de l’énergie potentielle électrique. [cite_start]L’élève apprendra à calculer cette énergie à l’aide des formules , et comprendra ainsi le rôle du condensateur comme réservoir d’énergie[cite: 183].
DEUXIÈME PARTIE : LE COURANT ÉLECTRIQUE CONTINU ET SES LOIS 🌊
Cette partie centrale du cours marque le passage de l’électrostatique à l’électrocinétique, c’est-à-dire l’étude des charges en mouvement ordonné. L’élève y découvre les concepts fondamentaux de courant, de tension et de résistance, ainsi que les lois qui les relient. L’analyse des circuits résistifs simples constitue le cœur de cette section, fournissant les outils mathématiques indispensables pour résoudre la majorité des problèmes d’électricité de base.
CHAPITRE 4 : GÉNÉRATION DU COURANT ET CIRCUIT ÉLECTRIQUE SIMPLE
4.1. Le courant électrique
Le courant électrique est défini comme un déplacement d’ensemble de porteurs de charge. [cite_start]L’intensité du courant (I) est quantifiée comme étant le débit de ces charges[cite: 158]. Le sens conventionnel du courant est établi, et l’ampère est présenté comme son unité de mesure.
4.2. Générateurs et récepteurs
L’élève apprend à distinguer les deux grandes familles de dipôles : les générateurs, qui fournissent de l’énergie électrique, et les récepteurs, qui la consomment (en la convertissant sous une autre forme). La nécessité d’un circuit fermé pour la circulation du courant est mise en évidence.
4.3. Le circuit électrique élémentaire
Le concept de circuit électrique est formalisé. [cite_start]Un circuit simple, comprenant un générateur, un récepteur (comme une lampe), un interrupteur et des conducteurs de liaison, est schématisé et analysé[cite: 157]. Le rôle de chaque composant est clairement identifié.
4.4. Tension électrique et mesures
La tension (U) ou différence de potentiel est consolidée comme la grandeur qui provoque la circulation du courant. Les appareils de mesure de base sont introduits : l’ampèremètre, qui se branche en série pour mesurer le courant, et le voltmètre, qui se branche en parallèle pour mesurer la tension.
CHAPITRE 5 : LA LOI D’OHM ET LA RÉSISTIVITÉ DES CONDUCTEURS
5.1. La loi d’Ohm pour les récepteurs passifs
La relation fondamentale entre tension, courant et résistance pour un conducteur ohmique est énoncée : . L’élève apprendra à utiliser cette loi pour calculer l’une des trois grandeurs connaissant les deux autres. [cite_start]La résistance (R), mesurée en ohms (Ω), est présentée comme l’aptitude d’un matériau à s’opposer au passage du courant[cite: 155].
5.2. Caractéristique tension-courant d’un résistor
La représentation graphique de la tension aux bornes d’un résistor en fonction du courant qui le traverse est une droite passant par l’origine. L’élève apprendra à tracer et à interpréter cette caractéristique, et à en déduire la valeur de la résistance à partir de sa pente.
5.3. La loi de Pouillet et la résistivité
La résistance d’un fil conducteur dépend de sa géométrie et du matériau qui le compose. La loi de Pouillet () est introduite pour calculer cette résistance. [cite_start]L’élève comprendra ainsi l’influence de la longueur (L), de la section (S) et de la résistivité () du matériau[cite: 155]. Cette loi est fondamentale pour le dimensionnement des câbles électriques, par exemple pour un projet d’électrification rurale dans le Kasaï.
5.4. Influence de la température
La résistivité de la plupart des conducteurs augmente avec la température. Ce phénomène est expliqué qualitativement, et la formule de variation de la résistance en fonction de la température est introduite, soulignant l’importance de ce paramètre dans certaines applications industrielles.
CHAPITRE 6 : ASSOCIATION DE RÉSISTANCES ET DIVISEURS DE TENSION
6.1. Association en série
Lorsque des résistances sont connectées en série, la résistance équivalente est la somme des résistances individuelles. [cite_start]L’élève apprendra à calculer cette résistance totale et à déterminer la tension aux bornes de chaque résistance, introduisant le concept de « pont diviseur de tension »[cite: 161].
6.2. Association en parallèle
Pour un groupement en parallèle, l’inverse de la résistance équivalente est la somme des inverses de chaque résistance. [cite_start]Le calcul de la résistance totale est exercé, et l’élève apprendra à déterminer la répartition du courant dans chaque branche, illustrant le principe du « pont diviseur de courant »[cite: 161].
6.3. Associations mixtes
Des circuits plus complexes, combinant des groupements en série et en parallèle, sont analysés. L’élève développera une méthode systématique pour simplifier ces circuits en calculant progressivement les résistances équivalentes des différents sous-ensembles.
6.4. Le code des couleurs des résistances
En électronique, la valeur des petites résistances est indiquée par un code de bagues colorées. Ce sous-chapitre enseigne à l’élève la méthode de décodage de ce standard international pour identifier la valeur nominale, la tolérance et parfois le coefficient de température d’une résistance.
CHAPITRE 7 : ÉNERGIE ET PUISSANCE EN COURANT CONTINU
7.1. Distinction entre énergie et puissance
Les concepts d’énergie (W) et de puissance (P) sont clairement différenciés. [cite_start]L’énergie représente une quantité de « travail » et se mesure en joules (J) ou en kilowattheures (kWh), tandis que la puissance représente le débit de cette énergie et se mesure en watts (W)[cite: 163].
7.2. Puissance électrique
[cite_start]La puissance électrique consommée par un dipôle est donnée par la relation générale [cite: 166]. L’élève s’entraînera à calculer la puissance pour divers composants, établissant ainsi le lien direct entre les grandeurs électriques de base et la consommation d’énergie.
7.3. L’effet Joule
La conversion de l’énergie électrique en chaleur dans un conducteur résistif est appelée l’effet Joule. [cite_start]Les formules spécifiques à la puissance dissipée par cet effet, et , sont établies et leur utilité est illustrée par des applications (chauffage, éclairage) et des inconvénients (pertes dans les lignes)[cite: 165, 167].
7.4. Calcul de l’énergie électrique
L’énergie électrique est le produit de la puissance et du temps (). [cite_start]L’élève apprendra à calculer la consommation d’énergie d’appareils électriques, en manipulant les unités appropriées (joule, wattheure, kilowattheure) pour des applications pratiques comme l’estimation d’une facture d’électricité à Lubumbashi[cite: 166].
TROISIÈME PARTIE : GÉNÉRATEURS, RÉCEPTEURS ET BILANS DE PUISSANCE 🔋
Cette troisième partie se focalise sur le comportement réel des composants actifs d’un circuit. L’élève y apprend que les générateurs et les récepteurs ne sont pas des dispositifs idéaux. Les concepts de force électromotrice, de force contre-électromotrice et de résistance interne sont introduits pour modéliser plus fidèlement la réalité. L’analyse des transferts d’énergie et des rendements devient alors possible, offrant une vision complète et pragmatique du fonctionnement des circuits électriques.
CHAPITRE 8 : CARACTÉRISTIQUES DES GÉNÉRATEURS ÉLECTROCHIMIQUES : PILES ET ACCUMULATEURS
8.1. Piles électrochimiques
Le principe de la conversion d’énergie chimique en énergie électrique est expliqué. [cite_start]La pile Leclanché (saline) et la pile alcaline sont décrites, en comparant leur constitution, leur tension nominale et leurs domaines d’usage respectifs[cite: 173].
8.2. Accumulateurs
Contrairement aux piles, les accumulateurs sont rechargeables. [cite_start]L’accumulateur au plomb, massivement utilisé pour le démarrage des véhicules et les systèmes solaires, et l’accumulateur alcalin (Ni-Cd, Ni-MH) sont décrits et différenciés[cite: 174]. L’importance de ces dispositifs pour le stockage d’énergie dans des sites isolés, comme un centre de santé à Inongo, est soulignée.
8.3. Capacité d’un générateur
La capacité d’une pile ou d’un accumulateur, exprimée en ampères-heures (Ah), représente la quantité de charge électrique qu’il peut fournir avant d’être déchargé. [cite_start]L’élève apprendra à définir cette grandeur et à l’utiliser pour calculer l’autonomie d’un appareil[cite: 175].
8.4. Indices de charge et de décharge
L’état de charge d’un accumulateur peut être estimé par la mesure de sa tension à vide ou de la densité de son électrolyte (pour les batteries au plomb). [cite_start]Les précautions à prendre lors de la charge et de la décharge pour maximiser la durée de vie de l’accumulateur sont également abordées[cite: 176].
CHAPITRE 9 : LE GÉNÉRATEUR EN CIRCUIT : FORCE ÉLECTROMOTRICE ET RÉSISTANCE INTERNE
9.1. Le modèle de Thévenin d’un générateur réel
Un générateur réel est modélisé par une source de tension idéale, appelée force électromotrice (f.é.m., notée E), en série avec une résistance interne (r). [cite_start]Ce modèle simple permet de prévoir le comportement du générateur lorsqu’il est connecté à un circuit[cite: 171].
9.2. Force électromotrice (f.é.m.)
La f.é.m. (E) représente la tension maximale qu’un générateur peut fournir, mesurée à ses bornes lorsqu’il ne débite aucun courant (tension à vide). [cite_start]Elle est la véritable mesure de la « force » du générateur[cite: 171].
9.3. Chute de tension interne
Lorsqu’un générateur débite un courant (I), une partie de la tension est « perdue » à l’intérieur du générateur à cause de sa résistance interne (r). Cette chute de tension interne vaut .
9.4. Loi d’Ohm pour un circuit complet
En appliquant la loi d’Ohm à un circuit fermé contenant un générateur réel (E, r) et une résistance de charge (R), on obtient la relation fondamentale . L’élève utilisera cette loi pour analyser complètement des circuits simples et calculer la tension réelle aux bornes du générateur en fonctionnement.
CHAPITRE 10 : LE RÉCEPTEUR ACTIF : FORCE CONTRE-ÉLECTROMOTRICE
10.1. Distinction entre récepteur passif et récepteur actif
Un récepteur passif (comme une résistance) ne fait que convertir l’énergie électrique en chaleur. Un récepteur actif (comme un moteur ou un électrolyseur) convertit l’énergie électrique en une autre forme d’énergie (mécanique, chimique) et est capable de s’opposer au passage du courant.
10.2. Force contre-électromotrice (f.c.é.m.)
Un récepteur actif est caractérisé par une force contre-électromotrice (f.c.é.m., notée E’), qui représente sa capacité à s’opposer à la tension qui l’alimente. Il possède également une résistance interne (r’).
10.3. Loi d’Ohm aux bornes d’un récepteur actif
La tension aux bornes d’un récepteur actif est donnée par la relation . L’élève apprendra à utiliser ce modèle pour analyser le comportement de ces composants dans un circuit.
10.4. Point de fonctionnement d’un circuit
Le point de fonctionnement d’un circuit simple (générateur alimentant un récepteur) est l’unique couple de valeurs (U, I) qui satisfait simultanément les équations du générateur et du récepteur. L’élève apprendra à déterminer ce point par le calcul ou graphiquement.
CHAPITRE 11 : BILANS DE PUISSANCE ET RENDEMENT DES CIRCUITS
11.1. Bilan de puissance d’un générateur
[cite_start]La puissance totale fournie par la f.é.m. d’un générateur () se divise en deux parties : la puissance utile fournie au circuit extérieur () et la puissance perdue par effet Joule dans sa résistance interne ()[cite: 168].
11.2. Rendement d’un générateur
Le rendement d’un générateur est le rapport de la puissance utile qu’il délivre à la puissance totale qu’il engendre. [cite_start]L’élève apprendra à calculer ce rendement (), qui caractérise son efficacité énergétique[cite: 171].
11.3. Bilan de puissance d’un récepteur
[cite_start]La puissance totale absorbée par un récepteur actif () se divise également : une partie est convertie en puissance utile (mécanique ou chimique, ) et l’autre est perdue en chaleur dans sa résistance interne ()[cite: 168].
11.4. Rendement d’un récepteur et d’une installation
Le rendement d’un récepteur est le rapport de sa puissance utile à la puissance qu’il absorbe (). L’élève pourra alors calculer le rendement global d’une chaîne énergétique complète, du générateur au récepteur, une compétence clé pour l’optimisation des systèmes électriques.
Annexes
1. Mémento des Unités et Formules
Cette section contiendrait un tableau récapitulatif de toutes les grandeurs électriques étudiées (charge, courant, tension, résistance, puissance, énergie, capacité), avec leur symbole, leur unité dans le Système International et les formules fondamentales qui les relient. Il servirait d’aide-mémoire permanent pour l’élève.
2. Tableau de résistivité des matériaux
Un tableau fournirait la valeur de la résistivité à 20°C pour les conducteurs les plus courants (cuivre, aluminium, argent, etc.) et pour quelques isolants. Cet outil serait indispensable pour les exercices d’application de la loi de Pouillet.
3. Guide de sécurité électrique
Des règles de sécurité fondamentales pour la manipulation des circuits électriques seraient énoncées. Les dangers du courant électrique sur le corps humain, le rôle de la mise à la terre, et les précautions de base (consignation, utilisation d’outils isolés) seraient expliqués de manière claire et directe.
4. Exemples de caractéristiques techniques
Des extraits de fiches techniques de composants réels (piles, batteries, résistances) seraient présentés. L’objectif est de familiariser l’élève avec la documentation des fabricants et de lui apprendre à y retrouver les informations étudiées en cours (tension nominale, capacité, résistance interne, tolérance).