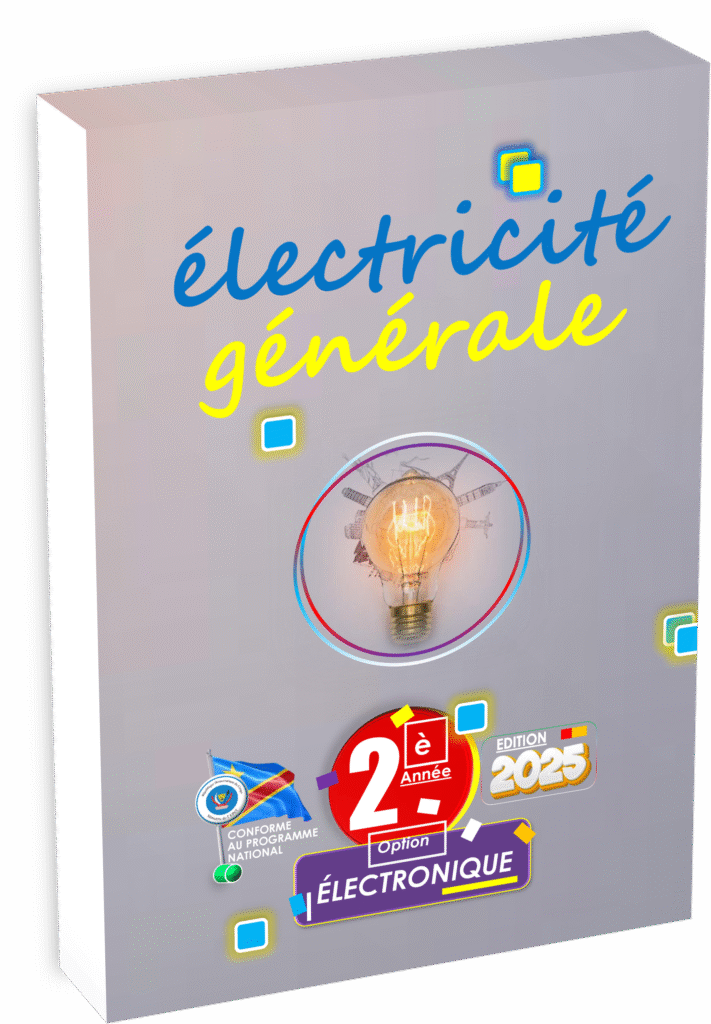
ELECTRICITE GENERALE
2ÈME ANNÉE – OPTION ÉLECTRONIQUE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC
Préliminaires
1. Objectifs Généraux du Cours
Ce manuel a pour finalité de faire évoluer la compréhension de l’électricité chez l’élève, en passant de l’analyse des circuits simples à la maîtrise des outils mathématiques puissants pour résoudre des réseaux complexes. Le cours introduit ensuite les phénomènes magnétiques et électromagnétiques, établissant le lien fondamental entre électricité et magnétisme. Enfin, il aborde l’étude du courant alternatif sinusoïdal, socle de la production, du transport et de l’utilisation de l’énergie électrique.
2. Compétences Visées
Au terme de ce programme d’apprentissage, l’élève sera en mesure de :
- Appliquer les lois de Kirchhoff et les théorèmes généraux (Thévenin, Norton, Superposition) pour analyser tout circuit électrique linéaire en courant continu.
- Expliquer les concepts de champ magnétique, d’induction et de flux, et appliquer les lois de Faraday et de Lenz pour analyser les phénomènes d’induction.
- Définir et calculer les grandeurs caractéristiques d’un signal alternatif sinusoïdal (valeur efficace, moyenne, pulsation).
- Analyser le comportement de circuits RLC en régime sinusoïdal, calculer leurs impédances et leurs puissances, et interpréter les phénomènes de résonance.
3. Approche Pédagogique
La démarche pédagogique s’articule autour de trois piliers : la complexification des modèles de circuits en continu, l’unification des phénomènes électriques et magnétiques, et l’introduction d’un nouveau formalisme mathématique pour le régime alternatif (diagramme de Fresnel). La résolution de problèmes concrets et l’analyse de systèmes réels sont au cœur de la méthode. Des études de cas, comme la modélisation d’un réseau de distribution électrique pour un quartier de Goma, l’analyse des forces électromagnétiques dans un moteur de traction pour la SNCC, ou le calcul du facteur de puissance d’une installation industrielle à Matadi, servent à contextualiser et à renforcer l’apprentissage.
PREMIÈRE PARTIE : MÉTHODES AVANCÉES D’ANALYSE DES CIRCUITS EN COURANT CONTINU 🧠
Cette première partie a pour objectif de doter l’élève d’un arsenal d’outils d’analyse lui permettant de résoudre des circuits électriques en courant continu qui dépassent la simple application de la loi d’Ohm sur des associations série/parallèle. Ces méthodes systématiques, basées sur des théorèmes fondamentaux, permettent de calculer les courants et les tensions dans des réseaux maillés de n’importe quelle complexité, une compétence essentielle pour tout électronicien.
CHAPITRE 1 : LES LOIS DE KIRCHHOFF POUR L’ANALYSE DES RÉSEAUX
1.1. Terminologie des réseaux : nœud, branche, maille
Afin de pouvoir décrire rigoureusement un circuit complexe, un vocabulaire précis est établi. L’élève apprendra à définir et à identifier un nœud (point de connexion de trois conducteurs ou plus), une branche (portion de circuit entre deux nœuds) et une maille (parcours fermé dans un circuit).
1.2. La loi des nœuds
La première loi de Kirchhoff, ou loi des nœuds, exprime le principe de conservation de la charge électrique. L’élève énoncera cette loi qui stipule que la somme des courants qui entrent dans un nœud est égale à la somme des courants qui en sortent. Il s’exercera à l’appliquer pour établir des relations entre les courants d’un réseau.
1.3. La loi des mailles
La seconde loi de Kirchhoff, ou loi des mailles, est une expression de la conservation de l’énergie. Elle énonce que la somme algébrique des différences de potentiel (tensions) le long d’une maille fermée est nulle. L’élève apprendra à parcourir une maille et à écrire l’équation correspondante.
1.4. Méthode de résolution par les lois de Kirchhoff
Ce sous-chapitre présente la méthode systématique de résolution d’un réseau. Elle consiste à appliquer la loi des nœuds à (n-1) nœuds et la loi des mailles à un nombre suffisant de mailles indépendantes pour obtenir un système d’équations linéaires dont les inconnues sont les courants de branche.
CHAPITRE 2 : LE THÉORÈME DE SUPERPOSITION
2.1. Principe de la superposition
Le théorème de superposition s’applique aux circuits linéaires contenant plusieurs sources indépendantes. Il énonce que le courant ou la tension en un point du circuit est la somme algébrique des courants ou tensions produits par chaque source agissant seule, les autres sources étant remplacées par leur résistance interne.
2.2. Méthodologie d’application
L’élève apprendra la méthode pas à pas : éteindre toutes les sources sauf une (une source de tension est remplacée par un court-circuit, une source de courant par un circuit ouvert), calculer la grandeur désirée, et répéter l’opération pour chaque source avant de sommer les résultats.
2.3. Avantages et limitations
L’avantage de ce théorème est de transformer un problème complexe en plusieurs problèmes plus simples. Sa limitation principale est qu’il ne s’applique pas au calcul des puissances, car celles-ci ne sont pas des fonctions linéaires du courant ou de la tension.
2.4. Exercices d’application sur des circuits multi-sources
Des exercices concrets, comme l’analyse d’un circuit alimenté simultanément par une batterie et un panneau solaire dans un système hybride à Kananga, permettront à l’élève de s’approprier la méthode et d’en apprécier l’utilité.
CHAPITRE 3 : LES THÉORÈMES DE THÉVENIN ET DE NORTON
3.1. Le générateur de tension équivalent de Thévenin
Le théorème de Thévenin est un outil de simplification extrêmement puissant. Il stipule que n’importe quelle partie d’un circuit linéaire vue depuis deux bornes peut être remplacée par un générateur de tension idéal () en série avec une résistance ().
3.2. Détermination de et
L’élève apprendra les méthodes de calcul des éléments du modèle de Thévenin. est la tension à vide mesurée entre les deux bornes. est la résistance vue depuis les bornes lorsque toutes les sources indépendantes sont éteintes.
3.3. Le générateur de courant équivalent de Norton
Le théorème de Norton est le dual de celui de Thévenin. Il énonce que le même circuit peut être remplacé par un générateur de courant idéal () en parallèle avec une résistance (, qui est identique à ).
3.4. Détermination de et passage Thévenin-Norton
Le courant de Norton est le courant de court-circuit qui circulerait entre les deux bornes. L’élève apprendra à le calculer et à utiliser les relations de transformation qui permettent de passer directement du modèle de Thévenin au modèle de Norton et inversement ().
CHAPITRE 4 : TRANSFORMATIONS DE CIRCUITS ET THÉORÈMES COMPLÉMENTAIRES
4.1. Le théorème de Kennelly : transformation triangle-étoile
Certains réseaux, comme les montages en pont, ne peuvent être simplifiés par des associations série/parallèle. Le théorème de Kennelly fournit les formules pour transformer un groupement de trois résistances en triangle (ou delta) en un groupement équivalent en étoile (ou Y), et vice-versa, rendant le circuit soluble.
4.2. Application à la simplification de ponts de résistances
L’élève appliquera la transformation triangle-étoile pour calculer la résistance équivalente d’un pont de Wheatstone déséquilibré, démontrant ainsi la puissance de cette méthode pour des configurations complexes.
4.3. Le théorème de Millman
Le théorème de Millman est particulièrement efficace pour calculer directement la tension à un nœud commun où convergent plusieurs branches contenant chacune un générateur et une résistance. Il simplifie considérablement l’analyse de circuits avec de nombreuses sources en parallèle.
4.4. Le théorème de réciprocité
Ce théorème énonce que dans un circuit linéaire passif, si une source de tension placée dans une branche A provoque un courant dans une branche B, alors la même source de tension placée dans la branche B provoquera le même courant dans la branche A. Ce principe a des applications importantes en théorie des antennes et des quadripôles.
DEUXIÈME PARTIE : MAGNÉTISME ET INDUCTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE 🧲
Cette partie explore le monde du magnétisme et son lien intime avec l’électricité. L’élève découvrira que les courants électriques sont une source de champ magnétique et, réciproquement, qu’un champ magnétique variable peut générer un courant électrique. Ces principes d’interaction électromagnétique sont au cœur du fonctionnement des moteurs, des générateurs, des transformateurs et de nombreux capteurs. La maîtrise de ces lois est donc fondamentale pour l’électronicien.
CHAPITRE 5 : LE CHAMP MAGNÉTIQUE ET LES MATÉRIAUX MAGNÉTIQUES
5.1. Phénomènes magnétiques fondamentaux
Les propriétés des aimants permanents sont décrites : existence de deux pôles (Nord et Sud), forces d’attraction et de répulsion entre pôles, et l’expérience de l’aiguille aimantée qui révèle l’existence du champ magnétique terrestre.
5.2. Le vecteur champ magnétique
Le champ magnétique est modélisé par un vecteur, noté , dont la direction et le sens sont donnés par l’orientation d’une aiguille aimantée. L’unité du champ magnétique, le tesla (T), est introduite. Les lignes de champ sont utilisées pour visualiser la topographie d’un champ magnétique.
5.3. Le flux magnétique
Le flux magnétique () à travers une surface est une mesure de la « quantité » de champ magnétique qui la traverse. Il est défini comme le produit de la composante normale du champ et de l’aire de la surface. Son unité, le weber (Wb), est présentée.
5.4. Courbe d’aimantation et hystérésis
La relation non linéaire entre le champ magnétique et le champ d’excitation magnétique dans un matériau ferromagnétique est étudiée. L’élève interprétera la courbe de première aimantation et le cycle d’hystérésis, en définissant les concepts de saturation, de rémanence et de champ coercitif.
CHAPITRE 6 : LE CHAMP MAGNÉTIQUE CRÉÉ PAR LES COURANTS
6.1. L’expérience d’Oersted et la règle de la main droite
L’expérience historique d’Oersted, qui montre qu’un courant électrique dévie une aiguille aimantée, est présentée comme la preuve qu’un courant est une source de champ magnétique. La règle de la main droite (ou du tire-bouchon) est introduite pour déterminer le sens des lignes de champ autour d’un conducteur.
6.2. Champ créé par un conducteur rectiligne
L’expression de l’intensité du champ magnétique créé par un courant rectiligne infini est donnée (Loi de Biot-Savart). L’élève apprendra que le champ est d’autant plus intense que le courant est élevé et que l’on est proche du fil.
6.3. Champ créé par une spire circulaire
La configuration du champ magnétique créé par une boucle de courant est analysée, montrant qu’elle se comporte comme un petit aimant plat.
6.4. Le solénoïde (la bobine)
Le solénoïde est présenté comme un enroulement de fil en hélice. L’élève étudiera la structure du champ magnétique à l’intérieur d’un solénoïde long, qui est remarquablement uniforme et intense. La formule sera utilisée pour calculer ce champ, essentiel dans la création d’électroaimants.
CHAPITRE 7 : L’INDUCTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE
7.1. L’expérience de Faraday
Les expériences de Michael Faraday sont décrites : l’apparition d’un courant dans une bobine lorsqu’on approche ou éloigne un aimant, ou lorsqu’on fait varier le courant dans une bobine voisine. Ces expériences montrent qu’un flux magnétique variable induit un courant.
7.2. La loi de Faraday
La loi de Faraday quantifie le phénomène : la force électromotrice (f.é.m.) induite dans un circuit est égale à l’opposé de la vitesse de variation du flux magnétique qui le traverse (). L’élève appliquera cette loi pour calculer la tension induite dans diverses situations.
7.3. La loi de Lenz
Le signe « moins » dans la loi de Faraday est interprété par la loi de Lenz : le courant induit a un sens tel qu’il s’oppose, par ses effets magnétiques, à la cause qui lui a donné naissance. Cette loi est une manifestation de la conservation de l’énergie. L’élève l’utilisera pour déterminer le sens du courant induit.
7.4. Les courants de Foucault
Ce sous-chapitre explique que si le flux magnétique varie à travers une masse conductrice, des courants induits y circulent en formant des tourbillons, appelés courants de Foucault. Leurs effets (échauffement, freinage) sont décrits, ainsi que leurs applications (freinage par induction, plaques de cuisson à induction).
CHAPITRE 8 : LES FORCES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
8.1. La force de Laplace
Un conducteur parcouru par un courant et placé dans un champ magnétique subit une force, appelée force de Laplace. L’élève apprendra à déterminer la direction et le sens de cette force à l’aide de la règle des trois doigts de la main droite, et à calculer son intensité avec la formule .
8.2. Application au moteur à courant continu
Le principe de fonctionnement du moteur électrique est expliqué comme une application directe de la force de Laplace. L’élève analysera comment les forces s’exerçant sur les spires d’un rotor créent un couple qui le met en rotation.
8.3. Le travail des forces électromagnétiques
Le travail effectué par la force de Laplace lors du déplacement d’un conducteur est calculé (). Cette relation établit un lien direct entre le travail mécanique fourni et la variation de flux magnétique, formant la base de la conversion d’énergie électromécanique.
8.4. La balance de Cotton
La balance de Cotton est un dispositif expérimental qui utilise la force de Laplace pour mesurer l’intensité d’un champ magnétique. Son principe est étudié pour illustrer une application concrète et précise du calcul de cette force.
TROISIÈME PARTIE : LE COURANT ALTERNATIF MONOPHASÉ ET SES GRANDEURS 📈
Cette partie introduit un changement de paradigme, en passant de l’étude du courant continu à celle du régime alternatif sinusoïdal. L’élève y découvre les nouvelles grandeurs et les nouveaux outils mathématiques nécessaires pour décrire des signaux qui varient périodiquement dans le temps. La maîtrise de ce nouveau langage est indispensable, car la quasi-totalité de l’énergie électrique est produite, transportée et distribuée sous cette forme.
CHAPITRE 9 : DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES DES GRANDEURS SINUSOÏDALES
9.1. Définition et représentation temporelle
Une grandeur sinusoïdale (tension ou courant) est définie par son expression mathématique . L’élève apprendra à tracer sa représentation graphique et à identifier ses caractéristiques : amplitude (), pulsation (), période (T) et fréquence (f).
9.2. Valeur instantanée, moyenne et maximale
La distinction entre la valeur instantanée (la valeur à un instant t), la valeur maximale (l’amplitude) et la valeur moyenne (nulle pour un signal sinusoïdal pur) est établie.
9.3. La valeur efficace
La valeur efficace d’un courant alternatif est définie comme la valeur d’un courant continu qui produirait le même effet thermique. Pour une grandeur sinusoïdale, la relation fondamentale est démontrée. L’élève comprendra que les voltmètres et ampèremètres en mode AC mesurent cette valeur.
9.4. Déphasage entre deux grandeurs
Lorsque deux grandeurs sinusoïdales de même fréquence n’atteignent pas leur maximum en même temps, elles sont dites déphasées. Le concept de déphasage (), mesuré en degrés ou en radians, est introduit. L’élève apprendra à déterminer si une grandeur est en avance ou en retard sur une autre.
CHAPITRE 10 : REPRÉSENTATION VECTORIELLE DE FRESNEL ET NOMBRES COMPLEXES
10.1. Le vecteur de Fresnel
La représentation de Fresnel est un outil graphique qui associe à chaque grandeur sinusoïdale un vecteur tournant. À un instant donné, on fige cette rotation et on représente la grandeur par un vecteur dont la longueur est proportionnelle à sa valeur efficace et dont l’angle correspond à sa phase.
10.2. Somme de grandeurs sinusoïdales
L’addition de deux grandeurs sinusoïdales (par exemple, deux tensions en série) est complexe dans le domaine temporel. L’élève découvrira que dans la représentation de Fresnel, cette opération se ramène à une simple somme vectorielle, beaucoup plus facile à réaliser graphiquement ou par calcul.
10.3. Introduction aux nombres complexes
Pour une approche analytique rigoureuse, les grandeurs sinusoïdales peuvent être associées à des nombres complexes. La tension peut être représentée par un nombre complexe dont le module est la valeur efficace et l’argument est la phase.
10.4. Opérations en notation complexe
L’élève sera initié aux opérations de base sur les nombres complexes (addition, soustraction, multiplication, division). Il comprendra que cet outil mathématique transforme les équations différentielles du régime sinusoïdal en simples équations algébriques, simplifiant radicalement l’analyse des circuits AC.
CHAPITRE 11 : LES PUISSANCES EN RÉGIME ALTERNATIF SINUSOÏDAL
11.1. Puissance instantanée et puissance active
La puissance instantanée est étudiée. Sa valeur moyenne sur une période, appelée puissance active (P), représente la puissance réellement consommée par le circuit. Elle se mesure en watts (W) et est donnée par la formule .
11.2. Facteur de puissance
Le terme est appelé facteur de puissance. Il représente l’efficacité avec laquelle l’énergie est transférée. L’élève comprendra l’importance, pour un distributeur d’énergie comme la SNEL, d’avoir des clients avec un facteur de puissance proche de 1 pour minimiser les pertes en ligne.
11.3. La puissance réactive (Q)
La puissance réactive (Q) est associée à l’énergie échangée entre la source et les éléments réactifs (bobines, condensateurs) du circuit. Elle ne produit pas de travail utile mais est nécessaire au fonctionnement de certains appareils. Elle se mesure en voltampères réactifs (VAR) et est donnée par .
11.4. La puissance apparente (S) et le triangle des puissances
La puissance apparente (S) est le produit des valeurs efficaces de la tension et du courant (), mesurée en voltampères (VA). Elle représente la puissance totale que la source doit fournir. Ces trois puissances sont liées par la relation vectorielle , qui peut être représentée par le « triangle des puissances ».
Annexes
1. Mémento des Théorèmes de l’Électricité
Cette section fournirait un résumé concis de tous les théorèmes d’analyse de circuits vus dans la première partie (Kirchhoff, Superposition, Thévenin, Norton, Millman, Kennelly), en rappelant pour chacun son principe et sa méthodologie d’application.
2. Formulaire sur le Magnétisme et l’Induction
Un formulaire regrouperait toutes les lois et équations importantes relatives à l’électromagnétisme : champ créé par diverses configurations de courant, loi de Faraday, loi de Lenz, force de Laplace, etc.
3. Le Trigonométrie pour l’Électricien
Un rappel des relations trigonométriques essentielles (sinus, cosinus, tangente) dans le triangle rectangle et des identités de base serait proposé. Cet outil est indispensable pour la manipulation des grandeurs alternatives et des diagrammes de Fresnel.
4. Introduction aux Risques Électromagnétiques
Une brève section de sensibilisation (enrichissement) discuterait des champs électromagnétiques dans l’environnement. Elle aborderait de manière neutre les normes d’exposition et les précautions à prendre à proximité des sources de champs intenses (lignes à haute tension, émetteurs radio), des sujets d’actualité pertinents pour un futur technicien en électronique.