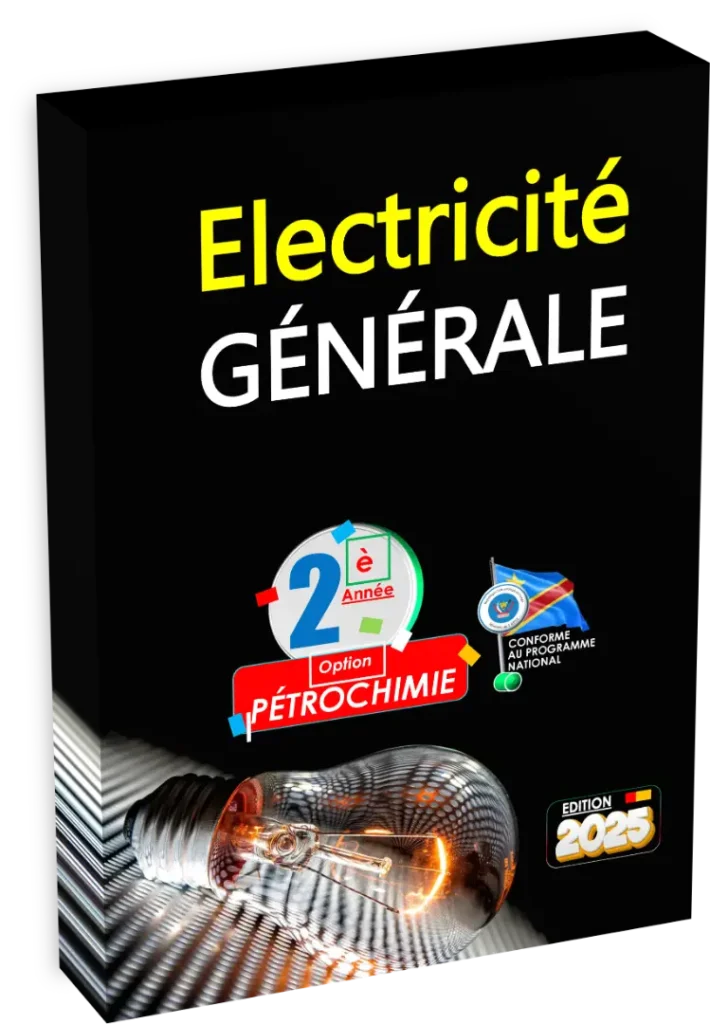
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE, 2ÈME ANNÉE / OPTION : PÉTROCHIMIE INDUSTRIELLE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC
Préliminaires
1. Finalités de la formation
La formation en électricité générale de deuxième année a pour finalité de faire passer l’élève de la compréhension des circuits en courant continu à la maîtrise de l’analyse des circuits en régime sinusoïdal monophasé et à une introduction aux systèmes triphasés. L’objectif est de le rendre capable de résoudre des problèmes complexes impliquant des composants réactifs (bobines, condensateurs) et de comprendre les notions de puissance qui régissent les installations industrielles et les réseaux de distribution d’énergie.
2. Compétences visées
À l’issue de cette année, l’élève devra maîtriser la représentation complexe des grandeurs sinusoïdales (vecteurs de Fresnel, impédances), être capable d’analyser le comportement des circuits RLC série et parallèle, et de calculer les différentes puissances (active, réactive, apparente) ainsi que le facteur de puissance. Il saura expliquer le principe et l’intérêt des systèmes triphasés, compétence fondamentale pour aborder les applications de puissance du secteur pétrochimique.
3. Approche Pédagogique
L’enseignement consolide la synergie entre la théorie et la pratique. L’introduction des nombres complexes comme outil mathématique est immédiatement appliquée à la résolution de circuits. Chaque concept, tel que la résonance ou la compensation d’énergie réactive, est d’abord modélisé puis vérifié expérimentalement en laboratoire. L’étude de cas pratiques, comme le calcul du dimensionnement d’une batterie de condensateurs pour une usine de la zone industrielle de Kingabwa à Kinshasa, ancre l’apprentissage dans un contexte industriel pertinent.
4. Rappels sur la Sécurité en Régime Alternatif
Une attention accrue est portée aux dangers spécifiques du courant alternatif, notamment les tensions plus élevées utilisées dans l’industrie et les risques de chocs électriques qui sont physiologiquement plus dangereux qu’en courant continu. Les règles de consignation d’une installation (mise hors tension, vérification, mise à la terre) et l’utilisation correcte des équipements de mesure en toute sécurité sont des compétences non négociables.
Partie I : Grandeurs Sinusoïdales et Représentation Complexe ⚡️
Cette partie a pour objectif de doter l’élève des outils mathématiques et conceptuels indispensables à l’analyse des circuits en régime alternatif. Après une consolidation des acquis de première année, elle introduit la notation complexe qui permet de transformer des équations différentielles en simples équations algébriques, simplifiant de manière spectaculaire la résolution des circuits.
Chapitre 1 : Rappels sur le Courant Alternatif Monophasé
Ce chapitre assure une base solide en révisant les notions fondamentales vues l’année précédente.
1.1. Définition et Caractéristiques d’une Grandeur Sinusoïdale
Les caractéristiques d’un signal sinusoïdal (valeur maximale, valeur instantanée, pulsation, période, fréquence) sont révisées. L’élève consolidera sa compréhension de la manière dont ces signaux sont générés par les alternateurs des centrales hydroélectriques comme celles d’Inga.
1.2. Valeurs Efficace et Moyenne
La signification physique de la valeur efficace comme grandeur de comparaison avec le courant continu est approfondie. L’élève s’exercera à calculer la valeur efficace à partir de la valeur maximale pour des signaux sinusoïdaux et à comprendre pourquoi la valeur moyenne d’un tel signal est nulle.
1.3. Notion de Déphasage
Le concept de déphasage entre deux grandeurs sinusoïdales de même fréquence sera réexaminé. L’élève apprendra à déterminer si un signal est en avance, en retard ou en phase par rapport à un autre, une notion clé pour comprendre le comportement des composants réactifs.
1.4. Visualisation à l’Oscilloscope
L’utilisation de l’oscilloscope comme outil principal de visualisation des signaux alternatifs est rappelée. L’élève s’entraînera à mesurer l’amplitude, la période et le déphasage directement sur l’écran de l’appareil.
Chapitre 2 : L’Outil Mathématique : Nombres Complexes
Ce chapitre introduit l’outil mathématique qui révolutionne l’étude du régime sinusoïdal.
2.1. Définition et Formes d’un Nombre Complexe
L’élève découvrira les nombres complexes et leurs différentes formes de représentation : la forme algébrique (a + jb), la forme trigonométrique [ρ(cosφ + jsinφ)] et la forme polaire (ou exponentielle) [ρe^(jφ)].
2.2. Représentation Géométrique dans le Plan Complexe
La représentation d’un nombre complexe par un point ou un vecteur dans le plan de Gauss (plan complexe) sera établie, ce qui constitue le fondement de la représentation de Fresnel.
2.3. Opérations sur les Nombres Complexes
Les opérations fondamentales (addition, soustraction, multiplication, division) seront étudiées. L’élève apprendra à choisir la forme la plus appropriée pour chaque type d’opération (forme algébrique pour les additions, forme polaire pour les multiplications).
2.4. Application à l’Électricité
L’association entre une grandeur sinusoïdale et un nombre complexe est formellement établie. L’élève apprendra la transformation qui permet de passer du domaine temporel (f(t)) au domaine fréquentiel (nombre complexe).
Chapitre 3 : Représentation de Fresnel et Impédance Complexe
Ce chapitre applique les nombres complexes pour modéliser les tensions, courants et dipôles.
3.1. Le Vecteur de Fresnel
Le vecteur de Fresnel est présenté comme la représentation graphique du nombre complexe associé à une grandeur sinusoïdale. L’élève apprendra à dessiner ces vecteurs pour additionner ou soustraire des tensions ou des courants.
3.2. L’Impédance Complexe (Z)
Le concept d’impédance complexe est introduit comme le rapport de la tension complexe au courant complexe (Z = U/I). L’élève comprendra que l’impédance généralise la notion de résistance au régime sinusoïdal pour tous les dipôles.
3.3. L’Admittance Complexe (Y)
L’admittance complexe (Y = 1/Z) est définie comme l’inverse de l’impédance. L’élève verra que cette grandeur simplifie particulièrement l’étude des circuits en parallèle, de la même manière que la conductance simplifie l’étude des résistances en parallèle.
3.4. Loi d’Ohm en Notation Complexe
La loi d’Ohm est généralisée pour le régime sinusoïdal sous la forme U = Z × I, où toutes les grandeurs sont des nombres complexes. Cette relation simple devient l’outil central pour l’analyse de tous les circuits AC.
Partie II : Analyse des Circuits en Régime Sinusoïdal Monophasé 🔌
Fort des outils de représentation complexe, l’élève aborde dans cette partie l’analyse quantitative des circuits électriques en régime sinusoïdal. Il étudiera le comportement de chaque composant passif (R, L, C) avant de les associer dans des circuits plus complexes (RLC série et parallèle). La maîtrise de cette analyse est essentielle pour comprendre des phénomènes comme la résonance et le filtrage.
Chapitre 4 : Le Comportement des Dipôles Passifs en AC
Ce chapitre examine la réponse de chaque composant fondamental à une tension sinusoïdale.
4.1. Le Résistor en Régime Sinusoïdal
L’élève constatera que pour une résistance pure, le courant et la tension sont toujours en phase. Son impédance complexe est un nombre réel pur (Z_R = R).
4.2. L’Inductance Pure en Régime Sinusoïdal
Pour une bobine parfaite, l’élève découvrira que le courant est en retard de 90° (π/2) sur la tension. Son impédance complexe est un imaginaire pur positif (Z_L = jLω), appelée réactance inductive.
4.3. Le Condensateur en Régime Sinusoïdal
Pour un condensateur parfait, l’élève apprendra que le courant est en avance de 90° (π/2) sur la tension. Son impédance complexe est un imaginaire pur négatif (Z_C = 1/(jCω) = -j/(Cω)), appelée réactance capacitive.
4.4. Le Modèle Réel des Composants
Les modèles des composants réels seront introduits : une bobine réelle est modélisée par une inductance en série avec une résistance, et un condensateur réel par une capacité en parallèle avec une grande résistance de fuite.
Chapitre 5 : Le Circuit RLC Série
Ce chapitre étudie l’association en série des trois composants passifs.
5.1. Impédance et Déphasage du Circuit RLC Série
L’élève apprendra à calculer l’impédance totale du circuit en additionnant les impédances complexes (Z = R + j(Lω – 1/Cω)). Il en déduira le module de l’impédance et l’angle de déphasage tension-courant.
5.2. La Résonance en Tension
Le phénomène de résonance sera introduit comme la condition pour laquelle l’impédance du circuit est minimale (égale à R), ce qui se produit lorsque les effets de la bobine et du condensateur s’annulent (Lω = 1/Cω). L’élève calculera la pulsation et la fréquence de résonance.
5.3. Le Facteur de Qualité (ou de Surtension)
Le facteur de qualité (Q) sera défini comme un indicateur de l’acuité de la résonance. L’élève comprendra qu’à la résonance, les tensions aux bornes de la bobine et du condensateur peuvent être beaucoup plus grandes que la tension d’alimentation, d’où le nom de « surtension ».
5.4. Bande Passante et Sélectivité
La notion de bande passante sera introduite pour caractériser la plage de fréquences pour laquelle la réponse du circuit est significative. L’élève verra que la sélectivité d’un filtre (sa capacité à sélectionner une fréquence) est inversement liée à sa bande passante.
Chapitre 6 : Le Circuit RLC Parallèle
Ce chapitre analyse l’association en parallèle des trois composants, duale du circuit série.
6.1. Admittance et Déphasage du Circuit RLC Parallèle
Utilisant les admittances, l’élève calculera l’admittance totale en additionnant les admittances de chaque branche (Y = 1/R + j(Cω – 1/Lω)). Il en déduira l’impédance totale et le déphasage.
6.2. La Résonance en Courant
Pour le circuit parallèle, la résonance correspond à la condition où l’admittance est minimale (le courant total absorbé est minimal). L’élève constatera que cela se produit à la même fréquence que pour le circuit série.
6.3. Le Facteur de Surintensité
À la résonance, les courants circulant dans la bobine et le condensateur peuvent être bien supérieurs au courant total fourni par la source. Ce phénomène de « surintensité » sera analysé en lien avec le facteur de qualité.
6.4. Comparaison des Circuits Série et Parallèle
Une comparaison systématique des propriétés des circuits résonants série et parallèle sera effectuée, en soulignant leurs comportements duaux (impédance minimale vs maximale à la résonance).
Chapitre 7 : Application des Théorèmes Généraux en AC
Ce chapitre montre que les grands théorèmes de l’électricité s’appliquent en régime sinusoïdal en utilisant la notation complexe.
7.1. Les Lois de Kirchhoff en Notation Complexe
L’élève appliquera la loi des nœuds (la somme des courants complexes est nulle) et la loi des mailles (la somme des tensions complexes est nulle) pour résoudre des circuits à plusieurs branches.
7.2. Le Théorème de Superposition
Le théorème de superposition sera appliqué aux circuits contenant plusieurs sources de fréquences différentes, en rappelant que le théorème ne s’applique qu’aux grandeurs instantanées et non aux valeurs efficaces.
7.3. Les Théorèmes de Thévenin et de Norton en AC
L’élève apprendra à déterminer le générateur de tension équivalent (Thévenin) et le générateur de courant équivalent (Norton) pour une partie d’un circuit AC. L’impédance de Thévenin/Norton est une impédance complexe.
7.4. L’Adaptation d’Impédances et Transfert Maximal de Puissance
La condition pour un transfert maximal de puissance d’une source vers une charge sera établie en régime sinusoïdal : l’impédance de la charge doit être le conjugué de l’impédance interne de la source (Z_charge = Z_source*).
Partie III : Puissance et Énergie en Courant Alternatif 📈
Cette partie aborde un aspect crucial pour les applications industrielles : la notion de puissance en régime sinusoïdal. Contrairement au courant continu, la présence de composants réactifs (bobines, moteurs) complexifie la situation. L’élève apprendra à distinguer les différentes formes de puissance, à comprendre le concept de facteur de puissance et à maîtriser les techniques pour l’améliorer, un enjeu économique et écologique majeur.
Chapitre 8 : Les Puissances en Régime Sinusoïdal
Ce chapitre décompose la notion de puissance en plusieurs composantes distinctes.
8.1. La Puissance Instantanée
La puissance instantanée p(t) = u(t) × i(t) sera définie. L’élève observera qu’elle est fluctuante et peut même devenir négative, indiquant un renvoi d’énergie vers la source par les composants réactifs.
8.2. La Puissance Active (P)
La puissance active, mesurée en Watts (W), est définie comme la valeur moyenne de la puissance instantanée. L’élève comprendra qu’elle représente la puissance réellement transformée en travail ou en chaleur, et qu’elle est la seule puissance facturée au consommateur résidentiel.
8.3. La Puissance Réactive (Q)
La puissance réactive, mesurée en Voltampères Réactifs (VAR), sera présentée comme la puissance échangée entre la source et les champs magnétiques (bobines) et électriques (condensateurs). Elle ne produit pas de travail utile mais est nécessaire au fonctionnement de nombreux appareils.
8.4. Cas des Dipôles Parfaits (R, L, C)
L’élève calculera les puissances pour chaque composant idéal : une résistance ne consomme que de la puissance active, tandis qu’une bobine et un condensateur parfaits ne consomment que de la puissance réactive (positive pour L, négative pour C).
Chapitre 9 : Puissance Apparente et Facteur de Puissance
Ce chapitre unifie les concepts de puissance et introduit un indicateur de performance clé.
9.1. La Puissance Apparente (S)
La puissance apparente, mesurée en Voltampères (VA), est définie comme le produit des valeurs efficaces de la tension et du courant (S = U_eff × I_eff). Elle représente la puissance totale que la ligne d’alimentation doit pouvoir supporter.
9.2. Le Triangle des Puissances
La relation fondamentale entre les trois puissances (S² = P² + Q²) sera visualisée géométriquement par le triangle des puissances. L’élève apprendra à construire ce triangle et à l’utiliser pour résoudre des problèmes.
9.3. Le Facteur de Puissance (cos φ)
Le facteur de puissance est défini comme le rapport entre la puissance active et la puissance apparente (cos φ = P/S). L’élève comprendra qu’il représente l’efficacité avec laquelle le courant est utilisé pour produire un travail utile. Un facteur de puissance proche de 1 est idéal.
9.4. Mesure des Puissances
L’utilisation du wattmètre pour mesurer la puissance active sera expliquée. L’élève apprendra comment, en utilisant un wattmètre, un voltmètre et un ampèremètre, il est possible de déterminer toutes les grandeurs du triangle des puissances.
Chapitre 10 : Amélioration du Facteur de Puissance
Ce chapitre aborde la problématique de la compensation de l’énergie réactive.
10.1. Causes et Inconvénients d’un Mauvais Facteur de Puissance
L’élève identifiera les charges inductives (moteurs, transformateurs), omniprésentes dans l’industrie minière du Katanga par exemple, comme la principale cause d’un faible facteur de puissance. Les inconvénients (courant en ligne plus élevé, pertes Joule accrues, pénalités financières) seront analysés.
10.2. Le Principe de la Compensation d’Énergie Réactive
Le principe de l’amélioration du facteur de puissance sera expliqué : il consiste à installer des condensateurs (qui fournissent de l’énergie réactive) en parallèle avec la charge inductive pour compenser l’énergie réactive qu’elle consomme.
10.3. Calcul de la Batterie de Condensateurs
L’élève apprendra à calculer la capacité des condensateurs nécessaires pour relever le facteur de puissance d’une installation d’une valeur initiale à une valeur cible (généralement supérieure à 0.9).
10.4. Avantages Techniques et Économiques
Les bénéfices de la compensation seront synthétisés : diminution de la facture d’électricité pour les industriels (via l’élimination des pénalités), réduction des pertes dans le réseau de la SNEL, et augmentation de la puissance active disponible sur une installation.
Partie IV : Introduction aux Systèmes Polyphasés 🏭
Cette dernière partie constitue une ouverture vers les réseaux électriques de puissance qui alimentent les industries et les villes. Elle introduit les systèmes triphasés, qui sont le mode quasi universel de production, de transport et de distribution de l’énergie électrique à grande échelle. La compréhension de leurs principes et avantages est fondamentale pour le futur technicien de l’industrie pétrochimique.
Chapitre 11 : Les Systèmes Triphasés Équilibrés
Ce chapitre présente la genèse et les caractéristiques fondamentales des réseaux triphasés.
11.1. Genèse des Tensions Triphasées
L’élève apprendra qu’un système de tensions triphasées est constitué de trois tensions sinusoïdales de même fréquence et de même amplitude, mais déphasées entre elles de 120° (2π/3). Leur production par un alternateur triphasé sera expliquée.
11.2. Avantages des Systèmes Triphasés
Les avantages majeurs du triphasé sur le monophasé seront démontrés : économie de conducteurs pour une même puissance transportée, puissance instantanée totale constante (ce qui assure un fonctionnement régulier des moteurs), et facilité de création de champs magnétiques tournants.
11.3. Tensions Simples et Tensions Composées
La distinction entre les tensions simples (mesurées entre une phase et le neutre) et les tensions composées (mesurées entre deux phases) sera établie. L’élève apprendra la relation qui les lie en amplitude (U = V√3).
11.4. Courants de Ligne et Courants de Phase
De manière similaire, la distinction entre les courants circulant dans les lignes d’alimentation et les courants traversant les récepteurs (phases du récepteur) sera définie.
Chapitre 12 : Montages Étoile et Triangle
Ce chapitre étudie les deux manières fondamentales de connecter les sources et les charges en triphasé.
12.1. Le Couplage Étoile (Y)
Le montage en étoile, qui dispose d’un point commun appelé neutre, sera décrit. L’élève apprendra que dans ce montage, les courants de ligne sont égaux aux courants de phase, et les tensions composées sont supérieures aux tensions simples.
12.2. Le Couplage Triangle (Δ)
Le montage en triangle, qui ne possède pas de neutre, sera présenté. L’élève découvrira que dans ce couplage, les tensions de ligne sont égales aux tensions de phase, et les courants de ligne sont supérieurs aux courants de phase (I = J√3).
12.3. Puissances en Triphasé Équilibré
L’élève apprendra à calculer les puissances active, réactive et apparente pour un système triphasé équilibré. Les formules générales (P = √3 UI cosφ) seront établies et appliquées à des récepteurs industriels comme les grands moteurs des usines de la GECAMINES.
12.4. La Méthode des Deux Wattmètres
Une méthode pratique pour mesurer la puissance active totale absorbée par une charge triphasée (équilibrée ou non) en utilisant seulement deux wattmètres sera présentée, concluant cette introduction aux réseaux de puissance.
Annexes
Cette section fournit des documents de référence pour une consultation rapide et une meilleure assimilation des concepts.
1. Glossaire des Termes d’Électrotechnique
Une définition claire et concise des termes techniques clés (ex: impédance, réactance, déphasage, triphasé) est fournie pour assurer la maîtrise du vocabulaire spécialisé.
2. Formulaire de Calcul en Régime Sinusoïdal
Un récapitulatif des formules essentielles pour le calcul des impédances, des puissances et des relations en triphasé, servant d’aide-mémoire pour la résolution d’exercices.
3. Le Triangle des Puissances
Une fiche visuelle rappelant la construction du triangle des puissances et les relations trigonométriques entre P, Q, S et le facteur de puissance cos φ.
4. Exemples de Circuits d’Application Industrielle
Des schémas simplifiés de circuits réels, comme le circuit d’alimentation d’un moteur asynchrone ou un circuit de correction de facteur de puissance, pour illustrer l’application concrète des notions vues en cours.



